by jefklak | 25 mai 2015 | Marabout
En 1969, après avoir enseigné à l’université d’Alger puis de Nanterre, Jeanne Favret-Saada s’installe dans le bocage mayennais pour commencer une enquête de plusieurs années sur la sorcellerie. Loin de se satisfaire d’une posture d’observatrice, et plutôt que d’imaginer, à distance, le fonctionnement du système sorcellaire, elle accepte d’en « occuper » une place, de se laisser affecter, de perdre une certaine maîtrise sur son devenir. Au-delà d’un apprentissage « pour sa vie », Jeanne Favret-Saada tire de cette expérience une analyse inédite du système des sorts et des rôles de chacun.e dans cette entreprise de conjuration du malheur. Trois ouvrages, devenus classiques en sciences sociales, sont nés de ce travail : Les mots, la mort, les sorts (1977), Corps pour corps, enquête sur la sorcellerie dans le bocage, avec Josée Contreras (1981), et Désorceler (2009).
Juliette Volcler (réalisatrice de l’émission radiophonique et du site internet L’intempestive) et Yeter Akyaz (réalisatrice sonore) ont rencontré Jeanne Favret-Saada dans un bistrot marseillais en 2011. Lors de cet entretien, disponible à l’écoute en ligne, « On parle du discours méprisant des élites (Église, médecine, psychiatrie, école…) sur la paysannerie et sur les pratiques de sorcellerie, on parle de tout ce qu’il s’agit de réapprendre lorsqu’on s’extrait de son milieu social, (…) on parle de la sorcellerie comme d’une manière d’exprimer ce qui ne peut pas l’être autrement ; on parle de la place des femmes dans ce système sorcellaire, de leur puissance et de leur esclavage ; on parle du désorcèlement comme thérapie et apprentissage de sa propre force. »
Ce texte est extrait du numéro 1 de Jef Klak, «Marabout», dont le thème est Croire/Pouvoir. Sa publication en ligne est la cinquième d’une série limitée (5/6) de textes issus de la version papier de Jef Klak, toujours disponible en librairie.
Les propos de l’entretien n’ont que très légèrement été réécrits lors de la retranscription, par souci de fidélité à la forme sonore.
Le site de l’Intempestive
Télécharger l’entretien en mp3
Télécharger l’article en PDF
Jeanne Favret-Saada est ethnologue, mais la définition est un peu courte…
D’abord, je suis une tout à fait vieille dame, parce qu’à la fin du mois de septembre [2011], j’aurai 76 ans. Quand j’étais jeune chercheure, j’ai participé à Mai-68. J’étais chercheure et enseignante à Nanterre qui, comme vous le savez, a eu une importance dans cette affaire-là. Nous étions deux ou trois enseignants, avec nos étudiants, à être dans toutes les manifestations. On avait décidé que l’on ne quitterait pas la France l’année suivante, que l’on travaillerait en France parce qu’on avait l’impression qu’il s’y passerait quelque chose. Ce qui était évidemment tout à fait faux. On attendait même la Révolution… C’est vous dire que ça n’a pas été tout à fait ça.
Or moi, Française née en Tunisie, avec des parents juifs, d’origine entièrement tunisienne depuis x générations – depuis toujours –, j’étais venue en France pour faire mes études supérieures à mes 18 ans, et je ne m’étais jamais sentie installée en France. J’aimais beaucoup la langue, la littérature, la France de la Révolution, la France laïque, etc., et je haïssais l’autre [France]. Je n’en voulais pas. De plus, dans les années où je suis venue, il y avait beaucoup plus d’antisémitisme que maintenant, et donc, je ne me sentais pas vraiment admise en France. Durant Mai-68, avec un groupe de camarades, on a été envoyés à Saint-Nazaire avec les « paysans travailleurs » – enfin, ceux que l’on a ensuite appelés les « paysans travailleurs ». On est entrés à la tête d’une manifestation à l’université de Nantes sur des tracteurs, avec des paysans. Là, j’ai dit : « Ça y est, cette France-là, je la veux. »
C’est donc à travers une lutte que vous avez commencé à vous sentir habiter en France ?
Une lutte avec des gens qui étaient justement de la France de la Révolution, de la France des révolutions, qui n’étaient pas la France confite, colonialiste, qu’on rencontrait dans Paris…
Quant à la sorcellerie ?
À la rentrée d’octobre-novembre 1968, j’ai eu un étudiant à Nanterre qui était pion dans un lycée de Laval [en Mayenne] et qui m’a parlé [de la sorcellerie]. Il m’en a parlé avec beaucoup de mépris d’ailleurs, mais ça m’a beaucoup intéressée. Probablement parce qu’il a réussi à faire passer le fait qu’il y avait des vies en jeu – ou plutôt, qu’il y avait de la vie et de la mort en jeu –, et aussi parce que mon précédent travail sur l’Algérie s’était beaucoup occupé des situations de vendettas, de mises à mort, etc. Je suis donc allée là-bas avec quatre ou cinq étudiants.
C’était à la Toussaint 1968 et j’ai tout de suite loué une maison pour venir à la fin de l’année universitaire m’y installer avec mes enfants. Dans un village. J’ai été frappée en arrivant : [il n’y avait] personne dans les villages, il pleuvait comme vache qui pisse et toutes les populations étaient réunies dans les cimetières avec des fleurs éclatantes ! C’est-à-dire : les gens en noir, les fleurs éclatantes et une pluie lugubre. C’était un tel choc que j’ai dit : « Ça, c’est bon pour moi, je viens ! »
Vous parlez du mépris avec lequel votre étudiant a commencé à vous évoquer les questions de sorcellerie…
Oui, il disait : « C’est des gens complètement tarés », évidemment. Bon moi, je ne comprenais pas pourquoi ils devaient être tarés, comment on pouvait dire d’un compatriote, par avance, qu’il est taré. Donc, [dans la continuité] de ces deux ou trois jours autour de la Toussaint, j’ai eu envie de rencontrer ces gens, de les connaître. Ils savaient des choses que je ne savais pas, de toute évidence. J’ai considéré que je devais prendre tout le temps qu’il me fallait – d’ailleurs, mon laboratoire [de recherche] n’a pas aimé qu’un an ne me suffise pas et que je continue indéfiniment à être là-bas ! Mais il fallait le faire dans leur temps ; selon ma possibilité à moi, aussi, d’entrer en relation avec des inconnus.
C’est quand même un aspect du terrain qui est pénible pour tous les ethnologues quand on entre en relation avec des gens qui… Il n’y a que dans les pays coloniaux que les gens se sentent obligés de vous répondre. Là, ils ne voyaient pas du tout pourquoi [me parler] ; et si je ne leur plaisais pas, ils m’envoyaient au bain. Et à la troisième fois de la journée où vous avez été envoyée au bain, eh bien, vous allez vous coucher et vous vous demandez : « Qu’est-ce que j’ai présenté d’insupportable ? Pourquoi ne leur ai-je pas fait envie ? » Petit à petit, j’ai appris comment parler avec les gens.
Ce qui est très frappant, c’est que vous avez tenu un journal quotidien de ce qui vous arrivait pour essayer de saisir, un peu, ce qui se passait – ce que l’on retrouve dans Corps pour corps, votre journal de terrain. […] Vous n’hésitez pas à montrer les errements, les erreurs que vous faites dans la communication, ou plutôt, dans les rapports quotidiens avec les personnes…
C’est surtout que l’on s’est déplacé de son propre groupe, de sa classe d’intellectuels, pour aller dans une autre région qui a non seulement d’autres règles de politesse concernant ce que l’on peut dire et ce que l’on ne peut pas dire, mais où les gens ont aussi recours à la sorcellerie – une [pratique] complètement méprisée en ville – et ont peur du jugement que vous porterez sur eux. Les pensées et leurs pratiques étant secrètes, vous ne savez pas, pendant longtemps, comment tomber juste. Vous dites des bêtises parce que ce qui est à découvrir, vous ne le connaissez pas. Moi, ça ne me vexait pas de m’apercevoir que, là encore, j’avais été une imbécile.
Justement, ce qui est très sensible dans Corps pour corps, c’est que vous arrivez complètement à rebours de ce que vous avait dit votre étudiant et de l’attitude générale de ceux que vous appelez « les folkloristes de la sorcellerie ». Vous partez du principe qu’il y a un discours et des pratiques qui se tiennent autour de la sorcellerie : comprendre d’abord ce dont il s’agit avant de les mépriser, et redonner de la valeur à la parole du peuple.
Oui. Ces gens pensent et pratiquent quelque chose qui est méprisé dans mon groupe. Or, ce sont des Français, comme nous, qui vont à l’école française, à l’école publique, qui vont, je ne sais pas, au catéchisme, qui font leur service militaire, qui regardent la même télé le soir. Ce sont des Français. Et ils ont en plus, dans leur région, un ensemble de pensées, de pratiques relatives à la sorcellerie. Mon idée était la suivante : s’ils « le » disent comme ça et pas autrement – alors qu’ils disposent entièrement de notre langue et de nos moyens de pensée –, c’est que « ça » ne peut pas se dire autrement. Donc, il faut leur faire crédit. Mais que sont-ils donc en train d’essayer de faire, de gérer avec « ça » ?
Ce qui s’exprime à travers « ça », ce sont des rapports humains extrêmement complexes, très difficiles à décoder rationnellement, qui passent par tout un tas de gestes et d’attitudes, de rapports humains qui ne peuvent pas s’exprimer par le langage courant et qui, à travers les pratiques de sorcellerie, créent un réseau de significations et de compréhensions du monde…
Vous avez dit « rationnellement », mais le problème c’est que nous aussi, dans nos vies, on n’est pas plus rationnels qu’eux. Par exemple, essayez de me faire un exposé sur la crise de la dette qui soit un peu cohérent. Même sur l’affaire DSK, qui est infiniment plus simple. Essayez que ce soit cohérent. C’est extrêmement difficile. Bon. Parmi les idées avantageuses que nous avons sur nous-mêmes – nous les citadins, les gens cultivés –, il y aurait que « nous » sommes rationnels et que les autres qui font notre monde ne sont pas rationnels. Ce que nous avons, c’est les raisons pour lesquelles nous faisons ceci ou cela, ce ne sont jamais que des raisons. Ce n’est pas la rationalité qui nous amène là. Avec eux, c’est exactement la même chose, il faut connaître leurs raisons, au pluriel.
Vous évoquez le discours méprisant des élites (les notables, l’Église, l’école, la médecine) qui disqualifient les pratiques de sorcellerie, qui les rejettent complètement.
[Ils disqualifient] même les pratiques paysannes. Par exemple, le directeur de l’hôpital psychiatrique me disait : « Être psychiatre ici, c’est de l’art vétérinaire. Ils n’ont pas de parole. » Ce n’est pas vrai. Quand ils ont commencé à me parler, ils ne s’arrêtaient pas pendant quatre heures. On peut dire qu’ils ont une parole. Interdite ou retenue devant le notable qui peut les interner, mais c’est tout. On ne peut pas dire que ce sont des êtres sans paroles, mais on peut dire qu’ils savent ce qu’est un rapport de force et qu’ils ne vont pas se risquer.
Vous montrez, à travers des exemples, que le discours prétendument rationnel, prétendument scientifique, est chargé de mythologie et de représentations qui ne sont pas plus justes que les représentations qui s’expriment à travers la sorcellerie…
Je peux même vous dire que depuis que mes livres ont été publiés, jusqu’à aujourd’hui – cela s’est produit cette semaine encore –, il y a pas mal de savants et de chercheurs qui m’écrivent pour me demander de les « désorceler ». D’ailleurs, je ne réponds pas, en général, à ces lettres parce qu’ils penseraient que c’est moi qui dois les désorceler, ce que je ne veux pas faire, de toute façon. J’ai eu sept ou huit directeurs de recherche au CNRS qui m’ont directement demandé de les désorceler. Donc il ne faut pas… vous voyez.
Mais là, ce sont des comportements totalement irrationnels au regard de l’univers dans lesquels ils s’expriment…
Être pris dans une crise de sorcellerie, c’est être pris dans des malheurs à répétition. Tout lecteur de mes livres, y compris s’il est directeur de recherche au CNRS, qui est lui-même pris dans des malheurs à répétition, se projette immédiatement sur ce que j’écris et pense tout de suite que j’ai la clef de son problème. Bien qu’il sache qu’il y a d’autres types de personnes qui s’occupent des malheurs à répétition, par exemple les psychiatres, les psychanalystes et toute une série de gens qui ont inventé les thérapies pour ceci ou cela, il ne veut pas s’adresser [à ces personnes]. C’est ce qu’il ne dit justement pas : « Je ne veux pas m’y adresser » ou : « Je m’y suis adressé et ça ne m’a rien fait ». C’est tout à fait absent de leur propos. [Ils disent :] « Je veux que vous me trouviez un désorceleur ». Vous voyez.
Mais ce qui est frappant, c’est de voir comment le moindre de mes lecteurs, pourvu qu’il soit pris dans des malheurs à répétition, se projette immédiatement, parce qu’il a, comme je le dis dans un papier qui sort ces jours-ci[2. Jeanne Favret-Saada, « La mort aux trousses », Penser/Rêver, no 20, p. 207-220, 2011.], « la mort aux trousses ». Il sent qu’il a la mort aux trousses, et là, il ne fait plus du tout de discours, il ne fait plus de chichis intellectuels, il ne dit pas : « Ces gens sont irrationnels ! » ou « Moi, je suis rationnel ! » ; il dit : « Je veux en sortir ! ».
C’est un effet auquel vous ne deviez pas vous attendre. Quand des personnes lisent vos livres de travers…
Non, ce n’est pas de travers, au contraire. Je dois prendre ça comme une prolongation de mon terrain : qu’est-ce qui arrive à ces gens ? Quelles ont été les demandes qui m’ont été faites après la sortie de ce livre ? Ils ne sont pas méprisables du tout. Ils sont dans des malheurs à répétition, et ils veulent cette cure-là, spécifiquement, cette façon-là d’en sortir spécifiquement, et pas une autre. Après tout, c’est tout aussi rationnel pour eux que pour quelqu’un du bocage.
Je me trompe peut-être, mais à travers vos écrits, vous avez donné une certaine légitimité à la sorcellerie. La psychiatrie et la psychanalyse ont leur place dans nos sociétés contemporaines. Mais, avant votre recherche, la sorcellerie avait-elle autant sa place ?
Bien sûr que non. Les gens qui en parlaient à l’hôpital psychiatrique étaient internés. On disait qu’ils avaient « une bouffée délirante à thème de sorcellerie ». Maintenant, ça va mieux. C’est-à-dire qu’il y a un certain nombre de psychiatres qui m’ont lue, qui en ont entendu parler, ou bien on leur a expliqué à la fac, je ne sais pas, mais en tout cas, maintenant, ça va mieux. D’ailleurs, les psychiatres et psychanalystes étaient vraiment hostiles à mon travail au début. C’est-à-dire ce que j’avais fait sur le terrain, ils adoraient, mais si je disais que cela sortait les gens de malheurs à répétition, ça, ils ne le supportaient plus. « Mais ce n’est pas une vraie thérapie, les nôtres sont les vraies ! » (rires)
Je dois dire que depuis trente ans, la situation a changé. Maintenant, je suis invitée trois ou quatre fois par an par des écoles de psychanalyse ou de psychiatrie, par exemple [aux cliniques de] La Chesnaie ou de La Borde, mais aussi en Belgique, à Bruxelles, etc., par des gens qui comprennent parfaitement ce dont il est question d’un point de vue thérapeutique dans ces affaires-là.
Vous expliquez que la pratique de désorcèlement est une thérapie qui s’exprime d’une autre manière que les thérapies conventionnelles, officiellement reconnues, comme la médecine…
Et qui, elles-mêmes, s’affichent comme telles. Jamais un désorceleur ne dira « Je suis un thérapeute ». Je pense qu’à partir du moment où l’on se dit atteint par le pouvoir d’un sorcier, c’est pour être pris en charge par un désorceleur qui traite le malheur à répétition et qui vous en propose une sortie. À l’inverse de mes collègues qui traitaient la sorcellerie comme une machine à accuser des gens en tant que sorcier, ou à proférer des énoncés irrationnels (telle personne que l’on connaît bien est toujours là, même quand on ne le voit pas, untel est invisible, etc.), bref, contrairement à ces collègues, je me suis dit « Mais pourquoi les gens prononceraient-ils des choses de ce genre si ça n’est parce qu’ils veulent sortir de là où ils sont ? ».
Un spécialiste leur est proposé : le désorceleur, que l’on trouve tous les cinq, six villages (et ils vont toujours chercher celui qui est le plus loin de chez eux pour ne pas non plus avoir à trop se trouver dans son pouvoir). Si on me demande quelle est la statistique [du nombre de] sorciers, je répondrais qu’il n’y a pas de sorciers… En fait ce sont juste les ensorcelés qui accusent d’autres [personnes] d’être des sorciers. Donc on ne peut pas dire qu’il y a tant de sorciers dans la Mayenne, mais on peut dire qu’il y a tant de désorceleurs. C’est une profession masquée ; on se cache toujours, [on préfère dire] « Je suis cartomancienne, je suis coiffeur, je suis hongreur ». Ils ont toujours des métiers de façade : ils sont agriculteurs, par exemple. Mais leur activité principale, c’est en fait de désorceler.
Dans l’histoire de la sorcellerie, quelles que soient les époques, il a toujours fallu se cacher ?
Oui, à cause de l’Église catholique. Fondamentalement, c’est la répression de l’Église qui joue encore beaucoup aujourd’hui, puisque l’Église s’est associée, pour ces affaires-là, à la médecine et à l’école. Elle a défini une foi rationnelle – ce qui me paraît être une chose incroyable, puisqu’on trouve rationnel de croire que Jésus est né d’une vierge, qui elle-même a été conçue sans péché, qu’il est mort et qu’il a ressuscité… Ça, c’est rationnel ! (rires) Mais c’est rationnel parce que c’est admis par tout le monde. C’est admis par les religions communes. Donc on ne va pas dire que c’est irrationnel, sauf les méchants athées, une corporation à laquelle j’appartiens personnellement.
En conséquence, ça [la foi rationnelle] ne m’a jamais paru plus rationnel que la sorcellerie. C’est un usage plus connu, et c’est tout. Et c’est l’Église catholique qui ne veut pas, qui n’a jamais voulu qu’il y ait une autre autorité localement, qui dise « Moi, j’ai des pouvoirs ; moi, je peux ceci ou cela ». Et donc, c’est comme ça qu’elle a pris le virage depuis un siècle en traitant « ça » d’irrationalité. Alors qu’avant, elle le traitait de superstition : supertes, ce qui est en plus de la foi, et ce qui est faux, c’est l’hérésie.
Concrètement, comment peut-on définir une crise de sorcellerie, telle que vous l’avez constatée dans le bocage ?
C’est la progression d’une famille d’exploitants agricoles, de paysans, dans des malheurs qui se répètent : des voitures ou des tracteurs qui se bloquent, qui tombent dans le fossé, des enfants qui ont des maladies, la femme qui ne peut pas accoucher, la vache qui fait du lait rempli de germes – bien que le fermier soit un bon fermier, qui travaille bien. C’est-à-dire que dans tout l’espace qui est celui de l’exploitation agricole, le domaine de la ferme, se passent des malheurs qui se répètent, [transmis] d’un objet à l’autre de la ferme, ou d’un être à l’autre de la ferme.
À un certain moment, quelqu’un intervient – qui connaît bien cette famille – et s’adresse au chef de famille. Il lui dit « Y’en aurait pas, par hasard, qui te voudraient du mal ? ». Officiellement, celui à qui [on s’adresse] tombe des nues, dit qu’il n’y avait jamais pensé, bien que tout le monde a entendu parler de la sorcellerie dans sa famille, mais qu’il n’y avait jamais pensé et donc, [ce quelqu’un qui intervient], je l’appelle « l’annonciateur ». C’est celui qui annonce son état à un futur ensorcelé et lui propose d’aller voir le désorceleur qui l’a [lui-même] tiré d’affaires il y a plusieurs années. Puis c’est chez le désorceleur que le diagnostic sera posé : Y a-t-il ou n’y a-t-il pas un sort ? Et qui est le sorcier ?
« Y’en aurait pas, par hasard, qui te voudraient du mal ? » – vous avez redit cette phrase [centrale]. Dans vos trois livres, vous portez une attention à la retranscription de la parole des personnes, jusque dans les accents, dans la manière de parler.
Parce qu’au début, je comprenais très peu de choses, et pourtant, ils parlent très bien français. Donc, je ne comprenais pas, j’ai dû apprendre [la langue]. Évidemment, ce n’est pas comme apprendre une langue à tons en Asie (rires), c’est pas du tout aussi compliqué : en trois mois, j’étais au point. Pour cela, j’ai dû apprendre comment ils rythment les phrases, comment la communication verbale est articulée sur la communication non verbale – ce que nous avons nous aussi, que nous utilisons à plein pot, sans le savoir parce que, pour nous, c’est évident. Mais nous avons des jeux de regards, de bouche, de mains, de claquement de langues. Nous communiquons aussi très largement par des moyens non verbaux. Mais quand ce sont d’autres – dont vous ne connaissez pas le système de communication – qui communiquent comme ça, évidemment, il faut l’apprendre.
Vous dites que la pratique ethnographique courante, qui consiste à aller chercher des informations auprès d’un informateur ne sert strictement à rien. Il faut accepter d’être pris dans un jeu de communications, de relations beaucoup plus complexe que cela. Les gens n’ont accepté de vous parler qu’à partir du moment où vous étiez identifiée à une place, à l’intérieur de ce système de sorcellerie.
C’est-à-dire quand ils ont compris que j’étais débordée par ce qui se passait, que moi-même, je ne maîtrisais pas. Par exemple, il y a eu une fois où mon fils a été malade… J’étais là, avec mes enfants qui avaient 6 ou 7 ans, et puis 7 ou 8 ans, et mon fils a été malade. Le médecin était inquiet parce que c’était une orchite, une inflammation des testicules qui pouvait le rendre stérile par la suite. Je n’avais pas le téléphone en ce temps-là, j’allais téléphoner à la cabine du village à tous les laboratoires où il avait fait des analyses à Paris, avant. Et le médecin ne comprenait toujours pas.
Tout le monde entendait la communication, et ils me disaient « Alors les docteurs, ils ont trouvé ? », [je répondais] « Non, ils n’ont pas trouvé ». Quand le médecin l’a guéri, il m’a dit : « Je l’ai guéri mais je ne sais pas pourquoi. » J’ai répété ça autour de moi. Évidemment, [les gens] étaient très contents : ils ont vu que j’avais expérimenté, comme eux, une histoire de maladie incompréhensible. Et donc, après, quand des gens ont commencé à me raconter leurs histoires, c’était très… L’atmosphère d’une ferme où il y a du malheur à répétition, c’est terrible. Les gens sont très prostrés, il fait très sombre, c’est accablant comme atmosphère, donc ça me faisait de l’effet, évidemment.
Ce que j’ai écrit à propos de mon terrain, ce n’est pas de l’information sur un système symbolique d’autrui qui serait là, dans un ciel, qu’il faudrait décalquer puis faire descendre dans mes bouquins. Il ne s’agit pas d’informations, mais d’informations vitales. Il s’agit de quelque chose qui les affecte, et de quelque chose que vous ne pourrez comprendre que si vous acceptez d’en être affecté aussi. C’est-à-dire de comprendre pourquoi une communication humaine, c’est aussi ça. Et pas une communication de singes, d’infrahumains, d’abrutis, d’alcooliques…
Cela fait écho, non seulement à la pratique de l’ethnologue, mais également au rapport du journaliste traditionnel à son environnement, qu’il ne va traiter qu’en termes d’actualité… On le remarque quand on travaille sur les quartiers, je crois, où il est tout à fait naturel qu’il y ait un rejet vis-à-vis du journaliste, puisqu’il n’est présent que dans un rapport de prédation du quotidien des gens.
Et puis le journaliste qui va dans le quartier, il sait déjà ce qu’il veut trouver, il sait déjà ce qui se passe, et il sait déjà ce qu’il va en dire. Il cherche juste un peu de couleur locale. Alors on comprend que les gens n’aient pas envie de servir à faire de la couleur locale pour le journaliste. Ils ont des choses à dire, que le journaliste n’imagine même pas. On voit d’ailleurs, quand des journalistes sont restés six mois dans une banlieue, qu’ils ont récolté tout à fait autre chose à en dire.
Vous dites que la sorcellerie, il faut bien voir que ce n’est pas quelque chose d’anodin, c’est un combat à mort entre deux hommes, et derrière eux, du coup, entre deux familles, entre deux exploitations.
Oui, mais je ne dirais pas [un combat à mort] entre deux hommes, mais entre soi et le malheur qui est incarné provisoirement par quelqu’un que l’on accepte finalement de désigner comme sorcier. Parce qu’on s’imagine que ça se fait comme ça, de désigner quelqu’un. Mais moi, parce que j’ai vu beaucoup de séances de désorcelement, je voyais bien qu’il fallait plusieurs semaines au désorceleur pour y arriver. C’est-à-dire pour que les ensorcelés puissent accepter de faire tomber la responsabilité de ce qui leur arrivait sur quelqu’un dont ils savaient que, possiblement, il lui arriverait des malheurs à répétition et qui puisse supporter que « ça » lui arrive. Donc, il s’agit de déménager le malheur d’une exploitation dans une autre, d’une famille dans une autre, et donc c’est tout à fait le contraire de ce que la presse raconte quand on dit « Ah oui, c’est untel qui m’a fait ça ». Non, pas du tout. C’est une opération très longue, très travaillée.
Au fond, le désorcèlement passe par le fait que le désorceleur va apprendre à l’ensorcelé à réassumer une part d’agressivité nécessaire, largement désapprise par l’Église catholique, entre autres, qui apprend plutôt à tendre l’autre joue… La soumission. La soumission, voilà.
Voilà, c’est-à-dire que les ensorcelés se présentent comme des gens qui sont toujours bons. « Nous », on nous a appris à tendre l’autre joue. « Nous », on ne fait pas de mal. « Nous », on n’a jamais fait de mal à personne. « Pourquoi il ne nous arrive que du mal ? Dites-nous qui nous fait du mal ? » Ce qui est frappant, c’est que quand les ensorcelés arrivent chez le désorceleur, ils ont tout de suite des idées sur des gens de leur famille. Parce que la famille, c’est le lieu des vrais conflits, surtout dans l’agriculture, où il y a des jalousies sans fin autour de qui a hérité, puisque tous les héritages vont maintenir l’exploitation du successeur – et pas du tout les filles, qui ne touchent presque jamais leurs parts (elles l’ont en dette, qui ne sera sans doute jamais remboursée). Les autres frères [du successeur] ont dû aller s’installer ailleurs… [La famille], c’est un lieu de conflits gravissimes.
Et donc, aux ensorcelés, si on leur dit « Qui vous veut du mal ? », ils ont tout de suite des tas d’idées. Et le désorceleur, il dit toujours « Non, non, non, c’est plus loin que vous ne le pensez ». Donc il s’agit de sortir les conflits de la cellule familiale qui doit rester toujours unie. Parce que, comme je l’ai compris, c’est un genre de thérapie qui vise aussi à sauver les exploitations familiales. C’est-à-dire que cette famille, qui a cette exploitation, ne doit pas se défaire, elle ne doit pas se séparer, le couple ne doit pas divorcer, il ne doit pas se fâcher avec ses frères, ses sœurs, ses parents. Il faut que l’origine du mal soit trouvée ailleurs, chez d’autres, non parents. Pas trop loin, parce qu’on ensorcelle avec le toucher, le regard et la parole, parce que la théorie de la sorcellerie suppose une proximité de face-à-face. Pas trop loin, mais pas trop près non plus ; pas des parents.
Et quand le désorceleur a réussi à trouver une figure de quelqu’un, d’un proche que les ensorcelés accepteront de charger de cette responsabilité, alors ça commence à marcher mieux. Parce que ça veut dire qu’ils ont aussi accepté de ne pas se penser comme « tout bon », comme « Nous, on n’est que bons et les autres, ils ne sont que mal » : ils ont accepté de se mélanger un peu avec la volonté, par exemple, de rendre des coups à ceux qui leur en donnent.
Vous évoquez, dans ces affaires qui concernent des familles, la différence entre le rôle des hommes et le rôle des femmes face à une crise de sorcellerie. Et notamment le fait que les femmes ne se trouvent pas dans le rôle de la sorcière, comme on a l’habitude de se le représenter. La femme joue le rôle de redonner de l’assurance à l’homme visé par un sorcier ; elle lui permet de se réaffirmer et donc de reprendre pleinement sa place dans le monde.
Oui. C’est-à-dire que les femmes, épouses d’exploitants (à cette époque-là en particulier, mais enfin, le droit a changé, mais la réalité n’a pas beaucoup changé) ne sont rien dans les exploitations. C’est lui qui est le chef d’exploitation et c’est lui le chef de famille. Donc, si elles pensent que c’est de la faute de leur mari que l’exploitation ne marche pas, elles peuvent partir. Mais que feront-elles ? Quoi ? Elles seront apprenties boulangères à Paris ? Elles n’ont pas fait d’études : elles ont évidemment intérêt à essayer de requinquer leur exploitant de mari. Et donc, elles le font comme les femmes font pour requinquer leur pauvre petit mari qui pleurniche à la moindre difficulté. Elles leur font avaler… les rituels qu’il faut faire. [Ceux] qui, si on les fait, nous mettent dans l’état d’esprit de rendre coup pour coup. Elles leur font faire ce qu’elles-mêmes, elles ont fait très vite et très bien dès le début du désorcèlement. Alors que lui, à cause de son orgueil d’homme rationnel et de représentant public de la famille, il doit éviter de se présenter comme un abruti devant le village, le maire, l’instituteur, le curé. Lui, il traîne la patte tout le temps. Ce sont les épouses qui font ce qu’il faut pour les énergétiser progressivement.
Le désorcèlement est un système de communication complexe, dans lequel tout le monde doit accepter d’être partie prenante à 100%. Les femmes entrent tout de suite à 120%, les maris à 40 ou 50%. Donc, il s’agit d’amener le mari le plus près possible des 100%, et il n’y a que les épouses qui peuvent le faire, parce que le désorceleur ne les voit pas assez souvent, et il n’a pas de temps à perdre avec des gens qui ne veulent pas de sa soupe. S’ils n’en veulent pas, tant pis pour eux. Donc c’est le travail de la femme, qui est à la fois complètement exploitée et à la fois complètement puissante. Mais il ne faut pas dire que les femmes sont puissantes simplement dans cette affaire-là. C’est une puissance pour être esclave, une puissance qu’elles déploient pour être esclave. Mais c’est mieux d’être cette esclave-là qu’une divorcée commis de boulangerie à Paris, avec un studio en grande banlieue…
…et donc impuissante ?
Impuissante parce qu’il n’y a pas, pour les femmes, d’accès possible à une position de puissance sociale.
Dans l’exploitation, c’est comme s’il y avait un contre-balancement, où la femme a une importance, mais invisible…
Oui, c’est ça. C’est-à-dire que quand on dit qu’elles sont puissantes dans ce sens-là, c’est qu’elles ont beaucoup de vitalité : elles se démènent pour survivre, pour que l’exploitation survive, pour que leur mari fasse son boulot. Elles ne vont pas le mépriser. Elles vont au contraire le pousser à devenir enfin un peu orgueilleux, mauvais.
On peut dire en quelque sorte que c’est une forme de solidarité liée à la division sexuelle des tâches ?
Oui. Et pas seulement des tâches : de la propriété, des statuts juridiques. Donc elles n’ont pas d’autre issue que de se débattre pour réanimer leur petit mari.
Vous évoquez longuement les rapports que vous avez eus avec madame Flora qui a été votre désorceleuse. Notamment dans Corps pour corps, votre journal de bord, vous écrivez comment, au départ, elle vous autorisait à assister à des séances. En étant là, vous notiez tout, mais sans arriver à percevoir la logique de ce qui s’y passait. C’est en revenant [sur vos notes] que vous avez fini par saisir comment, à travers l’usage de la parole, elle arrivait déjà à comprendre où se situait le malheur de la personne qui venait la voir, sans d’ailleurs que cette personne ait l’impression qu’on lui posait des questions… Il y avait divination. Au fur et à mesure, vous avez compris ce fonctionnement, non pas dans la position extérieure d’une observatrice qui serait scientifique…
Non, j’étais sa cliente.
Oui, voilà, vous étiez sa cliente : vous avez vous-même été engagée dans un désorcèlement avec madame Flora.
J’étais sa cliente pour ma vie, et d’ailleurs, elle m’a appris des choses. J’étais au même moment en psychanalyse, et elle m’a appris des choses que la psychanalyste était absolument incapable de m’apprendre. Entre autres, à me dépatouiller des rapports de force injustes – ce qui est une chose sur laquelle j’avais toujours achoppé jusque-là. À partir du moment où elle m’a donné, sur plusieurs années, cet entraînement, je l’ai fait sans me fatiguer : dès que je m’aperçois qu’on est en train de me maltraiter, je mets toujours quelques claques morales aux uns et aux autres, jusqu’à ce qu’ils comprennent que je suis là, en face. Après, je m’arrête, parce que moi, j’ai horreur des rapports de force. Mais je peux mettre mon habit de méchante, mon habit de fille agressive avec des collègues, par exemple.
Donc être désorcelée, c’est assumer sa puissance et savoir la montrer, qu’on soit un paysan du bocage, ou qu’on soit une femme dans la France contemporaine.
Absolument, c’est ça. Et savoir la montrer quand il faut, c’est-à-dire quand l’autre joue le rapport de force. Par exemple, il y a des collègues, dans des rapports de travail entre universitaires, qui estiment que quelqu’un ne peut être bon que si tous les autres sont posés comme nuls en face de lui. Donc, il s’agit très vite de lui monter sur la tête, et de le montrer en défaut sur quelque chose de fondamental, publiquement. Après ça, il ne s’y risque plus, mais il faut y penser. Je veux dire que ça m’accablait, je me disais : « Mais enfin, les êtres humains sont des ordures », et puis, après, quand j’ai compris que c’était si simple de montrer la force et de ne plus s’en servir, voilà, j’ai appris quelque chose pour ma vie, d’extrêmement important.
Finalement, après la lecture de vos bouquins et cet entretien, le désorcèlement, c’est juste apprendre à trouver sa place dans le monde parmi…
C’est plus que ça. Parce que la psychanalyse est assez bien pour vous faire trouver votre place dans le monde. [Ce que j’ai appris, c’est] être capable de mobiliser ce qu’il faut de force en face des autres, ce qui est toujours lié à ce que les autres essaient de vous imposer. C’est vraiment la gestion du rapport de force.
Il se trouve, par exemple, que j’avais un père extraordinairement autoritaire (on pourrait même dire un « tyran » domestique) et que j’avais décidé très jeune que je ne voulais ni obéir ni commander. J’ai réussi à faire ça. C’est-à-dire que j’ai refusé de diriger un laboratoire, j’ai refusé tout honneur professionnel qui m’amenait à diriger quelque chose, à commander quelqu’un. Mais j’étais totalement incapable de gérer les rapports de force avec les autres, je fuyais, je m’en allais, je me disais « C’est des imbéciles, je les déteste, je vois pas pourquoi j’aurais à me défendre », et en fait, ça me créait des ennuis, tout le temps.
Madame Flora, elle, prenait les problèmes que j’avais dans mon existence à ce moment-là. Elle me disait « Mais vous n’allez pas vous laisser faire là-dedans, attendez ! ». Et elle comprenait très bien comment fonctionne le CNRS, ou comment fonctionne une maison d’édition (parce que j’avais eu des problèmes avec un éditeur à l’époque). En fait, elle me déployait, y compris par rapport à l’administration de mon laboratoire, des arguments. Elle imaginait des scènes totalement irréalistes, mais avec tant de précisions que ça m’imprimait des schémas : répartir les mobilisations de force au bon moment. Et oui, après ça, la vie était beaucoup plus simple.
C’est un apprentissage de sa propre autonomie et de sa propre résistance.
De trouver la bonne force. Ne pas commander, ne pas obéir. Ce qui existe, c’est savoir déployer la bonne force au bon moment et de ne pas aimer la force, mais ne pas non plus la fuir.
Une définition presque libertaire finalement.
Oui, absolument.
C’est comme si vous disiez « Je ne suis ni inférieure ni supérieure à quiconque ». Comment avez-vous géré les rapports que vous avez eus avec la classe paysanne dans votre recherche sur la sorcellerie ? « Je ne suis ni supérieure ni inférieure à ces gens-là », or, il est possible que des gens, en face de vous, aient joué un rôle soumis au regard de l’image péjorative généralement portée sur eux. Cela s’est-il exprimé ? Comment ? Comment avez-vous déconstruit ça ?
Je pense qu’au départ, j’ai essayé de comprendre comment les gens parlaient et que j’accordais beaucoup d’importance à des façons de parler anciennes. J’avais 32 ans, j’étais jeune quand j’ai fait ça. Pour eux, j’étais de la génération des enfants, des enfants qui n’arrêtaient pas de les mépriser au nom de la culture des Lumières, du « merveilleux » savoir qu’ils apprenaient dans les lycées agricoles, et qui leur ont fait bousiller la France en trente ans (rires). Du coup, ils étaient extrêmement honorés que ces choses, que leurs enfants interdisaient de mentionner, intéresse quelqu’un. Je crois que beaucoup m’ont reçue au départ comme quelqu’un qui était envoyé par la classe des jeunes, mais qui n’était pas comme les jeunes et qui avait envie d’apprendre d’eux toutes ces choses-là qui n’intéressaient personne. Leurs enfants étaient évidemment, eux aussi – comme les journalistes, les savants – sûrs de tout savoir de leurs parents, et que ces derniers n’étaient pas intéressants.
Vous êtes retournée dans le bocage après la parution des livres. Vous avez eu des retours ?
J’y suis restée très longtemps à mi-temps, et j’ai gardé des relations jusqu’aux années 1980 à peu près. Je sais que mes livres se sont beaucoup vendus dans la région et j’étais au Salon du livre au Mans il y a deux ans, au moment de la sortie de Désorceler. Il est passé plein de gens qui m’ont dit « Ah ! Mais c’est vous ? Elle existe ! ». Ces livres ont beaucoup été diffusés dans les bibliothèques de lycées, dans les fermes – surtout Corps pour corps –, et ils ont joui d’un grand respect de la part des gens. Vous savez, c’est rare, parce que d’habitude, les ethnologues ont un procès quand ils s’en vont. Pas parce qu’ils ont méprisé les gens, mais parce qu’ils disent des secrets que l’on pourrait reconnaître. Moi, j’ai fait extrêmement attention à ce que personne, jamais, ne puisse être reconnu. Non seulement j’ai maquillé les noms de villes et de personnes, mais j’ai maquillé les maladies. Donc je pense qu’à part les intéressés, personne, vraiment, ne pouvait savoir de qui je parlais.
En avez-vous rediscuté avec des personnes qui vous avaient parlé [de leur crise de sorcellerie] ? Qu’ont-ils pensé de votre analyse de la sorcellerie ?
Ah non, ça je ne sais pas, parce que Désorceler est sorti très récemment, en 2009. Après Les mots, la mort, les sorts, j’ai été là-bas, c’est sûr. Mais ce qui s’est passé, c’est que la presse, Ouest-France, vexée que je ne leur ai pas donné des papier, ou que je ne me sois pas présentée (je ne sais pas), m’a impliquée successivement dans deux affaires, dont une affaire de meurtre liée à la sorcellerie. Dans le village des assassins et dans le village des victimes, personne ne leur parlait [aux journalistes]. Ils ont [donc] fait une carte en triangle comprenant le village où j’habitais, celui des assassins et celui des victimes, et ils ont dit « Voilà le triangle de la sorcellerie ». Elle existe seulement dans ce triangle-là, la sorcellerie. Tout le truc, c’était que les autres puissent dire « C’est pas nous ».
Et donc vous étiez la sorcière dans cette histoire ?
Non, mais ils ont fait un papier sur moi qui connaissait si bien la région, qui avait habité là longtemps, qui avait su tant d’histoires… En fait, je n’avais jamais été ni dans le village des victimes ni dans le village des assassins. Et ils ont dit que je connaissais particulièrement cette histoire. Après ça, il est très difficile de continuer à parler avec les gens de « ça ». On peut parler, mais d’autres choses.
by jefklak | 19 mai 2015 | Terrains vagues
Comment Paris s’est-elle transfigurée au cours des derniers siècles pour finir vidée de ses habitants les plus pauvres, emportant avec eux les amorces de mutuellisme et de solidarité populaire qu’ils avaient élaborés ? Comment s’est jouée en détail la gentrification depuis Belleville jusqu’aux couronnes qui entourent la capitale ? Que laissent présager les projets urbanistiques du Grand Paris en termes de nouveaux déplacements de populations, mais aussi de rapports de forces à réinventer ?
Entretien croisé avec Anne Clerval, géographe auteure de Paris sans le peuple aux éditions de La Découverte (2013) et Eric Hazan, auteur de L’invention de Paris (Seuil, 2002), Paris sous tension (La Fabrique, 2011) et plus récemment La dynamique de la révolte (La Fabrique, 2015). Eric Hazan est par ailleurs le fondateur des éditions La Fabrique qui viennent de publier un précieux travail sur l’histoire ouvrière de Paris d’Alain Rustenholz : De la banlieue rouge au Grand Paris (2015).
Télécharger l’article en PDF
Quelles sont les grandes politiques urbanistiques qui ont transformé le Paris populaire en le détruisant ? Comment peut-on se figurer aujourd’hui ce qu’a pu être ce Paris populaire ?
Eric Hazan : Le grand moment de bascule date des années Malraux-De Gaulle-Pompidou. Avant, on ne construisait pas grand-chose dans Paris. Les premiers coups ont été portés dès le début des années 1960 dans les « quartiers rouges », le 13e et le haut du 20e, qui avaient le tort de voter communiste. L’opération Malraux a eu un énorme impact sur les quartiers populaires : on a tout blanchi, tout rénové, et du coup les loyers ont massivement augmenté ; la population a changé. Dans les années 1950, le Marais que j’ai connu était un quartier noir de suie, sale et pauvre. Les hôtels historiques étaient en pleine décrépitude. Les cours étaient encombrées de charrettes à bras et d’appentis en tôle. Le quartier juif – la rue des Rosiers, la rue Ferdinand-Duval, la rue des Écouffes – était misérable. C’était d’ailleurs un phénomène ancien : dans Le cousin Pons, Balzac décrit déjà la décadence du Marais, depuis sa splendeur au XVIIe siècle, du temps de Madame de Sévigné. Sous Henri IV, sous Louis XIII, pendant la Fronde, le Marais était le centre politique et intellectuel du pays. Et puis, vers la fin du XVIIe siècle, la noblesse et la haute bourgeoisie en ont eu assez de ces rues étroites et sans lumière et ont émigré vers l’Ouest, où ils ont fait construire le faubourg Saint-Germain. Tout ce beau monde est parti vers les quartiers aérés, et le Marais est tombé en déshérence.
Je pense aussi à la Montagne Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement, dont l’histoire est bien décrite dans Paris insolite de Jean-Paul Clébert . J’ai vécu dans cette rue dans les années 1960 : le quartier était un domaine de clochards, qui faisaient leur toilette sur la petite fontaine en face de ce qui était l’École Polytechnique, dominant la place de la Contrescarpe.
Les années Pompidou ont davantage transformé Paris que l’ère Haussmann. Certes, Haussmann a commis deux crimes urbanistiques impardonnables : il a détruit l’île de la Cité et ses dix-sept églises pour en faire un désert où règnent le sabre – la Préfecture de Police –, le goupillon et le bistouri avec l’Hôtel-Dieu. Il a creusé un immense trou dans le quartier turbulent du Temple, trou qui est devenu la place de la République. Récemment, on a bien essayé de la ressusciter, mais d’un trou on ne peut pas faire une place. Cela dit, ailleurs, Haussmann faisait attention à limiter les dégâts. La percée emblématique du boulevard de Sébastopol a évidemment démoli une partie du quartier, mais de part et d’autre, à 50 mètres, on a la rue Saint-Martin et la rue Saint-Denis à peu près intactes. L’urbanisme de Haussmann ne visait pas à détruire des quartiers, mais à créer des axes de circulation, avec un objectif militaire évident : de la caserne de la place de la République (du Château-d’Eau à l’époque), on pouvait faire partir la cavalerie et l’artillerie dans toutes les directions, aussi bien vers Montmartre que vers Belleville.
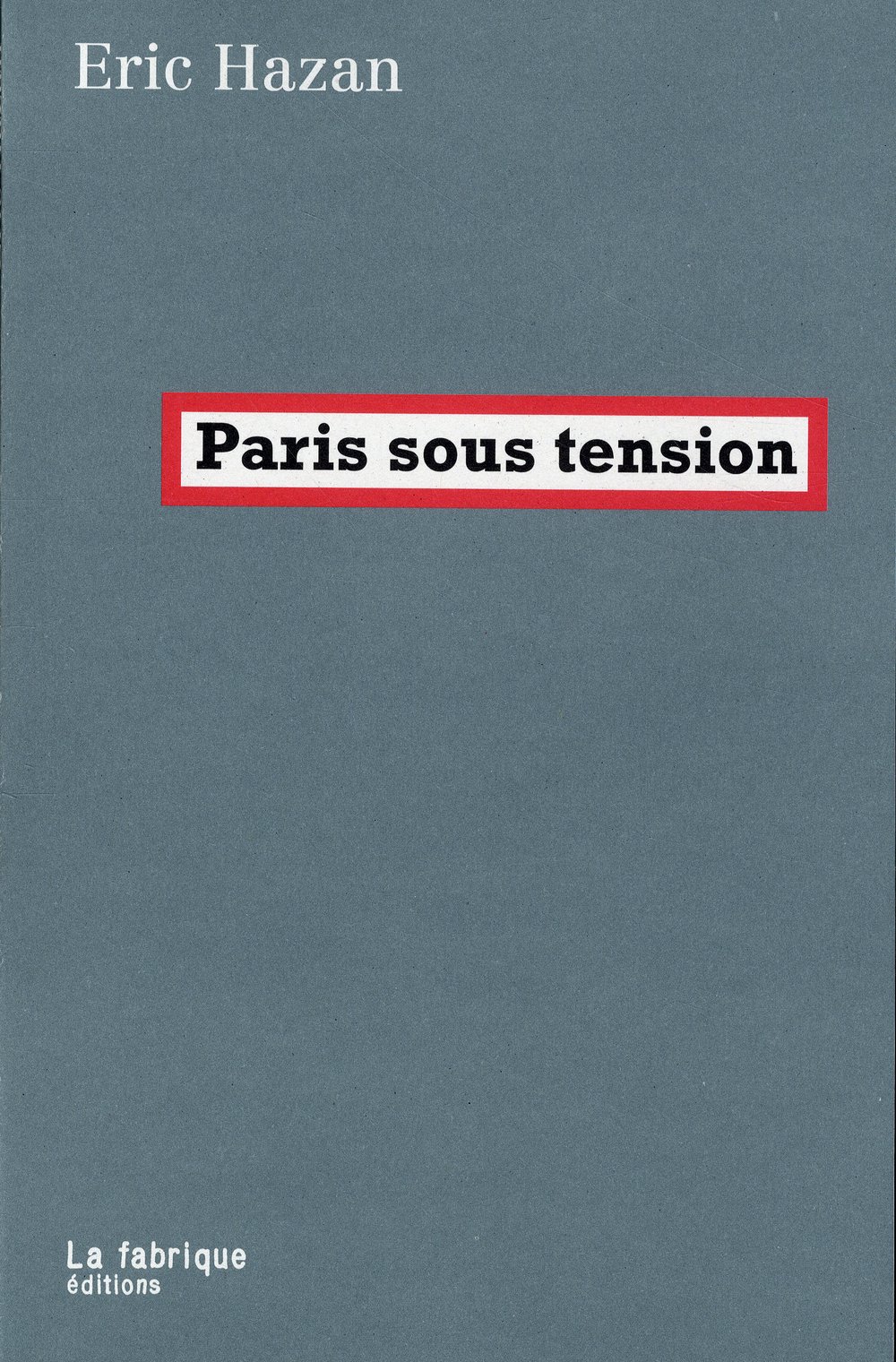
Avec Pompidou, cet aspect militaire de l’aménagement urbain disparaît ?
Anne Clerval : Sous Haussmann, on est en plein boom industriel. Il y a un afflux énorme de ruraux et d’immigrants qui viennent renforcer la classe ouvrière parisienne. Quand, un siècle plus tard, Pompidou intervient, ce n’est pas du tout le même contexte : la désindustrialisation commence, le tissu d’activités se relâche. La réorganisation de la production a été un mouvement lent et progressif, mais elle a contribué à évincer de Paris les classes populaires. Pompidou est un accélérateur de ce phénomène, mais on y avait déjà pensé avant. Il y a une citation dans le livre d’Eric Hazan (L’invention de Paris), qui remonte aux années 1850 : « Paris n’a pas besoin de posséder en son sein tant de manufactures, tant de grandes usines. La destination de notre capitale, c’est d’être une ville de luxe et de plaisir. » (Auguste Chevalier) [2.Auguste Chevalier, Du déplacement de la population, de ses causes, de ses effets, des mesures à prendre pour y mettre un terme, 1850.]. Cela permet de comprendre l’édification des grands magasins sous Haussmann, mais les quartiers de misère ont continué d’exister, alors qu’ils furent peu à peu évincés sous Pompidou.
Or ces quartiers étaient tenus par un tissu social riche de sens, caractérisé par une forte interconnaissance locale et par des pratiques quotidiennes d’entraide et de solidarité (ce qui n’empêchait pas malgré tout les concurrences et les rapports de force, y compris violents). C’est ce tissu social qui a servi de creuset pour la politisation du peuple parisien. Du mouvement des associations ouvrières des années 1840 (associations de consommateurs permettant de baisser le prix d’achat des biens de première nécessité, et associations de producteurs qui sont les premières formes des coopératives) est né une multitude d’organisations collectives ouvrières dans la deuxième moitié du XIXe siècle. En plus des syndicats de travailleurs (légalisés en 1884), la vie quotidienne des ouvriers s’organise en marge du capitalisme – à travers les sociétés de secours mutuel, les coopératives d’achat, les cantines populaires autogérées (notamment inspirées du « mutuellisme proudhonien »). Les quartiers populaires parisiens, comme dans d’autres villes industrielles telles que Barcelone un peu plus tard [3. Voir notamment l’excellent petit livre de Chris Ealham, Barcelone contre ses habitants. 1835-1937, quartiers ouvriers de la révolution, Éditions CMDE, Collectif des métiers de l’édition, 2014.], ont amorcé des pratiques d’auto-organisation sur une base de classe, qui donnaient corps au quotidien à une perspective révolutionnaire socialiste non autoritaire [4. Sur les prémices de cette conscience de classe ouvrière parisienne, voir la somme impressionnante de Maurizio Gribaudi, Paris ville ouvrière. Une histoire occultée (1789-1848), La Découverte, 2014.].
Outre les entraves et la répression qu’ont connues ces pratiques d’auto-organisation ouvrière au XIXe siècle, la désindustrialisation, et avant elle, l’atomisation des lieux et des collectifs de travail, ainsi que la rénovation urbaine pompidolienne ou l’éviction d’une partie du peuple parisien en banlieue, tous ces facteurs ont convergé vers l’affaiblissement de ces pratiques. De ce point de vue, la préoccupation sécuritaire (à des fins contre-révolutionnaires) n’a jamais disparu des politiques d’urbanisme, même si elle s’est euphémisée ou masquée. Mais l’hygiénisme est toujours à la fois sanitaire et moral, donc éminemment politique.
C’est tout ce tissu social et ces pratiques d’auto-organisation qui faisaient un quartier populaire et dont on ne retrouve que des traces dans ceux d’aujourd’hui, à travers des formes de solidarité quotidienne, des pratiques économiques autonomes, y compris illégales, dans un contexte de chômage de masse, et des associations locales, qui ne sont d’ailleurs pas toujours tenues par les classes populaires elles-mêmes.
EH : Mais pas intra-muros.
AC : Intra-muros, il y a encore aujourd’hui des formes de solidarités populaires, par exemple sur la base de l’origine nationale ou régionale des migrants (comme les Chinois de la région de Wen Zhou dans le 3e arrondissement et à Belleville). Ces formes de solidarité, non exemptes d’exploitation entre migrants de la même origine, permettent notamment aux commerçants chinois de réunir les sommes nécessaires à l’achat de commerce et la force de travail requise (en général fondée sur l’exploitation de la famille) pour faire tourner ce commerce. Comme on le voit dans cet exemple, il ne s’agit plus de formes de solidarités qui pouvaient se poser volontairement en rupture ou en marge du capitalisme et qui visaient l’abolition des rapports de classes. Cela n’est pas directement lié aux politiques d’urbanisme qui ont transformé les quartiers populaires, mais au contexte politique qui n’est plus le même, notamment en termes de mobilisation des classes populaires.
La désorganisation de la classe ouvrière est due à de multiples facteurs comme la réorganisation du travail sur un mode flexible, la désindustrialisation, la crise de la reproduction ouvrière à travers la massification scolaire, celle de la représentation ouvrière, elle-même liée à l’évolution bureaucratique des principaux syndicats, aux trahisons électoralistes des partis politiques sociaux-démocrates, et à l’histoire nationale et internationale du communisme autoritaire. Cette désorganisation a aussi une dimension spatiale, à travers la diversité de trajectoires résidentielles au sein des classes populaires entre les trajectoires des immigrés en France (nombreuses discriminations au logement qui confinent les primo-arrivants au logement privé dégradé ou sans confort et les cantonnent ensuite dans certains segments dévalorisés du parc social), celles des fractions stables des classes populaires (y compris immigrées ou issues de l’immigration) qui peuvent accéder à la propriété de plus en plus loin du centre, et celles des locataires du parc privé, souvent repoussés en périphérie par la hausse des prix immobiliers. Or ces trajectoires résidentielles sont de plus en plus contraintes par les pouvoirs publics [5. Voir à ce sujet, une bonne synthèse des recherches en sciences sociales au sujet des mobilités résidentielles des classes populaires : Sylvie Fol, Yoan Miot et Cécile Vignal (dir.), Mobilités résidentielles, territoires et politiques publiques, PU du Septentrion, 2014].
De telles divisions, exploitées de toutes parts, s’inscrivent aussi dans l’espace : ce sont des gens qui n’habitent pas forcément les mêmes quartiers ; par ailleurs, habiter un pavillon de banlieue, un grand ensemble d’habitat social ou un petit appartement parisien, ce n’est pas la même chose. Ce sont des clivages très forts. Ce n’est pas ce qu’on observait dans le Paris ouvrier. Certes, le peuple de Paris était composite, fait d’ouvriers de divers secteurs, d’employés du commerce et de domestiques mais aussi d’artisans et de petits commerçants indépendants, sans compter la diversité des origines géographiques. Pourtant, par la cohabitation dans les mêmes quartiers, par la diffusion des pratiques quotidiennes de solidarité et d’auto-organisation, et par la mobilisation politique, il y avait une vraie cohésion de cet ensemble hétérogène.
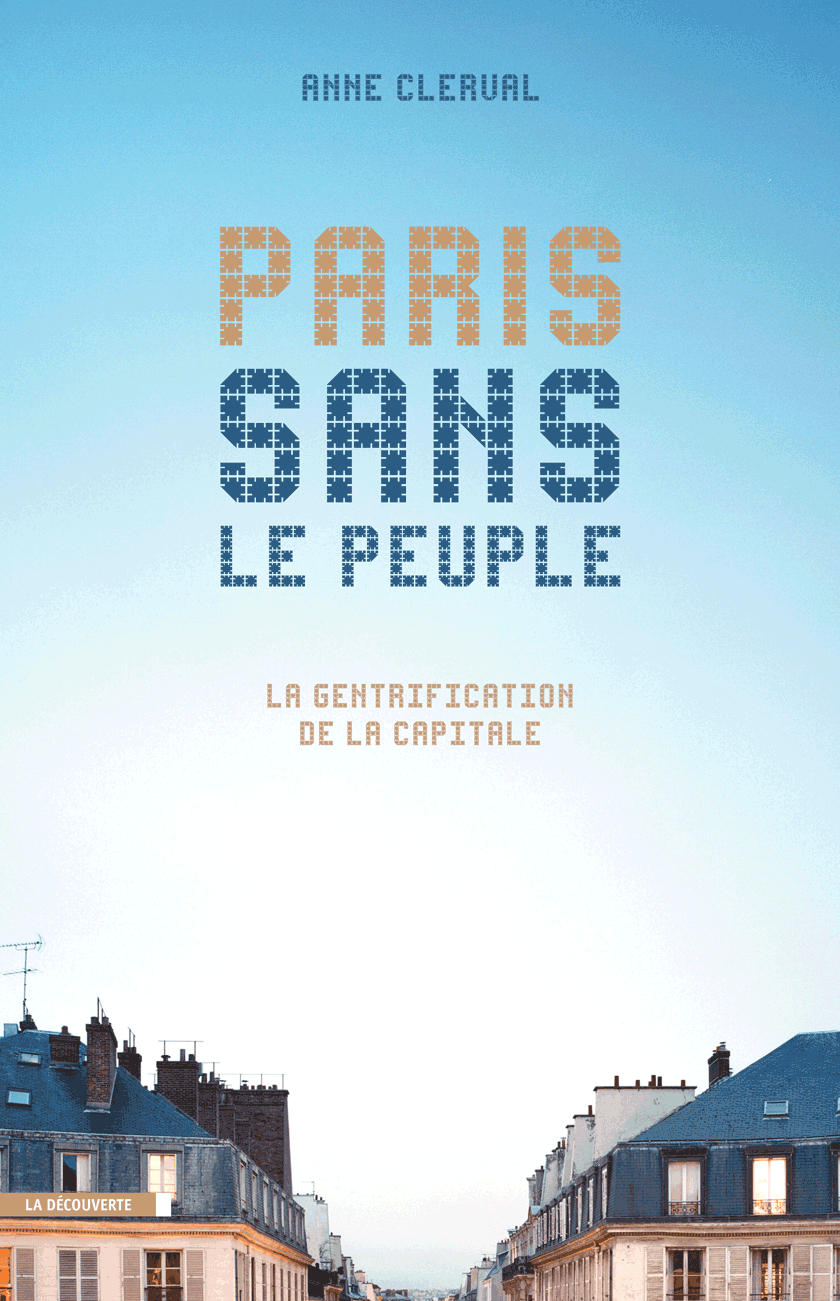
Aujourd’hui, quel est le rôle des pouvoirs publics dans la transformation urbaine et sociale de Paris, notamment celle des quartiers populaires ?
AC : Je ne crois pas que les choses aient été « planifiées » en région parisienne : le processus de gentrification, c’est-à-dire l’embourgeoisement des quartiers populaires par la transformation matérielle du quartier (notamment de l’habitat), est avant tout lié au marché immobilier privé et à la réhabilitation des logements par des ménages ou par des promoteurs, avec l’aide des banques (notamment à travers la baisse des taux des prêts immobiliers permettant la diffusion de l’accession à la propriété dans les classes intermédiaires). L’agrégation de tous ces facteurs a bien plus transformé les quartiers populaires de Paris que les politiques de rénovation urbaine des années 1970-1980. Disons simplement que les pouvoirs publics peuvent être des facilitateurs à certains moments.
À Paris, ils ont mis un certain temps à comprendre qu’il y avait une opportunité pour eux à soutenir ce processus. Jusqu’au milieu des années 1980, ce sont même des mesures de réglementation des loyers comme la loi de 1948 (qui encadrait strictement les loyers dans les logements construits avant cette date) qui ont freiné la gentrification. Jusqu’à la libéralisation des loyers par la loi Méhaignerie de 1986, redéfinie par la loi Malandain-Mermaz de 1989, la spéculation immobilière passait surtout par la démolition d’un immeuble entier et son remplacement par un immeuble neuf où les loyers étaient libres. On voit bien ce type de résidences privées haut de gamme des années 1970 dans le 15e arrondissement ou le long du canal Saint-Martin (10e) par exemple. Dans les années 1980, des ménages de la petite bourgeoisie intellectuelle ont commencé à accéder à la propriété dans des logements anciens des quartiers populaires qu’ils ont fait réhabiliter. La libéralisation des loyers et l’augmentation qui en a découlé, parallèlement à la baisse des taux des prêts immobiliers, ont accéléré ce processus. Ce faisant, ils valorisaient, symboliquement et financièrement, les logements anciens, même dans un tissu urbain de piètre qualité comme celui qu’on dit « faubourien ».
Or, dans le même temps, les pouvoirs publics (l’État, puis la mairie à partir des lois de décentralisation de 1982-1983) ont mené une politique de rénovation urbaine, c’est-à-dire de démolition/reconstruction d’îlots entiers, dits insalubres depuis la fin du XIXe siècle, et dont on considérait que le tissu urbain n’avait aucune valeur. La rénovation au bulldozer côtoyait déjà la patrimonialisation de tissus urbains « nobles » comme le Marais ou le faubourg Saint-Germain (préservés et réhabilités suite à la loi Malraux de 1962). C’est assez tardivement par rapport aux débuts du processus de gentrification que les pouvoirs publics ont compris que le tissu urbain populaire, faubourien, pouvait lui aussi favoriser l’accumulation de la rente foncière.
En 1995, le nouveau maire de Paris, Jean Tiberi (RPR) abandonne officiellement la politique de rénovation pour des raisons d’abord liées à des rapports de forces politiques (six arrondissements du Nord-Est parisien étaient alors passés à gauche). Le faubourg Saint-Antoine est un bon exemple de ce virage : jusqu’ici, les plans d’urbanisme prévoyaient de détruire les cours intérieures utilisées par l’artisanat du bois, pour reconstruire en ouvrant de nouvelles rues ou en comblant les parcelles. À partir de 1995, un plan d’occupation des sols spécial est mis en place pour préserver ces cours. Ce tissu urbain est ainsi revalorisé, c’est-à-dire les formes urbaines, mais pas le tissu social – car l’artisanat du bois est mourant et les classes populaires ont déjà commencé à partir, du fait de la hausse des loyers. On a donc préservé la forme, les cours artisanales, mais il n’y a plus d’ouvriers ni d’artisanat du bois, seulement des plaquettes publicitaires et un guide Gallimard sur l’histoire du quartier. Cette histoire n’est plus vivante, elle n’est plus qu’une queue de comète, une trace de ce qu’ont emporté la réorganisation mondiale de la production de ces trente dernières années et la nouvelle division internationale du travail.
Néanmoins, la rénovation urbaine s’est en fait poursuivie dans les quartiers de friches industrielles de l’Est parisien comme les ZAC Bercy (12e arrondissement) et Rive gauche (13e). Elle est encore à l’ordre du jour, dans le nord de Paris cette fois, avec le vaste projet de reconversion urbaine « Paris Nord-Est », le long du périphérique, à cheval sur les communes de Paris et d’Aubervilliers. Il s’agit de créer un nouveau pôle d’affaires dans un quartier de logements sociaux. L’originalité consiste à changer complètement la nature du quartier sans détruire pour l’instant les logements sociaux. On commence par construire des bureaux pour des cadres, des commerces destinés à cette nouvelle clientèle et des logements privés neufs (par des promoteurs immobiliers qui récupèrent l’augmentation de la rente foncière) et même un peu de nouveaux logements sociaux (dont une partie pour les classes moyennes). On modifie le quartier non pas en déplaçant les gens, mais en changeant l’équilibre de la composition sociale du quartier, ce qui transformera à terme la norme dominante dans l’espace public. Il s’agit d’une opération de gentrification planifiée par la reconversion d’anciennes friches industrielles et la démolition/reconstruction.
Dans le cadre de friches industrielles de l’ampleur de l’ancien entrepôt Macdonald, situé dans l’ancienne zone des fortifications de Paris où les logements sociaux dominent, le risque financier est trop important pour qu’un opérateur privé se lance dans l’opération. D’où l’appui des pouvoirs publics, à la fois pour récupérer les terrains, assumer le risque financier, notamment durant le temps important nécessaire à l’opération, et piloter le projet d’aménagement (en concertation étroite avec les investisseurs privés). Mais l’opérateur principal du projet Paris Nord-Est est BNP-Paribas, déjà auteur de la reconversion en bureaux (pour une de ses filiales financières) des anciens Moulins de Pantin le long du canal de l’Ourcq. Ce projet est révélateur d’un changement d’échelle de la gentrification : l’acteur principal n’est plus l’accédant à la propriété de classe intermédiaire mais un grand groupe financier de rang international. Et ce changement d’échelle s’appuie sur l’intervention publique.
Même s’il est difficile de généraliser pour ce qui concerne la banlieue, chaque municipalité menant sa propre politique, on constate qu’il y a souvent un appui public à l’augmentation de la rente foncière dans des quartiers populaires où elle était jusque-là sous-évaluée (extension d’une ligne de métro, projet urbain sur une friche industrielle comme les Docks de Saint-Ouen par exemple). À Montreuil, Bagnolet, Aubervilliers ou Saint-Denis, le Plan national pour la rénovation des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), une aide publique à la réhabilitation privée, a été un facteur déterminant. De tels plans sont des accélérateurs, ils permettent notamment de mettre dehors de petits propriétaires qui n’ont pas les moyens de faire des travaux, ou de virer les occupants sans-titre.
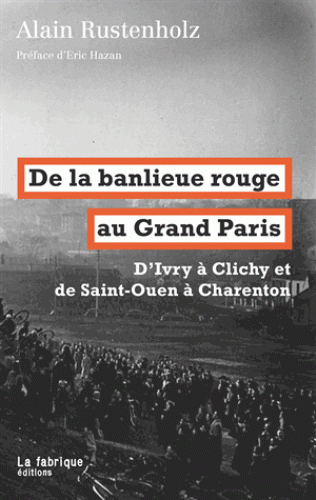
Pour bien se repérer, quelle définition pourriez-vous donner des notions de « tissu urbain » et de « tissu social » ? Quelles différences et imbrications mutuelles comportent-elles ?
AC : À mon sens, le « tissu urbain » désigne le bâti d’une ville, habitat, équipements, bâtiments d’activité, espace public et notamment réseau viaire. La métaphore du tissu rappelle que cela forme un tout, auquel l’histoire confère une certaine cohérence (ou incohérence pour les tissus dits hétéroclites et entrecoupés de ce qu’on nomme des « coupures urbaines », voie de chemin de fer ou autoroute par exemple, qui entravent la circulation piétonne d’un endroit à un autre). Mais cette image du tissu renvoie aussi à la représentation organique de la ville comme s’il s’agissait d’un être vivant. Cette représentation de la ville comme un organisme est discrètement réactionnaire : elle justifie les hiérarchies sociales (il y a une tête qui ordonne et des membres qui exécutent) et, plus généralement, naturalise les inégalités sociales qui se manifestent dans l’espace urbain. Les dysfonctionnements de la ville qui en découlent sont considérés comme des maladies : on parle de métastases urbaines, de thrombose des axes de communication. Et on peut continuer de filer la métaphore avec la médecine et la chirurgie : plutôt que de remettre en cause le mode de production capitaliste de la ville, il s’agit de la soigner, s’il le faut avec l’aide du bistouri (comme le dit l’historien Louis Chevalier dans L’assassinat de Paris). Il faut donc être vigilant quant à l’emploi de ce terme, notamment quand il est utilisé à la place de tissu social, charriant l’idée fausse selon laquelle on pourrait régler les questions sociales par une intervention sur l’espace urbain.
La notion de « tissu social » renvoie aux personnes qui vivent dans cet espace (pour ce qui nous occupe ici) et à l’ensemble des rapports sociaux qui les relient et les divisent. La gentrification a comme caractéristique de transformer à la fois le tissu urbain et le tissu social, révélant ainsi leur interaction.
EH : J’entends bien le danger du mot « tissu », si on le prend au sens de partie d’un corps vivant : ça tendrait à faire de la ville un organisme. Moi, je l’emploie au sens textile : une ville, ça se tricote, ce qui signifie d’une part lenteur – pour faire le beau centre d’Ivry, Renaudie a mis plus de vingt ans – et d’autre part échelle réduite. Les bonnes opérations d’urbanisme sont de petite taille, avec comme ancêtre l’axe Place Dauphine-Pont-Neuf-rue Dauphine, première opération d’urbanisme concerté à Paris.
Les différentes étapes de gentrification qui ont commencé dans les années 1980, au faubourg Saint-Antoine puis à Belleville, se sont-elles faites en douceur ?
EH : Au début des années 1990, il y a eu une résistance organisée autour de l’association La Bellevilleuse, dans le bas-Belleville. Le processus de démolition était pourtant bien engagé, avec l’ensemble du Nouveau-Belleville, la rue du Pressoir, le long du boulevard de Belleville – qui est un désastre urbanistique total. L’idée de base était que tout le bas du quartier, entre la rue des Couronnes et la rue de Belleville devait être détruit. Et là, on a connu une résistance, pas extrêmement structurée, mais qui a rassemblé les gens du quartier, jusqu’à l’abandon du projet, il y a 10 ou 15 ans. Récemment, tout le monde s’attendait à ce que soit détruit le petit immeuble à l’angle de la rue Ramponneau et du boulevard de Belleville, un relais de poste du XVIIe siècle en quasi ruines. Sous la pression du quartier, je pense, il a été retapé, et pas si mal. Aujourd’hui, il existe donc une sorte de résistance informelle, qui reste relativement efficace.
AC : Ce qu’il est néanmoins important de relever dans cette histoire, c’est qu’il ne s’agissait pas d’une lutte contre la gentrification, mais contre la rénovation. La victoire a consisté à arrêter le projet de démolition/reconstruction. Mais ceux qui ont mené cette lutte étaient les premiers gentrifieurs de Belleville, c’est-à-dire des gens qui avaient acheté et investi dans ce quartier très populaire, parfois délabré. Ils risquaient d’être expropriés et ont voulu défendre leur bien. Comme ils étaient de gauche, ils ont eu l’intelligence de tenir un discours sur la mixité sociale et sur l’importance de maintenir sur place tous les habitants pour préserver le quartier. Il y avait donc un double discours, non pas ambivalent, mais sur deux axes : la préservation du tissu urbain d’un côté et le maintien de la population sur place, du tissu social, de l’autre. Les arguments sur le tissu urbain ont fait mouche ; le 20e arrondissement est passé à gauche en 1995, et Tiberi a abandonné la rénovation en partie à cause de ce rapport de forces.
Pour autant, une fois que le projet a été abandonné, une Opération programmée de l’amélioration de l’habitat (Opah) a été lancée pour aider à la réhabilitation, sans préoccupation pour le maintien des habitants sur place : de fait, les loyers ont augmenté et le quartier a pris de la valeur. L’ambiance du quartier a progressivement changé, les cafés à la mode ont fleuri, puis le street art. Le ver était dans le fruit, puisque ceux qui ont mené la lutte ne faisaient pas partie des classes populaires – ils avaient bien une stratégie d’alliance de classes, mais que voulaient-ils sauvegarder le plus ? Le tissu urbain ou le tissu social ?
EH : Aujourd’hui, quand on se promène dans le quartier ou quand on y habite, on a l’impression que la rue ne représente pas l’habitat. Les gens viennent là parce qu’ils ont leurs habitudes, leurs cafés, leur marché, mais souvent ils habitent ailleurs, plus loin, en banlieue.
AC : Les vieux chibanis ont été obligés de déménager, mais ils reviennent tous les matins prendre leur café, parce que cela reste leur tissu social. Du coup, la rue renvoie l’impression d’être dans un vrai quartier populaire, mais quand on regarde la composition sociale des résidents, la part de cadres qui se sont installés là depuis une vingtaine d’années est sans commune mesure avec les banlieues populaires.
EH : Il y a cinq ans encore, l’idée qu’il puisse y avoir un jour une galerie d’art rue Ramponneau paraissait insensée. Aujourd’hui, il y en a moins cinq sur moins de 300 mètres. Depuis que j’y habite, il y avait une grande vitrine toujours fermée par un rideau de fer, une boutique d’articles religieux juifs. Et puis soudain, le rideau s’est levé sur une galerie d’art ! Rue Jouye-Rouve, qui est une petite perpendiculaire du boulevard de Belleville qui va vers le parc, c’est la même multiplication de galeries. Je ne comprends pas quelle est leur économie, leur public, comment elles survivent. Mais ce qui est sûr, c’est que les galeries d’art et les magasins bio sont deux signes symboliques et matériels de la gentrification.
AC : Matériels surtout, car concrètement, cela fait augmenter le prix des baux commerciaux et cela transforme la fréquentation. Il faut ajouter à cela l’effet de concentration : plusieurs galeries au même endroit, cela attire d’autres galeries. Or celles et ceux qui viennent dans ces galeries sont issu.e.s de la petite bourgeoisie intellectuelle, pas des classes populaires.
Par ailleurs, tous les logements sociaux ne sont pas bon signe : à Paris, beaucoup de « logements sociaux » sont destinés aux classes moyennes et contribuent donc à la gentrification. Ce qui se joue dans la question du maintien ou non d’une pratique ouverte au street art dans la rue Denoyez à Belleville relève d’une concurrence interne à la même classe : la petite bourgeoisie intellectuelle des artistes s’oppose à la petite bourgeoisie intellectuelle au pouvoir à la mairie. Les classes populaires n’ont pas grand-chose à voir là-dedans et ont toutes les chances d’être perdantes quelle que soit l’issue de ce conflit. En particulier, les demandeurs de logement sociaux, dont l’écrasante majorité appartient aux classes populaires, ne sont jamais consultés dans les projets urbains.
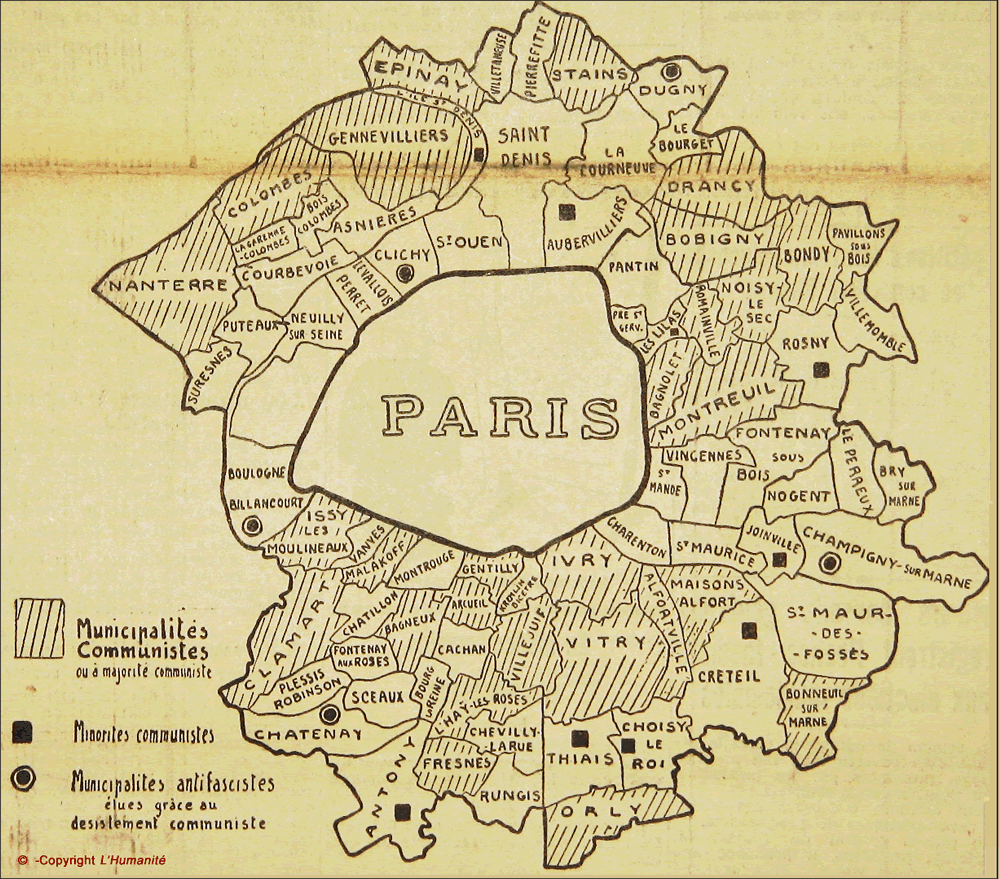
Que va modifier de plus le Grand Paris pour la ville et sa banlieue ?
EH : Je ne pense pas qu’il faille traiter la banlieue comme un tout, ce qu’on a tendance à faire dans trop de débats. La première couronne est en voie de gentrification ; par endroits, c’est déjà bien fait. Quand j’étais interne dans les années 1960, Levallois était un immense garage : de l’automobile d’occasion à perte de vue. Quand on voulait frimer, on allait acheter une décapotable là-bas. Aujourd’hui, c’est Thalès, la Sous-direction anti-terroriste (Sdat) et des résidences pour cadres.
Le bas d’Issy-les-Moulineaux était une grande friche jusque dans les années 1980, puis ça s’est transformé en zone de bureaux à toute vitesse. Ce phénomène ne se restreint plus à l’Ouest, il fait le tour, au Sud, Malakoff, Montrouge. Les éditions du Seuil sont boulevard Romain-Rolland, juste de l’autre côté du périphérique, mais toujours dans le 14e. Flammarion est au-delà de la BNF dans le 13e, presque à Ivry. À l’Est, ce n’est pas encore tout à fait le cas, Montreuil est sur la voie, mais pas entièrement. Pour la bourgeoisie, intellectuelle ou pas, il y a encore beaucoup à gagner dans l’Est parisien.
Ces avancées des classes moyennes signifient qu’une grande partie de la population qui habitait là est repoussée vers la couronne suivante. Chasser progressivement les pauvres vers la périphérie est un phénomène vieux d’au moins quatre siècles : c’est un processus historique lent, avec des moments d’accélération comme celui qu’on vit aujourd’hui, mais c’est un processus continu. Il n’y a jamais eu de retour des classes populaires vers le centre, pour l’instant.
AC : La banlieue n’est pas homogène, c’est vrai, de même que Paris. À Neuilly, on ne parle pas de gentrification, ç’a toujours été d’emblée une annexe des beaux quartiers. D’autres villes dans le prolongement, jusqu’à Saint-Germain-en-Laye ou Versailles, n’ont jamais vraiment été populaires. Ces beaux quartiers continuent de s’embourgeoiser, avec un renforcement de la présence des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Dans leur cas, on peut parler de filtrage social par le haut et de renforcement de leur exclusivité sociale. Le peu de classes moyennes et populaires qui y vivaient s’en va.
À Boulogne-Billancourt, à la fois ville bourgeoise et ouvrière, la fermeture des usines Renault et le projet d’aménagement de l’île Seguin ont joué le rôle d’accélérateurs. À Issy et Levallois, la gentrification a été planifiée par la droite. On a démoli puis construit des sièges d’entreprises et des logements haut de gamme.
Le projet du Grand Paris est un projet d’intensification de la gentrification, dans un contexte de métropolisation, c’est-à-dire de concentration des activités tertiaires stratégiques (finance, assurance, conseil, conception, etc.). Les futures gares du réseau Grand Paris Express s’accompagnent d’un Contrat de développement territorial (CDT), c’est-à-dire d’un projet d’aménagement urbain, de création ou de restructuration des nouveaux quartiers de gare : ce sont souvent des espaces peu denses qu’on va densifier. Les projets annoncent des bureaux, du logement haut de gamme, des équipements pour les nouvelles populations que l’on souhaite attirer, et aussi des logements sociaux. Tout le monde débat : y en aura-t-il 50%, 30% ou bien 20% ? Dans tous les cas, même si on en fait 50%, la moitié qui reste sera du logement privé neuf, donc cher et destiné aux cadres. Comme pour Paris Nord-Est, cela contribuera à la gentrification des quartiers actuellement populaires où est prévue l’implantation d’une gare du nouveau réseau.
EH : On a une chance, c’est qu’il n’y a plus d’argent public. Le drame des années 1960 dont on parlait, c’est que l’argent coulait à flots. Il y a eu un mécanisme de ciseaux malencontreux entre cette période où l’argent abondait et le moment le plus bas du niveau de l’architecture et de l’urbanisme français.
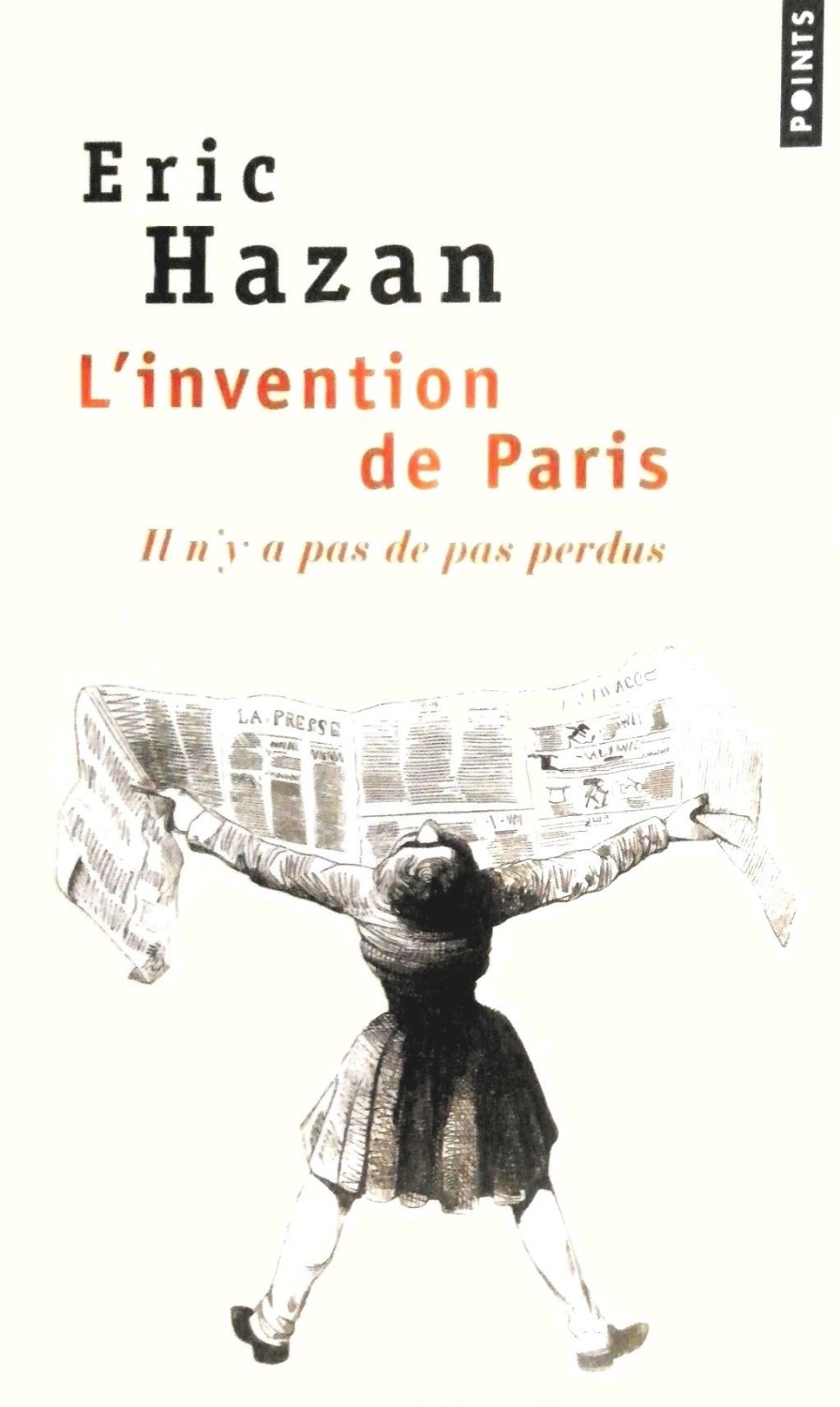
Sous Mitterrand, l’architecte Roland Castro est chargé en 1983 dans la banlieue lyonnaise de réaliser « l’achèvement du tissu urbain ». Est-ce que cette idée de « tissu urbain » n’intervient pas justement au moment où tout se désagrège ? Quel est ce lien entre tissu urbain et tissu social ? Quand on voit l’histoire des squats parisiens, à un moment donné, ce n’était plus possible, un squat ne tenait même pas un jour, donc forcément, on les trouve désormais à Montreuil, à Ivry, à Saint-Denis. Comment recréer une logique de tension, un rapport de forces avec le pouvoir ? Est-ce qu’on peut reprendre Paris ou bien faut-il lâcher le terrain ?
EH : C’est par la périphérie qu’on reprendra la ville. Paris ce n’est pas foutu, ce n’est pas irréversible. Il ne s’agit pas de l’abandonner, mais de la reprendre par une offensive venant de la périphérie. L’idée en vogue dans les milieux révolutionnaires, celle d’abandonner les métropoles, de partir vers d’autres territoires, ne me semble pas juste.
AC : Ça me fait penser à une planche de L’An 01 de Gébé, au moment où l’on construit les grands ensembles en banlieue : il représente Paris avec plein de tours autour, et puis un personnage dit : « Merde, on s’est encore fait virer de Paris ! », et un autre répond : « Non, mais ils sont complètement cons : on les encercle ! »
À partir de là, on peut réfléchir à comment relier tissu urbain et tissu social. Les quartiers populaires n’ont quasiment jamais été construits par les classes populaires elles-mêmes, sauf peut-être en banlieue, dans les petites zones pavillonnaires ; sinon, il s’agit de promoteurs privés, de petits-bourgeois qui ont créé des immeubles de rapport voués à la location. Cela dit, vu le manque d’intervention des pouvoirs publics et des propriétaires, les classes populaires ont tissé des formes sociales à partir de ces formes urbaines de piètre qualité et vite dégradées. C’est ce que je disais tout à l’heure à propos des pratiques d’auto-organisation ouvrière à Paris ou à Barcelone. Elles permettaient d’envisager ce que Lefebvre appelle le « droit à la ville », c’est-à-dire la capacité de décider collectivement de la façon de produire la ville et de ses finalités (versant urbain de la récupération et de l’autogestion de la production, afin de l’adapter aux besoins réels). Ce qui compte dans une perspective émancipatrice, ce n’est pas tant le tissu urbain que la capacité collective des habitants d’une ville à décider de la façon dont on le produit et l’utilise.
Au contraire de cette perspective, les urbanistes parlent de faire de la « couture » urbaine entre Paris et la banlieue. C’est une vision purement formelle qui n’a rien à voir avec le tissu social : il s’agit de recouvrir le périphérique, de faire de petits immeubles entre les grands immeubles pour recréer de la « continuité urbaine . On fétichise la forme urbaine comme si elle était productrice de tissu social sans remettre en cause le mode de production technocratique de la ville au service des classes dominantes et des intérêts du capital. Et tout cela est enrobé de discours sur le lien social, le vivre ensemble ou la mixité sociale, héritiers d’une pensée de collaboration de classe venue du catholicisme social au XIXe siècle pour faire barrage au socialisme. L’État n’a jamais autant mis en avant la mixité sociale que depuis le tournant de la rigueur du Parti socialiste en 1983 : depuis que le PS s’est rallié au capitalisme dans sa version néolibérale, le désengagement de l’État des structures keynésiennes de redistribution (relative) des richesses n’a pas cessé de s’approfondir. Or, plus les inégalités sociales augmentent, plus on exhorte au vivre ensemble des groupes sociaux de plus en plus antagonistes.
Remettre en cause la mixité sociale comme un dispositif de fabrique du consentement est déjà un premier élément de lutte contre la dépossession des classes populaires dans l’espace urbain. Mais en termes de stratégie politique, la priorité devrait être de retisser des solidarités de classe, par des pratiques d’entraide au quotidien, dans une perspective de lutte contre un régime politique et économique inégalitaire. Reprendre Paris semble pour l’instant difficile, mais il y a des choses à faire dans les banlieues populaires, notamment là où se trouvent les squatteurs, qui révèlent souvent malgré eux l’avant-garde du front de gentrification.
Aujourd’hui, on observe parfois un hiatus entre des gens qui sont héritiers des pensées et des pratiques du mouvement ouvrier, mais qui font le plus souvent partie de la classe intermédiaire, et les classes populaires, où la conscience de classe est très affaiblie. Pour retisser du lien social sur une base de classe et dans une perspective politique (ce qui est le contraire du lien social dépolitisant et consensuel que prônent les pouvoirs publics), il me semble qu’il faut s’appuyer sur ce qui existe déjà dans les banlieues populaires, notamment à partir des luttes de l’immigration et des descendants des immigrés. La défiance envers l’État est forte parmi les classes populaires racisées, il y a un travail de lien politique à faire avec elles. Mais pour cela, il faut accepter de partir des objectifs de lutte des classes populaires, qui peuvent aller de l’accès au logement social à la négociation avec les pouvoirs publics. Il y a parfois des refus dogmatiques de soutenir ce type de démarche au nom d’une certaine pureté politique. Or, historiquement, le mouvement ouvrier a politisé un nombre conséquent de personnes qui ont commencé à se battre pour seulement réduire le temps de travail, améliorer leurs conditions de travail et leur vie quotidienne. La radicalisation ne peut être un préalable aux luttes, elle se gagne dans les luttes.
Stratégiquement, on pourrait partir de là où sont les gens des classes populaires. Le but, c’est qu’ils s’organisent collectivement. Même si c’est juste pour un logement décent ou pour obtenir une indemnité de licenciement, le plus important, c’est le développement des pratiques d’auto-organisation collective et la politisation qui se fait à travers ces luttes. Et dans ces luttes, les militants comme des squatteurs peuvent se mettre d’emblée en position d’alliés et non de meneurs, pour ne pas reproduire les rapports de domination de classe et bien souvent de « race » – sans parler de la place que prennent les hommes dans ces luttes.

Pour aller plus loin :
Anne Clerval, Paris sans le peuple, éd. La Découverte, 2013.
Eric Hazan, L’invention de Paris, éd. Seuil, 2002.
Eric Hazan, Paris sous tension, éd. La Fabrique, 2011.
Eric Hazan, La dynamique de la révolte, éd. La Fabrique, 2015.
Alain Rustenholz, De la banlieue rouge au Grand Paris, éd. La Fabrique, 2015.
Chris Ealham, Barcelone contre ses habitants. 1835-1937, quartiers ouvriers de la révolution, éd. CMDE, Collectif des métiers de l’édition, 2014.
Maurizio Gribaudi, Paris ville ouvrière. Une histoire occultée (1789-1848), éd. La Découverte, 2014.
Sylvie Fol, Yoan Miot et Cécile Vignal (dir.), Mobilités résidentielles, territoires et politiques publiques, éd. PU du Septentrion, 2014.
Jean-Paul Clébert, Paris Insolite, éd. Attila, 2009.
Louis Chevalier, L’assassinat de Paris, éd. Ivréa, 1997.


by jefklak | 04 mai 2015 | Contrôle continu, Marabout
Traduction par Émilien Bernard
(Avec le concours de Grégoire Chamayou)
L’usage devenu banal des drones sur les champs de bataille en transforme la géographie. La guerre n’a plus de lieu spécifique, et ne répond presque plus à la définition classique. C’est dans des zones aux limites indéfinies qu’interviennent ces avions sans pilote, dirigés comme des jouets, par des humains à des milliers de kilomètres. Professeur de géographie à l’université de la Colombie-Britannique de Vancouver, Derek Gregory propose de repenser l’espace géopolitique à l’aune de ces nouvelles pratiques : aussi loin soit-il, le « pilote » du drone n’est finalement qu’à cinquante centimètres de la zone de conflit, matérialisée par son seul écran d’ordinateur. La guerre devient aussi intime que virtuelle. La cible n’est plus un ennemi indifférencié, mais un criminel connu, dont l’assassinat se joue des questionnements moraux, malgré les efforts des juristes de l’armée pour les légitimer.
Texte original : « Drone geographies », publié dans le numéro 183 de la revue anglaise Radical Philosophy (janvier/février 2014). Radical Philosophy est un magazine de philosophie féministe et socialiste créé en 1972, et paraissant tous les deux mois.
Ce texte est extrait de la partie hors thème du numéro 1 de Jef Klak, « Marabout », dont le thème est Croire/Pouvoir. Sa publication en ligne est la quatrième d’une série limitée (4/6) de textes issue de la version papier de Jef Klak, toujours disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF
L’an dernier, Apple a rejeté à trois reprises une application de Josh Begley intitulée « Drones+ ». Son principe ? Envoyer une notification en pushA à l’utilisateur dès que tombait la nouvelle d’une frappe de drone américain. Apple a considéré que beaucoup pourraient trouver l’application « contestable » (la marque n’a en revanche rien dit de ce que les utilisateurs pourraient penser de ces frappes). Alors qu’il défendait sa thèse devant l’université de New York plus tôt cette année, Begley s’est interrogé : « Souhaitons-nous être autant connectés à notre politique étrangère qu’à nos smartphones ? […] Voulons-nous que ces objets soient le lien par lequel nous expérimentons la guerre télécommandée ? » Ce sont de bonnes questions, et Apple y a répondu de manière tranchée. Plusieurs artistes ont eu recours aux plates-formes numériques pour mettre en lumière les lieux où s’exerce la violence à distance – je pense en particulier à Dronestream du même Begley et à Dronestagram de James Bridle, mais il y en a de nombreux autres. Leur travail m’a poussé à réfléchir aux multiples et complexes cadres géographiques au sein desquels s’inscrivent ces opérations. Dans cet article, je me focaliserai sur quatre d’entre eux.
Mon approche est à la fois resserrée et globale. Elle est resserrée parce que j’aborde uniquement l’utilisation des drones de type Predator et Reaper par l’US Air Force en Afghanistan et en Irak (parfois en tant que bras armé du JSOC – Joint Special Operation CommandB), ainsi que leur implication dans des assassinats ciblés sous l’égide de la CIA au Pakistan, au Yémen et en Somalie. D’autres corps d’armée de pointe usent également de drones, balistiques ou dédiés à l’Istar (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & ReconnaissanceC), en tant qu’entités agissantes d’une violence militaire organisée en réseau, mais il est encore plus difficile de détailler leurs opérations. L’US Army et les Marines ont ainsi recours à des drones, mais la plupart sont de petite taille et leur champ d’intervention se limite à des tâches de surveillance et de reconnaissance pour le combat rapproché et les attaques terrestres.
Cependant, malgré ces limitations, mon propos se veut global, parce que je souhaite mettre au jour la matrice de violence militaire que ces plates-formes à distance contribuent à activer. Nombre des réponses critiques aux drones sont excessivement focalisées sur l’aspect technique (ou techno-culturel) de cet objet – le drone – et ignorent pratiquement ses dispositifs et évolutions plus larges. Cette tendance relève à mes yeux d’une erreur autant analytique que politique.

Insécurités intérieures
Le premier cadre géographique que j’aborderai se trouve au cœur des États-Unis, où sont dirigées ces opérations à distance que l’US Air Force décrit comme le fait de « projeter du pouvoir sans projeter de vulnérabilité ». Bien sûr, les Predators et Reapers sont stationnés dans les zones de conflit, ou à proximité. C’est également le cas des « équipes de lancement et de récupération » qui assurent les décollages et les atterrissages de ces engins via des liaisons diffusées en ondes courtes sur la bande CD. Étant donné les problèmes techniques qui accablent ces « appareils volants imprévisibles » – pour reprendre l’expression de Jordan Crandall –, il faut aussi conserver des équipes de maintenance fournies sur le théâtre d’opérations pour l’entretien des aéronefs.
Dès lors qu’il est en l’air, cependant, le contrôle du drone est généralement confié à des équipes de vol stationnées sur le territoire terrestre des États-Unis via un satellite à bande kuE, relié à une station terrestre de la base aérienne allemande de Ramstein et un câble à fibre optique traversant l’Atlantique. Le réseau inclut également des officiers supérieurs et des juristes militaires, qui supervisent les opérations depuis l’US Central Command’s Combined Operation Center de la base aérienne d’Al Udeid au Qatar. Enfin, des spécialistes en analyse de l’image liés à l’Air Force’s Distributed Common Ground System scrutent minutieusement l’intégralité des vidéos enregistrées par les engins volants. Considérés dans leur ensemble, les quatre avions qui constituent une Patrouille aérienne de combat capable de fournir une couverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 mobilisent 192 personnes, la majorité d’entre elles (133) étant situées hors de la zone de combat et de tout danger immédiat.
On court ici le risque de glisser de la forme « guerre » vers une forme de politique de la vengeance, évolution impliquant virtuellement que tous les risques sont transférés sur les habitants des pays étrangers. Les populations vivant dans les zones exposées à des attaques taxent fréquemment les frappes par drones d’actes lâches, mais le fait que la majorité de ceux qui contrôlent ces missions en réseau ne mettent pas leur vie en danger a également provoqué divers débats aux États-Unis sur l’éthique militaire et le code d’honneur. Les critiques ont invoqué le principe de la réciprocité des risques, c’est-à-dire ce que Clausewitz avait décrit comme la force morale impliquée dans toute guerre : pour tuer dans l’honneur, le soldat doit être prêt à mourir. Aujourd’hui, le combattant à distance reste le vecteur de la violence, mais il n’est plus sa victime potentielle.
Des voix critiques ont ainsi ridiculisé les équipages de drones en les qualifiant de « guerriers en cabine », menant la guerre comme on se rend au bureau. Les engins volants sans pilotes peuvent effectuer des vols d’au moins dix-huit heures – certains ont réalisé des vols de plus de quarante heures – et cela requiert un personnel capable de travailler par tranches de dix ou douze heures, alternant entre leur foyer et le travail. Nombre d’entre eux ont déclaré que cette répartition leur posait des difficultés considérables.
Comme c’était déjà le cas dans les guerres précédentes, les équipages d’avions conventionnels sont d’abord déployés dans des lieux éloignés du conflit. Lorsqu’ils retournent à leurs bases à la fin d’une mission, ils restent cantonnés au sein d’un espace militaire qui leur permet de rester fixés sur l’objectif et de sauvegarder leur « intégrité psychique ». C’est également le cas pour les équipages de lancement et de récupération. Mais c’est beaucoup plus compliqué pour ceux qui travaillent dans des unités dédiées aux Predators et aux Reapers, stationnées aux États-Unis. L’un d’eux a ainsi résumé le problème en expliquant qu’ils « font le trajet jusqu’à leur travail aux heures de pointe, se glissent sur un siège situé en face d’une rangée d’écrans, dirigent un engin de guerre aéroporté en vue de lancer des missiles sur un ennemi situé à des milliers de kilomètres, avant de récupérer les gosses à l’école sur le chemin du retour ou d’acheter une brique de lait à l’épicerie du coin et de rentrer chez eux pour le dîner. » Il décrivait cette situation comme « une existence schizophrénique, répartie en deux mondes ». La pancarte à l’entrée de la base aérienne de Creech annonce « Vous entrez sur le CENTCOM AOR [Aire d’OpéRation] », mais « On aurait tout aussi bien pu écrire “Vous entrez sur le territoire d’Alice au pays des merveilles et de Lewis Caroll’’, vu la manière dont mes deux mondes restaient étrangers l’un à l’autre ». « La chose la plus étrange à mes yeux , a expliqué un pilote, est de se lever le matin, de conduire mes enfants à l’école puis de tuer des gens. » Un autre confirme qu’il existe « une déconnexion particulière liée au fait de livrer une guerre par écran interposé, depuis un fauteuil rembourré, dans une banlieue américaine », avant de rentrer chez lui, « toujours tout seul avec ses pensées et le poids de ce qu’il avait fait ».
Les combattants à distance sont peut-être plus vulnérables à cette forme de stress et d’instabilité post-traumatiques – le résultat moins de ce qu’ils ont vu que de ce qu’ils ont fait, même si les deux sont évidemment liés. Cet état est sans doute aggravé par les perpétuels allers-retours entre les deux mondes.
Dans Grounded, pièce de théâtre de George Brant, une pilote décrit sa difficulté à maintenir la séparation nécessaire pour décompresser ; progressivement, et de manière de plus en plus marquée, l’un des deux espaces a tendance à se fixer en surimpression sur l’autre ; l’organe précis et fixe (semblable au regard de la Gorgone) se voit remplacé par une vision brouillée et elle finit par ne plus savoir où (ni qui) elle est. Les deux mondes commencent à n’en faire qu’un : le désert emprunté lors de ses trajets de retour nocturne de Creech ressemble désormais aux paysages désertiques, grisés, d’Afghanistan, tandis que le visage d’une enfant sur son écran, la fille d’une cible prioritaire, se transforme en celui de son propre enfant. La mise en scène de Brant est d’autant plus marquante que l’attention du public a habilement été distraite, de manière à ce qu’il ne comprenne pas tout de suite cette évidence : lui aussi est contrôlé à distance, « télécommandé ».
Quand des voix critiques s’élèvent pour dénoncer les frappes de drones dirigées par la CIA au Pakistan ou ailleurs, qu’elles demandent à en connaître les fondements juridiques ainsi que les règles et procédures suivies, elles détournent l’attention publique du Waziristan vers Washington. Madiha Tahir a dénoncé le fonctionnement de ce qu’elle nomme « la performance théâtrale de fausse confidentialité » de l’administration Obama concernant ses guerres de drone dans les « Régions tribales fédéralement administrées du Pakistan », performance qui permet de focaliser l’opinion sur le spectacle de la politique américaine plutôt que vers les corps des Pakistanais gisant au sol.
Par l’intermédiaire de ce spectacle de foire atrocement efficace, Obama et son armée d’aboyeurs et de bonimenteurs (des porte-parole parlant « sous couvert de l’anonymat » parce qu’ils ne sont « pas autorisés à parler officiellement » ainsi que des baratineurs servant de façade officielle, comme Harold Kohn et John Brennan) ne mettent pas seulement en scène un secret erroné, mais également son opposé : une fausse intimité par laquelle le débat public se focalise sur la transparence et la responsabilité, comme si c’était le seul domaine qui importait. Au vrai, explique Tahir, « quand vous demandez aux personnes qui vivent sous la menace des drones ce qu’eux voudraient, ils ne répondent pas “la transparence et la responsabilité”. Ils disent qu’ils veulent la fin des tueries. Ils veulent cesser de mourir. Cesser de se rendre aux funérailles – et d’être bombardés même quand ils pleurent leurs morts. La transparence et la responsabilité sont pour eux des problèmes abstraits qui n’ont pas grand-chose à voir avec la réalité concrète de ces crimes réguliers et systématiques ».

À distance
La deuxième série de cadres géographiques que j’aimerais étudier a trait aux étranges connexions qui permettent ces opérations. Tuer d’une distance toujours plus grande est un leitmotiv dans l’histoire de la guerre. L’aviateur américain Charles Lindbergh voyait cette caractéristique comme la plus représentative des guerres modernes, celles où « quelqu’un tue à distance, mais ne le réalise pas en le faisant ». Loin de se représenter « les corps mutilés et agonisants » sur la terre ferme, écrivait-il en 1944, l’aviateur se sent davantage extérieur, comme s’il « voyait la scène se dérouler sur l’écran d’un cinéma, dans un théâtre situé à l’autre bout du monde ». Nombre de commentateurs ont affirmé que la prophétie de Lindbergh s’était réalisée – et radicalisée – dans la guerre des drones contemporaine.
Il est certain que l’on tue désormais d’une distance toujours plus grande et que le meurtre n’est plus seulement projeté sur un écran, mais également exécuté par son intermédiaire. De nombreux critiques insistent sur le fait que l’indifférence s’accroît avec la distance, même si le processus n’est pas aussi automatique que beaucoup le croient. Dans ses Lettres sur les aveugles (1749), Denis Diderot demandait : « Nous-mêmes, ne cessons-nous pas de compatir lorsque la distance ou la petitesse des objets produit le même effet sur nous que la privation de la vue sur les aveugles ? » Sa question résonne à travers l’histoire plus tardive du bombardement. Un Commandant de bombardier de la RAF, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, parlait à n’en pas douter au nom d’innombrables camarades quand il admit que « ces lumières scintillantes sur un arrière-fond de velours n’étaient en rien des gens pour moi, juste des cibles. Ce sont la distance et l’absence de visibilité qui vous permet de faire ces choses ». La différence aujourd’hui ? Les retours vidéo filmés par les drones compensent ce manque de visibilité. Or les critiques insistent sur le fait que l’impression de détachement n’est pas seulement conservée par l’écran lui-même, mais également aggravée par lui. L’écran ramènerait la violence militaire au statut de jeu vidéo et inculquerait une « mentalité PlayStation » à ceux qui la perpètrent.
Le sujet est cependant considérablement plus compliqué qu’on pourrait le penser. Les jeux vidéo contemporains sont hautement immersifs, et les vidéos en haute résolution fournies par les drones permettent aux équipages de rétorquer qu’ils ne sont pas situés à des milliers de kilomètres des zones de guerre, mais plutôt à cinquante centimètres : la distance entre l’œil et l’écran. La sensation de proximité visuelle est aussi palpable que convaincante. En outre, les équipes sont souvent chargées de traquer une personne pendant des semaines entières, voire des mois : « On les voit en train de jouer avec leurs chiens ou de faire leur lessive. On connaît leurs habitudes comme on connaît celles de nos voisins. On se rend même à leurs enterrements. » Voilà pourquoi ce même officier suggère que « d’une certaine manière, la guerre est devenue intime ». Un autre insiste sur le fait que lui et ses collègues « comprennent que les existences aperçues sur l’écran sont aussi réelles que les nôtres ». Le journaliste Mark Bowden fait écho à ces sentiments. « Les pilotes de drone deviennent intimes avec leurs victimes », écrit-il, ajoutant qu’ils les observent dans « leur vie au quotidien, auprès de leurs femmes et de leurs amis, de leurs enfants ». Ce qu’il désigne comme « la clarté éblouissante de l’image offerte par l’optique des drones » implique que « la guerre télécommandée se révèle chargée d’intimité ».
Cette « course à l’intime » est devenue de plus en plus déterminante dans de nombreuses opérations militaires. Elle se révèle ici – comme partout ailleurs – violemment intrusive et chargée de questions en suspens. Et les conditions dans lesquelles elle se déroule sont révélatrices. Premièrement, les équipages peuvent voir sans être vus. Comme l’explique Grégoire Chamayou dans Théorie du drone (éd. La Fabrique, 2013) : « Le fait que le tueur et sa victime ne soient pas inscrits dans des “champs perceptifs réciproques” facilite l’administration de la violence. » La séparation physique entre un acte et ses conséquences est grandement accentuée dans les opérations à distances. Un état de fait aggravé par la répartition des rôles dans la chaîne de commandement : des officiers supérieurs, des juristes militaires, des spécialistes de l’image et des commandants de l’armée de terre étudient avec attention les retours vidéo des Predators et des Reapers. Cela contribue à répartir le « personnel » d’une telle manière que, pour beaucoup de membres de l’équipe, l’acte en question en devient également plus impersonnel. La technologie nous « hypnotise », explique le reporter Mark Benjamin, mais « elle rend également le fait de tuer un autre être humain sinistrement impersonnel ».
Les enregistrements vidéo mettent en scène ce qu’Harun Farocki désigne sous le terme d’« images opérationnelles », « qui ne représentent pas un objet, mais font partie d’une opération ». Le caractère « impersonnel » de l’opération n’est pas uniquement fonction de la technologie : ce qui importe est justement son incorporation au sein d’un processus – une procédure opérationnelle standard – et d’une chaîne de commande qui est à la fois techno-scientifique et quasi juridique. Cette alliance est cruciale. Eyal Weizman note que les programmes utilisés pour estimer les dommages collatéraux activent une forme d’instrumentalisation calculée, qui fonctionne non seulement pour améliorer les opérations en question, mais également pour les justifier. En résumé : « La violence légifère. » Le meurtre est conduit sous la bannière de la Raison militaire, qui investit le processus avec un détachement expressément conçu pour minimiser les réponses émotionnelles. Le tout est composé d’une économie visuelle intrinsèque qui imprègne l’opération d’une signification particulièrement tronquée. Ainsi que l’observe Nasser Hussain, le son modèle l’image, et dans le cas de l’assassinat à distance, « l’absence de son synchronisé transforme l’image en un monde fantôme, dans lequel les figures semblent dénuées de vie, même avant qu’elles ne soient tuées. Le regard oscille en silence. Le détachement que craignent les critiques du drone provient en partie du silence associé aux séquences ».
Il faut aux membres des équipes entre six et douze mois pour absorber les connaissances techniques nécessaires aux opérations menées à distance. « Tu te mets chaque jour un peu plus dans la position où tu considères que c’est la vraie vie, que tu y es vraiment », a expliqué un opérateur de capteurs à Omer Fast. Mais, continuait-il, « tu deviens dans le même temps de plus en plus distant émotionnellement ». Autre citation parlante, celle de cet officier qui plus haut évoquait la guerre en expliquant qu’elle devenait plus « intime » : « Je ne décrirais jamais cela comme une connexion émotionnelle, mais plutôt comme une forme […] de sérieux. J’ai observé cet individu, et, quel que soit le nombre d’enfants qu’il ait, quelle que soit la proximité de sa femme […], ma mission est de l’abattre. Le caractère dramatique de ce geste est évident : je vais faire ce geste et cela va affecter sa famille. »
Cette forme d’intimité envahissante et intrusive – Matthew Power la désigne comme une « intimité voyeuriste » – ne favorise pas l’identification à ceux dont les existences sont sous surveillance. Ils restent obstinément autres, position qui ressort parfaitement du témoignage d’une femme pilote expliquant qu’« elle ne voulait pas être comme ces femmes afghanes qu’elle observait – soumises et voilées de la tête aux pieds ». Ce sentiment d’altérité n’est pas que le produit d’une séparation culturelle ; il découle également d’une herméneutique techno-culturelle de la suspicion. Quand les équipes manœuvrant des drones sont appelées en renfort pour fournir un appui aérien rapproché aux troupes terrestres, leur géographie sensorielle se diversifie parce qu’ils ne sont plus seulement immergés dans des retours vidéo, mais également dans un flux de communications radio et de messages en réseau avec les troupes de terrain via mIRC F. Ce faisant, elles sont insérées dans ce que le Colonel Kent McDonald de l’École médicale d’aérospatiale de l’US Air Force décrit comme une « relation virtuelle » avec les soldats terrestres. Cette relation ne peut exister pour les « autres », qui restent définis uniquement par leur signature optique (une dépersonnalisation que les soldats américains ne connaissent jamais, sauf accidentG). Malgré des limites évidentes, cette interaction entre équipes de drones et équipes terrestres constitue une relation fondée sur la réciprocité et dont les « autres » sont complètement exclus. Un officier dépeignait ceci en ces termes : « Ceux qui utilisent ce système sont très impliqués personnellement dans le combat. Vous entendez les rafales d’AK 47 et l’intensité des voix appelant à l’aide sur la radio. Vous regardez cette personne, vous êtes à 50 cm d’elle, et vous utilisez tous les moyens à votre portée pour la sortir de ses ennuis. »
« L’intimité » est par conséquent développée dans un champ culturel divisé (une autre forme de rupture induite par le contrôle à distance) dans lequel les équipages sont tellement appelés à s’identifier à leurs camarades de combat qu’ils sont prédisposés à interpréter toute autre action (soit : toute action d’un « autre ») comme hostile ou dangereuse. Cela a parfois des conséquences désastreuses pour des innocents. Peu importe que les investigations militaires portant sur des dommages collatéraux évoquent souvent « l’erreur humaine plutôt que les dysfonctionnements de la machine » – ce qui est relativement vrai, et soulève d’autres questions éthiques –, car les erreurs de ce type sont avant tout produites par la fonction opérationnelle d’un système techno-culturel dont les dispositions favorisent de telles issues.
« Si les individus utilisent des instruments technologiques, explique Judith Butler, l’inverse est également vrai : ces instruments utilisent eux-mêmes les individus (ils les positionnent, leur fournissent des perspectives, établissent les trajectoires de leurs actions) ; ils encadrent et forment tous ceux qui entrent dans leur champ visuel ou sonore, mais aussi, réciproquement, ceux qui n’en font pas partie. »
Ce n’est pas le cas des situations d’appui aérien de proximité, mais quand les équipages sont impliqués dans des missions d’assassinats ciblés, elles œuvrent main dans la main avec la Joint Prioritized Effects ListH de l’armée (ou, dans le cas d’attaques aériennes dirigées par la CIA, dans la « Disposition MatrixI » approuvée par le Centre de Contre-terrorisme), des dispositifs desquels la présomption d’innocence a déjà été évacuée. La description que fait Martin de la nouvelle norme en matière de ciblage est révélatrice : « Je doute que les pilotes et équipages de B-17 ou de B-29 se tracassaient autant en lâchant des tonnes de bombes sur Dresde ou Berlin que moi lorsque j’ai dû supprimer un criminel roulant en voiture », explique-t-il en évoquant l’assassinat d’une cible connue sous le nom de « Rocket Man », à Sadr City. L’équipage chargé de cette mission avait beaucoup délibéré : « Nous devions nous montrer prudents en réalisant un tir dans cet environnement, pour éviter la mort d’une poignée de personnes qui ne méritaient pas nécessairement d’être tuées. »
Le recours décontracté à un langage vernaculaire du maintien de l’ordre – « On a dégommé le criminel ! » – n’a rien d’exceptionnel. Il est intégré au dispositif administratif qui autorise l’assassinat ciblé et relève du processus plus général de judiciarisation de la « kill chain ». Les juristes militaires insistent sur l’importance de récolter ce qu’ils désignent comme une « chaine de garde à vue optique » tout au long de « la poursuite de la cible ». Ce sont des juristes du ministère de la Défense, pas des avocats de la défense, et leurs formulations font évidemment peser la balance au détriment de ceux qui sont pris dans le champ des opérations militaires.

Espace de la cible, espace du corps
Ces considérations recoupent une troisième sorte de géographie qui se développe en rapport avec l’assassinat ciblé. Ce dernier, je dois insister sur ce point, n’est pas la seule fonction remplie par les drones. Et cette tâche n’est d’ailleurs pas non plus leur apanage, ainsi que des dissidents russes et des scientifiques iraniens l’ont appris à leurs dépens – à Londres pour les premiers, à Téhéran pour les seconds. Néanmoins, de nombreux commentateurs ont insisté sur le fait que l’utilisation de drones, particulièrement en matière de frappes ciblées, menaçait de transformer le lieu et la signification de la guerre elle-même.
Le terme « champ de bataille » renvoie autant à un espace physique qu’à un espace normatif. Sa déconstruction physique s’est accélérée depuis au moins la Première Guerre mondiale, quand le recours au bombardement a redessiné les contours de la mise à mort d’une manière si dramatique que Giulio Douhet a pu déclarer qu’à l’avenir « l’espace du champ de bataille ne sera plus limité que par les frontières des pays en guerre, tandis que tous leurs citoyens deviendront combattants, puisque chacun d’entre eux sera exposé aux offensives aériennes de l’ennemi. Il n’y aura plus de distinction entre soldats et civils ».
Les drones ont désormais dissous ces limites physiques. L’un des objectifs centraux en matière de politique étrangère de l’administration Bush, qui a animé ses successeurs avec une férocité tout aussi marquée, était de mener « des conflits dans des pays avec qui nous ne sommes pas en guerre ». Les drones ont ainsi transgressé de façon répétée et routinière ces frontières en matière de pays belligérants, assignés qu’ils étaient à la poursuite de missions transnationales de chasseurs-tueurs – tout particulièrement dans le cadre de la guerre « secrète » au Pakistan.
Cependant, en un contraste marqué avec les pronostics lugubres de Douhet concernant la reconfiguration de l’espace normatif de la guerre – qui ont été tristement confirmés par chaque campagne de bombardement stratégique depuis la Première Guerre mondiale –, les drones auraient également renforcé le principe de bonne distinction des cibles. Leurs promoteurs affirment que leur présence sur la durée et leurs capacités améliorées de surveillance garantissent un respect sans précédent des obligations en matière de droit humanitaire international concernant la distinction entre combattants et civils. Ce débat recoupe forcément deux champs, l’un fondé sur les faits – le nombre de morts et de blessés – l’autre sur l’aspect sémantique, ce dernier interrogeant les frontières entre combattant et civil dans un cadre de guerre irrégulière. Mais il est également sous-tendu par une problématique normative, et même par un « nomos » – quelque chose approchant du sentiment d’agencement spatial proposé par Carl SchmittJ. La raison en est qu’au cœur même de la réponse américaine au 11-Septembre reposait ce que Frédéric Mégret voit comme « une tentative délibérée de manipuler ce qui constitue le champ de bataille et de le transcender dans des évolutions qui libèrent la violence plus qu’elles ne la contraignent ». Cela conduit au projet concerté de transformer l’un des principaux registres de l’imaginaire de la guerre, avec l’accent mis sur l’individualisation de la mise à mort.
Pratiquement et théoriquement, l’individualisation aseptise le champ de bataille : l’opinion publique n’est plus confrontée aux images de destruction à grande échelle provoquée par le bombardement de villes entières ou par celles de tapis de bombes s’abattant sur des villages en pleine forêt tropicale. « Rien à voir avec Dresde », m’a-t-on répété inlassablement, comme s’il s’agissait du standard approprié pour juger de la conduite contemporaine d’une guerre. Ces frappes contre des individus sont des ponctuations au sein de ce que Jeremy Scahill nomme des « guerres sales », lesquelles « libèrent la violence » et menacent de transformer la terre entière en champ de bataille.
Dans les guerres conventionnelles, les combattants sont autorisés à tuer sur le fondement de ce que Paul Kahn désigne comme leur identité corporative : « Le combattant ne porte pas la responsabilité individuelle de ses actions, parce que ses actes ne sont pas plus les siens que les nôtres. […] La guerre est un conflit entre des sujets appartenant à une corporation et inaccessibles à la notion ordinaire de responsabilité individuelle, plutôt qu’entre soldats ou officiers. »
L’ennemi peut être tué, quel que soit ce qu’il ou elle est en train de faire (excepté s’il se rend). Juridiquement, il n’y a pas de différence entre le fait de tuer un général ou de tuer son chauffeur, entre lancer un missile sur une batterie qui menace votre engin volant où lâcher une bombe sur un baraquement en pleine nuit. « L’ennemi est toujours dénué de visage, explique Kahn, parce que nous n’attachons pas plus d’importance à son histoire personnelle qu’à ses espoirs pour le futur. » Les combattants sont par conséquent vulnérables à la violence non seulement parce qu’ils sont ses vecteurs, mais également parce qu’ils sont enrôlés dans le mécanisme qui l’autorise : ils sont tués non pas en tant qu’individus, mais en tant que porteurs contingents (parce que temporaires) d’une corporation supposée hostile.
Mais désormais, dans la mesure où la force militaire est dirigée contre des individus spécifiques sur la base d’actes déterminés qu’ils ont commis ou, par extension préventive, sont susceptibles de commettre, apparaît une subjectivité politique différente, dans laquelle l’ennemi se voit transformé en criminel. « Le criminel est toujours un individu, écrit Kahn, ce n’est pas le cas de l’ennemi ».
Cet état de fait présente au moins quatre implications en matière de géographie de la violence militaire. Premièrement, l’individualisation transforme les contours du renseignement. À tel point que Peter Scheer suggère que « la logique de la guerre et celle du renseignement ont permuté, l’une devenant l’image en miroir de l’autre ». Tandis que le ciblage s’est focalisé sur les individus, la collecte de renseignements s’est transformée en exploitation de bases de données et en interception de ces mêmes données à une échelle planétaire. Il est naturellement difficile de relier ces points de manière détaillée, mais les intrusions planétaires de la National Security Agency (NSA) ont été largement documentées par Glenn Greenwald, qui a utilisé des informations classifiées fournies par un ancien contractuel de la NSA, Edward Snowden.
Bien que l’on n’ait accès qu’à un instantané grossier des capacités de ses Opérations de collecte globale, « Boundless InformantK » constitue une couverture de haute volée mise en place pour une multitude de systèmes interconnectés. Pris dans leur ensemble, ces documents cartographient une dimension fondamentale de la guerre sans frontières. Le Pakistan s’affirme ainsi comme l’une des cibles principales de la surveillance secrète, tandis qu’Hassan Ghul, chef des opérations militaires d’Al Qaeda a été une Cible prioritaire particulièrement suivie. Une série de communications interceptées ont fourni à la Counter Terrorism Mission Aligned Cell (CT-MAC) de la NSA un « vecteur » des codes utilisés par Ghul tandis qu’il gravitait dans les environs des Régions tribales fédéralement administrées du Pakistan (il passait en fait d’une maison sécurisée à une autre). Finalement, on intercepta un e-mail de sa femme qui contenait suffisamment d’informations pour établir les coordonnées précises nécessaires à une frappe de drone. Elle se déroula près de Mir Ali, dans le Waziristan du Nord, et le tua, ainsi que deux de ses compagnons le 1er octobre 2012. Dans ce cas précis, et sûrement dans beaucoup d’autres, l’espace de l’individu pris comme cible est un bon exemple de ce que Rob Kitchin et Martin Dodge nomment « espace/code », un espace produit et activé par un logiciel et qui, dans sa spatialité, est « à la fois local et global, situé en un lieu précis, mais accessible de n’importe quel endroit via le réseau ».
Deuxièmement, l’individualisation implique un ensemble de techniques juridiques chargées d’identifier positivement, détecter et traiter l’individu-cible – ce qui élargit le champ d’action juridique de la violence militaire : « Dans la mesure où quelqu’un peut être ciblé en vue de l’usage de la force militaire (capture, détention, assassinat) uniquement en raison des actes précis et spécifiques auxquels il ou elle a participé, la violence militaire se rapproche de plus en plus aujourd’hui d’une “judiciarisation” implicite de la responsabilité individuelle. »
La distinction traditionnelle entre les opérations militaires et celles relevant de la police, les unes étant tournées vers « l’extérieur » et les autres vers « l’intérieur », s’était déjà trouvée bousculée, notamment par l’utilisation de l’expression fourre-tout « Forces de sécurité ». Elle est aujourd’hui rendue encore plus perméable par ce que Chamayou désigne comme une « doctrine étatique de violence non-conventionnelle », combinant des éléments relevant aussi bien des opérations militaires que des opérations policières, sans réellement s’inscrire précisément dans l’un de ces champs : « des opérations hybrides, enfants terribles de la police et de l’armée, de la guerre et de la chasse. » Ces nouveaux vecteurs de la violence étatique traversent les frontières dans les deux sens, aussi bien vers l’intérieur que vers l’extérieur. Dans la vision horrifiée qu’en donne Kahn, ils incarnent « le pouvoir politique considéré comme une administration de la mort ». Ne correspondant ni à l’état de guerre ni au maintien de l’ordre, « cette nouvelle forme de violence », conclut-il, « doit être vue comme la forme high-tech d’un régime de disparition ».
Troisièmement, l’individualisation renvoie à la production technique d’un individu sous la forme d’un objet à cibler, loin des bouffées d’humanité qui jaillissent brièvement sur les écrans vidéos des Predators. La personne est appréhendée via une image sur écran, une trace sur un réseau et une signature sur un capteur. L’individu-cible qui en résulte est à la fois artificiel et compressé. Les « cibles prioritaires » sont nommées et font l’objet de « frappes de personnalité » (même si en Afghanistan nombre d’entre elles n’étaient en fait que des individus liés de manière plus ou moins marquée aux combattants aguerris des talibans ou d’Al Qaeda), mais la plupart des mises à mort ciblées sont dirigées contre des sujets anonymes (« sans visage »). Ils sont introduits dans le champ de vision militaire par une rythmanalyse L et une étude des réseaux qui font apparaître des éléments dénotant un « schéma de vie » suspect, une sorte de balistique de l’espace-temps, dont les méthodes d’exécution ont été parfaitement disséquées par Joseph Pugliese : « Le terme militaire de “schéma de vie” est imprégné de deux systèmes entrelacés de compréhension scientifique : algorithmique et biologique. Dans le premier, le sujet humain détecté par les caméras de surveillance des drones est transformé via des algorithmes en une séquence de chiffres modélisée : des suites numériques de zéros et de uns. Converti en données numériques codées en tant que “schéma de vie”, le sujet humain ciblé est réduit à un simulacre anonyme qui tressaute sur l’écran et peut être efficacement liquidé via un “schéma de mort” déclenché par un joystick. Analysés à travers la vision scientifique de la biologie clinique, “les schémas de vie” connectent les technologies de surveillance des drones aux techniques d’une science instrumentaliste, à sa vision constitutive de détachement objectif et à sa production de violence exterminatrice. Les “schémas de vie” sont ce que l’on découvre et analyse dans les boîtes de Pétri d’un laboratoire. »
L’acte de tuer se voit considéré comme le point culminant de l’histoire naturelle de la destruction – dans un sens qui n’est précisément pas celui que pointait W.G. Sebald – et les cibles sont prises en compte « individuellement » dans un registre beaucoup plus comptable que corporel. Les autres victimes qui sont accessoirement tuées au cours d’une frappe restent la plupart du temps non identifiées par ceux qui sont responsables de leur mort : « dommages collatéraux » frappant des individus dont l’anonymat confirme qu’ils ne sont pas considérés comme tels, mais comme tributaires d’une punition collective.
Par le biais de cette focalisation sur une mise à mort unique – via une « frappe chirurgicale » –, les autres personnes affectées sont placées hors du tableau. Toute mort entraîne des effets qui dépassent largement la simple question de la victime concernée, mais ceux qui planifient et exécutent un meurtre ciblé ne sont concernés que par le sort du terroriste ou du réseau insurgé à laquelle la cible est supposée être attachée. Pourtant, ces opérations provoquent, de manière annexe, mais pas accidentelle, d’immenses dégâts dans le tissu social dont il ou elle faisait partie – sa famille étendue, la communauté locale, etc. La sensation de perte continue à hanter d’innombrables autres individus (qui ne sont jamais comptabilisés). Amnesty International a ainsi documenté une frappe qui s’est déroulée près du village de Ghundi Kala, dans le Waziristan du Nord, le 24 octobre 2012, incluant dans son étude une photographie annotée montrant la position de la famille de Mamana Bibi qui travaillait dans les champs avec elle quand elle fut tuée. Personne n’a expliqué pourquoi la grand-mère était visée, mais son fils, réconfortant les petits-enfants de Mamana traumatisés par ce qu’ils avaient vu cet après-midi ensoleillé, expliqua qu’« elle était le lien qui maintenait l’unité de notre famille. Depuis sa mort, le lien est coupé et la vie n’est plus la même. Nous nous sentons seuls et perdus ». L’attention des critiques s’est focalisée, de manière conséquente et compréhensible, sur la constitution de ce que Judith Butler nomme une « vie dont on peut porter le deuil », mais il semble tout aussi important de cerner ce qui constitue une « vie survivante ».
Il faut sans aucun doute nous interroger, avec Madiha Tahir, sur ce que ressent quelqu’un qui vit parmi les ruines, ce qu’il en coûte de faire face à un sentiment de perte qui est à la fois profondément personnel et irrémédiablement collectif. La même question a hanté l’histoire du bombardement pendant une centaine d’années, mais sa gravité n’est en rien atténuée par le fait que les Predators et Reapers ont remplacé les bombardiers Lancaster et les Forteresses volantes.
Quatrième point : l’individualisation implique que la guerre suive à la trace l’individu-cible. C’est une forme de ciblage dynamique poussé à l’extrême. La chasse à l’homme fonctionne sur les logiques de poursuite et d’évasion, explique Chamayou, de prédateur et de proie – l’un avance tandis que l’autre fuit. En Afghanistan et au Pakistan, cela a débouché sur une danse macabre* dans laquelle les insurgés traversent la frontière de l’Afghanistan au début de la saison des combats, au printemps, et font ensuite retraite dans leurs sanctuaires pakistanais à la fin de l’été. Mais l’espace militaire et paramilitaire n’est plus circonscrit par quelque champ de bataille que ce soit, ni par une zone de guerre limitée : le lieu de la frappe ciblée est défini par la présence fugitive de l’ennemi-proie. Il n’y a clairement plus d’alternatives. Les départements américains de contre-insurrection et de contre-terrorisme travaillent main dans la main à cet effet. Leurs opérations « kinétiques » mortelles déploient des drones pour des combats sur le front en Afghanistan et pour des frappes ciblées en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen, en Somalie et ailleurs. Mais il y a une distinction importante entre les deux. Kahn explique que la force létale peut légalement être tournée contre un ennemi en raison de son statut : c’est la logique de la guerre telle que supervisée par le droit international humanitaire (parfois appelé droit des conflits armés).
Mais la force létale ne peut être utilisée contre quelqu’un soupçonné d’être un criminel qu’après qu’il ait montré des « signes de dangerosité » : c’est la logique du maintien de l’ordre sous l’égide du droit international humanitaire. Les raisons juridiques invoquées par les Américains pour justifier leurs assassinats ciblés brouillent la frontière entre les deux. L’administration Obama insiste sur le fait que le droit international humanitaire donnerait le cadre opérationnel légal de son recours à la force létale dans ses campagnes de contre-insurrection et de contre-terrorisme, mais elle a également invoqué ce que ses experts juridiques ont désigné comme une « extension » du concept d’imminence, ceci afin d’étendre la poche temporelle au sein de laquelle des individus ciblés sont susceptibles de représenter une menace pour les États-Unis. Sa justification repose ainsi sur l’idée d’autodéfense. Cela renvoie à cette idée de sphère spatiale de l’assassinat ciblé, parce que l’affirmation des conflits armés transnationaux entre acteurs étatiques et non étatiques, en tant que modalité dominante de la guerre moderne récente, relocalise les assassinats sur un terrain juridiquement non balisé, dans lequel la cible se resserre sur le corps humain d’un individu tandis que le champ de la violence militaire tend à s’étirer jusqu’aux limites du globe.
Chamayou décrit ce phénomène comme une dialectique entre la spécification et la globalisation. « La zone de conflit armé, fragmentée en “kill-box’’ miniaturisables, tend idéalement à se réduire au seul corps de l’ennemi-proie – le corps comme champ de bataille. » Il ajoute : « C’est parce que nous pouvons viser nos cibles avec précision que nous pouvons, disent en substance les militaires et la CIA, les frapper où bon nous semble, et ce même en dehors de toute zone de guerre ». Cette perspective d’un terrain de chasse global produit et ponctué par des « zones mobiles d’exception » perturbe profondément la plupart des critiques.

Menaces globales
De telles considérations s’insèrent directement dans une quatrième et dernière série de cadres géographiques qui tracent les contours de ce que Ian Shaw appelle « un empire prédateur ». Un empire par lequel le monde deviendrait une « zone de tir à volonté », selon l’expression de Fred Kaplan. Les indices de cette évolution sautent aux yeux. En mars 2011, les Predators et Reapers de l’US Air Force ont réalisé un million d’heures de vol en zone de combat. En octobre 2013, ce chiffre avait déjà doublé. Le Pentagone a en outre pris la décision en janvier 2012 d’augmenter le nombre de drones armés de 30 % en vue de développer une capacité militaire « moins encombrante et plus agile ». Il a également chargé l’armée de l’air de constituer 65 patrouilles aériennes de combat d’ici 2014, avec une capacité à « monter » à 85. Les opérations à distance se sont également étendues de la base aérienne de Creech à plusieurs autres bases des États-Unis, tandis que les USA ont déployé des drones au sein de conflits et d’« opérations contingentes hors du continent » en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Mali, au Pakistan, en Somalie et au Yémen.
Or certaines précautions sont de mise. L’Empire Prédateur de Shaw évoque « les stratégies, pratiques et technologies gravitant autour du déploiement des drones chargés de frappes ciblées », mais uniquement pour réduire l’espace fonctionnel de leur usage à l’assassinat. Et pourtant, son livre étend également leur champ d’action : « Partout et nulle part, les drones sont devenus des outils souverains de vie et de mort », administrés via ce qu’il appelle « une géographie étendue des bases de drones ». Son index géographique est inspiré de celui de Nick Turse, dont l’article « l’empire secret des bases de drones » liste plus de soixante sites. Plus de la moitié d’entre eux sont situés à l’intérieur des États-Unis, bien loin de ce qu’il désigne comme les « joyaux extérieurs de la couronne » (dont certains me semblent davantage relever de la verroterie).
Peut-être que ce dernier point importe peu ; l’objectif des opérations à distance étant précisément de faire usage de la puissance depuis la « patrie ». Mais ces chasseurs-tueurs ont comparativement un rayon d’action limité – environ 1 250 kilomètres pour un Reaper et 1 850 pour un Predator –, si bien que leurs bases doivent être situées à proximité du théâtre des opérations. D’où leurs équipes de lancement et récupération déployées sur place. Le Pentagone s’est lancé dans diverses expérimentations conçues pour améliorer la flexibilité opérationnelle, notamment le lancement de drones depuis des avions-cargos, ou la conception de bases pour drones pliables dans des containers de cargos, ceci afin qu’elles puissent être déployées rapidement et que les engins volants puissent être lancés dans les quatre heures suivant leur arrivée.
Mais dans leurs formes présentes et dans un avenir proche, ces tentatives n’impliquent pas des armes à portée mondiale (les États-Unis ont déjà développé de terrifiantes aptitudes en la matière, et sont en train d’en développer d’autres, à l’image du Prompt Global Strike, qui sera capable d’effectuer une frappe de missile conventionnel partout dans le monde en moins d’une heure). Ces plates-formes commandées à distance sont également particulièrement limitées dans leurs aptitudes sur le terrain où elles pourraient être utilisées. Elles sont lentes – la vitesse de croisière d’un Predator est d’environ 135 km/h, celle d’un Reaper de 370 km/h – et loin d’être agiles, si bien qu’elles sont vulnérables aux attaques aériennes. Elles volent à des altitudes qui les mettent à portée des défenses anti-aériennes et ne peuvent donc opérer dans les espaces de combat A2/AD (accès interdit, zone non autorisée). En septembre 2013, le Général Mike Hostage, commandant de l’USAF Air Combat Command, les décrivait comme « inutiles dans un environnement hostile ». Même en tenant compte des conflits entre services portant des visions différentes de la puissance aérienne, ces limitations ne poussent pas à considérer les Predators et les Reapers en tant que positions avancées de l’Empire américain – même en tant qu’unités de substitution.
Il ne s’agit pas ici de contester la réalité palpable de l’impérialisme américain, dont l’empreinte militaire est apposée sur plus d’un millier de bases tout autour du monde. Ni de minimiser ses tentatives sans précédent d’établir un système de surveillance globale à trois niveaux incluant des drones non armés à l’image du Global Hawk. Mais son pouvoir militaire et sa capacité de violence militaire sans équivalent sont investis dans des projets plus ambitieux que les Predators et les Reapers.
Cela ne veut pas dire que nous pouvons fermer les yeux sur leur développement et leur déploiement. De nombreux autres pays ont déjà développé, ou sont en train de le faire, une expérience en matière de drones militaires ; la plupart de ces programmes touchent à des engins dépourvus d’armes, mais dans la mesure où ils peuvent être utilisés dans des guerres pour diriger, via leur réseau, des frappes aériennes conventionnelles, la distinction n’est pas si rassurante qu’elle peut sembler l’être. En outre, les coûts financiers d’une technologie telle que le drone tendent à se réduire, si bien que la perspective d’acteurs non étatiques utilisant les drones pour lancer des attaques devient de moins en moins improbable.
Ce qui est certain, c’est que le concept de « zone de tir à volonté » de Kaplan, qui réutilise l’un des slogans les plus effroyables de la guerre du Vietnam, semble pousser l’analyse trop loin. Ce que j’ai décrit comme « une guerre sans frontières » est également une guerre se déroulant quelque part. Quand les États-Unis font usage de drones armés pour exporter leur guerre hors des zones d’hostilité déclarées, ils visent immanquablement certaines des populations les plus vulnérables et dénuées de défense de la terre, lesquelles ont souvent vu leurs propres gouvernements se faire les complices de ces frappes mortelles. Dans ces régions, il n’y a pas de sirènes d’alerte aérienne, pas de défenses ou d’abris antiaériens ; et généralement des services médicaux d’urgence très limités et incapables de venir en aide aux innocents frappés.

Matières et matérialités
Mon propos porte sur un champ qui évolue rapidement. Toute une série d’usages pacifiques pour les drones non armés se développe à grande vitesse, et même ceux que j’ai évoqués ici se trouvent, à l’image d’autres systèmes militaires modernes, accolés à des séries de technologies civiles que la plupart d’entre nous considèrent comme des acquis. C’est en fait précisément de cette manière que les drones armés – leurs technologies, leurs représentations et dispositifs – sont devenus un pan à part entière de la vie quotidienne, qui exige de notre part une vigilance poussée. Ainsi que je le suggérais en commençant, ce sont souvent les artistes qui ont pris les devants dans la remise en cause de ces développements. James Bridle l’expliquait brillamment : « Nous vivons tous sous l’ombre du drone, même si la plupart d’entre nous ont la chance de ne pas vivre directement sous son feu. Mais l’attitude qu’ils représentent – celle de la technologie utilisée de manière dissimulée et violente ; du brouillage de la morale et de la culpabilité ; de l’illusion de l’omniscience et de l’omnipotence ; de la valeur toujours plus réduite accordée à la vie des autres ; de, pour le dire franchement, la guerre perpétuelle – devrait tous nous concerner. »
C’est à ce niveau, également, que la « fracture télécommandée » qui caractérise ces opérations est la plus insidieuse. Le débat public aux États-Unis s’est focalisé sur la question du rôle du président dans l’autorisation de l’assassinat de citoyens américains et sur la menace que fait peser la surveillance des drones sur la vie privée. Même ceux qui enquêtent sur la machinerie juridico-administrative via laquelle l’administration Obama conduit ses assassinats ciblés concentrent leurs critiques sur Washington. Tandis que ceux qui interrogent la pratique des opérations à distance évoquent uniquement les bases aériennes situées sur le territoire des États-Unis.
Ce sont des sujets importants, mais nous devrions nous sentir tout autant concernés par la manière dont les drones ont transformé le lieu de vie d’autres personnes en zone mortuaire. Je comprends tout à fait les vives critiques de Roger Stahl concernant la fascination des médias envers les pilotes de drones et la manière dont ils domestiquent habilement la guerre. Les médias réécrivent ainsi la logique de la sécurité nationale et invitent le lecteur-spectateur à se transporter aisément « de la cuisine au cockpit ». Mais l’interpénétration de la guerre et de la paix ouvrent un champ géographique encore plus large. Voici ce que déclarait le photoreporter Noor Behram, qui a passé des années à courageusement documenter les effets des frappes de drones sur son Waziristan du Nord natal : « C’était un jour comme les autres dans le Waziristan. Sortir de la maison, remarquer un drone dans le ciel, continuer à mener ta vie sans savoir s’il va te cibler. Ce jour-là, cela s’est passé dans la matinée, alors que j’étais chez moi en train de jouer avec mes enfants. J’ai remarqué le drone et j’ai commencé à le filmer avec ma caméra. Puis je l’ai suivi… »
Il faut se munir d’un objectif grand-angle pour saisir les géographies que j’ai mises en exergue dans ce texte. Les drones ont indubitablement fait évoluer la conduite de la guerre contemporaine – et dans le cas des assassinats ciblés, ils ont radicalement transformé l’idée même de conflit armé. Mais leur usage ne peut être dissocié de la matrice de violence militaire et paramilitaire dont ils font intégralement partie. Et c’est cette matrice qui devrait être la cible principale de l’analyse critique et de l’action politique.
Illustrations : James Bridle / Drone Shadows :
Short Term Memory Loss
Pour aller plus loin :
Le site de Derek Gregory : Geographical Imaginations.
Sur Jef Klak : Mortels algorithmes. Du code pénal au code létal, par Susan Schuppli. Traduit de l’anglais par Lucie Gerber, paru dans la revue Radical Philosophy 187 (sept/oct 2014).
Sur Article 11 : « À jouer la guéguerre des machines, nous serons toujours perdants ». Entretien croisé avec Grégoire Chamayou et Thomas Hippler. Propos recueillis par Ferdinand Cazalis.
Théorie du drone, Grégoire Chamayou, éd. La Fabrique, 2013, en librairie.

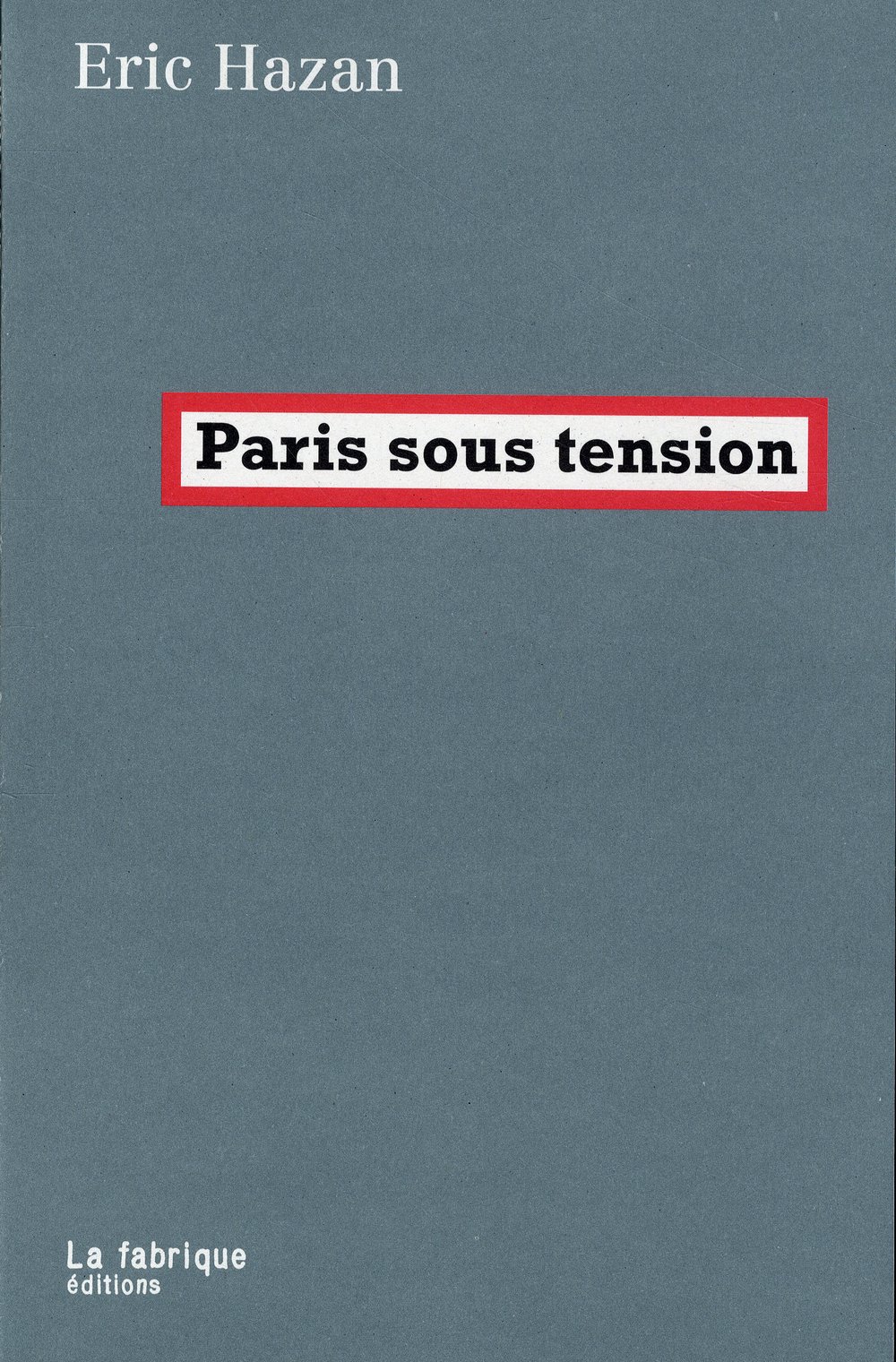
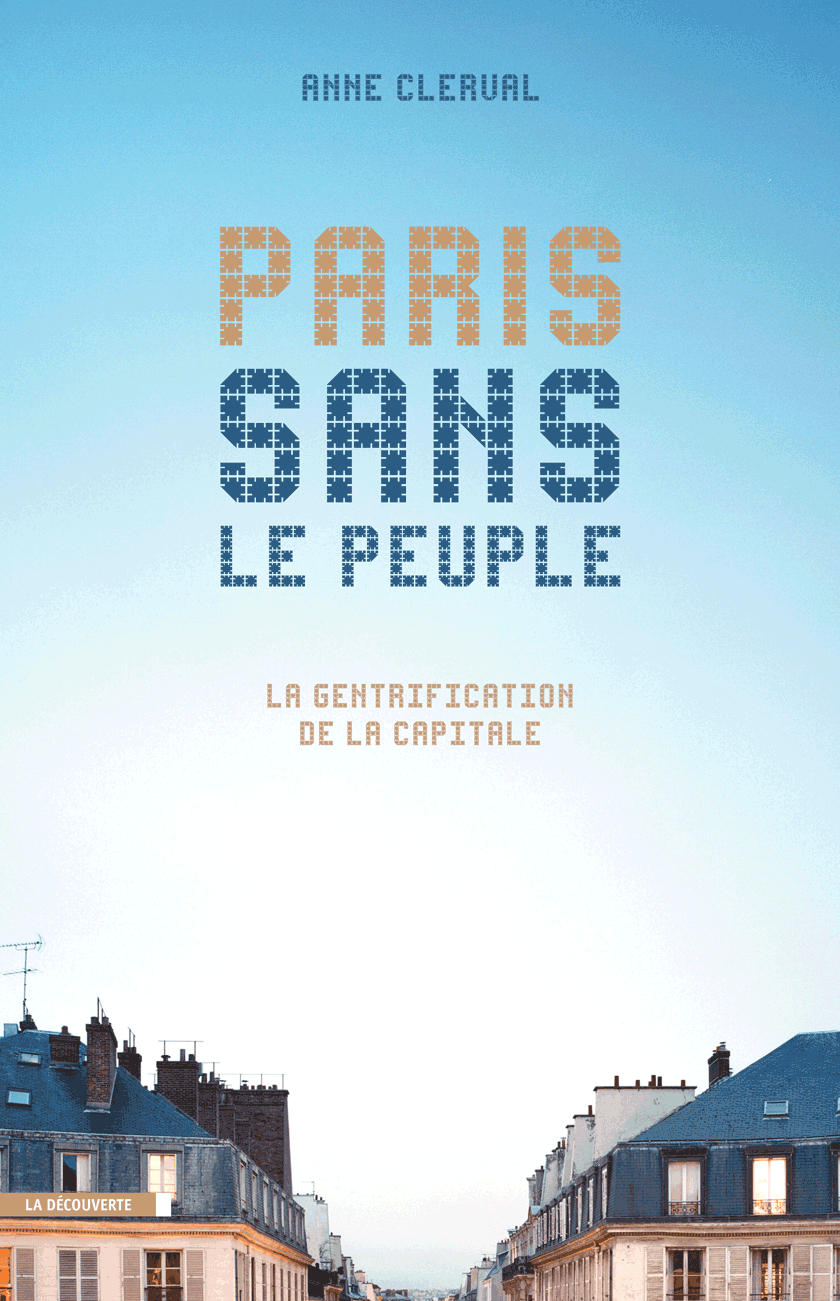
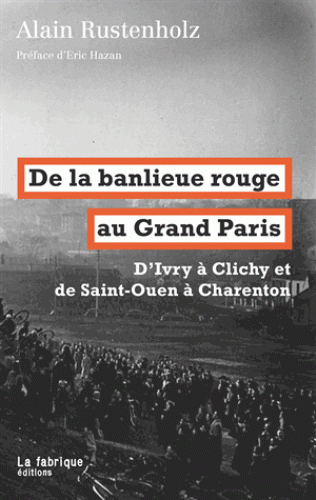
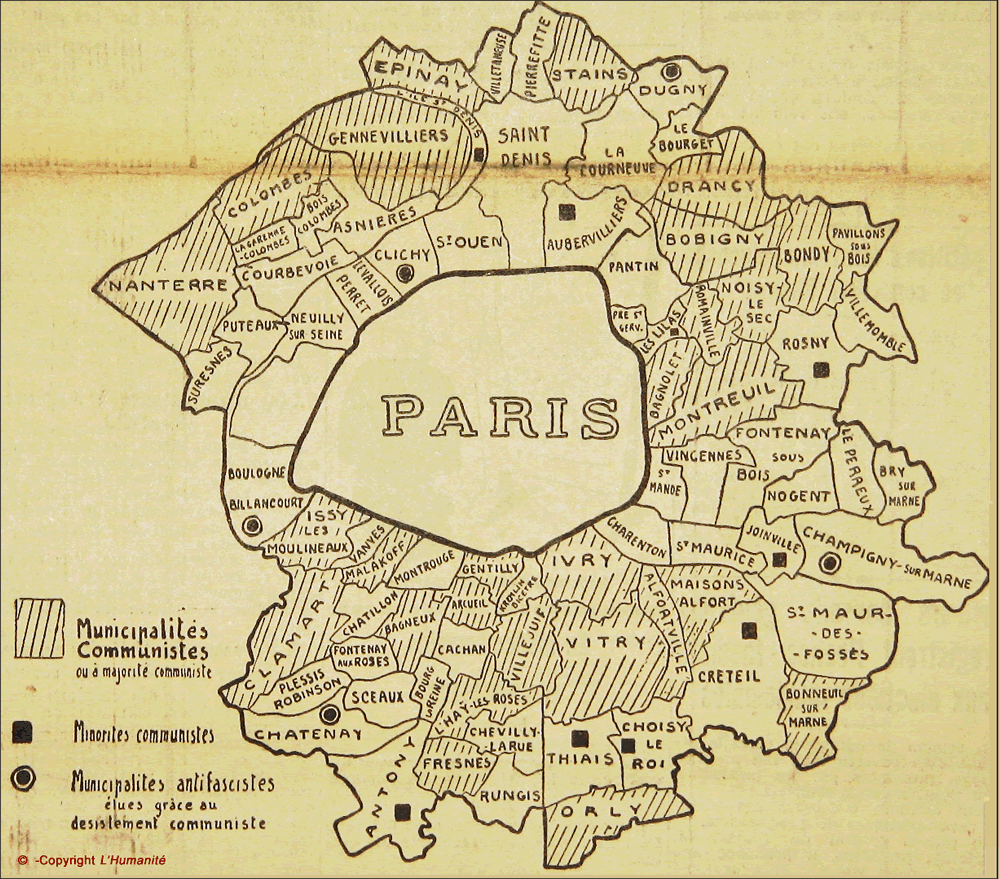
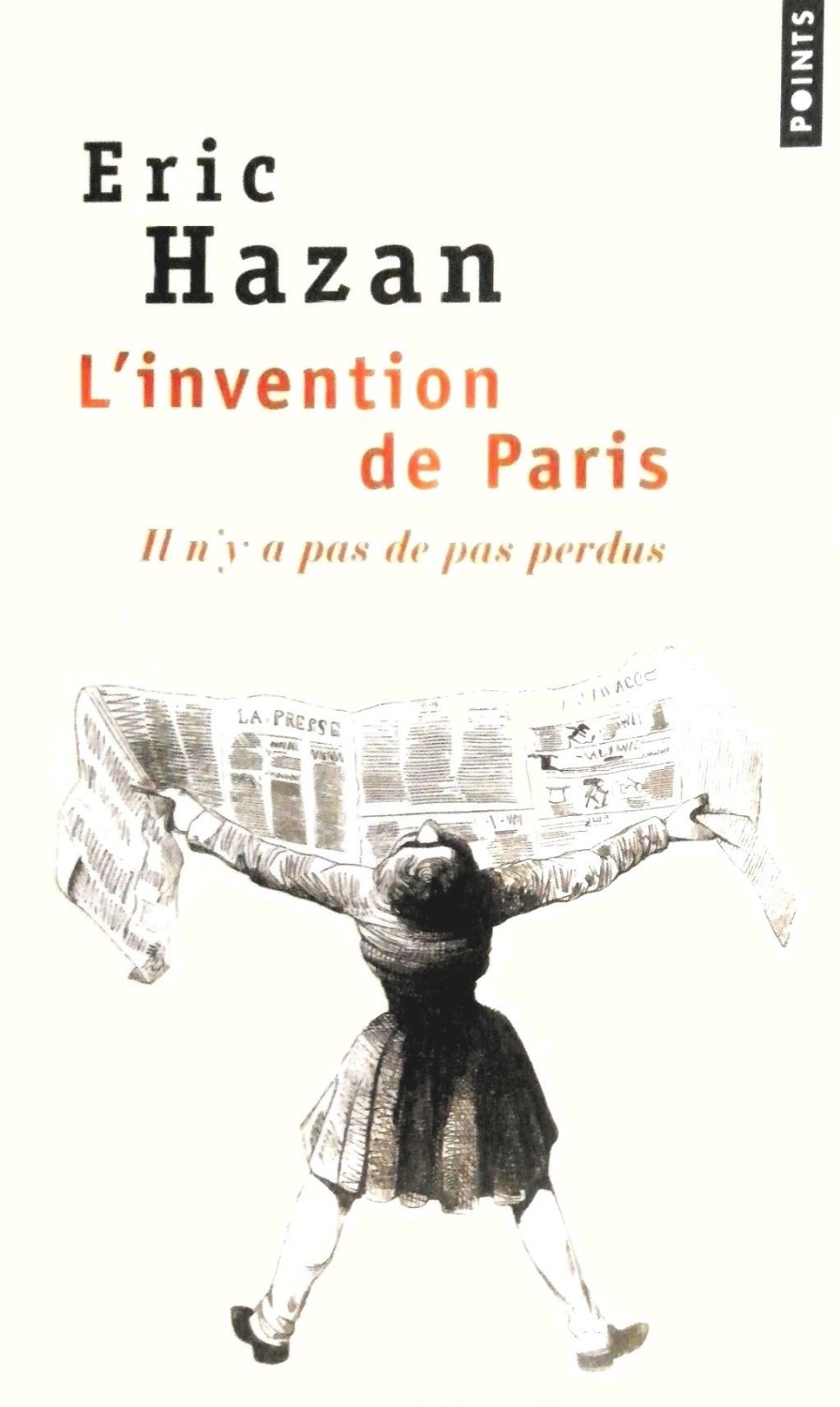









Recent Comments