by jefklak | 27 décembre 2016 | Culture de base, Marabout, Terrains vagues
Pendant près de quinze ans, le mathématicien Theodore Kaczynski fut considéré aux États-Unis comme l’ennemi public numéro un pour l’envoi de colis piégés artisanaux (de 1978 à 1996) à diverses personnes construisant ou défendant la société technologique. Trois morts et 23 blessés avec 16 bombes envoyées. Il a pendant ce temps écrit un Manifeste, faisant aujourd’hui référence dans la critique de la technologie.
James Benning est cinéaste, il travaille sur celui que le FBI a surnommé « Unabomber », sans pouvoir discuter avec lui : depuis 1998, Kaczynski est incarcéré à l’ADX Florence, dans le Colorado, une prison de très haute sécurité.
Ce texte est issu du numéro 1 de Jef Klak, « Marabout », paru en 2014 et encore disponible en librairie.
Téléchargez l’article en PDF.
INTRODUCTION
Après des études de mathématiques à la fin des années 1960 entrecoupées de voyages et de périodes de militantisme, James Benning est à ce jour l’auteur d’une quarantaine de films, dont une vingtaine de longs-métrages. Un temps, il y explore des formes narratives, mais de manière peu conventionnelle : la fiction y émerge d’une libre association de voix, de son et d’image. Il se nourrit pour cela aussi bien d’histoires imaginaires, de faits divers, de documents historiques que de son propre carnet de voyages, voire de la bande sonore du film d’un autre. Benning poursuit la tradition du cinéma expérimental américain, en particulier celle du cinéma structurel théorisé par P. Adams Sitney en 1969, mais avec la volonté de faire un cinéma plus en prise politiquement.
Peu à peu, à travers une rigueur mathématique et un sens du cadre époustouflant, l’observation du paysage, centrale depuis le début dans son travail, devient omniprésente, proposant au spectateur de s’interroger sur ce qui le possède, ce qui l’a transformé et dans quel but, comme par exemple dans la trilogie californienne composée de El Valley Centro (1999), Los (2000) et Sogobi (2001). L’essentiel de son œuvre a été tournée et est diffusée sur son support original 16mm.
Toutefois, à partir de la fin des années 2000, Benning effectue un passage radical à la vidéo numérique. Parmi les films réalisés depuis, trois d’entre eux s’appuient sur les écrits de Théodore Kaczynski : Nightfall (2011), Two Cabins (2011) et Stemple Pass (2012). L’intérêt de Benning pour Unabomber, mathématicien de formation comme lui, remonte à plusieurs dizaines d’années. Il utilise dans ses films des fragments des textes que Kaczynski a publiés depuis son Manifeste [2. Le Manifeste, a été initialement publié par le Washington Post et le New York Times alors que Kaczynski était activement recherché. Ce dernier avait alors promis d’arrêter ses attentats si le texte – de la taille d’un livre – était publié dans les colonnes de ces grands journaux. Il est disponible en français aux éditions de L’Encyclopédie des nuisances sous le titre La Société industrielle et son avenir, Paris, 1998. ] de 1995 , mais aussi des extraits de son journal inédit, pour rendre compte de sa pensée anti-technologique radicale. Au-delà des films, Benning a construit une réplique de la cabane [3. À propos de deux cabanes reconstruites par James Benning : . Voir aussi le livre de Julie Ault (FC) Two Cabins by JB (édité par A.R.T Press, USA, 2011). Au printemps 2014, James Benning a fait une exposition à partir de ces cabanes et des écrits de Kaczynski, intitulée « Decoding Fear », à la Kunsthaus Graz (Autriche).] dans laquelle Kaczynski a vécu pendant vingt-quatre ans dans le Montana (dans le sillage de celle de Thoreau, l’auteur de Walden, qu’il avait reproduite précédemment), et développe une œuvre plastique où la figure de Kaczynski occupe une grande place.

Ted Kaczynski à son arrivée dans le Montana, en 1970.
Comment avez-vous entendu parler de Kaczynski ? Est-ce au moment où il est apparu dans l’actualité ?
Quand il n’était pas connu, quelques années avant qu’on l’attrape, je me suis intéressé à lui parce qu’il était insaisissable et qu’un certain nombre de gens autour de moi étaient interrogés par la police : des gens qui travaillaient à l’Exploratorium de San Francisco, un ami artiste de Nashville qui bossait avec des feux d’artifice, et aussi j’ai entendu dire que Tony Conrad [4. Né en 1940, Tony Conrad est un réalisateur américain d’avant-garde, musicien, compositeur, professeur et écrivain. Dans les années 1960, il appartient au groupe de musique expérimentale The Dream Syndicate aux côtés de John Cale.] avait été interrogé. Celui-ci a d’ailleurs étudié les mathématiques à Harvard au même moment que Kaczynski, donc si c’est vrai, la police a interrogé quelqu’un qui a effectivement très bien pu connaître Kaczynski pendant qu’il était dans cette université. Et puis, à l’époque où j’étais dans le Wisconsin, quatre jeunes gens avaient fait sauter le bâtiment de recherche en mathématiques de l’armée de l’université de Madison. Un étudiant en troisième cycle n’a pas pu sortir à temps et y a perdu la vie. Les auteurs avaient prévenu de l’explosion, mais le dispositif de retardement était mal réglé et la bombe a sauté beaucoup plus vite que prévu. Trois d’entre eux ont été arrêtés, et un a réussi à s’enfuir, Leo Burt. Je connaissais un petit peu ces gens, et comme Leo Burt n’a jamais été attrapé, je pensais que c’était l’Unabomber – ou bien alors un informateur du FBI.
Puis, quand le Manifeste a été publié, ça m’a beaucoup intéressé, particulièrement les commentaires de Kaczynski sur la sursocialisation [5. Kaczynski reprend ici une catégorie de psychologie pour dénoncer le conformisme des gauchistes à la morale bourgeoise et leur amour inconditionné envers la société qui les empêche de la critiquer radicalement. Le fait que la technologie, omniprésente dans notre société, soit la plupart du temps absente du discours critique de la gauche est pour lui un effet direct de cette sursocialisation.] de la gauche. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, j’ai milité pendant un temps, et j’ai pu constater de mes yeux comment la sursocialisation pouvait rendre les choses plus compliquées, comment les egos se mettaient en travers du politique. Et j’ai trouvé les avertissements de Kaczynski sur la technologie particulièrement pertinents.
En même temps, pour un militant, les commentaires de Kaczynski sur la gauche dans le Manifeste sont très contre-productifs ; ils empêchent toute forme d’adhésion si l’on n’est pas d’accord à 100% avec lui…
C’est un fanatique. Mais cela ne signifie pas que ses avertissements ne soient pas valables. Il a perçu nettement ce vers quoi nous nous dirigions, comment le monde de l’entreprise a pris le dessus, avec la technologie comme outil principal, ou bien encore comment les gouvernements empêchent les individus d’utiliser la violence, tout en l’utilisant pour leurs intérêts… C’est un des points fondamentaux du raisonnement de Kaczynski : le combat est absolument inégal.
C’est la partie qui m’intéresse le plus dans ses écrits, une critique de la technologie qui n’est pas sans rapport avec celle de Günther Anders [6. Philosophe allemand du XXe siècle, Gunther Anders (1902-1992) a beaucoup travaillé sur les questions de technologie et de morale, notamment à partir d’entretiens avec le commandant de bord qui était dans l’avion porteur de la bombe H lâchée sur Hiroshima. Son ouvrage le plus célèbre est L’obsolescence de l’homme, éds. Ivrea et Encyclopédie des nuisances, 2002. (NdE : Nicolas Rey a réalisé un film en 16mm à partir de son œuvre : Autrement, la Molussie, 2012).]. Celle de Kaczinsky est très forte et très radicale. Mais je ne suis pas convaincu par les alternatives qu’il propose, et parfois, en le lisant, j’ai du mal avec ce fanatisme dont vous parlez. Par ailleurs, il m’est arrivé de constater que ses écrits sont repris par l’extrême droite… Ce qui nous amène à la question : comment résister à la société technologico-industrielle sans être réactionnaire ?
J’ai bien peur que ce soit probablement trop tard, non ? Je crois que Kaczynski lui-même pense que la seule solution passe par un retour à la chasse et à la cueillette. Ce qui arrivera peut-être après la bombe ou un autre désastre, qui ne laissera que quelques-uns d’entre nous sur Terre. Dans les années 1980, Kaczynski a écrit à une agence gouvernementale pour déposer des plans d’un abri anti-atomique, non qu’il ait vraiment eu peur qu’une explosion nucléaire se produise dans le Montana, mais il ne voulait pas louper l’occasion de participer à la vie de chasseur-cueilleur qui s’ensuivrait ! Il voulait être sûr d’être là pour « la solution ».
Il ne voulait pas manquer l’occasion…
Ça a l’air dingue dit comme ça, mais c’est probablement réaliste au final.
Quel type de réactions y a-t-il aux films et à la diffusion de ses écrits à travers eux ?
De ce que j’ai entendu, les gens pensent que je suis plutôt neutre, que je donne le temps au spectateur de penser à ces questions et d’arriver à ses propres conclusions à travers l’observation. Dans Stemple Pass, on entend les mots de Kaczynski, puis on a le temps d’observer un lieu particulier. Que se passe-t-il dans l’observation alors que ces mots entendus auparavant vous trottent encore dans la tête ? Les mots et les images se renseignent l’un l’autre.
Je n’ai pas entendu de critique comme quoi je me ferais duper et que son point de vue ne devrait pas être relayé à cause de ce qu’il a fait. Il a tué trois personnes, c’est un fait, mais toutes les heures, mon gouvernement en tue plus que ça – et personne ne souhaite y penser vraiment. Nous devrions sans doute nous y mettre, parce que nous sommes partie prenante de cette violence : qui paye ses impôts achète ces cartouches. J’ai plutôt entendu dire qu’il valait la peine d’avoir ce genre de discussions. Sans doute parce que cette voix est entendue dans un cadre ouvert qui permet, je l’espère, de questionner autant nos propres croyances que les siennes.
Stemple Pass donne le temps d’apprécier l’évolution de sa pensée, c’est effectivement une dimension essentielle de votre film : la manière dont il se met, petit à petit, à faire ce qu’il a fait, et la réflexion qui l’y mène…
Je n’utilise qu’une toute petite partie du journal de Kaczynski dans Stemple Pass, uniquement des fragments écrits pendant la première année. J’ai lu l’intégralité de ce journal, tenu entre 1970 et 1995, et il y a là-dedans beaucoup plus que ce qui peut être présenté dans un film de deux heures. J’ai essayé de choisir des textes qui, comme vous dites, donnent un aperçu de l’évolution de sa pensée.

La vue depuis laquelle a été filmé Stemple Pass ; à droite la réplique de la cabane de Kaczynski que James Benning a construite.
Tout son journal était chiffré, n’est-ce pas ?
Pas tout, mais une partie, oui. Mon cahier préféré commence en anglais, puis est interrompu par un codage sous forme de chiffres, pour se terminer en espagnol. Il y a un volume entièrement écrit sous forme de nombres que j’ai déchiffrés ; c’est celui qui est lu dans la troisième partie de Stemple Pass.
Avez-vous été en contact avec Kaczynski ?
Je ne lui ai écrit qu’une seule fois, je lui ai envoyé une carte pour son anniversaire, et il m’a répondu par une carte postale, ce qui était plutôt drôle. Il a le sens de l’humour. Je sais qu’il a tué trois personnes, qu’il vit dans une cellule de 3 mètres sur 3,65 mètres, les mêmes dimensions que sa cabane. J’ai de la compassion pour les personnes en prison, ils sont humains.
Il est donc au courant de votre travail ?
Ça ne lui plaît pas. Il pense que ça ajoute à la montagne de conneries qui circule à son propos. Une amie correspond en revanche avec lui depuis trois ans, donc je peux être en relation avec lui à travers elle. Au début, il me détestait.

L’intérieur de la véritable cabane de Kaczynski.
La « société » a puni Kaczynski de manière suffisamment sévère pour qu’on ne puisse pas vous en vouloir de lui donner un peu de voix, me semble-t-il. Mais comment voyez-vous le fait d’utiliser ses écrits pour faire de l’art, alors que, pendant ce temps-là, il est assis en prison sans aucune possibilité d’influer sur ce que vous faites ?
Cela me donne une grande responsabilité. J’ai fait Stemple Pass pour présenter ses idées aussi clairement et précisément que possible, sans imposer ma propre opinion. J’ai essayé de lire ses mots de manière neutre. J’ai également essayé de choisir un ensemble de textes qui donnent à voir les différents aspects de sa pensée, bons ou mauvais. Ce n’est pas une mince affaire, car la personnalité de Kaczynski est complexe. Lui-même n’a jamais demandé à voir aucun de mes travaux le concernant ; son sentiment que cela ajoute à la montagne de conneries vient du traitement que lui ont fait subir les médias après son arrestation. Il considère qu’il y a toutes les chances que ce soit pareil, et je ne voudrais pas avoir à le convaincre que je suis plus juste. Mais c’est une figure publique, et je pense que je suis en droit de réagir à ses idées. Même s’il ne peut pas voir mes films ou mes installations, il aurait pu demander à recevoir (FC) Two Cabins by JB, le livre à propos du projet des deux cabanes publié par Julie Ault, puisqu’il connaissait son existence.

Une image de Nightfall.
Dernière question, à propos du fait que vous avez produit tant de films en 16 mm et que ces travaux à propos de la technologie soient en numérique. Ce paradoxe…
J’en suis très conscient. D’une certaine manière, l’ordinateur m’a permis d’être autonome dans ce que je faisais. Avant cela, je devais me fier à un labo, je ne faisais pas mes propres travaux de laboratoire, et travailler avec d’autres devenait de plus en plus pénible. J’ai donc arrêté : c’était devenu trop compliqué d’avoir de bonnes copies des films, elles étaient très vite détruites. Maintenant que je suis passé au numérique, je peux faire un film de A à Z avec très peu d’aide. Parfois, j’ai besoin de conseils avec l’ordinateur, et j’ai des amis qui peuvent m’aider pour ça, mais je n’ai plus besoin de sous-traiter quoi que ce soit.
Cela dit, je suis bien conscient que l’ordinateur peut vous voler toute votre vie. Être assis devant cette machine vous consume. À l’utiliser, je gagne en autonomie, mais dans le même temps, qu’est-ce que j’y perds ? Je travaille principalement quand je suis à la montagne, quand je peux aussi sortir et avoir une autre vie. Mais je suis bien conscient de cette contradiction : Stemple Pass qui met en question la machine, la technologie, et moi qui m’appuie dessus totalement.
N’oublions cependant pas que les films en 16mm sont aussi très technologiques. Je dois avouer qu’autour de 2005, l’angoisse d’avoir de mauvaises copies de mes longs-métrages est devenue accablante. Mes films 16mm avaient besoin de précision : la fixité, l’étalonnage, la qualité du son, tout ça est devenu un cauchemar pour moi. Ce n’était pas seulement les labos, c’est aussi la projection, le mauvais son, le point pas fait, l’absence de fixité. Cela prenait six mois pour produire une bonne copie, et deux séances pour la détruire. C’était décourageant, pour dire le moins.
Globalement, le support film, c’est terminé, mais il y aura toujours des artistes pour continuer, et un certain nombre de musées et de programmateurs qui voudront l’archiver et le diffuser. Il y aura toujours quelques endroits où montrer du 16 et du 35mm, et là, la projection sera de bonne qualité, parce qu’ils auront une obligation de résultat. Mais j’ai suffisamment de films anciens que j’essaie de restaurer : je pourrais passer le reste de ma vie à ne faire que ça. Le film, c’est fragile, il faut le stocker dans de bonnes conditions, et cela vire au magenta au bout d’un moment, quoi qu’on fasse. Donc si vous voulez avoir de bonnes copies, il faut sans cesse retravailler le passé, et c’est un gros travail, surtout si vous travaillez aussi dans le présent. C’est la même chose qui arrive avec les vinyles. Il y a un certain nombre de gens qui tentent de préserver cette technologie. En particulier à cause de l’aspect performance, du scratch et de la culture du DJ. Je ne pense pas qu’il faille le voir comme quelque chose de nostalgique, cela doit être jugé pour ce que c’est.
Maintenant que je travaille en numérique, disons que je suis plutôt content d’avoir passé le cap, parce que cette nouveauté m’a rendu joueur à nouveau. Avec le 16 mm, je connaissais mes émulsions, je savais obtenir ce que je voulais. Quand je suis passé à la HD, j’ai dû me rendre compte que ce n’était plus un film que je faisais, c’était quelque chose qui devient des 0 et des 1. Le capteur de cette caméra prend la lumière d’une certaine façon, et quand on apprend à comprendre qu’il peut faire le meilleur comme le pire, on peut commencer à s’en servir pour le meilleur, comme un peintre qui passerait de l’aquarelle à la peinture à l’huile. Je pense que certains de mes films numériques sont assez beaux, même si je me dispute souvent avec des gens qui disent qu’ils ne peuvent pas l’être autant que ceux d’avant. Ma réponse est qu’ils sont différents.
C’est aussi un état d’esprit : tout dépend de ce qu’on imagine être la réalité. Le film en noir et blanc, c’était la réalité jusqu’à ce que la couleur arrive et représente l’imaginaire. Puis la couleur est devenue plus subtile et elle s’est mise à représenter la réalité – tandis que le noir et blanc a été rangé du côté de la mémoire et du rêve. Avec le temps, les gens penseront que le numérique, c’est la réalité, et le film quelque chose d’autre, la mémoire, ou le passé. J’aime bien comment ces choses évoluent. Qui sait ce que la technologie nous réserve pour demain ? La seule chose que je sais, c’est que le ressort en sera le profit, et que les artistes n’auront pas vraiment leur mot à dire.
by jefklak | 21 décembre 2016 | Bout d’ficelle
Assimilée au capitalisme, à la futilité et à l’extravagance du style vestimentaire bourgeois, la mode est fortement dépréciée dans l’URSS naissante, au lendemain de la révolution d’Octobre. Prônant le rejet de la consommation ostentatoire, l’homme et la femme bolcheviques doivent faire preuve d’austérité et s’habiller simplement. Très rapidement pourtant, dès les années 1930, le concept de mode réapparaît, des politiques vestimentaires sont élaborées, une organisation bureaucratique statue sur la pertinence « soviétique » des modèles créés… Entretien avec Larissa Zakharova, historienne et auteure de S’habiller à la soviétique. La mode et le Dégel en URSS (éd. CNRS, 2012).
Ce texte est issu du numéro 2 de Jef Klak, « Bout d’ficelle », paru en mai 2015 et encore disponible en librairie.
Téléchargez l’article en PDF.
Comment en êtes-vous venue à l’étude de la mode soviétique ?
À Saint-Pétersbourg, j’ai commencé par travailler sur la redistribution du logement pendant la guerre civile (1917 à 1921). Le sujet n’avait rien à voir avec la mode, mais m’a poussée à définir le cadre théorique de ce que serait une histoire du quotidien en Union soviétique. Dans l’historiographie russophone des années 1990, l’histoire du quotidien était assez mal vue. On la considérait comme anecdotique, dissociée de la grande histoire événementielle qui elle, avait toute sa légitimité. Il se disait qu’aborder le quotidien revenait à faire une description statique et non problématisée des manières de vivre et de faire, laquelle n’avait pas un grand sens explicatif par rapport à l’expérience soviétique.
De cette historiographie russophone, je suis passée à l’historiographie francophone, et j’ai découvert les travaux de Michel de Certeau sur les arts de faire, les ruses anonymes et le bricolage qui composent le quotidien… Il m’a semblé que ce cadre conceptuel et théorique convenait très bien à cette société de pénurie : en Union soviétique, les individus étaient contraints de s’adapter au manque et à la pénurie au quotidien, et devaient déployer toute une palette de manières de faire pour construire leur mode de vie et leur environnement matériel.
Puis j’ai découvert les travaux de Alf Lüdtke[2. Alf Lüdtke (dir.), Histoire du quotidien, Paris, Éditions de la MSH, 1994 (1989).] et de l’Alltagsgeschichte (histoire de la vie quotidienne) allemande. Ce courant insiste, de la même manière que de Certeau, sur la créativité des agents ordinaires, mais en lien étroit avec la sphère d’action politique et économique d’État. Quand je me suis intéressée à la mode en URSS, pour ma thèse de doctorat, j’ai défini le quotidien comme lieu d’intersection entre politiques d’État et réponses des individus. Ceux-ci peuvent à leur tour modifier le cours des événements et les cadres d’action des dirigeants, infléchir le cours des politiques.
Comment avez-vous procédé pour écrire votre histoire de la mode ?
L’essentiel de ma documentation provient des archives institutionnelles. De ce point de vue, l’historien de l’URSS est bien loti, parce que cet État bureaucratique a produit énormément de documentation, dans des domaines qui ne sont pas aussi bien documentés dans les sociétés démocratiques libérales. L’univers de la création vestimentaire était, parmi d’autres, une sphère très investie par l’État. Dans les sources institutionnelles, on trouve de nombreuses traces des interventions et négociations entre les dirigeants, les experts et les consommateurs.
J’ai avant tout travaillé avec les matériaux fournis par les instances de création vestimentaire : les « Maisons de modèles de vêtements ». Dans ces institutions étatiques, les créateurs étaient des fonctionnaires chargés de concevoir des modèles de vêtements pour les entreprises de confection, qui étaient souvent réutilisés par les ateliers de couture sur-mesure. Les modèles devaient correspondre au concept de mode socialiste qui avait été élaboré au préalable, et se distinguer de la mode « bourgeoise », incompatible avec la société soviétique. J’ai également consulté les fonds d’autres instances : le Conseil des ministres ; le Comité central du Parti, qui veillait à l’élaboration et à l’application des mesures prises durant l’époque khrouchtchévienne[3. Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste de l’URSS de 1953 à 1964 et président du Conseil des ministres de 1958 à 1964.]. J’ai aussi travaillé avec les documents de la Direction des statistiques, parce que les dirigeants voulaient savoir ce que les individus consommaient, de quelle manière, et dans quelle mesure ils étaient satisfaits de ce que l’État leur offrait comme biens de consommation. Enfin, j’ai utilisé les enquêtes sur les budgets des ménages, réalisées par les Directions des statistiques à travers le pays. À partir du terrain de Leningrad (Saint-Pétersbourg), j’ai sélectionné un échantillon de 465 enquêtes, dans lesquelles j’ai analysé ce que les individus achetaient, combien ils dépensaient dans les magasins d’État ou auprès de particuliers qui vendaient sur les marchés ; combien ils dépensaient dans les ateliers étatiques de couture sur mesure ; combien chez les couturiers privés.
Tous ces documents m’ont donné un tableau général des politiques menées dans le domaine de l’habillement, ainsi que des pratiques de consommation des individus ordinaires pendant la période de dégel des années 1950-1960. J’ai ensuite complété ces matériaux d’archive par une vingtaine d’entretiens avec des consommateurs de cette période, qui m’ont permis d’aborder la question des cultures de consommation : pourquoi les gens s’adressent plutôt aux couturières privées ou à un atelier de couture sur-mesure ; qui achète dans les magasins d’État, et qui refuse par principe d’y aller ?
Pouvez-vous détailler ce que vous entendez par « mode soviétique » ? Comment ce concept a-t-il émergé, et comment est-il devenu un objet politique de l’URSS ?
La formulation même de l’expression « mode soviétique » rencontre souvent des sourires sarcastiques parmi les chercheurs – il s’agirait de deux termes inconciliables. Or, pour les acteurs de l’époque soviétique, le terme avait du sens, même s’il n’avait rien d’une évidence. L’élaboration de ce concept a fait l’objet d’âpres débats au fil des changements politiques de l’État soviétique.
Dans un premier temps, au lendemain de la révolution d’Octobre, la situation est particulièrement incertaine : les entreprises de confection et de textile ferment, puis sont nationalisées, mais elles ne peuvent fonctionner, puisque le pays est en guerre civile jusqu’en 1921. L’État n’a pas encore défini de politiques dans le domaine de l’habillement. En revanche, un milieu artistique émerge, et des créateurs expérimentent différents styles. On voit apparaître, par exemple, les courants du constructivisme révolutionnaire et de l’art industriel – que l’on voulait faire descendre dans la rue et rendre accessibles à tous. Les porteurs de ces concepts et de ces expériences artistiques possèdent souvent une formation prérévolutionnaire et connaissent des créateurs occidentaux, français notamment.
Nadejda Lamanova est l’une des figures fondatrices de la mode socialiste. C’est une couturière, qui avait créé des toilettes pour la cour impériale avant la révolution. Paul Poiré, avec qui elle était en contact, pensait qu’elle resterait travailler en France après la Révolution. Mais Lamanova faisait partie de ceux qui étaient très attirés par l’idéologie bolchévique. Elle est donc restée en Russie pour élaborer le cursus de formation des créateurs, appliqué au premier Institut textile fondé à Moscou en 1919. Elle élabore le principe du costume socialiste, qui devait être « rationnel » et fonctionnel, où la forme devait être adaptée aux circonstances, à la morphologie, au type de personnalité… Il s’agissait presque d’une théorie de la mode, mais qui ne s’opposait pas encore à la mode bourgeoise occidentale. Très vite pourtant, cette élaboration théorique a été utilisée dans les débats sur l’incompatibilité de la mode, phénomène d’origine bourgeoise, avec l’économie socialiste et la société soviétique, censée être égalitaire, où les distinctions sociales étaient prohibées. Ce concept de mode soviétique a donc été élaboré à l’époque de la Nouvelle politique économique (NEP – entre 1921 et 1928), qui introduit une relative libéralisation économique et le retour d’une certaine liberté dans le quotidien, pour dynamiser le pays suite à la guerre.
À la fin des années 1920, Staline s’impose à la tête du pouvoir et met fin à la NEP. Il nationalise et centralise l’ensemble de la production, et introduit une politique d’industrialisation à marche forcée, ainsi que des cartes de rationnement dans le quotidien. Toute réflexion sur la mode devient alors complètement inappropriée, puisque les usages politiques promeuvent l’ascétisme. Le terme même de « mode » est en quelque sorte banni du vocabulaire quotidien. Les magazines apparus dans les années 1920 changent de titre : ils ne portent plus ouvertement sur la mode, mais sur « l’art de s’habiller », qui défend les idées de rationalité, de fonctionnalité, de simplicité. On ne parle plus de mode.
À la fin de la NEP, les créateurs se réfèrent-ils à l’idée de formation d’un homme nouveau pour justifier les choix esthétiques des vêtements ? Les choix formels sont-ils articulés à une idéologie ?
Le concept de mode socialiste élaboré par Nadejda Lamanova s’inscrivait déjà dans un discours général sur l’homme nouveau. Elle n’était pas la seule à promouvoir ces idées, et dialoguait constamment avec d’autres personnalités, comme le commissaire à l’Éducation (Anatoli Lounatcharski), ou le commissaire à la Santé (Nikolaï Semachko), qui promouvaient l’idée d’hygiène sociale. Le débat sur l’hygiène peut paraître un peu éloigné de celui sur la mode, mais ils ont une vraie cohérence. Dans le projet de l’homme nouveau vivant dans une société égalitaire, les propositions de Lamanova allaient dans le même sens que celles d’autres penseurs de l’époque.
Après la période d’industrialisation, un nouveau revirement survient dans la deuxième moitié des années 1930. Suite au 17e congrès du Parti en 1934, Staline déclare que les fondements du socialisme ont été posés en Union soviétique, et que l’époque de l’ascétisme est terminée. « La vie est devenue meilleure et plus joyeuse », son fameux slogan, est affiché partout. C’est dans ce cadre qu’est lancée la campagne de lutte pour la koultournost’ (voir encadré), cette acculturation de l’homme nouveau. On estime que l’idée d’hygiène sociale n’a pas suffisamment été appliquée, et l’on entreprend donc d’expliquer aux Soviétiques ce qu’est être koultourny, un « homme civilisé ». Cette lutte pour la koultournost’ entraîne le retour en force de l’idée de mode : l’homme ou la femme soviétique est « civilisé » quand il sait s’habiller avec goût et selon la mode. Par cette idée d’éducation du goût, les créateurs trouvent leur fonction dans la société soviétique : ils sont chargés d’élaborer les tendances de mode, et peuvent ainsi éduquer les consommateurs au sens du « beau ». Dans la mesure où la mode socialiste vise à donner à tous un sens de l’esthétique, on estime alors que celle-ci n’est plus problématique, puisqu’elle ne produit pas de distinction sociale.
Mode et économie planifiée font-elles bon ménage ?
Difficilement. La mode, avec le concept d’évolution des tendances, implique en effet de changer périodiquement les vêtements avant leur usure matérielle. Or, d’après les économistes soviétiques, on ne peut pas jeter les produits issus du travail humain avant leur usure physique complète : ce serait irrationnel et contre-productif. Jusqu’à la fin de l’époque soviétique, les créateurs ont buté sur l’argument selon lequel la mode ne convenait pas à une économie planifiée. Ils ont donc tenté d’élaborer un rythme spécifique à la mode socialiste, moins rapide que la mode occidentale. Ils « ralentissent » la mode en proposant plusieurs lignes simultanées : parallèlement au « fond de collection[4. Ensemble des modèles qui restent inchangés d’une collection à l’autre, malgré les changements de tendances.] » permanent, les créateurs alimentent le marché avec des tendances déjà produites lors des précédentes saisons, en même temps qu’ils produisent de nouvelles silhouettes. Ils offrent ainsi plusieurs rythmes de changements de silhouettes, et parviennent à justifier la présence de la mode dans le cadre de l’économie planifiée socialiste.
Sur quoi se fonde ce « sens du beau », censé être partagé par tous ?
Il se fonde sur la notion de « bon goût », qui implique que le « sens du beau » est le même pour tout le monde. Les créateurs élaborent des règles de bon goût complètement figées, qui n’évoluent pas dans le temps. C’est pourquoi l’idée de bon goût se substitue souvent à l’idée même de mode, jusqu’à la dénaturer, puisque la mode est censée évoluer et altérer les conventions du goût. Or les créateurs soviétiques définissent leurs fonctions sociales par un travail d’éducation des consommateurs au bon goût, et oublient que la mode peut jurer avec ses règles.
Concrètement, le bon goût de rigueur consiste à accorder les accessoires de la même couleur : le chapeau, les gants, les souliers, le sac, l’écharpe ou le foulard. Une autre règle préconise de changer de souliers en arrivant au théâtre : on laisse les bottes dans le vestiaire et on chausse des souliers élégants pour assister à un ballet, à l’opéra ou à une pièce de théâtre. Ou encore, on choisit ses vêtements en fonction des circonstances, comme cela se fait dans la mode occidentale : en France, la mode distingue les robes de cocktail, celles de l’après-midi ou du soir… Cette distinction est reprise par les créateurs soviétiques, qui y ajoutent des valeurs propres à la société socialiste. Ils introduisent par exemple la catégorie des vêtements de travail.
Le discours des créateurs est aussi beaucoup plus normatif que celui des journalistes de mode, français notamment. Les créateurs soviétiques, qui jouent également le rôle de journalistes, peuvent écrire dans la presse qu’« il est impossible de porter chez soi des robes démodées ». On cherche également à créer des vêtements d’intérieur, qui doivent eux aussi être à la mode : une des règles du bon goût dictait en effet de changer de vêtements en rentrant chez soi. On ne pouvait pas être habillé de la même manière du matin au soir, il fallait changer de tenue à plusieurs moments de la journée.
Dans vos travaux, vous parlez du rôle du Grand conseil artistique, qui sélectionnait les modèles avant leur production. Il semble que la question du bon goût faisait polémique parmi ses membres…
Le Grand conseil artistique réunissait des représentants de différents corps professionnels. Il sélectionnait les modèles élaborés par les créateurs, et pouvait imposer un véto à certains d’entre eux. On n’y discutait pas tant du goût, mais plutôt des besoins des consommateurs. Les membres de ce conseil avaient des interprétations très divergentes des ordonnances du gouvernement. Ce dernier demandait d’améliorer le quotidien des Soviétiques en fournissant aux consommateurs davantage de vêtements, beaux, pratiques, confortables, etc. Mais les termes des ordonnances étaient très vagues et c’était aux professionnels de les interpréter, de les décliner en fonction de leur définition de ce qu’étaient les « beaux » vêtements, convenables à l’homme soviétique.
Les différences entre cultures professionnelles créaient des blocages dans la communication entre les acteurs censés travailler de concert. Les « travailleurs de commerce » – les employés des magasins d’État – avaient par exemple leur propre procédé de suivi de la demande, qui se fondait sur ce qui avait été demandé pendant la période précédente. Cette définition de la demande jurait avec la notion de mode, parce qu’elle ne pouvait prendre en compte aucune nouveauté. Les travailleurs de commerce rejetaient d’emblée toute nouveauté radicale, parce qu’ils ne pouvaient être sûrs de son succès, et apparaissaient donc comme conservateurs au sein des instances de sélection.
Ces employés de magasins d’État choisissaient-ils eux-mêmes ce qu’ils faisaient entrer dans leur stock de marchandises à commercialiser ?
Les vendeurs et leurs chefs, qu’on appelait « experts en marchandises », devaient effectivement suivre la demande par le biais de feuilles de contrôle, en notant chaque transaction. La méthode de suivi n’était pas parfaite, car sans moyen de systématiser, on notait de manière un peu lacunaire, aléatoire. Il existait donc certains mécanismes de transmission de la demande. « Une femme est venue demander une robe noire pour des funérailles et n’en a pas trouvé » : c’était noté, et transmis aux entreprises de confection. Mais que faisaient celles-ci ? Elles produisaient 10 000 robes noires de funérailles, selon le plan quinquennal. Cela provoquait forcément un problème d’ajustement, entre une demande ponctuelle et ce type d’arrivages.
Il se pouvait aussi que la demande bute sur un problème de fourniture des matières premières. Si des consommateurs demandaient des robes en laine de telle silhouette, il était possible d’en obtenir le patron, mais que l’entreprise ne dispose pas de tissu en laine pour les produire en quantité suffisante. L’économie centralisée n’arrivait tout simplement pas à activer jusqu’au bout ce mécanisme de communication, qui était pourtant formellement instauré entre les différentes instances de production vestimentaire.
Pour revenir à l’idée des cultures professionnelles divergentes, c’est avant tout la nouveauté des lignes qui posaient problème aux travailleurs de commerce, qui se fondaient sur les observations des pratiques d’achat passées. Ces propositions de nouveautés étaient également problématiques pour les travailleurs des entreprises de confection. Ils avaient les chiffres du plan en tête et lorsqu’ils voyaient une ordonnance expliquant qu’il fallait produire plus de « beaux vêtements pratiques pour le consommateur soviétique », cela signifiait, pour eux, produire la même robe en 25 000 exemplaires. C’était simple : on activait les chaînes de production, et hop hop hop, c’était produit. Pour les créateurs, la mode, c’était au contraire la diversité, et produire plus de beaux vêtements voulait dire proposer une plus grande variété de silhouettes. Les entreprises étaient particulièrement résistantes à cette diversification, qui impliquait d’adapter le processus de production à chaque patron, chaque matière, et d’apprendre aux ouvrières à couper les nouveaux tissus. Dans les magasins d’État, on trouvait donc surtout des vêtements démodés, qui étaient produits selon le plan et non pas selon les propositions des créateurs.
Il y avait donc une immense différence entre ce que les créateurs proposaient et les vêtements qui parvenaient à la population…
Oui mais, néanmoins, les gens pouvaient très facilement se tenir informés des dernières créations. Les patrons des modèles validés par le Grand conseil artistique – non produits en masse – étaient présentés dans les magazines de mode. À chaque fois que l’on se rendait au cinéma, les actualités, projetées sous forme de courts-métrages avant le film, contenaient des défilés de mode ; et les émissions de radio donnaient des descriptions verbales des nouvelles silhouettes à la mode. Par ailleurs, les nouvelles collections de la Maison des modèles faisaient l’objet de présentations publiques. Les consommateurs pouvaient ensuite suivre ces suggestions, mais ils devaient se montrer ingénieux : trouver du tissu, une couturière, faire la queue dans un atelier de couture sur-mesure, ou coudre eux-mêmes. En revanche, il serait faux de dire qu’à l’inverse, les personnes qui se rendaient dans des magasins d’État choisissaient la facilité, car il s’agissait d’espaces de pénurie.
Des modèles non validés par le Grand conseil artistique pouvaient-ils circuler sur le marché ? Quelle était l’influence de ce Conseil ?
Entre 1950 et 1960, on peut aisément parler du règne des experts. Les hiérarques du Parti faisaient confiance à ces personnes issues du milieu de la mode : ils les estimaient capables de juger ce qui serait beau et approprié, puisqu’elles appuyaient leur savoir sur une conception presque scientifique de la mode socialiste. L’étendue du pouvoir de ces experts s’illustre particulièrement avec l’affaire des stiliagui. Il s’agissait de jeunes, des zazous[5. Courant de mode de la France des années 1940. Il s’agissait de jeunes gens reconnaissables à leurs vêtements anglais ou américains, et affichant leur amour du jazz.] soviétiques, qui ont commencé à porter des vêtements de production étrangère à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rapidement considérés comme des personnes inclinées devant l’Occident bourgeois et non dévouées à la cause communiste, les stiliagui étaient assimilés à des « parasites sociaux ». Cet épisode s’inscrit dans un contexte politique bien particulier, marqué par la lutte contre le cosmopolitisme de la seconde moitié des années 1940.
Les créateurs sont intervenus dans ce débat en récupérant les tendances des zazous et en les intégrant, petit à petit, à leurs créations. Le style des stiliagui s’illustrait notamment par des pantalons très étroits – on disait qu’ils devaient s’armer de savon pour les enfiler, et ces jeunes étaient comparés, dans la presse, à des perroquets. En réponse, les créateurs ont donc rétréci la largeur des pantalons, jusqu’à les faire apparaître sous cette forme dans les magasins d’État, à la fin des années 1950. Ils étaient d’ailleurs tellement étriqués que des consommateurs ont alors fait le signalement suivant : « Vos pantalons sont si serrés que les hommes soviétiques qui se respectent doivent se faire coudre des pantalons plus larges par leurs propres moyens. » En jouant un rôle de médiateur, les créateurs ont ainsi réussi à faire passer la mode antisoviétique pour soviétique : à partir du moment où la mode des stiliagui a été intégrée aux créations officielles, la stigmatisation a cessé. Cela a amené certains chercheurs à dire que le mouvement des stiliagui avait disparu à la fin des années 1950. En réalité, ils sont devenus moins visibles dans le paysage urbain, car plus de jeunes gens se sont mis à porter des pantalons étroits. Mais l’étiquette même des stiliagui qui avait une forte connotation péjorative était désormais davantage appliquée aux marginaux et aux déviants sociaux (« hooligans », « parasites », etc.) qu’aux jeunes habillés à la mode. Le fait même de porter un pantalon serré a perdu le sens politique négatif qui lui avait été assigné jusqu’alors.
Un vêtement d’inspiration occidentale n’était donc pas considéré comme une menace s’il était produit sur le sol soviétique ?
Tout en définissant la mode soviétique en opposition à la mode bourgeoise, les créateurs soviétiques se sont toujours tenus au courant de ce qui se faisait en Occident. À l’époque du Dégel (1953-1964), ils se rendaient très régulièrement en France avec l’autorisation des instances du Parti : ils avaient pour consigne d’utiliser l’expérience occidentale afin d’améliorer le système de production vestimentaire de l’URSS. Cependant, les ordonnances du gouvernement étaient très vagues ; elles ne spécifiaient pas ce qu’était l’« expérience occidentale », et laissaient la possibilité aux créateurs de rencontrer qui ils voulaient. Inspirés par leur culture professionnelle, par Nadejda Lamanova et ses contacts au sein de la haute couture, ils ont vite repéré Paris et Christian Dior – qui passaient pour l’incarnation du « meilleur ». Tandis que les discours publics relayaient, dans la presse, l’opposition entre mode bourgeoise et mode soviétique, les créateurs écrivaient, noir sur blanc dans leurs rapports de mission, à propos de la mode française, que « tout [était] parfait et [pouvait] être imité ».
Ils reprenaient ainsi les modèles parisiens dans leurs créations, et les faisaient passer pour de la mode socialiste. Il s’agissait d’un double langage, en quelque sorte, et forcément, cela ne passait pas inaperçu. Par exemple, quand les créateurs des pays socialistes se réunissaient à des congrès internationaux de mode, ils s’adressaient des reproches réciproques du type « Vos robes trapèzes ressemblent étrangement à une proposition récente d’Yves Saint Laurent », ce à quoi les créateurs interpellés répondaient « Non, c’est faux, nous nous sommes inspirés des robes traditionnelles russes à bretelles, les sarafanes ». Justifiés ainsi, ils devenaient irréprochables, puisqu’ils avaient évidemment le droit de reprendre les lignes des costumes folkloriques. Ce qui comptait, c’était les justifications qui paraîtraient dans la presse et qui permettraient de dire : « Ça, c’est de la mode socialiste ! » Au final, un citoyen soviétique qui aurait eu accès au patron d’une robe occidentale par voie de contrebande, et qui l’aurait fait reproduire chez une couturière, n’aurait pas été montré du doigt dans la rue, parce que le gouvernement faisait, tout simplement, la même chose que lui.
Contrairement à l’idée reçue d’une grande standardisation
des produits sur le marché soviétique, les vêtements présentaient donc une grande diversité…
C’est ce que l’on peut voir sur les photos prises par des particuliers – et non sur des photos officielles, car les photographes de presse devaient représenter la foule soviétique comme homogène. Entre 1950 et 1960, les silhouettes partagent de grandes similarités entre la France et l’Union soviétique, même si les conditions de production altéraient la qualité des matériaux et modifiaient les lignes des vêtements. Et puis, les citoyens soviétiques avaient aussi accès à des films étrangers dans le cadre de programmes de coopération culturelle, comme le festival de films néoréalistes italiens de 1957. Suite à la projection du film français Babette s’en va-t-en-guerre (1959) avec Brigitte Bardot, les femmes soviétiques se sont massivement coiffées « à la Babette ».
Existe-t-il une distinction sociale par la mode ? La haute couture existe-t-elle encore ?
Même si c’était une prétention du régime, la société soviétique n’a jamais été égalitaire. Très vite, les privilèges se sont institutionnalisés, et les élites ont bénéficié d’un accès facilité à des produits plus diversifiés et de meilleure qualité. Ces inégalités se justifiaient de différentes manières. À partir des années 1930, suite aux exploits d’Alexei Stakhanov, le stakhanovisme[6. Afin d’améliorer la productivité industrielle de l’URSS, le second plan quinquennal (1933-1937) est caractérisé par la création d’écoles techniques pour former et perfectionner les travailleurs, et élève au rang de « héros du travail » les ouvriers qui se démarquent par leur forte efficacité. Le plus célèbre d’entre eux est le mineur Alexeï Stakhanov qui, dans la nuit du 30 au 31 aout 1935, aurait abattu 14 fois plus de charbon que la norme établie. Cette propagande en faveur du sacrifice au travail s’accompagne de l’augmentation de contraintes et de sanctions encadrant sévèrement les ouvriers (suppression des salaires pour les travailleurs considérés inefficaces, rétablissement du livret ouvrier, allongement de la journée de travail, etc.).] fait son apparition, avec le privilège, pour les « travailleurs de choc » d’accéder à un niveau de vie supérieur à celui des autres. Par ailleurs, il se disait aussi que les travailleurs dirigeants qui avaient de lourdes responsabilités, comme celle de représenter l’Union soviétique à l’étranger, devaient avoir une apparence convenable, respectable. C’est ainsi que les « distributeurs spéciaux » ont été créés : grâce à des systèmes de distribution spécialisés et fermés, les travailleurs des différents corps ministériels et du Parti avaient droit à des biens de meilleure qualité. Les élites artistiques bénéficiaient à peu près des mêmes avantages, et je me suis rendu compte, en menant des entretiens, que certains s’évertuaient, de plus, à établir des liens informels avec les Maisons des modèles, pour y acheter les pièces uniques qui avaient servi lors de défilés de mode, selon le principe de la haute couture. Les entreprises de confection avaient tendance à simplifier les patrons envoyés par les créateurs : par souci d’efficacité, l’idée créatrice était altérée. La pièce unique créée pour le défilé n’était donc jamais reproduite à l’identique, et était forcément de meilleure qualité, légèrement différente que les vêtements produits en masse. Donc oui, bien sûr, il existait une distinction sociale par le biais de la mode.
Vous pouvez peut-être en dire un peu plus sur les pratiques
quotidiennes des consommateurs ?
J’ai distingué, très schématiquement, trois cultures de consommation par rapport à la mode : ceux qui suivent la mode, ceux qui préfèrent le classicisme des magasins d’État, et les personnes qui empruntent aux deux. Ceux qui suivent la mode ne se rendaient jamais dans des magasins d’État : ils s’adressaient à une couturière privée, à un atelier de confection, ou cousaient eux-mêmes. Ces trois manières de fabriquer correspondent à des budgets différents – le plus cher étant d’avoir recours à des couturières privées, et le moins onéreux étant de coudre soi-même.
À partir des enquêtes de budget et des entretiens que j’ai réalisés, je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de lien de corrélation entre les revenus des gens et leur culture de consommation. On pouvait avoir de très faibles ressources et suivre une mode, à partir du moment où l’on avait une machine à coudre à la maison. Ma grand-mère, par exemple, cousait pour toute la famille. Elle suivait des patrons de couture, et y ajoutait sa marque de fabrique, son style… On reconnaissait chacun de ses vêtements.
C’était une pratique courante ?
Oui, et c’était aussi encouragé par l’État car, malgré la volonté du pouvoir de satisfaire les besoins des consommateurs, il existait des problèmes d’approvisionnement et de communication entre les différents maillons de la chaîne du système de production. Aussi, en parallèle de la production d’État, on trouvait un discours sur la nécessité, pour les jeunes filles, d’apprendre la couture – « C’est toujours pratique ». Je suis née en 1977, et j’ai appris à coudre à l’école, alors qu’en France, à la même époque, les cours de couture avaient été supprimés depuis longtemps dans l’enseignement général. Il existait même des cours du soir, pour celles qui voulaient se perfectionner. Les moyens mis à disposition par l’État étaient tels que l’on pouvait ensuite transformer cette activité en profession, et donc en activité illégale, puisqu’en théorie, on avait pas le droit de faire du profit chez soi. Malgré ce paradoxe, il existait un milieu très dense de couturières expérimentées, lesquelles avaient leur clientèle.
Elles ne couraient aucun risque ?
En cas de litige, un client aurait toujours pu dénoncer sa couturière – et dans ce cas, la milice constatait la production illégale, et condamnait la personne à un ou deux ans de travaux forcés – mais en réalité, le système fonctionnait bien, parce qu’il y avait une complicité et des intérêts communs entre clientèle et couturières. Cela complétait l’offre de l’État.
Finalement, cette diversité des pratiques, cette variété des silhouettes et l’image du bien-être qui se reflètent dans les archives privées découlaient de la participation de tous ces acteurs légaux, semi-légaux et illégaux. Ce qui comptait pour les dirigeants soviétiques, c’était le résultat final : la satisfaction du consommateur. Si la foule avait l’air contente, pourquoi chercher à embêter les couturières alors qu’elles apportaient leur pierre à l’édifice du bien-être général ?
On retrouve cette attitude ambivalente pour la revente des biens occidentaux, entrés en Union soviétique par voie de contrebande ou lors des divers moments d’ouverture à l’Ouest. Par exemple, le Festival international de la jeunesse et des étudiants de 1957 a été le théâtre de ventes massives de biens étrangers. Or, vendre des vêtements dans la rue était interdit puisque considéré comme une forme de spéculation. Aussi, des « dépôts-ventes » ont été mis à disposition des étudiants étrangers pour servir de points de revente, où ils pouvaient ensuite être légalement achetés par des consommateurs soviétiques ordinaires. Les objectifs économiques n’étaient pas toujours alignés sur le discours et la logique de pureté politique.
Où se fournissaient les stiliagui ? Dans ces magasins d’occasion ?
Suite à la Seconde Guerre mondiale, les biens étrangers entrent d’abord en Union soviétique sous forme de butin de guerre, de trophées saisis par les soldats et les officiers de l’Armée rouge. Ensuite, ils entrent avec les touristes. Des fartsovchtchiki – des spéculateurs, selon le langage officiel, qui vendaient des biens de production étrangère – allaient voir les touristes étrangers et leur demandaient d’acheter leurs chemises, leurs chaussettes, tout ce qu’ils pouvaient. Puis le trafic s’est développé, et des « touristes » bien informés amenaient intentionnellement des biens à revendre parallèlement au développement des magasins d’occasion.
Même si, au début, le stiliaguisme s’est fondé sur l’usage des biens de production étrangère, la plupart de ces jeunes fabriquaient des vêtements à partir de matériaux et de vêtements soviétiques. Avant que leur style ne soit repris par les créateurs, ils rétrécissaient leurs pantalons, ils amenaient leurs chaussures chez le cordonnier pour y faire mettre des semelles compensées. Ils bricolaient ce qu’ils imaginaient être de la mode occidentale. D’ailleurs, plusieurs mémoires écrits par des stiliagui racontent leur stupeur lorsqu’ils rencontrèrent la vraie jeunesse occidentale, lors du Festival de la jeunesse de 1957 : ce qu’ils avaient imaginé n’avait rien à voir avec les pratiques quotidiennes des jeunes occidentaux, habillés de manière très simple, beaucoup moins sophistiquée qu’eux.
Des règles officielles d’attribution de vêtements existaient-elles (quotas, contrôle de l’usure) ?
Non, hormis pendant les périodes où les cartes de rationnement étaient instaurées, et où il y avait des normes d’attribution des produits de consommation ordinaires. C’est-à-dire, lors de la guerre civile (de 1917 à 1921), puis avec les grandes politiques de planification et d’industrialisation (de 1928 à 1935), pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu’en 1948, puis sous l’époque gorbatchévienne, mais cela ne concerne alors que les biens alimentaires.
En deux mots, comment la mode socialiste a-t-elle évolué jusqu’à la fin du régime ?
Après la période du Dégel, dans les années 1960 et 1970, le système soviétique parvient à améliorer les conditions de production, les salaires augmentent, le pouvoir d’achat aussi (c’est ce que l’on appelle le contrat social brejnévien), le phénomène de reproduction des élites s’installe durablement, les canaux d’arrivage des produits occidentaux se multiplient, les jeans apparaissent sur le marché soviétique, l’industrie soviétique essaie de les reproduire…
Je n’ai pas fait d’enquête pour la période postérieure, mais je sais que la femme de Gorbatchev, Raïssa Gorbatcheva, a fait en sorte qu’un magazine de mode ouest-allemand, Burda moden, soit traduit en russe. Avec la Perestroïka, la distinction discursive entre une mode soviétique et une mode bourgeoise perd définitivement sa raison d’être.
La koultournost’
Dans une brochure moscovite publiée en 1938, la koultournost’ est définie comme « un ensemble d’attitudes dans la vie quotidienne : “l’homme cultivé’’ ne jure pas, ne crache pas… Il sait se tenir à table, se montrer galant avec les dames, il connaît les bonnes manières. Il apprécie la musique, le ballet, mais ce qu’il aime par-dessus tout, ce sont les livres. » Apparue dans les années 1930, la lutte pour la koultournost’ correspond à la volonté de « civiliser » les Soviétiques. La koultournost’ s’éloigne de la notion de capital culturel, car elle ne se réduit pas à une accumulation de connaissances dans les domaines de la culture dite légitime (art, littérature, musique, formation scolaire, etc.). Elle s’apparente davantage à la notion de « civilisation des mœurs » avancée par le sociologue Norbert Elias. Modèle de l’« homme cultivé », au même titre que la soznatel’nost’ (conscience sociale), la koultournost’ comprend une forte dimension hygiénique (aspect propre, apparence soignée), la diffusion des bonnes manières (gestes, expressions verbales), des normes du bon goût et du sens esthétique, le partage d’un niveau d’éducation jugé acceptable ainsi que des bases de connaissances sur l’idéologie soviétique. Cette stratégie d’intégration au moyen de valeurs et de pratiques communes était notamment dirigée vers les paysans qui arrivaient en ville pour gonfler les rangs des ouvriers.
by jefklak | 15 décembre 2016 | Genre rage
La question de l’émancipation des femmes est loin d’être résolue. Mona Chollet est de celles qui s’attachent à décrypter les mécanismes persistants d’infériorisation des femmes. Dans Beauté fatale. Les nouveaux visages d’une aliénation féminine (Zones, 2012 ; La Découverte, « Poches/Essais », 2015), elle montre à quel point l’inégalité des droits s’est muée en censure mentale, et comment les contraintes ont été intériorisées à coup d’injonctions à respecter le modèle de féminité dominant. Son dernier ouvrage, Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique (Zones, 2015 ; La Découverte, « Poches/Essais », 2016), tente quant à lui de déconstruire l’image toute faite du foyer et d’en explorer les potentialités émancipatrices, prenant ainsi à contre-pied la vision du foyer comme structure reproductrice d’inégalités, garant de l’ordre social et entérinant le modèle familial. Comprendre et lutter contre la domination masculine passe par la nuance. Entretien.
Téléchargez l’entretien en PDF.
Comment s’articulent dans ton dernier livre les deux axes, en apparence contradictoires, entre l’utopie d’un foyer émancipateur et le foyer comme symptôme de l’esclavage domestique ?
Le foyer comme lieu d’esclavage et d’aliénation est une image aujourd’hui évidente pour tout le monde. Grâce à l’apport féministe, on est conscient des enjeux du travail ménager. Même si les choses bougent peu, c’est très présent dans les consciences, et les inégalités sont moins faciles à faire accepter qu’avant : pour qui veut les reproduire, il faut de nouvelles ruses. À côté de ça, le foyer renvoie à l’image négative du pantouflard qui aime le confort.
J’avais ces deux images en tête et l’envie de les dépasser, de montrer sous quelles conditions le foyer devient un lieu émancipateur – même s’il ne suffit pas de rentrer chez soi et de fermer la porte pour cela. J’avais aussi envie de défendre le travail domestique, la plupart du temps vécu par les femmes – à raison – comme une corvée, une oppression. Or, même si c’est rarement possible, dans l’absolu, il peut avoir beaucoup de vertus s’il est fait dans de bonnes conditions, s’il est égalitairement réparti, s’il s’inscrit dans un emploi du temps pas trop dément. Il permet une prise immédiate sur son environnement, il nous permet d’empoigner ce qui nous concerne directement.
C’était l’occasion également d’interroger les modèles communément admis, comme celui de la configuration familiale. L’injonction à se mettre en ménage n’est jamais remise en question, même quand les conditions financières permettraient une alternative. Tout le monde semble toujours admettre qu’au-delà d’un certain âge, la vie doit ressembler à ça ; tous les arrangements un peu différents (habiter seule ou avec des gens qui ne sont pas de sa famille) demeurent réservés aux années d’études. Après, les choses sérieuses commencent, et on doit rentrer dans le rang.
Les perspectives ont elles changées depuis les axiomes posés par Virginia Woolf dans son livre Une chambre à soi, où elle prône l’autonomie matérielle, à la fois un revenu indépendant et un espace tranquille pour écrire, comme nécessaire au développement d’une liberté intellectuelle ?
Le texte de Woolf demeure très important en ce qu’il montre l’envers de l’enfermement des femmes. À certaines conditions, le cadre domestique peut être pour elles un lieu de liberté et pas seulement d’oppression. Mais cela implique de faire un sort à la figure idéale de la femme au foyer, encore terriblement ancrée dans les mentalités, et présentée comme un idéal d’épanouissement : assurer le travail domestique pendant que le mari se consacre aux activités intellectuelles, artistiques ou scientifiques. Le monde du travail est tellement dur et inhospitalier – et d’autant plus ingrat pour les femmes, évidemment – qu’il est assez facile de ré-enchanter le foyer comme un lieu protecteur, que l’on façonne soi-même et où on est entouré uniquement de gens que l’on a choisis ou qui sont de son sang. C’est une image classique hyper rassurante, dès lors qu’on a besoin de se réfugier loin du monde du travail. Mais, dans une société où bien souvent les couples se séparent, diminuer ou arrêter son activité salariale implique une énorme mise en danger. Cela contribue aussi à enfermer les femmes dans des rôles très limités, et cela entretient les représentations stéréotypées – même quand c’est repeint et vendu sous les couleurs du lifestyle et de la bonne cuisine. Finalement, l’envers de cette image-là, la célébration des femmes douées pour rendre la maison idyllique, est une manière implicite de montrer celles qui ont une activité intellectuelle ou un travail épanouissant comme des femmes dénaturées. J’avais lu une étude sur la manière dont la presse du début du XXe siècle présentait une image merveilleuse des foyers d’écrivains où la femme servait à la fois de secrétaire et de boniche. À l’inverse, les couples qui partageaient une activité artistique, scientifique ou intellectuelle étaient présentés comme formant des foyers tristes, le sommet de la désolation – Pierre et Marie Curie, notamment. Aujourd’hui, cela n’a pas tant changé…

L’utopie d’un foyer émancipateur n’est-il pas de fait réservé à une élite de privilégiés ?
Oui, je consacre beaucoup de pages à montrer pourquoi, dans les faits, c’est rarement possible ! En particulier, le fait que le travail soit autant déstructuré aujourd’hui, que les femmes soient souvent employées à temps partiel avec des horaires flexibles, morcelle complètement les loisirs. Je cite l’exemple d’une ouvrière qui a l’impression que les chefs font exprès de fractionner son temps de congé et de loisir, de sorte qu’elle n’a jamais plusieurs jours de repos d’affilée. Dès lors, le peu de temps passé à la maison ne peut être que consacré à faire les vitres ou aux lessives en retard. C’est une course permanente qui ne laisse jamais de vrai temps à soi. J’ai lu dernièrement le témoignage d’une esthéticienne qui louait son appartement pour n’y passer que son temps de sommeil, tellement ses amplitudes horaires de travail étaient grandes. Comment développer un lien avec le lieu où l’on vit dans de telles conditions ?
Cela dit, penser le foyer comme émancipateur semble aussi difficile pour les classes moyennes ou supérieures. Dans pas mal de foyers riches, la maison n’est pas vraiment habitée. Au-delà de ça, le modèle dominant du travail à temps plein fait en sorte que tout le monde est crevé quand il rentre chez lui, a peu de temps de loisirs pour paresser sans regarder sa montre. C’est étonnant, puisqu’on a l’impression de vivre dans une société qui exalte le plaisir domestique… Mais c’est seulement dans le but de nous vendre des appareils électroménagers, des meubles design, plutôt que pour nous proposer un lieu bienfaisant en tant que tel. Le manque d’espace fait que les gens sont les uns sur les autres, ou qu’ils habitent très loin en banlieue et passent leur temps dans les transports. Finalement, on observe une sorte d’empêchement, d’arrachement pour tout le monde. Et puis, durant le peu de temps qui reste, il faut sortir, partir en voyage dès qu’on a trois jours de libres. Tout se conjugue pour empêcher le simple fait de profiter de ce lieu.
La domination masculine est moins visible et semble plus intériorisée. On observe encore un grand écart entre loi et réalité.
L’enfermement physique dans le cadre du foyer a été remplacé par un enfermement symbolique – c’était la thèse de Naomi Wolf dans Le Mythe de la beauté, mais aussi de Susan Faludi dans Backlash. Les femmes ont intégré des univers autrefois uniquement masculins, comme le travail salarié ou la politique. Mais elles doivent encore s’y faire accepter, et elles ont toujours tout faux ; c’est pratiquement mission impossible.
Il faut être crédible, donc pas trop jolie pour ne pas donner l’impression qu’on est arrivée là grâce à son physique (cette idée qu’une femme belle est forcément bête), et en même temps rester féminine, sinon on est vue comme une femme dénaturée, trop masculine, etc.
Par exemple, le regard sur la minceur dans le milieu professionnel est assez intéressant : il s’agit à la fois d’effacer le corps maternel nourricier trop lié à l’univers du foyer et de composer avec le sentiment de culpabilité d’être là, donc faire en sorte de ne pas prendre trop de place avec son corps. Se faire toute petite, au sens littéral. Le diététicien Gérard Apfeldorfer dit qu’un corps de femme idéal, c’est un corps d’homme avec des seins. Et c’est vrai, pas trop de hanches ni de formes : l’idéal est de pouvoir être identifiée dans le monde du travail comme un corps efficace. Cette surveillance qui s’exerce sur le corps des femmes dans les milieux professionnels et politiques est toujours une manière de leur rappeler qu’elles ne sont pas légitimes dans ces univers. Les ramener à leur physique, c’est une manière de nier leur parole et leurs compétences. Une manière de les rejeter, de leur dénier le droit d’être là.
Le rapport à la parole est régi par les mêmes mécanismes. Même si les femmes parlent trop peu, on trouve qu’elles parlent toujours trop. La part de parole masculine en réunion demeure écrasante. C’est dur de se faire entendre. Aujourd’hui encore, les femmes ont plus tendance à bégayer, elles sont moins sûres d’elles. Les réunions non mixtes prennent alors tout leur sens : un lieu où l’on prend confiance en soi, pour ensuite prendre sa place dans les réunions mixtes[2. Voir https://infokiosques.net/spip.php?article239.]. Exercer son droit de parole, occuper pleinement sa place d’oratrice, c’est quelque chose qui ne vient pas spontanément : il faut se créer l’occasion de s’entraîner pour trouver un sentiment de légitimité.
L’idéal de féminité paraît construit par la classe dominante, mais les idées féministes sont-elles transclasses ?
Ce qui m’a frappée en travaillant sur la beauté, c’est qu’il y a tout un travail pour dissimuler le fait que ce qui est prôné, c’est une beauté de femme riche. C’est frappant dans les discours de stars qui donnent leurs secrets pour être toujours belle à 50 ans : en général, ce sont des femmes très fortunées, qui ont consacré leur vie à soigner leur corps et n’ont jamais fait de boulot pénible. On aura beau lire tous les secrets de beauté dans les magazines, il n’y a pourtant pas de miracle : tout le monde n’a pas accès aux meilleurs soins de santé, aux produits de beauté, éventuellement aux opérations chirurgicales, ou encore au sport. Toute une somme de moyens sont mis en œuvre, puis escamotés, pour faire culpabiliser les femmes qui ne ressemblent pas à ce modèle-là à 50 ans. Alors que c’est humainement impossible ! Enfin, socialement impossible, pour être plus juste.
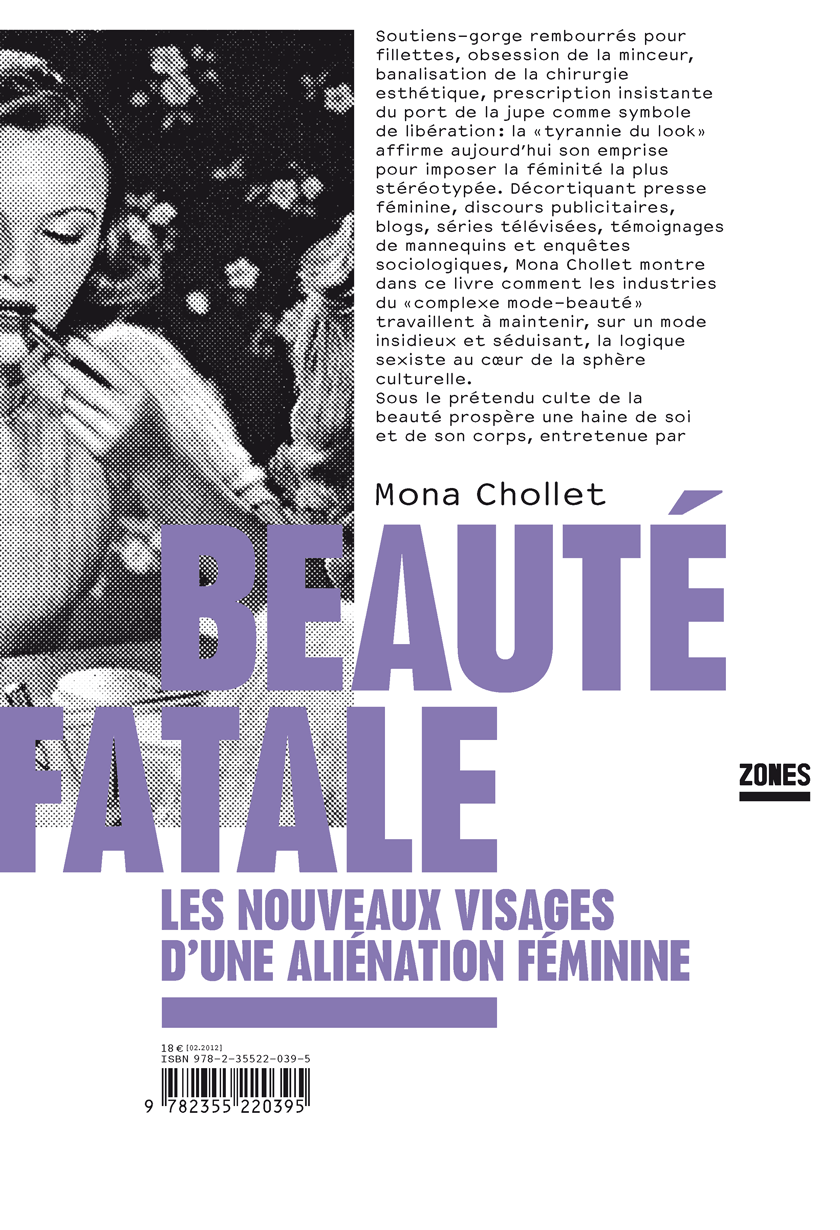
Il est parfois difficile d’adapter théorie féministe et pratique de vie. Sur le chemin de l’émancipation de la norme patriarcale, on se retrouve souvent à lutter contre nos propres désirs correspondant à l’imaginaire dominant.
Quand Beauté fatale est sorti, j’ai découvert une théorie selon laquelle dénoncer l’imposition de certains modèles revenait à exercer soi-même une tyrannie. On m’a reproché d’opprimer les femmes en leur interdisant de se faire refaire les seins. Ce discours me sidère, puisqu’il passe sous silence le fait que ce genre de désir n’est pas spontané, qu’il y a tout un climat qui le nourrit. Ces injonctions, on ne nous les adresse pas toujours directement, mais on les a intégrées de manière très profonde. Nos désirs sont façonnés par certaines normes. Derrière la mise en place de ces idéaux, il y a une machine de guerre énorme : la pub, la télé, les discours des magazines, les fausses évidences, les préjugés de l’entourage. Des forces puissantes se conjuguent pour imposer ces modèles-là. En face, la critique est toujours minoritaire, elle ne dispose pas des mêmes moyens, le rapport de force est trop inégal. Et tout cet appareil idéologique se défend quand on l’attaque : tous les stéréotypes négatifs sur les féministes sont autant de réactions venant du système qu’elles attaquent. Par ailleurs, loin de moi l’idée d’édicter une norme, ou de juger les femmes qui portent des talons, ou qui sont très maquillées, ou très minces ; mon propos n’est sûrement pas non plus de dénoncer comme frivoles ou superficielles les femmes attentives à leur apparence. De toute façon, je suis prise moi-même dans ces ambivalences, ces fascinations et ces injonctions, et je n’ai de leçons à donner à personne. Ce que je cherche, c’est à analyser tout cela, à y réfléchir, à le comprendre. Après, le comprendre ne veut pas dire qu’on s’en libère, ce serait trop beau, trop facile. Ce sont des forces puissantes face auxquelles on pèse bien peu. Je suis très attentive à la façon dont chaque femme se débrouille avec elles. Par exemple, sur Twitter, j’ai longtemps suivi une féministe qui lançait des tweets hyper vengeurs sur le patriarcat et qui enchaînait sur la dernière marque de fond de teint achetée. J’aimais bien ce côté décomplexé. Elle n’essayait pas de dissimuler le fait qu’elle était conditionnée comme tout le monde. De fait, il y a une énorme ambivalence chez toutes les femmes, entre une fascination pour tout ce qu’on a intégré comme normes et comme préoccupations, et un rejet aussi énorme, mêlé d’une exaspération totale. Tout cela cohabite. Cela m’intéresse de voir comment chacune négocie avec les injonctions sociales. Comment et pourquoi on ne se bat pas contre certaines normes tandis qu’on va en rejeter d’autres radicalement. Ça évolue au fil du temps, aussi : à telle époque, on est sensible à telle norme et pas à telle autre et puis ce sera l’inverse. On est condamnée à bricoler, en fait, mais comprendre les ressorts de l’aliénation n’est jamais peine perdue.
Dans Beauté fatale, je raconte comment moi-même je me suis fait reprogrammer le cerveau par une nutritionniste : je suis devenue très sensible aux variations de mon poids, alors que je n’y avais jamais fait attention avant. Je me suis mise à vivre avec cette norme-là, et aujourd’hui encore, je me rends compte que, quand au boulot quelqu’un apporte un gâteau, toutes les femmes, moi comprise, se disent « mince, je vais grossir » – alors que les mecs se jettent dessus. Mais au final, je suis contente d’avoir travaillé sur l’injonction à rester mince, puisque, au sens littéral, c’est l’injonction à ne pas prendre trop de place. Je pense que d’en avoir conscience me protège malgré tout. Comprendre les mécanismes cachés derrière aide à relativiser, à ne pas faire reposer l’essentiel de l’estime de soi-même là-dessus.
Les femmes parviennent-elles à se libérer de l’emprise du regard de l’homme et à prendre position comme sujets?
En tant que femme, on est toujours encouragée à se demander comment on est perçue, de quoi on a l’air, si on est désirée ou pas, et pas tellement ce qu’on désire soi-même, ce qu’on pense, comment on juge les autres… Ce déséquilibre-là est ravageur, il nous fragilise terriblement. On se laisse ballotter au gré du regard et du jugement des autres au lieu de se demander de quoi on a envie et de s’affirmer en tant que sujet. L’enjeu derrière la beauté est là : dans le déséquilibre entre la dimension d’objet et la dimension de sujet. Ce déséquilibre est évident dans la culture et dans l’art. Aux États-Unis, le groupe d’artistes féministes Guérilla Girls dénonce le sexisme à l’œuvre dans les musées en montrant le décalage entre la faible représentation de femmes artistes exposantes et à l’inverse la surreprésentation de femmes nues exposées. Les femmes ne sont pas incitées à développer leur vision du monde et à s’affirmer ou à développer leur personnalité, mais à se constituer comme des objets d’agrément, un peu décoratifs.
Je ne nie pas du tout que la dimension d’objet existe dans une certaine mesure pour tous les êtres humains, nous ne sommes jamais de purs sujets, mais c’est intéressant de voir comment la plupart des hommes privilégient leur dimension de sujet, souvent presque exclusivement : ils accordent de l’importance à leurs désirs, leurs jugements, leurs pensées. Ils ont tendance à voir les femmes comme des objets alors qu’ils s’objectifient eux-mêmes très peu – ils s’en foutent de la façon dont ils sont habillés ou coiffés, ou de leur poids. Les conséquences de ce déséquilibre sont flagrantes dans les cas de violences conjugales. Les femmes grandissent tellement avec l’idée qu’elles doivent plaire à tout prix que si quelque chose ne va pas dans leur couple, elles pensent que c’est forcément de leur faute. Elles ne sont pas poussées à s’affirmer, à faire confiance à ce qu’elles ressentent, à refuser ce qui ne leur va pas. C’est une éducation au masochisme encore assez présente. L’image de la femme dévouée, de l’abnégation féminine règne encore. On refoule sa colère parce qu’il faut rester la femme douce, agréable et ne pas faire de vagues.
Les garçons sont aussi élevés pour se conformer à un modèle, mais c’est un modèle de force – et ils souffrent quand ils ne correspondent pas à ce critère (lorsqu’ils sont chétifs ou vulnérables, par exemple). Ce qu’on apprend aux filles, c’est à être en position de faiblesse[3. Voir https://antisexisme.net/2016/02/06/impuissance-04/.]. Les stéréotypes de beauté l’expriment très bien : porter des chaussures avec lesquelles on ne peut pas courir, des vêtements qui entravent le mouvement, cultiver un petit gabarit, en un mot être la faible créature qu’un homme doit avoir envie de protéger – mais qu’il peut aussi agresser. La reproduction d’inégalité et de domination se joue structurellement sur l’éducation des enfants.






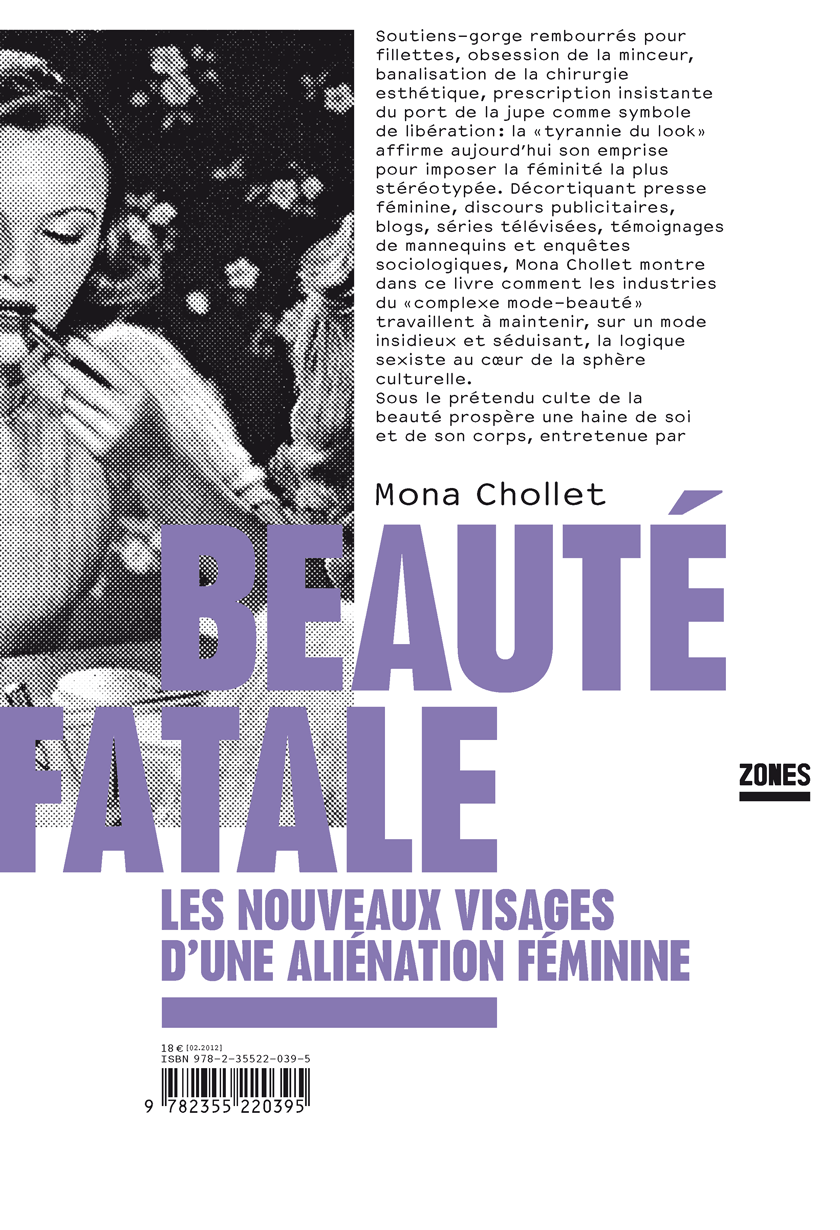
Recent Comments