by jefklak | 30 janvier 2017 | Bout d’ficelle, Culture de base, Dé-colonialités
Traduit de l’américain par le collectif Angles morts
1966, le mouvement Black Power est en pleine ébullition, le Black Panther Party vient de se créer et le premier super-héros noir apparaît dans les strips de Marvel Comics. « T’Challa, la Panthère Noire » évolue dans le Wakanda, nation africaine indépendante au développement technologique avancé. Les Noirs représentés au sein de cette Black Nation fictionnelle sont médecins, hommes politiques ou simples soldats pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs désireux de bousculer les représentations. Malgré les diverses tentatives de Marvel Comics pour en affaiblir la dimension politique, la Panthère Noire et le Wakanda ont porté haut les couleurs de la communauté africaine-américaine, comme en attestent les courriers des lecteurs, témoins de cette lutte symbolique au sein de la culture populaire des années 1960-70.
Cet article est paru dans le numéro 2 de Jef Klak, « Bout d’ficelle », encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF.
En juillet 1966, trois mois seulement avant la création du Black Panther Party à Oakland, en Californie, Marvel Comics présente La Panthère Noire (The Black Panther), premier superhéros noir admis dans l’univers immortel des comic books américains. D’abord conçue par Stan Lee et Jack Kirby sous le nom de « Tigre de Charbon », la Panthère Noire est officiellement intronisée dans « l’Univers Marvel » dans le numéro 52 des Quatre Fantastiques, un titre immensément populaire à l’époque.
Héritière de la couronne du Wakanda, une nation africaine cachée, la Panthère Noire est dotée de la puissance, de la vitesse, des sens, des réflexes et de l’agilité d’une panthère, lui conférant ainsi des pouvoirs surnaturels. Elle n’est pas le premier personnage noir dans les comics américains, mais c’est le premier à être doté de super-pouvoirs, une avancée que Marvel qualifie fièrement d’« événement révolutionnaire ». Quelques semaines à peine avant le lancement de la Panthère Noire, la police de Greenwood, dans le Mississippi, jetait Stokely Carmichael en prison, accusé d’avoir mené une foule de trois mille marcheurs pour les droits civiques, défilant sous un nouveau mot d’ordre : « Pouvoir Noir ! »
Pouvoir et Pulps
« Le thème des comics, c’est le pouvoir », déclara un jour Carmine Infantino, longtemps rédacteur en chef du label concurrent de Marvel : DC Comics. Sachant que les exploits hauts en couleur des superhéros et leurs super-pouvoirs servent de fonds de commerce à la plupart des comics, sa déclaration pourrait sembler singulièrement creuse. Elle est cependant loin d’être naïve pour analyser les relations entre représentations des super-pouvoirs dans les comics et perceptions du pouvoir politique et social dans l’imaginaire culturel américain.
Durant l’intense période politique des mouvements contre-culturels américains des années 1960 et 1970, les luttes sociales trouvent souvent un écho dans les pages de comics de superhéros populaires. Leur regain de popularité à cette époque est principalement dû à l’équipe innovante et audacieuse de Marvel Comics. Menée par un prolifique noyau dur constitué de Stan Lee, Steve Ditko et Jack Kirby, la maison d’édition réinvente le genre au début des années 1960, en rejetant le modèle de l’ère Superman, celui du superhéros classique conçu comme un noble sauveur surplombant l’humanité, au profit d’un nouveau type d’antihéros, embourbé dans des problématiques existentielles comme Monsieur tout le monde : un antihéros pour qui avoir des super-pouvoirs relève davantage d’un fardeau aliénant que d’un don libérateur.
En 1971, dans un article du New York Times Magazine, « Shazam ! Here comes Captain Relevant », Saul Braun a mis en lumière l’essor de cette réaction contre-culturelle, dirigée à la fois contre les clivages traditionnels liés à la guerre froide et contre les représentations des super-pouvoirs qu’elles impliquent :
« Il me paraît intéressant de remarquer que, à de rares exceptions près, la guerre du Viêtnam n’a pas suscité de résistance parmi une génération qui voyageait à travers le monde, avec une vision fantasmée du pouvoir. En revanche, elle a suscité, dans l’ensemble, l’opposition de la génération suivante qui, elle, a commencé à rejeter les comics des années 1950, avec leurs représentations du monde aseptisées, censurées et irréelles. Un monde dans lequel “nous” étions les bons et “eux” les méchants, dans lequel nous pouvions faire passer le non-respect des lois pour de l’héroïsme, un monde dans lequel les Noirs étaient invisibles. […] Un monde dans lequel aucun superhéros, en dépit des excès auxquels il pouvait se livrer, ne doutait jamais qu’il utilisait ses pouvoirs de façon sage et morale. »
A contrario, durant les années 1960-70, l’élite des mouvements de jeunesse américains est prise d’un soudain penchant pour les nouveaux superhéros de Marvel. En septembre 1965, Esquire magazine note que « Spiderman est aussi populaire que Che Guevara dans la frange radicale des universités américaines ». Un an plus tard, le même journal se penche à nouveau sur l’immense popularité des comics Marvel pour la jeunesse de l’époque, ainsi que sur la façon dont Stan Lee a accédé au rang d’icône :
« Le club de débat de l’université de Princeton a invité Stan Lee, auteur de dix comics de superhéros publiés par Marvel, pour s’exprimer dans le cadre d’une série de conférences aux côtés de Hubert Humphrey, William Scranton et Wayne Morse. [Stan Lee] a par ailleurs été invité à Bard (où il a attiré une audience plus grande que le président Eisenhower), à l’université de New York et à Columbia. […] Comme lui a confié un membre de l’Ivy League[2. NdT : Surnom donné à un ensemble de huit universités américaines, réputées les plus prestigieuses.] : “Les comics Marvel sont pour nous la mythologie du XXe siècle. À nos yeux, vous êtes le Homère de cette génération.” »
Le syndrome Superman
La défiance à l’égard du modèle classique des super-pouvoirs s’étend également au mouvement naissant du Black Power. Ce dernier emploie alors souvent le terme « Superman » pour symboliser les structures de pouvoir américaines dominées par les Blancs. Lors du procès des Sept de Chicago en 1969[3. NdT : Les Sept de Chicago étaient sept activistes, accusés notamment de conspiration contre le gouvernement, suite aux révoltes qui marquèrent la convention du Parti démocrate en 1968 à Chicago. Bobby Seale, qui devait initialement être jugé à leurs côtés, fit l’objet d’un procès à part. Ligoté et bâillonné pendant son procès, il fut condamné à quatre ans de prison pour outrage à magistrat.], dans l’une de ses interventions explosives devenues célèbres, Bobby Seale, président du Black Panther Party, dénonce « cette administration raciste, avec ses notions inspirées de Superman et sa politique digne des comics. Nous savons bien que Superman n’a jamais sauvé aucun Noir ». Pendant une audience, Seale provoque également le juge Julius Hoffman en déclarant : « Les Noirs ne sont-ils pas supposés être dépourvus d’esprit ? C’est ce que vous pensez. Nous avons pourtant un corps et un esprit. Je me pose la question suivante : n’avez-vous pas perdu le vôtre à cause du syndrome Superman et de toutes ces histoires de comics ? »
Dans son ouvrage intitulé Seize the time: the story of the Black Panther Party and Huey P. Newton, Seale utilise également le terme « Superman » pour désigner un agent du FBI auquel il a été confronté à Oakland le 16 août 1969 : « Il m’a regardé, arborant un large sourire. Il se prenait pour Superman. D’un simple regard, il était facile de voir à quel point il a été psychologiquement abruti par des concepts à la Superman. Il a subi un tel lavage de cerveau qu’il est persuadé de défendre le prétendu “monde libre”. » De même, le poète et musicien Gil Scott-Heron, auteur en 1970 de l’hymne désormais célèbre du Black Power « The Revolution will not be televised », composa un autre morceau intitulé « Ain’t no such thing as Superman ». Le rejet du concept de « Superman » et de la culture américaine des comics par Seale et Heron, montre que pour le Black Power, dans ses différentes composantes, la catégorie de « superhéros » incarne dès le départ un symbole mythique supplémentaire des super-pouvoirs exclusivement blancs – et méritait donc d’être déconstruite de façon critique.

La panthère surgit
C’est au sein de cette culture comics politiquement chargée que la Panthère Noire apparaît en 1966. Présentée dans le numéro 52 des Quatre Fantastiques, la Panthère Noire, également connue sous le nom de T’Challa, règne sur le royaume caché du Wakanda, situé dans les profondeurs de l’Afrique équatoriale. Le Wakanda abrite la seule source d’un métal précieux, le « vibranium », qui absorbe les vibrations et qui lui confère une valeur inestimable pour le développement technologique partout dans le monde. Le père de T’Challa fut tué par un chasseur d’ivoire, un Blanc du nom d’Ulysse Klaw qui tentait de prendre le contrôle des réserves de vibranium de Wakanda. T’Challa parvint à faire fuir Klaw et ses sbires du Wakanda, prétendit au rang de chef de la tribu en faisant valoir son statut d’héritier, et accepta les pouvoirs sacrés et mystérieux inhérents au titre de Panthère Noire. Peu après sa prise de pouvoir, le nouveau chef mit son propre génie scientifique au service de la transformation de son pays. Ce qui n’était que jungle devint une forteresse technologique moderne grâce à la vente « de petites quantités de vibranium à plusieurs fondations scientifiques, ce qui [lui] permit d’amasser une fortune, pareille à nulle autre sur la terre ! »
T’Challa fait preuve de ruse pour attirer les Quatre Fantastiques dans son pays afin d’éprouver ses grandes aptitudes de guerrier, en vue d’un combat final avec Klaw. La Panthère Noire parvient presque à battre les Quatre Fantastiques dans la jungle, en utilisant contre chacun d’eux une série d’ingénieux pièges techniques, finalement déjoués à cause de Wyatt Wingfoot, ami amérindien de l’équipe, qui n’est pas un superhéros et que la Panthère a négligé. Elle révèle par la suite que son objectif n’était pas de blesser les Quatre Fantastiques, mais de s’entraîner au combat en prévision de l’invasion imminente de Klaw. Prenant conscience des nobles intentions de la Panthère Noire, les quatre super-héros lui pardonnent, peu avant que l’on apprenne que Klaw est parvenu à franchir la frontière de Wakanda. En guise de symbole du respect pour le superhéros africain, les Quatre Fantastiques apportent leur aide pour vaincre Klaw et invitent T’Challa à se joindre à eux dans leur campagne mondiale contre le Mal.
Un enthousiasme mesuré
Les lecteurs s’empressent de répondre à la présentation par Marvel de son premier superhéros noir, et les réactions publiées sont dès le départ extrêmement positives. La première lettre, envoyée par un certain Henry Clay, de Détroit, paraît dans le numéro de novembre 1966 des Quatre Fantastiques :
« Je me réjouis de voir que vous avez rompu avec les traditions de votre profession et introduit un Noir en tant que héros sous les traits de Gabe Jones, le sergent Fury, un homme de la rue. Ce sujet, avant Marvel, semblait être un tabou implicite, mais désormais, un véritable superhéros noir existe ! Cela m’a presque fait danser des claquettes et déambuler, abasourdi, en répétant : ”Quelle bonne nouvelle… Quelle bonne nouvelle… !” Sa présentation, ses origines et son premier combat contre un véritable super-vilain en chair et en os, tout était superbe ! J’espère le voir bientôt dans son propre comic. »
Le numéro suivant des Quatre Fantastiques comporte bien plus de lettres de soutien. Linda Lee Johnson, de la Nouvelle-Orléans, félicite Lee et Kirby en déclarant : « Bravo à vous ! […] Vous êtes les premiers, les tout premiers à créer et présenter un superhéros noir. […]C’est vraiment merveilleux ! » Dans la même rubrique du courrier, Edward Koh de New Haven dans le Connecticut ajoute : « Je voudrais vous dire, Stan, combien j’ai été touché et fier de vous voir prendre position pour une cause qui le mérite. […] Vos grands idéaux dans le domaine de l’éducation et pour d’autres questions morales et sociales me rendent fier d’être un lecteur de Marvel. »
Si ces lettres louent l’audacieuse innovation de Marvel, la plus éloquente et astucieuse de ces premières réponses reste sans doute celle de Guy Haughton du Bronx, à New York, publiée dans le numéro de février 1967 des Quatre Fantastiques :
« Croyez-le ou non, mais vous êtes véritablement en train de faire diminuer la tension qui caractérise notre époque. Je pèse mes mots, vraiment. Il est si réconfortant pour un jeune Noir tel que moi – après avoir entendu parler toute la journée d’émeutes et d’explosions raciales – de s’asseoir, d’ouvrir un magazine Marvel et, disons, en page 2, dans la septième case, de voir un homme de couleur marcher dans la rue. Vous, mes amis, ne le comprendrez sans doute jamais, mais c’est quelque chose d’exaltant. C’est psychologiquement revigorant – oui, même dans quelque chose d’aussi modeste qu’un comic – de voir la race noire reconnue. […] Puis vous êtes arrivés avec la Panthère Noire. […] Je ne veux pas avoir l’air mélodramatique, mais je voudrais saluer votre courage, car il faut en effet du courage pour faire ce que vous avez fait. […] Mes amis, vous faites plus que divertir les masses, vous promouvez le respect humain et œuvrez pour un monde meilleur. »
La question de la terre natale de la Panthère Noire est pourtant soulevée dès les premières réactions de lecteurs. Le commentaire final de Haughton suggère que le choix de faire du superhéros un Africain plutôt qu’un Africain-Américain s’apparente à une esquive politique – une décision qui permet à Marvel d’être branché et pertinent tout en maintenant prudemment les super-pouvoirs noirs loin du tumulte du Black Power qui retentit dans les rues des États-Unis : « Un petit bémol tout de même. […] C’est bien, vous avez créé un superhéros noir, mais pourquoi doit-il être chef de tribu africain et ainsi de suite ? N’aurait-il pas pu être un simple Américain ? Si vous aviez créé un superhéros italien, serait-il le Ferrari Masqué ?? » Sur la question des super-pouvoirs noirs, Haughton semble davantage intéressé par qui est digne d’exercer de tels pouvoirs. L’aspect le plus important de la Panthère Noire n’est pas son pays ou même ses super-pouvoirs, mais plutôt sa condition de Noir (blackness) – et plus cette blackness est ordinaire, mieux c’est.
D’autres lecteurs ont relevé la banalité des pouvoirs du nouveau superhéros, un sentiment sans doute formulé de la manière la plus concise par Russell Bullock Jr. de Fembroke, dans le Massachusetts, pour qui « la “Sensationnelle Panthère Noire” est tout à fait déprimante ». En fait, les créateurs du superhéros, Lee et Kirby, se sont montrés indifférents à ses véritables super-pouvoirs. Plutôt que d’inventer une origine fascinante aux dons de la Panthère Noire, ses concepteurs ont réglé cette question par un mysticisme pseudo-ethnographique brumeux, en évoquant « un secret – transmis de chef de tribu en chef de tribu ! Nous ingérons certaines plantes et subissons de rigoureux rituels dont il m’est interdit de parler ! ».
Ce qui a stimulé l’imagination de Lee et Kirby réside dans le pays de la Panthère Noire lui-même, le Wakanda. Tandis qu’ils ne consacrent qu’une seule case, celle qui est évoquée précédemment, à la description des super-pouvoirs de la Panthère Noire, Kirby remplit pages après pages pour décrire les méandres de branches mécaniques mystérieuses de la pseudo-jungle du Wakanda. Lee, quant à lui, comble la narration par une succession d’exclamations émerveillées à la vue de ce paradis artificiel. Après tout, les Quatre Fantastiques ont presque plus été vaincus par la jungle du Wakanda que par les super-pouvoirs de la Panthère Noire. Pour Lee et Kirby, le paysage du Wakanda, avec sa richesse technologique, recèle la composante la plus « super » du personnage de la Panthère Noire. En fusionnant de manière inextricable la figure du superhéros avec deux des utopies américaines les plus marquées par la nostalgie – le passé paradisiaque de l’éden biblique et l’ère spatiale du Tomorrowland de Disney –, Lee et Kirby ont offert une vision surprenante du Super-pouvoir Noir qui tient plus du super-lieu que du super-pouvoir.
Au-delà du Wakanda
En dépit des innombrables merveilles de la terre natale de la Panthère Noire, le personnage lui-même n’est pas destiné à s’éterniser au Wakanda. Après avoir disparu pendant près d’un an des comics Marvel, il refait surface aux côtés de Captain America et d’Iron Man dans le numéro de janvier 1968 de Tales of Suspense, qui prépare le terrain de son voyage à New York en mai 1968 pour rejoindre la puissante équipe américaine de superhéros, The Avengers.
Une étrange transformation s’opère néanmoins au cours de son voyage vers Manhattan : quand il réapparaît en Amérique, le superhéros ne porte plus le nom de « La Panthère Noire », mais s’appelle désormais « La Panthère » ou « T’Challa ». Ce changement de nom inexpliqué ne passe pas inaperçu auprès des lecteurs de Marvel. En août 1968, les éditeurs publient la lettre de Lee Gray, de Détroit : « Le simple fait qu’il soit Noir n’est pas une raison pour supprimer “Noire” de son nom. » En réponse, les éditeurs défendent les auteurs comme suit : « [Ils] ne l’ont certainement pas fait parce qu’il est Noir ! Nous l’avons fait pour réduire le nombre de personnages affublés du qualificatif “Noir” qui se multiplient dans nos magazines : le Chevalier Noir, La Veuve noire et Black Marvel, pour ne citer qu’eux ! » Malgré cette explication, les éditeurs donnent immédiatement suite aux récriminations de Gray, annonçant que « l’assemblée Marvel a de nouveau voté – et vous avez probablement déjà remarqué que La Panthère est redevenue “La Panthère Noire” ! ».
Si ce changement de nom intempestif tente de tenir la Panthère Noire à l’écart du discours racial américain, l’intention tourne court. Dans le numéro de mars 1970 de The Avengers, intitulé « À la poursuite de la Panthère ! », Roy Thomas et John Buscema engagent pour la première fois la Panthère Noire dans un combat aux motifs raciaux, l’opposant à un groupe suprématiste blanc. Au début de l’histoire, le superhéros est capturé par ses adversaires qui entreprennent de salir sa réputation en envoyant un imposteur cambrioler des commerces locaux et attirer l’attention des médias. La situation empire quand deux dirigeants politiques radicaux – Hale, un Africain-Américain partisan du Black Power, et Dunn, un suprématiste blanc conservateur – se lancent dans un débat houleux à la télévision au sujet des récents agissements de la Panthère Noire : elle menacerait de déclencher des émeutes raciales dans le pays tout entier. À la fin de l’histoire, le lecteur découvre que Hale et Dunn sont les véritables coupables qui ont diaboliquement conspiré pour créer cette situation et favoriser leurs propres carrières politiques. La morale du scénario de Marvel ne brille pas par sa subtilité : les extrémistes politiques qui incitent à la haine (hate-mongers[4. NdT : Dans l’univers Marvel, les hate-mongers sont des clones dans lesquels des scientifiques ont transféré l’esprit d’Hitler après sa mort. Ils sont chargés de répandre le Mal. Ici, il faut aussi y voir une référence aux Hate Groups, catégorie utilisée dans le discours médiatique et politique américain pour condamner les groupes « extrémistes » dont la principale caractéristique serait d’inciter à la haine entre les groupes raciaux et sociaux. Cette notion a largement été utilisée pour disqualifier les mouvements nationalistes noirs.]), des deux côtés du débat racial, sont bien souvent davantage guidés par leur soif de pouvoir que par le bien-être de ceux qu’ils prétendent défendre.
Vaine tentative
Sept mois plus tard, Roy Thomas introduit à nouveau la Panthère Noire dans une intrigue construite autour de la question du radicalisme racial. Guest star dans le numéro 69 de Daredevil, « A life on the line », la Panthère Noire fait alors équipe avec le superhéros aveugle pour affronter un groupe de militants noirs, les Thunderbolts, une référence à peine masquée au Black Panther Party du monde réel. Cette histoire signe également la première occurrence de termes racialement connotés tels que « Pouvoir Noir », « Establishment » ou encore « Oncle Tom » en relation avec la Panthère Noire. Dans le déroulement de l’histoire, la Panthère Noire clame : « Cette vermine n’est pas intéressée par le Pouvoir Noir… mais uniquement par le pouvoir des Thunderbolts. » Le leader des Thunderbolts pour sa part, se moque de la Panthère Noire en lui lançant : « Tiens, tiens, voilà donc la Panthère ! L’homme noir originel[5. NdT : Il s’agit là d’une référence ironique à la notion d’homme originel (Original Man), répandue dans la culture populaire noire américaine, et qui fait de l’homme noir le premier homme. Il revient à l’islam noir américain, et notamment à la Nation of Islam, d’avoir développé une mythologie autour de cette question du premier homme noir. Cette notion s’est développée dans plusieurs directions, en s’inspirant des travaux panafricanistes sur les origines africaines de certaines civilisations et en trouvant des prolongements dans des mystiques musulmanes noires américaines comme celles des Five percenters.] de l’Establishment en personne. »
À bien des égards, le portrait de la Panthère Noire par Thomas dans « A life on the line » marque un tournant dans le développement du personnage, qui, à cette époque représente de plus en plus un idéal pour l’émancipation des Africains-Américains, une prise de position polarisant le lectorat comme jamais dans l’histoire des superhéros. L’auteur a ses partisans parmi les fans, dont Evan P. Katten de Bala-Cynwyd en Pennsylvanie, qui écrit : « J’ai été fortement impressionné par le numéro 69 de Daredevil […] L’équipe formée par Daredevil et la Panthère Noire s’annonce prometteuse ! […] Ce pourrait être l’équipe qui s’attaque aux problèmes sociaux – un Blanc aveugle et un Noir, qui représentent malheureusement deux des plus grands handicaps dans le monde d’aujourd’hui, bien qu’aucun ne soit à blâmer pour cela. » Or, bien qu’elle puisse sembler bien intentionnée, l’assimilation du fait d’être Noir à un handicap à laquelle procède Katten va à l’encontre de presque tout ce que le mouvement du Black Power prône à l’époque.
C’est pourquoi, à l’opposé, nombre de lecteurs Africains-Américains voient dans la manière dont la Panthère Noire évolue un affront au Black Power ainsi qu’une description non réaliste de la condition noire elle-même. À rebours des autres courriers publiés dans le même numéro, élogieux pour la plupart, William James de Youngstown, dans l’Ohio, écrit :
« Permettez-moi d’évoquer le numéro 69 de Daredevil et Roy Thomas, ainsi que l’effet que l’histoire a produit sur moi. Étant noir, comme toute autre personne noire, voir un écrivain blanc tenter d’écrire sur nous me fait toujours un peu grincer des dents. Peu importe dans quelle mesure il pourrait être un sympathisant de la cause noire, il ne sera jamais capable de penser comme un Noir. […] La façon dont Thomas dépeint les Noirs, reflétée par le type de dialogues qu’il impose à ses personnages noirs, s’apparente au portrait d’une bande de Blancs à peau noire. […] Ce que je vous conseille, Roy Thomas, c’est de sortir de chez vous et de vous trouver une piaule au cœur du ghetto de Harlem pour capter un peu de quoi on y cause. »
Les critiques de James semblent bien indulgentes comparées au seul courrier publié en réponse au « Pursue the Panther ! » de Roy Thomas dans le numéro 79 de Avengers. Adressée par Philip Mallory Jones d’Ithaca, dans l’État de New York, la lettre réprimande sur un ton cinglant Stan Lee et Roy Thomas pour leurs tentatives biaisées et simplistes de traiter les problèmes raciaux du pays. Jones débute son courrier en se présentant comme « un écrivain noir et lecteur de longue date de vos magazines très souvent sophistiqués ». La première critique de Jones porte sur une caractéristique du personnage : « T’Challa cache le fait qu’il est noir, car il veut être jugé comme un homme… et non comme un type racial ! » Jones avance en guise de réponse : « Voilà bien un raisonnement de Blanc. Cela implique que ce champion de la justice ne pourrait pas être considéré comme un homme si l’on en venait à savoir qu’il est noir, et ce ne serait qu’en étant blanc qu’il pourrait être jugé en tant qu’homme. » Jones accuse également l’histoire d’être uniquement destinée à prouver que la Panthère Noire n’est pas un « voyou » – ce besoin de justification « sous-entend qu’être noir, c’est être un criminel ».
Ces deux courriers de lecteurs charrient un fort ressentiment à l’égard de ce qu’ils perçoivent comme une tentative de Thomas d’enrôler la Panthère Noire pour en faire un agent de colonisation culturelle. De sorte que le T’Challa de Thomas se retrouve dans la position inattendue de colonisateur agressif, loin de l’immigrant bien intentionné. Cependant, pareille interprétation n’est pas très surprenante : privée du pouvoir de Wakanda, la Panthère Noire délocalisée n’a plus que ses mornes super-pouvoirs et sa blackness – une blackness dont l’origine culturelle diffère nettement de la rhétorique du Black Power de l’époque.

Retour au pays
Les transformations que la Panthère Noire connaît au début des années 1970 s’avèrent relativement mineures en comparaison de celles, nombreuses, expérimentées au cours du reste de la décennie. En 1973, un jeune auteur prometteur, Don McGregor, se voit confier, à la surprise générale, la déclinante publication bimestrielle Jungle Action avec pour instruction d’y donner un rôle de premier plan à la Panthère Noire. Avant l’arrivée de McGregor, Jungle Action avait pour personnage principal Tharn the Magnificent, un Tarzan blanc de seconde zone qui combattait des créatures de la jungle aux côtés de ses acolytes, deux splendides femmes blanches. Entre les mains de McGregor, Jungle Action devient le seul titre où la Panthère Noire apparaîtra pendant les quatre années à venir.
Après un passage dans The Avengers, le superhéros entame sa nouvelle trajectoire dans le numéro 6 de Jungle Action, quand McGregor prend les choses en main et introduit les lecteurs à une histoire épique intitulée « La rage de la Panthère » qui s’étale sur treize numéros. La Panthère Noire réalise qu’elle a perdu le contact avec son royaume natal, et un chef rival, Erik Killmonger, lui dispute le contrôle de Wakanda dont il a pris possession pendant qu’elle vivait ses aventures à l’étranger. La longue quête de la Panthère Noire, destinée à débusquer et vaincre Killmonger accompagné de ses lieutenants maléfiques, prend progressivement la forme d’une Odyssée, dans laquelle elle doit arpenter son propre royaume et rétablir le lien avec sa terre natale perdue.
Le premier courrier de la rubrique « Jungles Reactions » est publié dans le numéro de juillet 1974 de Jungle Action. Gary Frazier d’Eugene, dans l’Oregon, lance la discussion en qualifiant l’histoire de « révolutionnaire », en particulier l’attention subtile portée par McGregor aux différences de langage, suggérant ainsi de façon générale « que les Africains en Afrique sont différents des Afro-Américains ». Dans le numéro suivant, Bob Hughes de New Haven, dans le Connecticut, ajoute : « Après tous ces bons pères (et mères) blancs qui ont sillonné l’Afrique, un authentique, un véritable roi de la jungle noir africain était attendu avec impatience. » Dans le numéro 12 de novembre 1974, Meloney M.H. Crawford, de Saratoga Springs, dans l’État de New York, note que « les relations interpersonnelles et le développement des personnages atteignent un degré de sensibilité rare dans les comics aujourd’hui », et souligne l’importance de l’existence du Wakanda en tant que nation africaine indépendante dirigée par des Noirs : « Un dernier commentaire : Wakanda doit survivre ! Il est réconfortant de savoir qu’il a résisté aux assauts de chasseurs blancs, de filles de la jungle, de types à la Tarzan, et est resté une terre pour les NOIRS dans la jungle africaine. »
Dans la même veine, Ralph Macchio de Cresskil, dans le New Jersey, avance (de façon très développée) dans le numéro suivant : « Don, une nouvelle fois, le caractère et les traits de la Panthère ont été si clairement travaillés que j’ai vraiment eu le sentiment de déjà les connaître. Vous avez contribué en toute discrétion à l’avancement de la cause des Noirs, bien plus que les concurrents de Marvel avec leur “pertinence” mélodramatique qui avait du succès il y a quelques années. […] Au cours des derniers mois, nous avons observé les dessous d’une société entièrement noire, avec ses habitudes, ses conflits et, il est vrai, ses préjugés. […] Encore une chose : tenez les héros invités d’autres magazines à l’écart de cette série, car vous nous avez présenté Wakanda comme un monde qui se suffit à lui-même, et j’aime cela, énormément. »
En dépit des retours marquants de leurs fidèles lecteurs dont McGregor et l’équipe de Jungle Action bénéficient, la série connaît une fin prématurée. Elle est brusquement arrêtée en novembre 1976, six numéros seulement après la fin de « La rage de la Panthère ». Si de nombreuses raisons ont été avancées pour expliquer cet arrêt inattendu, la plupart d’entre elles se focalisent sur la logique économique et de maigres chiffres de ventes. Mais McGregor a donné une contre-explication à son licenciement, tout en admettant que les ventes de Jungle Action n’étaient pas à la hauteur des espérances de Marvel ou des siennes : « L’éditeur qui m’a renvoyé m’a dit, je cite, assez précisément car il y a certaines choses que je n’oublie pas : “Don, tu es trop proche de l’expérience noire.” C’est la raison qu’il m’a donnée à l’oral, je ne plaisante pas, pendant que je regardais le dos et la paume de mes mains blanches. “Vous voyez ce que je veux dire”, ajouta-t-il, et c’est ainsi que mon travail sur la Panthère s’acheva. »
Panthère cosmique
Ironiquement, il reviendra au co-créateur de la Panthère Noire, Jack Kirby, de révéler toute la mesure de l’investissement personnel des lecteurs à l’égard de la vision qu’avait McGregor de la Panthère Noire. Kirby, qui avait quitté Marvel en 1970 suite à des différends artistiques avec Stan Lee, réintègre l’entreprise en 1975 et, selon Shooter, se met en recherche de titres pour honorer son nouveau contrat, selon lequel il doit écrire et dessiner quatre numéros par mois. Après que McGregor a cessé de s’occuper de Jungle Action, Kirby se retrouve à nouveau aux commandes de la Panthère Noire. Pour la première fois, une série va être écrite, illustrée et éditée par Kirby lui-même. Dans le commentaire éditorial du premier numéro, il promet aux fans une « nouvelle Panthère Noire » : « Je peux seulement vous dire que vous verrez la Panthère qui vous est due, c’est-à-dire telle qu’elle a été pensée à l’origine. »
Si des lecteurs ont pu douter de la sincérité des prédictions théâtrales de Kirby, ceux-ci s’évanouissent à la lecture du premier numéro. Kirby y dévoile une nouvelle interprétation de la Panthère Noire, sans aucun rapport avec sa dernière incarnation dans Jungle Action. La première histoire, « La grenouille du Roi Salomon ! », inaugure la série en plongeant le superhéros dans une lutte intergalactique pour un artefact magique ancien – une intrigue qui inclut rien de moins qu’une grenouille cuivrée fonctionnant comme une antique machine à remonter le temps, un nain pour équipier, et un humanoïde à tête d’aubergine venu d’un futur lointain nommé « Hatch-22 ».
Sans surprise, les lecteurs réagissent immédiatement aux changements radicaux opérés par Kirby. La majorité des lettres traduisent un fort sentiment de trahison et de perte, les fans accusant Kirby d’avoir défiguré la Panthère Noire de McGregor. Ainsi du courrier de Jana Hollingsworth, de Bellingham, dans l’État de Washington : « Écoutez, je ne fais pas partie de la clique des supporters fanatiques de Don – je n’ai pas vraiment apprécié son LUKE CAGE –, mais ses histoires avec la PANTHÈRE étaient parmi les meilleures jamais produites. Elles étaient pertinentes, non pas dans un sens superficiel, mais véritablement pertinentes, à la fois sur les problèmes sociaux d’aujourd’hui et sur l’immuable condition humaine. Les intrigues de McGregor étaient aussi complexes que le monde réel, et ses personnages étaient d’authentiques êtres humains. Après “La rage de la Panthère” et “La Panthère contre le Klan”, il n’y a qu’un mot pour décrire “La grenouille du Roi Salomon” : obscène. […] Quand elle fut présentée dans les numéros 52 et 53 des Quatre Fantastiques, la Panthère n’était pas ce personnage cosmique insensé que vous avez dépeint. Il était le chef d’une nation africaine qui combinait son héritage traditionnel à la super-science occidentale. Dans “La rage de la Panthère”, McGregor explorait ce postulat d’une façon plus sophistiquée et réaliste. […] Je vous en prie, n’abandonnez pas ce monde réel pour foncer à travers l’univers. C’est le monde réel qui est véritablement fascinant. »
Malheureusement pour Kirby, la réaction d’Hollingsworth n’est que le premier nuage d’une pluie de lettres, suppliant Kirby et Marvel de ne pas « oublier ce que Don McGregor et Billy Graham ont entrepris de faire avec ce personnage dans Jungle Action ». Numéro après numéro, les lecteurs bombardent Kirby de protestations, l’enjoignant de restaurer le « monde réel » de la Panthère Noire et du Wakanda dans sa gloire passée. De nombreux lecteurs, tels John Judge de Clinton, dans l’Idaho, vilipendent durement Kirby : « Se saisir du premier personnage noir de Marvel et le dépersonnaliser à ce point est criminel. »
Les tentatives maladroites de Kirby, destinées à convertir ses lecteurs à sa nouvelle vision de la Panthère Noire ne font que jeter de l’huile sur le feu. Dans le sixième numéro, Kirby se fend d’une référence controversée à Alex Haley, le gagnant du prix Pulitzer en 1976 avec son roman Racines, pour justifier son point de vue : « Comme vous l’avez sûrement déjà remarqué, mon personnage n’est ni Kunta Kinte ni un Chicken George… » Dans le neuvième numéro de Black Panther, Kirby dévoile les « Mousquetaires Noirs », avec cette phrase d’accroche en couverture : « Un holocauste menace sa terre natale – T’Challa se déchaîne ! »
De manière révélatrice, ce même numéro signe également la disparition définitive des pages consacrées au courrier des lecteurs dans Black Panther. Après la publication du douzième numéro en novembre 1978, qui couronne sa deuxième année à la tête du titre, Kirby passe discrètement le relais à Ed Hannigan et Jerry Bingham. Jim Shooter confirme alors que ce changement n’est pas dû à de mauvaises ventes, mais à une décision du seul Kirby. Trois numéros seulement après, Marvel met un terme à Black Panther, en mai 1979.
Un lieu de pouvoir
Indépendamment de la façon dont on peut lire les réactions des lecteurs de Jungle Action, il est évident que quelque chose de singulier s’est produit avec la Panthère Noire présentée par McGregor. Entre ses mains, Jungle Action est devenu l’un des titres de Marvel les plus complexes dans sa conception, autant qu’audacieux sur le plan artistique. Après la plongée dans le Wakanda, lors des premières apparitions dans Les Quatre Fantastiques, proposée pendant deux numéros par Marvel, le pays a disparu quand la Panthère Noire est devenue un immigrant en Amérique. Après des années en marge de titres aux superhéros plus traditionnels, la Panthère Noire a regagné son royaume – un pays autosuffisant imaginé avec une richesse telle que les lecteurs s’y sont fortement attachés. Ce que McGregor et son équipe ont compris, c’est précisément ce que Lee et Kirby semblent avoir réalisé quand ils ont créé le personnage : ses super-pouvoirs sont dépourvus de tout intérêt, mais le concept de Wakanda en tant que lieu exerce un pouvoir d’attraction considérable. Là où Lee et Kirby n’ont fait qu’effleurer le potentiel narratif du Wakanda, McGregor l’a développé autant que possible.
En 1999, Dwayne McDuffie, auteur de comics et co-fondateur de la plus prospère des maisons d’édition de comics noires, Milestone Comics, se remémorait de façon saisissante sa propre expérience de lecteur de « La rage de la Panthère ». Après avoir qualifié l’intrigue « d’épopée de superhéros la mieux écrite qui n’ait jamais existé », McDuffie formulait à son tour des sentiments que l’on retrouvait dans le courrier des lecteurs de Jungle Action :
« On était en 1973… Le comic en question était Jungle Action nº 6. On y retrouvait un superhéros dont je n’avais jamais entendu parler, appelé la Panthère Noire, mais à cette époque, je n’avais jamais entendu parler non plus du Black Panther Party. Je fus frappé par la dignité des personnages de ce livre. […] La Panthère Noire était le roi d’une contrée africaine mythique où les Noirs étaient visibles à tous les échelons de la société : soldats, docteurs, philosophes, balayeurs, ambassadeurs – soudain tout était possible. En l’espace de quinze pages, les Noirs passaient d’êtres invisibles à des êtres inévitables. […] J’ai abondamment parlé de l’importance du multiculturalisme dans la fiction, tout comme dans la vie. J’ai prôné le sentiment de valorisation qu’un enfant peut éprouver quand il voit son image reflétée de façon héroïque dans les médias de masse. C’est précisément ce que je ressentis cet après-midi-là en découvrant l’infâme complot ourdi par le lâche (mais nuancé) Eric Killmonger pour usurper le trône revenant de droit à la Panthère Noire. Je réalisais alors que ces histoires pouvaient parler de moi, que je pouvais en être le héros. Des années plus tard, en écrivant mon propre comic, je décrivais ce merveilleux sentiment comme “la soudaine possibilité de voler”. »

Dans cette lecture, le « véritable » super-pouvoir de la Panthère Noire ne réside pas dans ses attributs félins, mais dans sa capacité à transporter tous ses lecteurs au Wakanda – vision utopique d’un puissant État noir souverain et indépendant. Le degré de progrès technologique et social du Wakanda rivalisait (voire dépassait) celui des États-Unis, et affirmait que l’indépendance et le développement autonome de la communauté n’étaient déterminés ni géographiquement ni culturellement. Ainsi, le Wakanda de McGregor offrait aux lecteurs des possibilités alternatives pour le Black Power, et les lecteurs ont accueilli avec passion une telle opportunité, exprimée par un « Wakanda doit survivre ! » et la supplication désespérée de Jana Hollingsworth adressée à Kirby : « Je vous en prie, n’abandonnez pas ce monde réel pour foncer à travers l’univers. C’est le monde réel qui est véritablement fascinant. »
Dans sa préface à Matters of gravity: special effects and Superman in the 20th century, Scott Bukatman a ainsi saisi la dimension libératrice des super-héros de comics : « Toutes les échappées fantastiques qui s’affranchissent de la gravité […] tels les vols de Superman dans le ciel de Metropolis, nous rappellent à nos corps en nous permettant momentanément de les ressentir différemment. Il s’agit d’un effet momentané, une élévation temporaire : nous sommes toujours ramenés à nous-mêmes. Néanmoins, ces échappées constituent bien plus que des refuges face à une existence intolérable, ce sont des échappées vers des mondes aux possibilités renouvelées. »
Les superhéros sont puissants précisément dans leur capacité à transporter les fans dans des « mondes de possibilités renouvelées ». C’est à travers cette capacité créatrice, cette capacité à libérer momentanément leurs lecteurs de contraintes matérielles autrement inéluctables, en les conduisant dans des espaces aux possibilités entièrement nouvelles, que les comics de superhéros les plus importants oscillent à la frontière invisible séparant l’évasion de l’espoir. Telles de resplendissantes étoiles polaires dans le vaste et fluctuant horizon de l’imaginaire culturel américain, les superhéros des comics tracent un chemin qui a pour point de départ des désirs frustrés pour nous mener jusqu’à l’imagination productrice, concept aussi poétique qu’émancipateur, proche des « lignes de fuite » de Deleuze et Guattari : ce que Dwayne McDuffie nomme la « soudaine possibilité de voler ». C’est à travers pareille évasion créative que les super-héros des comics donnent aux lecteurs le pouvoir d’atteindre des sommets imaginatifs interdits par les configurations conventionnelles du pouvoir social.
Titre original : « Imagining Black Superpower ! Marvel Comics’ The Black Panther, 1966-1979 ». L’auteur, Casey Alt, est artiste, designer et spécialiste des médias, vivant actuellement à Taipei, Taiwan. Il est diplômé de biologie humaine et d’histoire de la philosophie à l’université de Stantford, ainsi qu’en arts du design et des médias à UCLA. Son site internet : <u2325.com>.
by jefklak | 24 janvier 2017 | Contrôle continu, Genre rage
Dans les premières années du XXe siècle, ouvrent à Clermont-sur-Oise, Cadillac et Doullens, trois établissements publics laïcs pour mineures nommés « écoles de préservation de jeunes filles » où l’on enferme vagabondes et filles récalcitrantes de la campagne ou du sous-prolétariat. Leur histoire est très peu connue. Les éditions L’Arachnéen ont publié en octobre 2015 un ouvrage représentant le quotidien de ces « écoles » dans les années 1930. Vagabondes s’appuie sur un fonds photographique issu d’une commande officielle, et resté jusque là enfoui. Les photos sont accompagnées d’un montage de courriers administratifs et de documents officiels pour tenter de dresser un portrait de ces lieux d’enfermement.
Qui étaient ces jeunes filles ? Quel sort était réservé à celles que les correspondances administratives nommaient gracieusement des « idiotes perfectibles » ? Sandra Álvarez de Toledo, coordinatrice de Vagabondes, et Sophie Mendelsohn, auteure du texte qui clôt l’ouvrage, reviennent sur ce que les archives racontent de ces filles, sur la représentation de ces « écoles de préservation » et l’idéologie qui les sous-tendaient.
Télécharger l’entretien en PDF.

Photo nº 1 : Cadillac
Que voyez-vous sur cette image ?
Sophie Mendelsohn : Trois filles. Deux font le ménage dans la cellule qui leur sert de chambre, une fait son lit, l’autre nettoie le sol avec de l’eau – il me semble. Les cellules sont grillagées, de taille extrêmement réduite : on les appelait des « cages à poules ». Dedans, des pots de chambre, des torchons, des serviettes. Le photographe met en scène une activité censée représenter le bon esprit de l’institution, l’éducation à des fonctions sociales valorisées et à une vie de bonne moralité. Mais cette image traditionnelle est troublée par la présence d’une fille qui se recoiffe face à un miroir. Celle-ci échappe d’une certaine manière à l’assignation à un rôle social prédestiné. Elle introduit une autre dimension de la féminité, quand les deux autres sont courbées, à genou, rabaissées au travail ménager supposé les réhabiliter aux yeux de la société.
Sandra Álvarez de Toledo : Avec cette jeune fille baissée, dans l’ombre, qui prétend faire son lit, la raideur de la mise en scène est frappante. L’image est composée de manière très géométrique, avec une perspective qui file. On retrouve dans la plupart des images cette construction forte, qui renvoie à la maîtrise du photographe comme à l’emprise de l’institution. Et puis, si on regarde de plus près, on voit le délabrement réel des institutions, le désordre sous l’ordre apparent.
Quelle est l’histoire de ce fonds d’archives auquel vous avez eu accès ?
SM : C’est à la fois simple et bizarre. Ce fonds est le produit d’une commande passée par le ministère de la Justice, à la fin des années 1920, à un certain Henri Manuel, photographe mondain qui travaillait autour du monde du théâtre, de la mode et de la politique. Son studio avait alors pignon sur rue. Pour des raisons un peu étranges – cette commande étant très éloignée de ses sujets de prédilection –, c’est à lui qu’on a confié la tâche de photographier non seulement ces écoles de préservation, mais toutes les administrations pénitentiaires de France. Les photos ont toutes été prises entre 1930 et 1931.
SÁT : Le parcours d’Henri Manuel est pour le moins ambigu. Il était juif, mais a réalisé un portrait d’Hitler qui figure en couverture d’une des éditions françaises de Mein Kampf. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il a vendu le fonds de son studio de photographies à un certain Louis Silvestre, qui collaborait volontiers avec les Allemands. Henri Manuel est mort très peu de temps après la guerre, et les photos qui lui avaient été commandées par le ministère de la Justice ont disparu.
SM : On ne sait pas ce que le ministère en a fait. Apparemment rien, ce qui est étonnant parce que c’était une commande énorme, qui portait sur l’ensemble du système pénitentiaire français.
Les photos que vous avez sélectionnées concernent trois écoles de préservation : Doullens, Clermont et Cadillac. Comment s’est opérée votre sélection ?
SÁT : Il existe en tout une soixantaine d’images par établissement, collées dans des albums conservés par l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. J’avais remarqué, notamment à Clermont, que des visages revenaient d’une image à l’autre. Cela m’intéressait de faire apparaître des personnages singuliers, de produire des récits à partir de ces récurrences. Puis j’ai trouvé, dans les archives départementales, des documents qui restituaient d’une part la violence masquée par la mise en scène et qui, d’autre part,laissaient entrevoir des morceaux de vie. Le montage des images et des archives devrait faire apparaître les tensions entre la brutalité dont témoignent les documents administratifs et la marge de résistance des pupilles.

Photo nº 2 : Clermont
SÁT : Ici encore, la mise en scène est patente. La fille est sur une chaise gynécologique, mais elle a gardé ses vêtements, ses gros bas de laine. Elle détourne le visage. C’est une image-clé, qui illustre bien le soupçon qui pesait sur la virginité des filles.
SM : C’est le symbole pur de la violence médicale, de sa volonté de toute-puissance sur le corps féminin. Cette image rend particulièrement perceptible la perversion propre à l’idéologie hygiéniste dominante de l’époque. Toutes les filles subissent un examen gynécologique en entrant. C’est un passage obligé, comme dans les maisons closes, et habituellement justifié par la crainte de la syphilis.
SÁT : Au second plan, on devine la précarité de ces lieux. On fait vivre les filles en bas de laine troués dans des pièces glacées, insalubres. Les WC sont ouverts, les salles de bains suintent, le salpêtre tombe des murs. On peut penser que c’est parce que c’est « à la dure », mais en réalité, l’institution était pauvre et dysfonctionnelle ; le photographe n’a pas pu le dissimuler.
Que sait-on de ces lieux d’enfermement ?
SM : Ce sont des établissements publics et laïcs pour mineures, que l’administration pénitentiaire a nommés « écoles de préservation pour les jeunes filles ». Sous la Troisième République, un des gros enjeux de l’État est de montrer sa puissance face à l’Église. Il doit prouver qu’il est capable de prendre en charge les populations à risque, ce qui incombait jusque-là essentiellement au clergé. Ces trois centres laïcs sont en concurrence avec l’institution religieuse des Bons Pasteurs, une congrégation qui, jusqu’en 1975, a recueilli et enfermé la plupart des filles dites « de justice ». Ensuite, c’est vraiment la biopolitique au sens où l’entend Foucault : il faut faire vivre dans des conditions jugées respectables tous ceux sur lesquels on peut mettre la main, les rendre aptes à un bon fonctionnement. En raison de la chute de la natalité due à la Première Guerre mondiale, il y a la nécessité de promouvoir la procréation pour préserver la population. Il y a aussi, comme on le disait, le problème de la syphilis : les filles vagabondes sont considérées comme une population à risque, vectrices de maladies sexuellement transmissibles. Or l’État cherche à limiter l’arrivée de prostituées potentielles dans les villes, et donc la migration vers celles-ci des populations non contrôlables des campagnes.

Photo nº 3 : Cadillac
SÁT: C’est un réfectoire, l’image est encore une fois composée, cadrée, centrée. Il y a une surveillante, une cuisinière peut-être, et cinq filles qui ont l’air de s’amuser. L’une baisse les yeux en riant, une autre s’est tournée pour bavarder, ce qui signifie qu’elles étaient en mouvement au moment de la prise de vue. Le résultat est une photo à la fois immobile, raide, mais avec un certain mouvement à l’intérieur. Une marge de jeu semble exister, du moins dans le cadre de l’image.
S.M : Ce qui est amusant, c’est le contraste entre la mine réjouie, facétieuse, de la fille et la face patibulaire de la surveillante à droite. Elle a une tête effrayante, on dirait une sorcière avec sa main crispée en griffe sur la table et son regard de désapprobation qui englobe les cinq filles. Comme dans la première photo, il y a une ligne de fuite : alors qu’on est censé faire le ménage, on est plutôt en train de se faire belle ; alors qu’on est censé être écrasée par le poids des devoirs, on affiche une malice joyeuse.
SÁT : Et puis, il y a cet écriteau, en haut, qui énonce : « Dignité humaine / Devoirs de l’enfant ».
S.M : On peut remarquer que les devoirs de l’enfant sont rapportés à des espaces sociaux précis. Il a des devoirs dans sa famille et dans l’école, point. Ça définit les espaces dans lesquels il est soumis à un règlement qu’il doit respecter, et cela sous le chapeau de la « dignité humaine », impliquant « conscience », « liberté », « responsabilité » (et un quatrième principe qu’on ne lit pas sur la photo). On introduit ici la liberté, mais on ne voit pas bien quelle est la liberté de l’enfant qui n’a que ces deux espaces bien délimités, dans lesquels il est censé appliquer les règles qui lui sont imposées.
Dans ces photos, il y a l’institution, l’école-prison, rigide, ferme, mais il y a aussi tout ce qui ne colle pas avec cette image. On ne cesse de se demander si le photographe a enregistré volontairement ce qui débordait, ou si cela déborde malgré lui…
SÁT : Ce qui nous a intéressé dans ces images, c’est leur ambiguïté. Dans le livre, il ne s’agit pas seulement de proposer une vision de la répression, mais aussi d’essayer de voir ce qui se tramait entre les filles, entre les filles et l’institution, entre les filles et les surveillantes. Cela passe beaucoup par les regards, notamment dans les situations où les filles se savent photographiées. Là, il y a quelque chose qui brise le reportage, la commande, la propagande… On place une surveillante dans chaque plan, histoire de montrer que les filles étaient gardées de près ; mais le rôle qu’on demande aux filles de jouer sur les photos est trouble : la gaîté ou l’austérité de la discipline ? En tout cas, on peut faire l’hypothèse que si ce fonds n’a pas été utilisé du tout par le ministère de la Justice, c’est parce que de son point de vue, il était inutilisable.
SM : On a eu accès aux photos des établissements pour garçons et on n’y voit pas la même chose. L’ambiance, la manière de photographier n’est pas du tout la même. Les garçons sont montrés travaillant dans les champs ou dans l’industrie. La discipline semble beaucoup plus sévère, il y a moins de lignes de fuite.

Photo nº 4 : Cadillac
SÁT : Le réfectoire encore, dans son ensemble. L’architecture est extrêmement imposante : on a cette arche, très lourde et les diagonales des tables, avec ces serviettes déployées comme dans un restaurant chic. Peut-être s’agit-il d’une fête. Dans le fond, comme toujours, les surveillantes. Les filles dansent entre elles. Dans la sélection de photos que nous avons faite, nous avons privilégié tout ce qui est de l’ordre du mouvement, tout ce qui va à l’encontre de l’immobilité et de la contrainte.
SM : Il semble que la photo ait été prise avant le repas, car les tables sont immaculées, les serviettes bien présentées : donc on danserait avant le repas, ce qui semble un peu bizarre. Sur cette image, il y a aussi une fille noire ; nous n’en n’avons pas vu d’autres dans l’ensemble du fonds d’archives. C’est intéressant, car habituellement il n’y a aucune mixité dans ces institutions. Cette fille vient probablement des colonies.
Qui étaient les jeunes filles enfermées ?
SM : Il y a très peu d’informations à leur sujet. On sait par déduction – notamment parce qu’elles sont souvent attrapées pour vagabondage – qu’elles sont essentiellement issues du sous-prolétariat. Souvent, elles se sont enfuies d’une maison où elles avaient été placées par leur famille comme domestique.
SÁT : Derrière le délit de vagabondage, il y a toujours le soupçon de prostitution. Certaines filles étaient condamnées pour infanticide, qu’elles aient tué leur propre enfant, ou celui des patrons chez qui elles étaient placées comme domestiques. Les filles qui ont commis les moindres délits sont logées à la même enseigne que les criminelles.
SM : Et puis, il y a les filles de la campagne et du prolétariat, dont les familles veulent se débarrasser parce qu’elles ne sont pas contentes de leur comportement. La bourgeoisie, elle, met ses filles récalcitrantes dans les congrégations religieuses. L’assistance publique récupère celles dont les familles n’ont pas assez d’argent ou de respectabilité sociale pour y accéder.
Il y a donc, parmi elles, des filles enfermées à la demande d’un tiers ?
SM : Cela passe toujours par une procédure pénale. Les familles ne peuvent pas arriver et dire « on vous laisse notre fille ». Mais les juges, à l’époque, ont plutôt tendance à avoir la main lourde : une fille traînée devant l’un d’entre eux a très peu de chance de revenir dans sa famille. Pour le bien public, on considère qu’il vaut mieux enfermer les jeunes filles pour les protéger, même sans preuve de mauvaise conduite.
Les filles enfermées en école de préservation n’étaient en fait pas vraiment condamnées ?
SM : Non, en effet, en tant que filles et mineures, elles étaient acquittées pour « manque de discernement[2. Le « manque de discernement » signifiant que la justice considérait un défaut de conscience du caractère délictueux de l’acte au moment où il était commis.] ». Condamnées, elles auraient eu de courtes peines de prison, quatre à six mois – le vagabondage n’était pas puni très lourdement. La seule manière de les tenir enfermées longtemps était de considérer qu’elles étaient « non discernantes », et donc de les « préserver ». D’où l’euphémisme : si les « écoles de préservation » avaient été légalement des prisons, elles auraient été soumises à la juridiction générale. Alors qu’avec ce subterfuge juridique, on peut enfermer les filles jusqu’à leur majorité civile – 21 ans à l’époque. Certaines arrivaient à 14 ans parce qu’elles vagabondaient et restaient donc sept ans en institution. Pour les mêmes délits, elles faisaient des peines bien plus longues que celles des garçons.
Vous racontez à quel point les corps féminins de la classe populaire sont des éléments préoccupants pour l’État…
SM : Ces filles sont au croisement d’une justice de classe et d’une justice de genre, exactement au point de jonction de ces justices d’exception. L’ouvrage aurait pu s’intituler Des filles d’exception, pour faire apparaître justement le traitement exceptionnel dont elles sont justiciables. L’État craint ces vagabondes qui circulent librement sans contrôle familial ou juridique. Elles sont doublement dangereuses. D’abord en tant que filles du prolétariat, parce que si elles arrêtent de travailler ou de procréer, le système arrête de fonctionner. L’État doit absolument garantir les conditions du travail socialement obligatoire ! Et puis, elles sont victimes de représentations sociales et d’une justice produites par des hommes qui font d’elles des objets de désir, dangereuses en tant que tels.
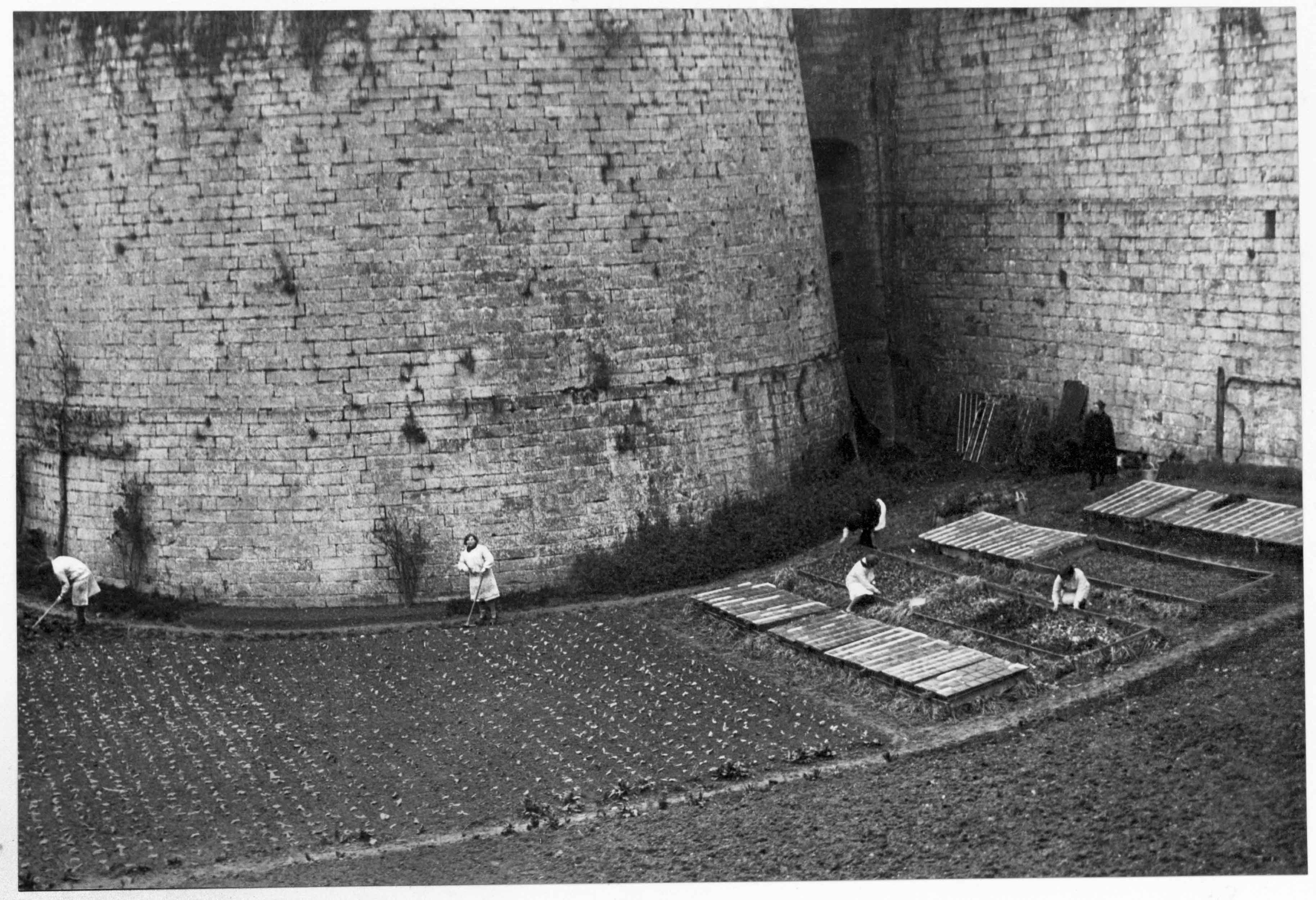
Photo nº 5 : Doullens
SÁT : Est-on dans les douves ? À l’extérieur du château ou dans un pré intérieur ? On ne sait pas, mais l’image donne toutefois une idée de l’échelle de la forteresse de Doullens : les filles apparaissent comme de toutes petites figurines. Le photographe a pris la liberté de choisir une focale très large pour montrer l’espace, toujours contraint, au lieu de se rapprocher et de montrer les filles en train de travailler bien sagement.
L’horizon est bouché, on ne voit pas le ciel, seulement le mur de la forteresse.
SM : Les trois établissements sont d’anciennes prisons. Clermont était une ancienne maison centrale de filles et de femmes ; Cadillac, le château des ducs d’Épernon, avait été « une maison de force et de correction pour les filles et les femmes », et Doullens, une ancienne forteresse militaire, avait aussi été une prison pour femmes. Et dans les trois cas, il n’y a eu pour ainsi dire aucun réaménagement des lieux.
Quelle est la place du travail dans la « réhabilitation » des jeunes filles ?
SM : Elles travaillent tout le temps. Travailler la terre, en particulier, est une activité honorable. C’est une idéologie très forte à cette époque-là : ramener les filles au bon air, au bon travail, pour qu’elles puissent vivre à la campagne dans un environnement non corrompu. La ville, c’est la corruption ; les travaux des champs, c’est l’innocence, la pureté.
SÁT : Toutefois, dans les images d’Henri Manuel, le rôle du travail chez les filles est bien moindre que chez les garçons. La réhabilitation des filles se fait par le travail de la terre, les travaux d’atelier et les travaux d’aiguille, mais aussi par le travail domestique : le ménage, la lessive, la cuisine, la buanderie.
Est-ce à dire que les filles apprenaient un métier ?
SM : Le but de ces institutions est de transformer des filles déviantes en domestiques – ou en ménagères au foyer. Mais il n’est pas simple à la sortie de l’école de leur trouver une place. Tout le monde est un peu suspicieux à leur égard. De fait, beaucoup ressortent vagabondes. Parfois, elles rentrent chez elles avec un petit pécule.

Photo nº 6 :, Clermont
SÁT : Sur cette photo, on ne voit à première vue qu’une chose : cette jeune femme qui nous regarde, qui regarde le photographe. Elle est jolie, maquillée, aguichante, quand d’autres filles paraissent toutes avoir la même tête, la même corpulence tassée (à force de féculents), la même coupe de cheveux. La femme de dos est sans doute une surveillante, elle a été placée dans l’image pour confirmer que les filles sont bien gardées. Mais la fille au tablier clair concentre sur elle toute la lumière.
SM : C’est vrai que cette silhouette à droite, noire et très austère, douche un peu la scène. La joie coquine qui émane du personnage de face est contredite par cette silhouette de corbeau.
SÁT : Cette scène est totalement incongrue. C’est forcément le photographe qui leur a demandé de se mettre à danser dans ce coin-là de la cour.
SM : Et l’esprit, encore une fois, est difficile à saisir : il y a toujours ce contraste entre un univers d’enfermement et ces corps, ces filles qui dansent, qui s’amusent, coincées sous la muraille.
SÁT : Et puis, ce sont des filles qui dansent ensemble, deux par deux, cela ouvre le chapitre important de l’érotisme, des relations homosexuelles qui se tissent dans ces écoles de préservation.
Ces images de danse sont troublantes parce qu’elles feraient presque passer ces écoles de préservation pour des lieux vivables, des colonies de vacances…
SM : De nombreuses photos sont sur cette ligne très ambiguë. Il y a, de manière générale, un énorme contraste entre les photos et les textes, dans lesquels on lit qu’elles sont punies à la moindre occasion. Et les punitions, c’est le mitard et la camisole de force. Elles ne sont pas censées s’amuser. Tout l’enjeu pour ces écoles de préservation est de « relever[3. « Ce qu’il y a de plus difficile dans le relèvement des enfants, c’est le relèvement des filles. Ce qu’il y a de plus difficile dans le relèvement des filles, c’est le relèvement de celles qui sont tombées jusqu’à la prostitution publique. », Rapport d’inspection, cité p. I.] » les filles. C’est le terme employé, un mot empreint de morale et de religion. Elles ont chuté, il faut les relever, pour les rendre aptes à réintégrer la société dans des conditions jugées acceptables. Et pour cela, tous les moyens répressifs sont bons.
C’est donc comme si ces photos contrevenaient à la fois au réel des écoles de préservation et à l’image que veulent en donner les institutions ?
SM : C’est le contre-emploi d’une photographie de propagande : on voit exactement ce qu’on ne devrait pas voir. On voit la vérité de ces lieux par la résistance des corps, on voit que ces lieux ne sont pas ce qu’ils auraient dû être. On voit l’enfermement, un peu, mais aussi le reste : ce qui a rendu ces lieux singuliers. On voit la complicité qui unit les filles bien plus qu’on ne le devrait ! L’institution combat ces rapprochements, cette sensualité, ce désir de s’amuser ; il faut absolument éviter que les filles aient leur propre vie en dehors de ce qui est autorisé par l’institution. Mais les photographies montrent l’échec de l’institution à combattre cela.
Pourtant, savoir danser, c’est important, comme être une bonne ménagère, ça fait partie de ce qu’une femme doit savoir faire ! Peut-être qu’il s’agit de former de futures épouses ?
SM : Ce n’est pas cela qu’on enseigne dans ces institutions. On ne prépare pas les filles à savoir se faire belle et à mieux séduire les hommes. Au contraire : elles sont toutes suspectées d’être des prostituées. Et il s’agit de montrer qu’elles ont renoncé à ce destin fatal et que leur enjeu ne sera plus d’être belle, mais d’être bien sage, de bien faire le ménage. C’est une des ambiguïtés qui traversent toutes les photos, on voudrait les montrer d’une certaine manière, mais on ne peut pas s’empêcher de les exposer telles qu’on ne veut pas qu’elles soient : comme des séductrices.

Photo no 7 : Cadillac
SÁT : Ici, on a une image de libération. Cela a beau être un cours de gymnastique – on le comprend grâce à d’autres clichés de la même série –, là, pour cette photo, on leur a sans doute simplement demandé de courir. Même si elles sont en uniforme, coincées entre deux rangées d’arbres, la sensation d’élan reste dominante. L’image est floue ; ce n’est que du mouvement. Une échappée, presque une image d’évasion collective.
SM : Cela soutient l’idée qu’il y a une forme de séduction qui opère sur le photographe – celle dont on essaie de les charger, puis de les débarrasser. Sur cette photo, on comprend qu’elle n’est pas nécessairement sexualisée, il s’agirait d’une liberté séductrice, quelque chose qui se maintient contre l’institution ou malgré elle.
On a l’impression d’une fuite collective et spontanée. Y a-t-il beaucoup de tentatives d’évasion ?
S.M : Oui, dès qu’elles peuvent s’échapper, elles tentent de le faire. C’est même troublant la facilité avec laquelle elles s’évadent. Il suffit d’une échelle qui traîne et hop ! elles filent.
SÁT : Les évasions rythment la vie de l’institution, c’est quasiment ritualisé ! La dernière partie du livre propose une sorte de parcours-type des filles des écoles de préservation : elles sont arrêtées, jugées, internées, puis elles s’évadent. Le plus souvent, elles sont reprises. Ensuite, elles se tiennent bien quelque temps, dans l’espoir d’être« louées » comme domestiques auprès d’une famille pour, peut-être, s’échapper de nouveau.
Pouvez-vous nous raconter la révolte de 1934 à l’école de préservation de Clermont ?
SM : On n’en sait malheureusement pas grand-chose. Il semblerait que la révolte du bagne de garçons de Belle-Île[4. La colonie pénitentiaire de Belle-Île est restée célèbre par la révolte d’une centaine de colons. Un soir d’août 1934, après qu’un des enfants a été roué de coups pour avoir mordu dans un morceau de fromage avant sa soupe, une émeute éclate, suivie de l’évasion de 55 pensionnaires. Ce fait divers est suivi d’une campagne de presse très virulente, et va inspirer à Jacques Prévert son célèbre poème « La chasse à l’enfant ». Il y dénonce la « battue » organisée pour rattraper les fugitifs, avec une prime de 20 francs offerte aux touristes et aux habitants de Belle-Île, pour chaque garçon capturé.] ait commencé à s’ébruiter – sans doute via des surveillantes –, et que cela ait incité les filles de Clermont, où le régime était particulièrement dur, à se révolter à leur tour.
SÁT : On peut supposer que des liens de complicité entre les surveillantes et les filles se nouaient parfois. Dans les archives, une surveillante est décrite comme « anarchiste » par l’administration. Il faut dire qu’elles sont elles-mêmes extrêmement surveillées. L’institution mène à leur encontre des enquêtes de moralité très poussées[5. Voir notamment cette archive p. 76 « Comme suite à votre communication du 6 février écoulé concernant Mme Frangopol, née Chasseur Sylvaine, institutrice à l’école de préservation de Doullens, j’ai l’honneur de vous rendre compte que l’enquête à laquelle j’ai procédé ne m’a pas permis d’établir que cette femme fréquentait des étrangers ou des personnes suspectes. Elle a toujours été effacée et elle n’est pour ainsi dire pas connue à Doullens depuis 4 mois que sa mère habite une petite maison isolée rue Tailly près de la rue d’Arras. Mme Frango Paul n’affiche aucune autre relation, elle ne reçoit d’autre part aucune correspondance en dehors des catalogues de grands magasins, néanmoins une surveillance discrète continuera d’être exercée sur ses agissements à Doullens. »].
Comment se déroule la mutinerie ?
SM : D’après ce que l’on sait, les filles refusent de monter dans leur chambre ou d’aller au travail. Il y a des échauffourées : elles se battent avec les surveillantes. La répression est féroce, elles ont toutes été mises au mitard, sous camisole de force. Ce n’était pas une tentative d’évasion collective, c’était plutôt une rébellion interne. Tout cela a été complètement étouffé par l’administration. Un seul journal s’est emparé de l’histoire, aussitôt démenti par le ministre de la Justice lui-même.
Comment s’achève l’histoire des écoles de préservation ?
SM : Cela se termine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand s’organise pour la première fois une justice spéciale pour les mineurs. On construit alors des établissements spécialisés qui ne sont plus des institutions de répression pure. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, à la petite Roquette, il y a des enfants de deux ans qui sont prisonniers parce qu’ils ont fait bêtises et que leurs parents sont allés voir le juge pour s’en débarrasser. Cela dure jusque dans les années 1890. De 1905 à la Seconde Guerre mondiale, le statut du mineur change, mais sans être complètement éclairci du point de vue du droit. On expérimente un traitement spécial des mineurs sans que la chose soit véritablement organisée. C’est une étape intermédiaire. Ces « écoles de préservation » correspondent à la fin d’un monde, celui où l’on traitait les mineurs comme des adultes.
by jefklak | 20 janvier 2017 | Le lundi au soleil, Marabout
J’ai creusé où on m’a dit de creuser. J’ai pris ma pelle et ma pioche. J’ai mis mon casque et mes œillères. J’ai vu quand même : le travail est un mensonge.
J’ai eu un emploi, on m’a donné un emploi du temps, je n’avais plus de temps pour moi. J’étais pillé, employé pour le temps que je représentais.
J’ai donné mon temps j’ai donné mon sang j’ai jeté mes gants j’ai mis la main à la pâte j’ai donné la patte à la main qui voulait me la prendre.
J’étais du temps on m’a découpé en tranches fines on m’a roulé dans la farine on m’a recouvert de papier je ne pouvais pas me périmer pas m’avarier j’étais salarié j’avais un sale air de pauvre.
Texte issu du numéro 2 de Jef Klak, « Bout d’ficelle », toujours disponible en librairie.
Télécharger le texte en PDF…
J’ai écrit quelque chose autrefois, mais je ne m’en souviens plus. J’ai cherché dans les cartons qui peuplent mon appartement, je n’ai rien trouvé.
Parce que je ne me souviens plus de ce que j’ai écrit, et parce que je ne retrouve pas une preuve tangible de cette activité passée, j’écris de nouveau.
J’écris pour la deuxième fois de ma vie.
C’était peut-être un poème, mais rien ne le prouve.
C’était peut-être un poème parfait, le plus beau des poèmes. Je m’en suis aperçu, alors j’ai dit : « Passons à autre chose. » Si j’avais continué, j’aurais été déçu. Je devais envisager une vie sans écrire, pour ne pas courir après un idéal déjà atteint. J’étais poète, mais avant tout j’étais vivant, et je voulais vivre intensément, aussi pouvais-je devenir n’importe quoi, n’importe qui.
L’histoire est belle. C’était peut-être cette histoire que j’écrivais, si dans mon poème il y avait une histoire. Celle d’un homme qui écrit puis renonce. Un écrivain qui devient quelqu’un d’autre. Mais alors c’était peut-être une nouvelle. Ou bien c’était un poème qui est devenu une nouvelle. Car tout change tout le temps.
Je suis devenu fossoyeur. Cela, je m’en souviens. Les trous, les morts, la terre. La terre est la seule chose qui dans notre métier reste toujours au singulier. Les morts, par contre, sont visages et nombres tout à la fois. Présence et quantité. Sept aujourd’hui, douze demain. Autant de trous pour les recevoir.
Creuser, creuser – pour aller où ? J’ai souvent changé de cimetière. C’est toujours la même terre.
Ce n’est pas facile d’être aimé quand on est fossoyeur.
L’amour est comme au fond d’un trou : on donne de grands coups de pelle parce qu’on est pressé de le trouver, on touche un truc, ça ressemble à l’amour, pourtant c’est inerte – on l’a brisé.
Ou alors il y a celles que notre métier fascine. Des hystériques traquant l’odeur de la mort sur nos corps. Et toutes celles qui se sont trouvées tétanisées – « désolées » – à l’idée que peut-être je les enterrerai.
De toute façon c’est compliqué de passer ses journées avec les morts, puis, le soir, de retrouver une vivante qu’on aime.
Je pense à Nora – je me souviens d’elle, je ne l’ai jamais oubliée. Je l’oubliais chaque jour pourtant, en creusant. Puis je posais ma pelle et je pensais à elle. Et le soir nous étions ensemble, mais pas vraiment. C’était de ma faute. Je n’y arrivais pas. Dans ma tête il y avait des trous, des morts et toute cette terre. Je ne quittais jamais tout à fait le cimetière. La mort s’attache.
Dans mes cartons il y a mille fois son visage. Photographies, preuves accablantes des négligences passées. Quand une photographie est réussie, quand le visage de Nora dans l’un de mes cartons resplendit, je comprends que je ne l’ai pas assez bien regardée. L’appareil a été plus attentif. La machine savait, et j’ignorais.
J’ignorais que ce visage devrait tenir toute une vie.
J’ai peut-être arrêté d’écrire parce que j’ai trouvé du travail. On se laisse dévorer par le travail. Écrire après le travail, je ne voyais pas comment.
Aimer après le travail – Nora s’est épuisée à force d’essayer de me ramener à elle. Elle y arrivait parfois, mais le lendemain les trous, les morts, la terre, tout reprenait, tout était à refaire. L’emprise est telle.
Ce n’est pas seulement le problème du cimetière. Ce serait pareil dans n’importe quelle boutique, n’importe quelle usine. Le quotidien est la grande ruine. Les jours qui se répètent. Attendre les vacances pour retrouver l’étendue d’une journée, d’un sentiment qu’on tient, qu’on peut tenir enfin.
Je pouvais bien être poète, tout ce que je voulais, j’étais avant tout salarié.
C’était peut-être un poème, peut-être une nouvelle. En tout cas, je n’écrivais que des choses courtes. Pour atteindre plus rapidement l’essentiel.
C’était peut-être l’histoire d’un enfant, l’enfant que j’ai été, quelques souvenirs que l’écriture a changés en histoires.
Je ne me souviens plus de rien, j’émets des hypothèses, j’attends qu’elles sonnent juste.
Parfois la terre sonne juste. Vous savez que vous creuserez un beau trou.
Que le travail m’ait dévoré sonne juste. Toute la journée creuser – qu’écrire après cela, et que dire à Nora ? Un très beau trou.
Que cette nouvelle dont je ne me souviens plus ait été l’histoire d’un enfant sonne juste également. Car je ne me souviens plus de ce texte ni de mon enfance.
Les hystériques s’énervent parce que je ne leur parle pas assez de mes parents. Elles croient que je leur cache quelque chose. J’ai seulement oublié. Leurs visages et leurs noms, leurs voix, leurs tendresses et leurs colères.
Quand on vous confie votre premier cercueil de moins d’un mètre quarante, votre enfance s’écroule. Vous perdez le contact avec elle, c’est terminé. Si vous écriviez sur l’enfance, vous ne pouvez plus, vous ne savez même plus ce que c’est, vous croyez être né au cimetière avec une pelle à la main, déjà grand, déjà barbu, et c’est ainsi que vous observez vos collègues : des hommes sans enfance. Vous passez la journée à creuser en pleurant, vous creusez de travers parce que vous pleurez, alors vous décidez de ne plus pleurer et vous y parvenez : il faut bien creuser. Pour les enfants morts, il faut faire de beaux trous. Et les beaux trous se font les yeux secs.
La première fois, on m’en a confié deux d’un coup. Deux frères à placer côte à côte, 3 et 8 ans. J’ai creusé en pleurant dans la terre du cimetière de Pantin, puis je n’ai plus jamais pleuré, et je n’ai plus jamais eu de nouvelles de mon enfance.
Même quand j’ai vu les deux petits cercueils blancs sortir de la grosse voiture noire, je me suis retenu de pleurer. On aurait dit deux boîtes à chaussures. Je m’en voulais d’avoir creusé des trous trop grands. Les cercueils paraîtraient aux parents plus petits encore que leurs enfants ne l’étaient. J’ai pensé à mon métier et à ce que je devais faire pour l’exercer correctement. Des trous plus adaptés. Nora est partie quelques mois plus tard. Je suis allé peupler un appartement de cartons qui ne contenaient pas ce que j’écrivais. Des cartons qui ne contenaient que le reproche de n’avoir pas assez aimé.
Peut-être est-ce après avoir enterré ces deux frères que je n’ai plus écrit. L’enfance, qu’est-ce que vous voulez en dire quand vous l’avez enterrée ?
J’ai choisi un caillou, j’ai dit : « C’est mon enfance », et je l’ai jeté par-dessus la grille du cimetière. Pour la sauver peut-être. L’éloigner de la terre où l’enfance de Pantin finit.
Petit, j’ai quitté la maison où j’avais grandi. J’ai choisi un caillou et je lui ai dit : « Tu es mon enfance, je te dépose sous les marches de ce vieux perron, ne m’oublie pas, nous nous retrouverons. » Et puis j’ai déménagé.
Ce caillou se souvient de moi puisque je me souviens de lui.
Il y avait la mer aussi. Nous y allions.
Je serais bien en peine d’écrire qui formait ce nous. Mais le fait est que nous allions à la mer.
Je ne me souviens pas de la solitude. La solitude, c’est aujourd’hui. Avant, je n’étais jamais seul, et, quand je l’étais, avec mes mains, dans l’eau très claire, j’attrapais des poissons.
Ce sont là mes seuls souvenirs.
Il y a toujours un moment où, dans une conversation avec une inconnue, cette inconnue vous demande ce que vous faites pour gagner votre vie. Je n’ai jamais aimé mentir. J’ai rarement été aimé plus d’une nuit.
Je sais que je suis un homme avec lequel on passe une nuit pour voir ce que ça fait. Le lendemain, on est de toutes les conversations, de tous les SMS, de tous les statuts sur les réseaux sociaux : « Sucer un croque-mort : done ! » 42 likes, 19 commentaires, 3 nouvelles demandes d’amitié.
Mais peu importe.
On ne comprend pas vraiment l’oubli. On ne le comprend (et d’ailleurs il s’agirait plutôt de l’admettre ; mais comprend-on tout ce qu’on admet, ou comprend-on seulement qu’on a admis ces choses que nous ne comprenons pas ?) qu’à partir du moment où on n’essaie plus de savoir quand tout a commencé.
Le jour où j’ai commencé à oublier – comme s’il s’agissait d’une activité sportive, et que, à force de pratique et d’assiduité, on m’avait remis une ceinture noire d’oubli et un certificat.
Le jour où j’ai oublié ce que j’avais écrit – mais le jour où j’ai oublié est seulement le jour où je me suis aperçu que j’avais oublié et qu’il était trop tard.
L’oubli n’est pas un enfouissement – il me suffirait de creuser pour tout retrouver. L’oubli est une expulsion, un exil. Un morceau de ma vie passée a été, dans ma vie présente – pour que ma vie présente puisse continuer ? – condamné à l’exil.
J’ai quitté cette maison où j’avais grandi, puis je n’ai plus jamais grandi.
Vous dites : « J’ai oublié. » Comme si vous y étiez pour quelque chose. Comme si vous aviez participé activement à ce processus. Mais l’oubli se joue de vous, sans vous. En vérité, ce sont les choses dont vous ne vous souvenez plus qui vous ont oublié.
Oublierai-je un jour ces deux petits cercueils blancs ? M’oublieront-ils, ces petits anges ?
J’ai creusé pour eux deux trous trop grands.
Et pour Nora j’ai tout vu trop petit.
Le soir, seulement le soir.
La retrouver chaque soir.
Il existe des cartes pour se repérer dans les cimetières – des divisions et des allées, des cadastres pour ne pas creuser au mauvais endroit, enterrer quelqu’un sur quelqu’un d’autre, cela arrive quand on ne lit pas encore très bien les cartes. Existe-t-il des cartes pour l’amour ?
C’est peut-être cela que j’ai tenté d’écrire autrefois et que j’ai oublié depuis. Un plan pour nous, Nora et moi, quelques repères posés au gré des mots afin que nous nous retrouvions.
C’est parce que j’ai oublié ce que j’ai écrit autrefois que j’écris de nouveau. À présent, je suis libre de m’en souvenir – venir par en-dessous, ramper parmi les morts avec les mots.
Se souvenir et, peut-être, revenir.
Tout commence toujours à Pantin pour les fossoyeurs. C’est le premier cimetière qui vous embauche.
Un cimetière immense, sans relief, où sous la terre il y a une source. L’eau résurgente inonde les trous qu’on creuse. On les vide avec une casserole. On est couvert de boue. Après la douche, on en a encore dans les cheveux et derrière les oreilles. La terre ne vous oublie pas.
Oublierai-je un jour le caillou que j’ai laissé sous les marches du perron de la maison de mon enfance ? Était-ce une maison ? Je ne me souviens que du caillou. Et il y avait la mer et nous, mais nous n’est plus un ensemble de visages et de noms, nous est une sensation très vague, disparue depuis trop longtemps.
Un jour, un cercueil sort d’un corbillard, et personne n’assiste à la mise en terre. C’est alors qu’on comprend ce qu’est l’oubli.
Un jour, un homme arrive et vous offre à manger. Vous avez enterré sa femme l’année passée. Il se souvient de vous. Il vient vous remercier. Il revient chaque année avec une attention pour vous. Les hommes sont bons parfois, s’ils se souviennent.
Un jour, un cercueil ne veut pas descendre. C’est comme s’il s’accrochait. Le trou est assez large pourtant. Mais le cercueil résiste. Et les visages heureux, émerveillés de ceux qui observent cette résistance.
Ce jour-là, vous vous souvenez que vous écriviez autrefois. Mais vous vous rendez compte que vous avez oublié ce que vous écriviez.
La mémoire n’est pas se souvenir. La mémoire est un lieu, une propriété. Se souvenir est un retour.
Ce texte était peut-être une carte pour retrouver Nora chaque soir en sortant du cimetière. Car il n’y a rien, rien pour nous indiquer qui nous devons aimer et comment faire. Nos petits cœurs et nos petits sexes (auxquels une boîte à chaussures conviendrait pour un enterrement, si ce grand corps que nous traînons ne les accompagnait pas aussi résolument), nous les jetons dans l’obscurité la plus totale.
Ils sont sans flair ni pensée, ils ne savent rien, n’ont aucune conscience du danger et encore moins du bonheur.
Que savons-nous de l’amour ?
Nous avançons à l’aveugle au hasard des propositions et des proies. Rien n’est donné, mais nous prenons. Nous pouvons tout expérimenter sans jamais rien connaître. Sans que jamais la moindre chance de savoir nous effleure.
Oublier ce que nous avons entrevu au bout de ces expériences est bien plus probable.
Oublier, ou méconnaître.
Et méconnaître parce qu’on n’y reviendra pas.
Comme dans un champ de cendres, nous cherchons les formes des fleurs passées.
Nous cherchons les formes des fleurs passées – c’est peut-être une phrase que j’ai écrite autrefois.
Quand j’écris aujourd’hui, je traque ce qui ressemble à ce que je pouvais écrire avant.
Mes pensées me semblent étrangères quand elles ne sont peut-être que les réminiscences de cet homme que j’étais avant d’en être un autre, un qui a oublié.
Si j’écris aujourd’hui, c’est pour me souvenir de ce que j’écrivais. Il n’y a pas d’autres raisons.
Le motif de mon action est une fiction. Une fiction passée et oubliée. Les fictions sont aussi des raisons d’agir. Les fantômes nous donnent des indications.
J’aurais pu écrire parce que je suis fossoyeur. Mais je suis devenu fossoyeur et je n’ai plus écrit. Aujourd’hui si j’écris, c’est parce que j’écrivais.
Nora. Cette nouvelle que j’ai écrite autrefois – à présent je m’en souviens, je suis venu par en dessous, j’ai rampé parmi les morts, et je peux la cueillir (la recueillir ?) – était une carte m’indiquant comment te rejoindre.
Ou bien une carte t’indiquant comment me rejoindre.
C’était à toi de faire tous les efforts. Je voulais te prévenir des difficultés que tu rencontrerais. Aussi, j’écrivais.
Cette nouvelle avait pour titre – puisque c’est une pensée qui me traverse à présent, et puisque cette pensée me paraît étrangère, comme si celui que je suis ne pouvait pas penser ainsi, et comme si je ne pouvais penser une telle chose que parce que je l’ai pensée autrefois – L’Armure des journées de travail.
Le cimetière, les trous, les morts – creuser au plus juste. La terre si dure quand il gèle. Les machines se brisaient. Il fallait frapper fort. Ma nouvelle parlait de cela. Cette terre qui est toujours la même et qui gèle l’hiver pour nous briser le dos.
Enterrer au mieux, au plus profond. La joie d’un trou bien fait, quand tout le monde voit qu’il est bien fait, même ceux qui n’y connaissent rien, n’en ont jamais vu d’autres. Et puis écrire quand même entre deux trous.
J’écrivais parce que je pensais à toi. J’écrivais quelque chose pour toi, dans les allées, les divisions, avant d’enterrer d’autres morts. Je pensais pouvoir venir à ton secours avec cette nouvelle. Comme quand j’étais si seul que je mettais mes mains dans l’eau pour toucher l’écaille des poissons.
Il fallait trouver quelque chose, dans toute cette détresse. Quelque chose pour revenir. Parce que le bonheur n’était pas encore inaccessible. Il était lié aux circonstances. Il était encore temps. Le bonheur était temps.
Le désir de se frayer un chemin le soir, jusqu’à toi, à travers l’armure des journées de travail.
Je rentrais vite, je ne traînais pas.
Le quotidien nous écrasait d’ennui, mais nous en triomphions quotidiennement. Ou bien nous tentions d’en triompher. Et c’était l’essentiel, ces tentatives d’un triomphe incertain. Car à vrai dire nous succombions souvent.
L’ennui comme la terre s’accroche. Mais que nous succombions ou triomphions, c’était le même élan, le même effort.
Quoi qu’il arrive, quoi qu’il advienne de nos efforts, il y avait toujours quelque chose du monde qui restait, quelque chose du désir et de l’être, quelque chose d’amoureux ou de noir. C’étaient des particules en suspension dans l’air d’un grand gymnase rempli d’athlètes, que les rayons du soleil parfois révélaient.
Voilà ce qu’essayait de saisir cette nouvelle : des particules. Cette nouvelle était un soleil.
On voudrait qu’il y ait chaque jour du soleil, chaque jour voir les particules, se souvenir que nous sommes vivants, c’est impossible, ce n’est pas grave, la vie sans gravité, mais pas sans joie, pas sans hargne.
Ce n’était pas grave, nous retrouverions le soleil – voilà ce que disait cette nouvelle. C’était une mauvaise nouvelle. Il arrive que le soleil ne revienne pas. Cela, je ne l’ai pas écrit. Ce n’est pas possible autrement.
Je l’écris aujourd’hui. Il est trop tard. La mer est loin. La solitude est là. Plus rien n’est temps.
Je sortais du cimetière et en rentrant chez nous tes mains étaient là pour le palp, ce qu’entre nous nous nommions palp, ma queue, tes seins, mes fesses, ta chatte, tu passes la tranche de ta main entre mes fesses et tu t’agrippes, palp, tu presses mon gland dans ton poing, palp, et je caresse et presse tout ce qui vient de chair entre mes doigts, tout ce qui est saillant, ce qui s’enroule, un monde que le palp devine, et que les yeux ne voient jamais de cette façon. La précision et l’hyperbole au bout des doigts, révélation d’un monde, exploration tout en surface et tout en creux – chercherions-nous nos corps de la même façon si nous pouvions rester ensemble infiniment ? Aurions-nous le goût du palp ? Le palp est une procédure, nous procédons à la joie qui viendra, le plaisir nécessite de telles procédures, après les journées de travail qui nous séparent, après l’absence, se retrouver n’est une question ni de repos ni de présence, il faut encore que nous nous cherchions.
Entre le travail et toi il y avait sept stations de métro, mais je ne prenais pas le métro, je marchais, la rue est en pente et je la dévalais bien qu’elle monte, j’avais besoin de marcher pour te retrouver, j’avais besoin de quitter la terre du cimetière et de m’appuyer sur le béton des boulevards pour me hisser jusqu’à notre septième étage. Mais entre toi et le travail je préférais prendre le métro pour te quitter le plus tard possible, et j’observais toutes les stations, les quais, les visages saisis par la lumière de l’aube, je serrais dans mon poing une pelle imaginaire, j’effleurais dans ma mémoire la nuit passée, je pensais à ce qui dans ton corps avait différé des nuits précédentes, je croyais te connaître, mais les variations m’étonnaient, et j’étais inquiet quand je ne te voyais pas varier, j’étais peut-être passé à côté de quelque chose, car tu n’étais pas la femme la plus stable du monde, il y avait tant à savoir de toi que je voulais parfois m’en préserver – puis j’enterrais des corps que je ne toucherais pas.
Le travail est un mensonge. Qui rêve enfant de devenir fossoyeur ? Qui rêve de creuser six bons trous avant de poser sa pelle dans un local vert pomme et de retrouver celle qu’il aime ?
Enfant, j’avais rêvé de te trouver puis de te retrouver chaque jour, j’avais rêvé de cette rue en pente menant vers nous, et je la dévalais déjà en rêve. Il y avait dans mon rêve un orchestre qui jouait quelque chose tandis que je dévalais la rue, ce n’était pas Beethoven car je ne connaissais pas Beethoven, mais ça lui ressemblait, et à vrai dire je ne te connaissais pas non plus pourtant cela ne m’empêchait pas de te rêver, aussi pouvais-je rêver de Beethoven sans le connaître. On rêve de ce qu’on aime avant de le connaître, c’est que l’amour est là, comme une donnée au fond de notre enfance, et l’existence presse notre enfance pour que l’amour en sorte, certains le goûtent d’autres l’abandonnent, j’ai goûté au rêve de toi, qu’y a-t-il de plus beau que de venir vers toi ?
Du cimetière jusqu’à toi en dévalant la rue, chaque soir poser la pelle et puis presser le pas, poser la pelle s’est incrusté comme une donnée réelle dans le rêve de l’amour réalisé, c’est un amas de terre dure à partir duquel le mouvement s’initie, et c’est parce que j’ai posé ma pelle que je peux te retrouver, c’est parce que j’ai retourné toute cette terre, parce que j’ai enterré tous ces morts que je ne connais pas que je cours à présent vers toi pour te connaître à fond – je ne peux plus dire à fond sans penser à la terre, à ce creux où nos corps échouent, aussi ne te connaîtrai-je jamais à fond, je crois, mais bien plutôt en long en large et en travers, c’est l’expression qui va, c’est l’expression qui va le mieux à l’encontre des jours, et je sors du cimetière en courant, mais je ne fuis rien, je te désire, c’est différent, seulement je m’aperçois que sur mes épaules quelque chose freine, quelque chose dans l’air de la ville résiste, une lourdeur, un épuisement, un bruit de machine, mais c’est moi qui l’émet, j’ai oublié d’ôter l’armure des journées de travail, je cours avec maladroitement, je manque de trébucher, de m’écrouler, de renoncer à courir, cette armure est si lourde, j’ai oublié de m’en dévêtir, je cours quand même.
Entre le travail et toi il y a le rêve, la juste distance d’un rêve, l’exacte distance qui me permet de te retrouver, un rêve gardé depuis l’enfance. Aujourd’hui j’ai enterré deux enfants, je ne sais plus où je suis né, les paysages dans lesquels j’ai grandi se sont tous effondrés, je ne sais pas si je vais pouvoir m’appuyer sur quoi que ce soit, je ne sais pas si je vais pouvoir te retrouver ni enlever l’armure des journées de travail, il y a des soirs où on ne peut pas, pardonne-moi.
Si j’écrivais, c’était pour te demander pardon. Et je crois que j’écrivais de longues phrases quand j’écrivais. Mais je trichais. Au lieu de points, je traçais des virgules. Parce que rien ne devait s’arrêter.
Les virgules sont des armes fragiles. Aussi ai-je arrêté d’écrire.
Aujourd’hui je ne creuse plus seul. Mon collègue s’appelle Casper comme le fantôme et je pense qu’il s’agit d’un fantôme. Nous nous adressons des phrases courtes qui semblent sans destinataire, des humeurs et des impressions qui n’invitent à aucune forme d’échange.
Nous creusons ensemble, chacun d’un côté du trou. La compagnie est nécessaire. Même si elle n’est d’aucun secours.
Aux poissons que j’attrapais dans l’eau claire de la mer d’où je viens, aux poissons que je laissais mourir sur le sable, j’offrais la feuille d’un palmier pour que leur tête ne se recouvre pas de sable. Cela n’était d’aucun secours. Mais cela me semblait nécessaire. Casper est cette feuille de palmier, tandis que j’étouffe.
Et quand je rentre le soir je ne marche plus, je prends le train.
Casper et moi dans le Francilien, nous venons d’une île et nous rejoignons la France. Nous avons commencé à creuser à Pantin, c’est là qu’on nous envoie d’abord, avant de nous faire faire le tour de l’île (de France), le tour de la terre.
Le cimetière de Pantin et sa source secrète. Nous écopions puis nous prenions le train.
J’ai creusé où on m’a dit de creuser. J’ai pris ma pelle et ma pioche. J’ai mis mon casque et mes œillères. J’ai vu quand même : le travail est un mensonge.
J’ai eu un emploi, on m’a donné un emploi du temps, je n’avais plus de temps pour moi. J’étais pillé, employé pour le temps que je représentais.
J’ai donné mon temps j’ai donné mon sang j’ai jeté mes gants j’ai mis la main à la pâte j’ai donné la patte à la main qui voulait me la prendre.
J’étais du temps on m’a découpé en tranches fines on m’a roulé dans la farine on m’a recouvert de papier je ne pouvais pas me périmer pas m’avarier j’étais salarié j’avais un sale air de pauvre.
Il fallait sourire il fallait s’ouvrir il fallait s’écarter laisser de la place pour que tout puisse rentrer dans l’employé du temps ça rentrait c’était le bon temps.
J’ai travaillé au corps. J’ai œuvré puisqu’il fallait œuvrer. J’ai cherché du travail – j’en ai trouvé. J’ai cherché une histoire. Les histoires sont partout. Les histoires courent les rues. J’en ai pioché une au hasard. Mauvaise pioche.
La question est celle de l’échange.
Je veux dire : l’échange existe-t-il vraiment ?
Je veux dire l’échange autre que celui d’un corps contre une vie. Ou bien est-ce la même chose ? Un corps contre un corps. Une vie contre une vie. Deux centimes contre un centime.
J’ai gagné de l’argent, j’ai donné du temps. J’ai jeté mon temps dans le poulailler. J’ai donné du grain à moudre.
Je veux dire l’échange même le plus banal. Existe-t-il ? Sans attente d’autre chose que ce qu’il est. L’échange en soi, qui ne vaut pas pour ce qu’il pourrait être, mais qui vaut seulement pour ce qu’il est. Pour le petit corps qu’il est. Pour la petite vie. Pour le petit centime.
Je veux dire : est-ce qu’on peut se contenter du monde ? Se contenter de cette vie ? Se contenter de soi ? De l’autre ?
Ce n’est pas la question du bonheur ; c’est la question de l’inespéré.
Je me souviens de la mer.
Le pire est que la mer est loin.
Au fond des trous que nous creusions à Pantin, nous la voyions sourdre.
Nous avons été d’autres hommes, me dis-je quand je rentre chez moi.
C’est peut-être une phrase que j’ai écrite autrefois. Nous avons été d’autres hommes. Mais à présent nous sommes ces hommes dans le Francilien. Et il n’est pas certain que nous nous souviendrons de ce que nous sommes.
by jefklak | 15 janvier 2017 | Contrôle continu, Dé-colonialités
Le collectif Angles Morts milite autour des questions de la justice, de l’enfermement et des méthodes policières. Il est également coordinateur du livre Permis de Tuer – Chronique de l’impunité policière. Septembre 2014. Éditions Syllepse.
10 à 15 morts. C’est le nombre moyen de décès (connus publiquement) causés dans le cadre d’une intervention de police en France chaque année. Un profil-type des individus victimes de la répression policière se dégage sans appel : un jeune homme des quartiers populaires, d’origine maghrébine ou subsaharienne. L’actuelle affaire Adama Traoré, mort cet été dans un commissariat, ou la relaxe en juin 2016 des policiers inculpés dans la mort de Zyed Benna et de Bouna Traoré ont démontré que les forces de police bénéficient d’une injustifiable impunité judiciaire. Pour comprendre la production et le maintien de ces violences, Rachida Brahim, sociologue au Lames (Laboratoire méditerranéen de sociologie de l’université d’Aix-Marseille), a étudié la dénonciation et le traitement des crimes racistes entre les années 1970 et fin 1990.
Télécharger l’entretien en PDF.
Qu’est-ce qui t’a amenée à effectuer une thèse sur les crimes racistes entre les années 1970 et 1990 ?
J’ai eu l’occasion de travailler dans le secteur associatif à Marseille, notamment avec des personnes issues de l’immigration maghrébine et engagées sur la question de la mémoire ou des luttes de l’immigration. Parmi les sujets évoqués, celui des crimes racistes revenait régulièrement. Les militants faisaient référence à « la flambée raciste » ou « l’été rouge » de Marseille, selon les termes employés par Yvan Gastaut et Gérard Noiriel[2. Yvan Gastaut, « La flambée raciste de 1973 en France », Revue européenne de migrations internationales, no 2, 1993, p. 61-75 ; Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France: XIXe-XXe siècle discours publics, humiliations privées, Pluriel, Paris: Hachette littératures, 2007.]. Il s’agit d’une série de violences entre août et décembre 1973, après le meurtre d’un chauffeur de tramway par un passager pris d’un accès de démence. Le passager en question était un immigré algérien.
Durant les quatre mois qui ont suivi ce drame, des expéditions punitives et des agressions ont systématiquement ciblé des migrants maghrébins[3. Voir Mathieu Léonard, « 1973 : un été raciste », CQFD no 115 (octobre 2013).]. Les militants associatifs évoquaient également des affaires datant d’après cette série de violences, au cours des années 1970, 80 ou 90. Par-delà la régularité des faits mentionnés, j’ai été frappée par le sentiment d’injustice qui accompagnait les propos. Le constat partagé était celui d’une forme d’impunité dans les affaires de crimes racistes. Je voulais en savoir davantage sur les violences de ce type, mais je tenais aussi à objectiver ce sentiment d’injustice, à revenir sur les faits pour rendre compte de sa matérialité. J’ai donc étudié cette période de trente ans en essayant de mettre en évidence le contexte dans lequel ces violences ont eu lieu et la manière dont elles ont été traitées par le système pénal, et plus largement au sein des arènes politiques et législatives.

Comment produire aujourd’hui des connaissances sur les crimes racistes en France ?
La première difficulté est celle des sources. Les données les plus accessibles sur les crimes racistes ont été compilées par les associations engagées sur la question. La presse constitue également une importante ressource. Du côté institutionnel, c’est plus compliqué. Certaines archives publiques sont soumises à des délais de communicabilité, par exemple celles de la police et de la justice. Cela peut aller de 25 à 100 ans, et les demandes de dérogation ne sont pas toujours acceptées. Enfin, pour ce qui est des statistiques, il est difficile d’avoir une idée précise de ce que représentent les crimes racistes. Depuis 1990, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) recense les actes et menaces racistes, mais elle réalise ses statistiques en se fondant uniquement sur les sources du ministère de l’Intérieur. Or, il y a le risque de sous déclaration, et ce qui est perçu comme un acte raciste par les membres du groupe visé n’est pas forcément catégorisé comme tel par les institutions qui prennent en charge ces violences.
La seconde difficulté réside dans le choix des concepts appropriés. Le racisme est une notion qui désigne une conséquence, un phénomène qui se manifeste dans une société donnée, mais il ne s’agit pas d’un concept opératoire. C’est un terme qui ne montre rien de la chaîne de causalité et de la complexité des interactions dans lesquelles il s’inscrit. Je crois même qu’il tend à occulter la construction politique et sociale qui conduit aux violences raciales. Depuis une vingtaine d’années, les recherches menées dans le monde anglo-saxon sur les théories de l’ethnicité ont amené un renouvellement des réflexions françaises sur la question. Comme le genre et la classe, l’ethnicité fait partie des principaux critères de classement qui, au sein d’une société, permettent de différencier et de hiérarchiser les groupes sociaux. Ce sont ces mêmes critères qui entraînent une inégalité de traitement dans différentes sphères du monde social, en matière de logement, d’éducation, de santé ou encore de travail. Cela implique que la catégorisation des individus selon des critères ethniques précède le racisme qui peut se manifester à l’échelle individuelle sous forme de sentiments ou d’actions. Autrement dit, la construction de la race précède le racisme.

Un des débats majeurs qui entoure encore la question consiste précisément à savoir s’il vaut mieux parler d’ethnicité ou de race. Ces termes sont des concepts opératoires dans le champ scientifique, et ils font partie intégrante des « savoirs assujettis » pour reprendre l’expression de Foucault, mais ils peuvent avoir de tout autres signification et fonction lorsqu’ils entrent dans des sphères différentes, notamment dans celle du politique. C’est surtout le cas pour le terme race. Ce sont donc des termes très exigeants, qui demandent à chaque fois que l’on précise notre pensée. Et il faut toujours expliquer que l’on parle bien exclusivement d’une construction sociale que l’on réprouve et non de caractéristiques auxquelles on donnerait soi-même une essence ou une réalité biologique.
Pour certains, l’ethnicité renvoie à la dimension culturelle de l’identité, alors que la race désigne des phénotypes et un supposé ancrage génétique. Pour d’autres, l’ethnicité sert de terme socialement acceptable pour parler de race. Il présente l’avantage de ne pas reprendre à son compte le terme de race, c’est-à-dire de ne pas faire exister la notion, et par extension le phénomène, que l’on tente précisément de déconstruire. Personnellement, je crois que pour s’y retrouver, il vaut mieux partir des critères concrets à partir desquels les différences sont construites, qu’il s’agisse de la forme de votre visage, de votre nationalité, de vos origines, de votre religion ou de votre culture. Il me semble que ces marqueurs jouent la même fonction que les critères strictement biologiques, qui étaient retenus durant la période coloniale par exemple. Ils recréent la race, ils participent à stratifier la société, ils érigent des barrières entre les groupes et stipulent que les différences entre ces groupes sont irréductibles. Qu’on le veuille ou non, cela ressemble bien à des catégories raciales – quand bien même la race aurait changé de forme. C’est un constat amer : je dois avouer que j’ai moi-même parfois encore du mal à l’admettre, disons à le digérer. Je constate aussi que j’ai réglé la question du mot approprié en employant les termes ethnicité ou catégorisation ethnique comme des synonymes aux expressions utilisant le terme race.
Comment définis-tu le processus de racialisation, concept que tu as mobilisé dans le cadre de tes recherches ?
On retrouve le même débat ici, certains parlent d’ethnicisation, d’autres de racialisation. Restons sur ce second terme. Cette recherche a entre autres permis de préciser ce que représentait la racialisation dans le contexte français. Elle désigne le processus par lequel les catégorisations ethniques sont produites et maintenues par-delà leur dénonciation. Différentes phases composent ce processus. Il faut prendre en compte la manière dont les catégories sont construites, la manière dont elles affectent les relations interpersonnelles, mais également la manière dont elles se perpétuent.
Le premier acte se déroule à l’échelle institutionnelle. Le fait de catégoriser des individus selon des critères ethniques est une opération inhérente à l’action des pouvoirs publics. Cela passe entre autres par l’édiction de décrets, de lois et de politiques spécifiques. C’est une opération à la fois macrosociale et exogène qui implique non seulement une assignation identitaire, mais également la création de frontières invisibles entre les groupes sociaux. La force de cette catégorisation réside dans le fait que des valeurs négatives sont associées aux critères que représentent les traits physiques ou culturels, la nationalité, les origines ou la religion d’une personne. Ces critères agissent alors comme des stigmates qui vont non seulement différencier, mais également inférioriser les membres du groupe concerné.
En ce qui concerne le sujet que je traite, je me suis intéressé à deux figures stigmatiques de l’homme arabe : celle du « travailleur arabe » dans les années 1970 puis celle du « jeune de banlieue » dans les années 1980-90. Dans un contexte de crise économique et de restriction de l’immigration, les premiers ont été perçus à travers l’insalubrité de leur logement, leur propension à la criminalité ou encore leurs capacités à troubler l’ordre public. Dans un contexte de développement des grands ensembles et de constante hausse du chômage, les seconds ont hérité des stigmates des pères. Ils ont, par ailleurs, régulièrement été présentés comme des délinquants, des jeunes assistés ou inadaptés, sachant que les médias ont tenu une place décisive dans le renforcement des catégorisations ethniques.
Le deuxième acte de la racialisation se joue à l’échelle interpersonnelle. Le fait de catégoriser des individus selon des critères ethniques peut entraîner des inégalités, des discriminations, mais aussi des violences physiques à l’encontre des membres du groupe minorisé. En raison du stigmate assigné, ces derniers constituent des cibles potentielles, plus ou moins exposées en fonction du type d’interactions et des tensions nationales ou internationales liées au contexte économique, social ou politique. La série de crimes racistes à Marseille en 1973, l’affaire du Bordeaux-Vintimille en 1983 ou encore celle d’Ibrahim Ali en 1995 sont, à des degrés variés, des exemples caractéristiques de ce type de violences.

Le dernier aspect du processus est le plus difficile à circonscrire. Toute la question est de savoir où s’arrête la racialisation. J’ai cherché la réponse en regardant de plus près ce qui se passait une fois que le groupe concerné dénonçait la violence spécifique dont il faisait l’objet. Je me suis donc intéressée à la manière dont les crimes racistes étaient régulés par les pouvoirs publics. En l’occurrence, durant la période étudiée, le crime raciste n’est pas une catégorie juridique ; par conséquent, les procès portent sur l’infraction retenue, mais pas sur le caractère raciste ou non de l’acte. C’est ce qui explique en grande partie le sentiment d’injustice des membres du groupe concerné par ce type de violence. Lorsqu’on écoute les personnes qui ont dénoncé ces violences, des crimes de 1973 à la récente affaire Adama Traoré par exemple, il y a un même leitmotiv : la race tue deux fois. Une première fois en raison de la violence induite par la catégorisation, et une deuxième fois en raison du traitement de cette violence qui, loin de prendre en compte la catégorisation ethnique et ses effets, va la maintenir en l’occultant. On rejoint ici la notion de racisme systémique et structurel : c’est le système, l’organisation et les règles mêmes d’une société qui contribuent à la production des inégalités et des violences corollaires, par-delà leur dénonciation.
Ton enquête démarre au début des années 1970, qui a vu naître les premières luttes dénonçant les crimes racistes à l’encontre des Maghrébins. À travers ces luttes, on voit poindre une question centrale : comment définir un crime raciste ?
C’est là tout le débat. Durant les trente ans sur lesquels porte cette recherche, les parlementaires ont régulièrement déclaré qu’il était impossible de définir le mobile raciste et par extension le crime raciste. Du côté militant, dès les années 1970, le Mouvement des travailleurs arabes (MTA) s’est impliqué dans une lutte sociale pour l’amélioration des conditions de logement, de travail et de séjour des immigrés[4. Abdellali Hajjat, « L’expérience politique du Mouvement des travailleurs arabes », Contretemps, no 16, mai 2006, p. 76-85.]. Parallèlement, les crimes racistes ont connu une forte politisation : le seul fait que la victime soit un « Arabe » pouvait suffire à qualifier le crime de raciste et à lancer une mobilisation. De manière plus générale, lorsqu’on observe les faits de ce type qui ont été dénoncés durant les trente ou quarante dernières années, on constate que, pour les membres du groupe concerné, un crime raciste est une violence spécifiquement dirigée vers une personne en raison de son appartenance à un groupe racialisé. C’est la définition qui a globalement été retenue par les pays qui emploient l’expression « crime de haine ».
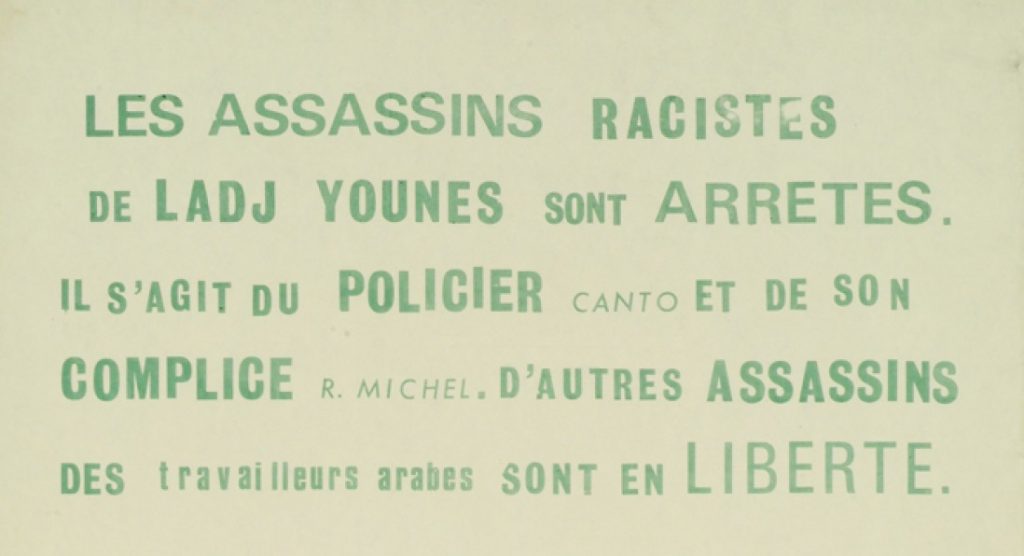
La notion est apparue dans les années 1980 aux États-Unis avant d’être introduite en Europe dans le courant des années 1990. Il s’agit plus d’un concept que d’une catégorie juridique bénéficiant d’une stricte définition légale. Son champ d’application varie selon les pays, mais dans l’ensemble, les crimes de haine désignent les violences commises en raison d’un mobile discriminatoire. Ils peuvent couvrir toutes les infractions pénales prenant pour cible des biens ou des personnes en raison de leur appartenance à un groupe minorisé selon des critères d’ethnicité, de religion, de nationalité, d’âge, de genre, en fonction de leur identité sexuelle ou en raison d’un handicap. La particularité des crimes de haine tient au fait que leur impact dépasse les individus pour toucher les membres de groupe qui partage la même identité sociale. Dans ce type de violence, l’auteur des faits a choisi sa cible en raison de l’hostilité qu’il éprouve envers le groupe auquel elle appartient. On parle dans ce cas de traumatisme indirect ou de « victime collective », car à travers l’individu touché par l’infraction, c’est toute une communauté qui est en réalité visée.
On a parlé alors de l’émergence du « mouvement immigré », comment est-il intimement lié au processus de racialisation ?
Le mouvement immigré, ce que l’on nomme également « luttes de l’immigration », désigne les mobilisations menées par les immigrés postcoloniaux, mais il peut aussi intégrer les luttes conduites par leurs descendants. C’est un abus de langage dans la mesure où ces derniers sont nés en France. À proprement parler, il serait plus juste d’évoquer un mouvement des racialisés, mais la catégorie « immigrée » est de loin celle qui a dominé en France. Beaucoup de militants parlent « des luttes de l’immigration et des quartiers populaires », ce qui me semble une formule déjà plus adaptée. Les recherches étasuniennes traitent de cette question en parlant d’« ethnicité mobilisationniste ». Les théories qui s’y rattachent envisagent l’ethnicité comme une ressource, un élément fédérateur qui est réapproprié et mobilisé dans la perspective d’une lutte sociale, dans le but d’accéder à davantage de biens ou de pouvoir.
Ces luttes sont intimement liées au processus de racialisation, parce qu’elles passent par une politisation des différentes formes de violences induites par les catégorisations ethniques. En France, il s’agit d’un mouvement fragmentaire qui a été conduit par différentes générations, au sens social du terme : la génération des « travailleurs arabes » dans les années 1970, puis la « seconde génération » dans les années 1980-90, avec tout ce que cette expression a d’illusoire. Les actions collectives menées par ces deux générations ont pris des formes très variées et s’inscrivent dans des contextes différents. Cela étant, l’objet des luttes est resté sensiblement identique au cours de ces trente ans : protester contre les inégalités en dénonçant la manière dont le racisme imprègne les différentes sphères de la vie sociale, celle du droit au séjour, du travail, du logement, ou encore de la santé. La question des crimes racistes représente également un point de similitude entre ces différents mouvements. La dénonciation de ces violences et de leur traitement a été une constante au sein de ces mobilisations.
Dans les années 1970, l’identité ouvrière et le mythe du retour au pays ont permis de délimiter la génération des travailleurs arabes. À cette période, les militants du MTA se mobilisent systématiquement contre les crimes racistes qui symbolisent d’après eux la violence plus générale, et notamment sociale, à laquelle sont confrontés les immigrés. Par exemple, dans la semaine qui suit le meurtre du traminot à Marseille en août 1973, on dénombre six morts, à raison d’un mort par jour. Les agressions se poursuivent au cours des mois d’octobre et novembre. Elles atteignent un point culminant en décembre 1973, après le plastiquage du consulat d’Algérie qui fait quatre morts et 22 blessés. Ces violences ont fait de la région marseillaise l’épicentre de la lutte des travailleurs immigrés. Dès le mois de septembre, les militants du MTA ont mis en place des commissions d’enquête populaires pour élucider les crimes, des groupes d’autodéfense, et organisé des stages nationaux des travailleurs ou de la Gauche arabe, des manifestations. Ils ont également lancé une grève générale contre le racisme, amplement suivie par les travailleurs immigrés à l’échelle régionale.

Les années 1980-90 se distinguent par le fait que le travail ouvrier se raréfie et que l’idée d’un retour au pays est progressivement abandonnée. Les membres de la « seconde génération » sont donc nés sur le territoire français dans une période de développement des grands ensembles et de constant accroissement du chômage. Ces années sont davantage marquées par une concomitance des protestations spontanées et des actions concertées. On note d’une part un usage renouvelé de l’émeute comme moyen de contester l’ordre établi et d’intervenir dans le débat public. Ce terme a acquis une connotation péjorative pour certains, mais c’est un terme déjà employé sous l’Ancien Régime et qui désigne tout simplement un soulèvement populaire et spontané provoqué par une émotion collective. Les plus médiatisées ont eu lieu au début des années 1980 puis au début des années 1990, mais ce ne sont pas des cas isolés. Les crimes racistes, les violences policières dans les quartiers populaires, mais aussi les jugements prononcés à l’issue des procès, ont régulièrement constitué le point de départ de ces protestations.
On relève d’autre part l’existence de collectifs structurés qui ont employé un répertoire d’actions allant de la grève de la faim à l’occupation d’espaces, en passant par l’organisation de rencontres nationales, de concerts ou de marches. Dans cet ensemble, la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983 est un des exemples les plus emblématiques de ce type de mobilisations. Après la Marche, les tentatives infructueuses de se fédérer à l’échelle nationale ont laissé la place à des structures qui se sont davantage concentrées sur l’action locale. La mort d’un habitant dans une cité a fréquemment donné lieu à l’organisation de marches silencieuses, à la création de comité de soutien ou d’associations.

Comment réagissent les acteurs étatiques face à ces violences racistes et ces mobilisations ? Pourquoi les parlementaires se refusent-ils à définir légalement un crime raciste ?
Entre les années 1970 et fin 1990, en ce qui concerne les crimes racistes, deux conceptions différentes d’un même phénomène ont coexisté. Pour les membres du groupe concerné, les crimes racistes constituaient une violence spécifique qui aurait mérité un aménagement des règles du droit. Pour les pouvoirs publics, il s’agissait d’une violence qui relevait du droit commun, c’est-à-dire des règles qui s’appliquent de la même manière à tous les citoyens – et il n’était pas envisageable de créer un droit particulier. Lorsqu’on étudie les débats parlementaires sur cette question, on constate que les parlementaires ont justifié le fait qu’il était impossible de créer une incrimination spécifique en se référant à la conception universaliste de la citoyenneté impliquant que le droit devait être le même pour tous.
Dans les faits, si la race tue deux fois, c’est parce qu’elle fait écho à un double mouvement porté par le droit et dans lequel les groupes minorisés sont enserrés. Le premier mouvement correspond au premier acte de la racialisation évoqué en amont. Il consiste à particulariser les individus en les catégorisant selon des critères ethniques. Cette action entraîne des inégalités de traitement, mais en raison de la stigmatisation inhérente, elle peut aussi induire des violences, des crimes racistes en l’occurrence. Le second mouvement réside au contraire dans le fait d’universaliser ces mêmes individus au moment précis où ils dénoncent la violence produite par le particularisme. Bref, cela revient à invoquer des règles communes pour des groupes qui ont auparavant été différenciés. Alors que la première violence trouve son origine dans le particularisme, la seconde réside dans le fait que ce même particularisme est ensuite occulté.

Concrètement, durant ces trente ans, alors que la question des crimes racistes a régulièrement atteint un haut degré de politisation, dans l’arène législative, un même débat a été reconduit au cours des trois principales lois portant sur la pénalisation du racisme. À chaque reprise, les parlementaires ont interrogé, puis rejeté la possibilité de définir le mobile raciste qui aurait permis de caractériser ces crimes. Par conséquent, la législation antiraciste s’est exclusivement intéressée à la répression de la parole raciste et des discriminations.
La « Loi relative à la lutte contre le racisme », promulguée le 1er juillet 1972 est considérée comme le socle de cette législation. Le Mrap et la Licra interpellaient le gouvernement depuis treize ans en faveur de sa mise en place. Elle porte sur les provocations à la haine raciale, les diffamations, les injures raciales et les actes de discrimination. Or, contrairement aux recommandations de l’ONU, elle ne prend pas en compte les agressions et homicides à caractère raciste. La question est totalement absente dans la sphère législative, comme dans celle du politique en général.
Pour ce qui est des années 1970, j’ai pu consulter les archives du Ministère de l’intérieur. Les dossiers conservés montrent que le gouvernement algérien répertoriait les violences prenant pour cible ses ressortissants et demandait régulièrement des informations au ministère de l’Intérieur français sur les circonstances des faits et leurs suites pénales. Les rapports dressés par les services de police, par les préfets, mais également par les agents ministériels en vue de répondre au gouvernement algérien nient systématiquement la présence de mobile raciste pour mettre au contraire en avant des affaires de vols, des rixes, des règlements de compte, des suicides ou des accidents.

À l’issue de la Marche de 1983, le gouvernement socialiste avait promis aux manifestants une nouvelle loi qui permettrait d’aggraver les peines dans les affaires de crimes racistes. Dans les faits, lors du vote de la loi de 1985 dé sur diverses dispositions d’ordre social, cette option a été écartée et remplacée par une mesure permettant à certaines associations de se porter partie civile dans les affaires d’homicides à caractère raciste. À travers cette loi, le mobile raciste est implicitement reconnu, mais il ne fait pas l’objet d’une définition. Un sénateur insiste notamment sur le fait que le mobile raciste représente une notion trop « vague », et par là impossible à admettre dans le Code pénal. Par conséquent, lors des procès, les conflits d’interprétation sur ce qui constitue ou non un crime raciste perdurent.
Au début des années 1990, plusieurs actes de violence racistes ébranlent à nouveau une partie de l’opinion. Différentes organisations se plaignent des insuffisances de la législation. Une nouvelle loi sur la question est alors négociée. Le mobile raciste constituait l’élément central de la proposition de loi initiale, il a une nouvelle fois été discuté, puis abandonné. La Loi Gayssot, votée le 13 juillet 1990, « tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe » renforce surtout les sanctions de la loi de 1972 et crée le délit de négationnisme.
Dans les affaires de crimes policiers en France, ou de morts pendant ou suite à des interventions policières, la dimension raciste des agissements policiers est chaque fois évacuée, rarement évoquée par les familles mêmes des victimes. Qu’en penses-tu ?
Pour ce qui est des familles des victimes, c’est une position compréhensible. Les violences policières constituent un type très particulier de faits dans l’ensemble des crimes qui sont perçus comme racistes. Par rapport aux crimes commis par un individu ordinaire, lorsque la famille tente d’avoir gain de cause, il y a une difficulté supplémentaire, dans la mesure où l’usage de la force entre dans les prérogatives des agents de police, ce qui implique que la violence peut-être considérée comme légitime.
Il faut aussi noter que, même si la législation a évolué depuis 1990, il reste extrêmement difficile de prouver le caractère raciste d’un fait. En France, le mobile raciste d’un homicide peut être pris en compte depuis la loi Lellouche votée en 2003. Les parlementaires se sont pliés aux recommandations de l’Union européenne en se rapprochant du concept de crimes de haine adopté par d’autres États. Selon les pays, quand le mobile raciste est avéré, la législation en vigueur prévoit une majoration des peines ou une peine spécifique. En France, la loi de 2003 aggrave les peines punissant « les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe » lorsque le mobile raciste est prouvé. Cela étant, c’est à nouveau sur ce point que le texte de loi a achoppé. Les parlementaires ont refusé d’inverser la charge de la preuve et ont déclaré que le mobile raciste ne serait reconnu que si l’infraction était précédée, accompagnée ou suivie de propos racistes, ce qui bien sûr n’est pas toujours le cas. Le député à l’origine de cette loi a précisé qu’il s’agissait « de rattraper le retard, de combler un vide juridique et de mettre fin à la passivité, objectivement conciliante, des autorités judiciaires ». Dans les faits, la condition qui a été posée a réduit le champ d’application du texte de loi et a limité l’impact qu’il aurait pu avoir sur la procédure pénale.
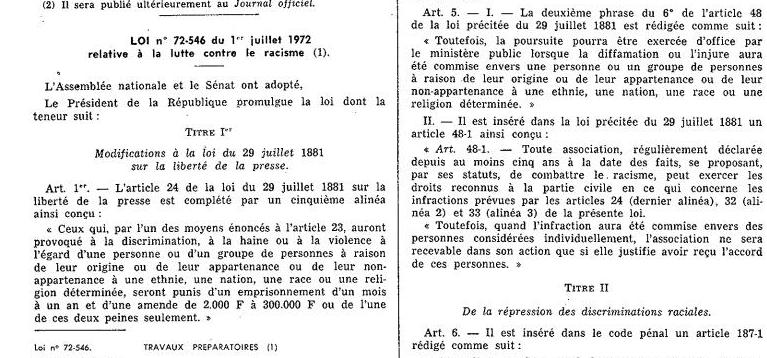
On voit aussi à travers ton travail qu’entre les crimes perpétrés par des civils français des années 1970, que certains qualifient d’arabicides, et ceux commis dans le cadre d’opérations policières depuis les années 1980, le crime raciste a changé de nature…
Pour avoir une idée un peu plus précise de l’évolution de cette violence, j’ai tenté de constituer une base de données en recensant les actes dénoncés comme racistes entre les années 1970 et fin 90. J’ai pu répertorier 731 cas. Ce n’est évidemment pas exhaustif, mais cela permet déjà de tirer quelques constats. En ce qui concerne les différences, du point de vue des victimes d’abord, les cibles sont variées, il a pu s’agir d’un individu isolé, de groupes d’individus, d’édifices publics représentant l’État algérien ou encore de cités, de foyers, de cafés fréquentés par des Maghrébins. La différence majeure tient au fait qu’à partir des années 1980, « les jeunes de banlieues » remplacent « les travailleurs arabes » qui étaient visés durant la décennie précédente. Il semble également que les violences diminuent : elles sont plus nombreuses dans les années 70 que dans les années 90, mais pour vérifier ce point, il faudrait bénéficier de statistiques plus importantes. Enfin, plus on avance dans le temps, plus l’islam est visé. L’affaire du foulard en 1989 est un marqueur fort de cette tendance qui s’est depuis accentuée.
En ce qui concerne les continuités, j’ai pu remarquer que, quelle que soit la décennie, la violence peut s’exprimer selon trois formes. On peut d’abord nommer les violences politiques exercées par des personnes qui agissent au nom de leur proximité ou de leur adhésion aux thèses de l’extrême droite. Elles donnent lieu à des attentats, des agressions ou des expéditions punitives. Il y a également des violences situationnelles. Elles peuvent avoir lieu lors d’une scène de la vie quotidienne. Pour l’auteur des faits, le but est généralement de protéger ce qu’il considère comme une propriété au sens large et subjectif du terme (sa maison, son commerce, des membres de sa famille, une femme, une fête nationale ou simplement sa tranquillité). Le passage à l’acte criminel s’explique ici par la présence de deux facteurs : d’une part la nuisance ou la menace qu’incarne pour lui la présence d’un Maghrébin et d’autre part l’idée d’un bien à protéger. Viennent enfin les violences disciplinaires, plus connues sous le nom de violences policières, et qui sont associées dès les années 1970 à des crimes racistes. La notion de discipline est intéressante parce qu’elle laisse voir ce qui est sous-jacent à ces violences, et notamment le fait d’user illégitimement la force dans le but de répondre à un désir de coercition, à une volonté de discipliner des corps catégorisés comme déviants.

Dernier élément de compréhension au sujet de ces violences : un sentiment d’injustice accompagne invariablement le récit de ces actes. Il renvoie à ce que l’on appelle une victimisation secondaire. Cette notion est d’abord apparue aux États-Unis dans les années 1970 après une scission au sein de l’étude de la criminologie, lors de l’émergence d’une criminologie critique, influencée par les mouvements néomarxistes et féministes.
La victimisation primaire désigne l’action par laquelle une personne est la cible d’une infraction et acquiert le statut de victime d’un point de vue légal. La victimisation secondaire advient au moment où cette même personne fait le récit de l’infraction dont elle a fait l’objet – lors d’un échange entre la victime et ses proches, mais aussi lors de la confrontation avec les institutions qui représentent les interlocuteurs des victimes. Il peut s’agir du système médiatique, éducatif, médical, policier ou judiciaire. Cette victimisation secondaire est provoquée par des attitudes de blâmes et d’inversement des responsabilités, par une banalisation des faits ou par l’existence d’un vide juridique.
La victimisation secondaire a d’abord été mise en évidence par les analyses féministes portant sur les violences faites aux femmes. Les premières études menées sur la question des agressions sexuelles ont par exemple montré que les victimes de viol sont fréquemment considérées comme responsables de ce qui leur arrive – ce qui, de fait, accentue la violence initialement subie. C’est sous l’influence conjuguée des mouvements féministes et des recherches conduites en criminologie victimologique que plusieurs pays ont modifié leurs législations sur le viol dans les années 1980. Dans le cas qui nous intéresse, la victimisation secondaire a été provoquée par le traitement pénal et législatif de crimes racistes qui empêchait de caractériser le mobile raciste.
On est loin ici de l’image qui domine aujourd’hui sur la victimisation. Il s’agit d’un terme qui a été manipulé et galvaudé, parce qu’il s’inscrit dans le cadre des luttes visant à imposer une représentation du monde social plutôt qu’une autre. L’idée de victimisation a souvent été retournée contre les personnes dénonçant un préjudice et exprimant des revendications pour décrédibiliser leurs paroles et déclarer qu’elles abuseraient du statut de victimes. C’est un reproche qui a par exemple été fait aux féministes, aux homosexuels et plus récemment à ceux qui ont porté publiquement la question de l’islamophobie. Pour s’opposer à ce détournement du terme et répondre à l’accusation, il faut revenir au sens initial. La victimisation primaire exprime simplement l’action par laquelle une personne va être victime d’une infraction selon une définition légale. C’est un fait, un statut dans un cadre donné, ceci n’implique en rien une posture d’éternelle victime ni une dérive vers une autovictimisation exacerbée et sans fondement.

by jefklak | 10 janvier 2017 | Culture de base, Marabout
Traduit par Émilien Bernard
Article original de la revue anglaise Strike !
Qui n’a pas lu Jaroslav Hašek (1883-1923) est un sagouin. C’est ainsi. Pas de discussion. D’autant que l’écrivain pragois a eu l’élégance de laisser une œuvre de taille modeste, essentiellement couchée dans Le brave soldat Chvéïk et ses déclinaisons (Nouvelles aventures du soldat Chvéïk et Dernières aventures du soldat Chvéïk ). L’affaire de quelques heures de lecture. Lâchez donc vos écrans et filez fraterniser avec ce bon Chvéïk. En guise d’apéritif, voici un joyeux éloge au fondateur du « Parti pour un progrès modéré dans les limites de la loi ».
Cet article est initialement paru dans le premier numéro de Jef Klak, « Marabout », encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF.
Pour être franc, sa vie fut un vrai désastre. Certains l’ont catalogué comme pur bolchevique, mais c’était avant tout un bolchev-hic. Ses années de jeunesse furent difficiles et il se débrouilla pour que les choses empirent progressivement. Du temps où il publiait deux journaux anarchistes à Prague, il fit en sorte qu’une cinglante polémique les oppose. Il édita également le prestigieux magazine Animal World, dans lequel il inventait des animaux fantastiques et mettait en vente des chiens « de race » qu’il avait auparavant volés dans les rues. Son unique œuvre, Le brave soldat Chvéïk, fut en majeure partie rédigée alors qu’il était ivre. Au vrai, c’est une recension délabrée de récits d’ivrognes glanés dans les bars. Une recension classée dans la liste des cent plus grands livres du siècle dernier. Voilà comment ce vil bohémien qu’était Jaroslav Hašek mena sa vie et son œuvre.
Hašek était par essence anarchiste et rétif à l’autorité. Il fut actif de 1906 à 1909 dans le mouvement anarchiste tchèque, mais se vit expulsé d’un collectif parce qu’il avait troqué le vélo du bureau contre de la bière. Autre exploit : il mena une grève des employés du tramway sans jamais avoir travaillé dans cette branche. Il fut également arrêté pour avoir jeté une pierre sur un policier durant une émeute. Lors du procès, il se défendit en expliquant qu’au cours des événements il avait repéré un fossile très rare traînant au sol. Craignant qu’il soit perdu – ou pire, utilisé comme projectile – il l’avait alors projeté par-dessus un mur pour le sauvegarder. C’est ainsi qu’il avait malencontreusement heurté un inspecteur de police.
Alors que sa fiancée le présentait à son éventuel futur beau-père quelque peu inquiet, Hašek lui assura qu’il venait de décrocher un emploi stable. « Quel est le salaire ? », s’enquit l’homme. « Deux litres de bière par jour », lança-t-il joyeusement.
L’un des plus beaux faits d’armes de Hašek fut la création – en compagnie de quatre amis artistes – du « Parti pour un progrès modéré dans les limites de la loi[2. Pour en savoir plus, lire Histoire du Parti pour un progrès modéré dans les limites de la loi, par Jaroslav Hašek, publié chez Fayard en 2008.] » en vue des élections au conseil de Prague de 1911. La ville faisait partie de l’Empire austro-hongrois et une censure très stricte s’y appliquait, mais Hašek parvint à la contourner en fondant un parti revendiquant une modération poussée à l’extrême. Ses réunions publiques étaient joyeusement chaotiques. Elles se tenaient immanquablement dans des bars et étaient surveillées par des espions du gouvernement, qui espéraient y récolter des preuves de subversion.
« Que pensez-vous de La Couronne ? lui demanda un jour un agent, dans l’espoir que Hašek se trouverait forcé de critiquer ouvertement l’Empereur.
– C’est un excellent établissement, répondit-il. J’y bois fréquemment[3. Hašek répond ici via un jeu de mot sur le nom, très répandu pour un pub, « The Crown », qui peut se traduire par « La Couronne ».].– Pourquoi le portrait de l’Empereur est-il retourné contre le mur ? , s’enquit un autre. Sa réponse :
– Pour éviter qu’une mouche ne lui chie dessus, ce qui pourrait conduire certaines personnes à des remarques inappropriées. »
Alors que des foules affluaient aux meetings nocturnes, Hašek promit un jour, sans vraiment réfléchir à la portée de ses termes, de dévoiler lors de la prochaine réunion une liste de vingt élus municipaux ayant assassiné leur propre grand-mère. Le soir en question, la tension était à son comble, d’autant que des policiers et des officiels s’étaient joints à l’immense assemblée. Hašek s’était mis dans un beau pétrin. Mais ses amis vinrent à sa rescousse.
Avant que Hašek ne se lance, le « Président du Parti » (poste qui n’existait pas) expliqua d’une voix grave qu’une question urgente se posait, et qu’elle devait être discutée prioritairement selon un point de la constitution du Parti répertorié à la « Section 35, sur l’agriculture » (il n’y en avait pas non plus). « Quelle est votre position sur le syndrome pieds-mains-bouche ? », lui demanda-t-il. « Voilà une question d’une stupidité extraordinaire, répondit Hašek, mais à laquelle il me faut répondre. » Il parla ensuite pendant 89 minutes des ravages de cette maladie sur le bétail dans les empires ostrogoth et wisigoth, avant de conclure sa démonstration en affirmant que l’unique porteur de ce syndrome à l’heure actuelle était le maire de Prague. Il fallait d’ailleurs fournir de toute urgence à ce dernier dix galons de bain de bouche à la créosote. La foule quitta le bar, en quête de créosote… et du maire.
Le jour même de l’élection, et seulement quelques minutes après l’ouverture du scrutin, ses partisans commencèrent à coller des affiches clamant une victoire écrasante de Hašek. Les votants se voyaient conviés au pub servant de QG au parti, afin de célébrer la victoire. Ils furent des centaines à s’y rendre. Finalement, un policier fit son entrée et demanda à Hašek de retirer les affiches. Ce dernier offrit une accolade à l’humble agent de police, lui annonça qu’il faisait de lui son chef de la police et triplait son salaire actuel, puis le renvoya à son devoir.
La suite de sa vie fut tout aussi extraordinaire. Conscrit au sein de l’armée austro-hongroise, il fut capturé par les Russes. Après la révolution d’Octobre, il s’enrôla brièvement dans la Légion tchèque puis dans l’Armée rouge, au sein de laquelle il atteignit rapidement le rang de Commissaire politique, avant de reprendre la route de Prague en 1920. Les trois années suivant son retour, il mena une existence de vagabond, rédigeant des récits sur des bouts de papier qu’il perdait immanquablement. Le lendemain, il demandait aux gens s’ils se rappelaient de l’histoire qu’il leur avait racontée la nuit précédente. Il buvait des quantités d’alcool prodigieuses. À l’époque de sa mort, en 1923, il pesait près de 140 kg. Il fallut démolir un mur de sa maison pour emporter son corps.
Il était cependant parvenu à écrire le récit des aventures du « Brave soldat Chvéïk », qui semblaient remarquablement similaires à ses propres pérégrinations. Par sa pratique d’une forme de sagesse indexée sur la folie et d’une obéissance surjouée à l’autorité, Chvéïk est le personnage de roman le plus anarchiste et subversif de l’histoire. Voici un exemple tiré du premier chapitre :
Le propriétaire de la taverne locale fréquentée par Chvéïk tente toujours d’éviter toute conversation avec lui – il craint d’être surveillé par des agents de police. Un jour, Chvéïk entre dans le bar et se voit saluer ainsi par la patronne en pleurs :
« Après votre départ, mon mari a été arrêté pour subversion. Il a été condamné à dix ans de prison voilà une semaine.
– C’est une excellente nouvelle , rétorque joyeusement Chvéïk.
– En quoi donc est-ce une bonne nouvelle ?
– Eh bien, il a déjà tiré une semaine de sa peine. »
En septembre 2000, j’étais à Prague lorsqu’éclatèrent les émeutes contre la Banque mondiale et le FMI, en compagnie de Jane Nicholl et de Martin Wright. Nous nous étions rendus au très touristique Chalice, l’un des innombrables pubs où Hašek avait ses habitudes. En quittant les lieux, nous avons entendu des volées de gaz lacrymogène et repéré de la fumée provenant des combats de rue. Alors qu’on se précipitait pour y prendre part, j’ai ramassé une pierre, et l’ai rapidement inspectée pour voir si un fossile s’y accrochait.








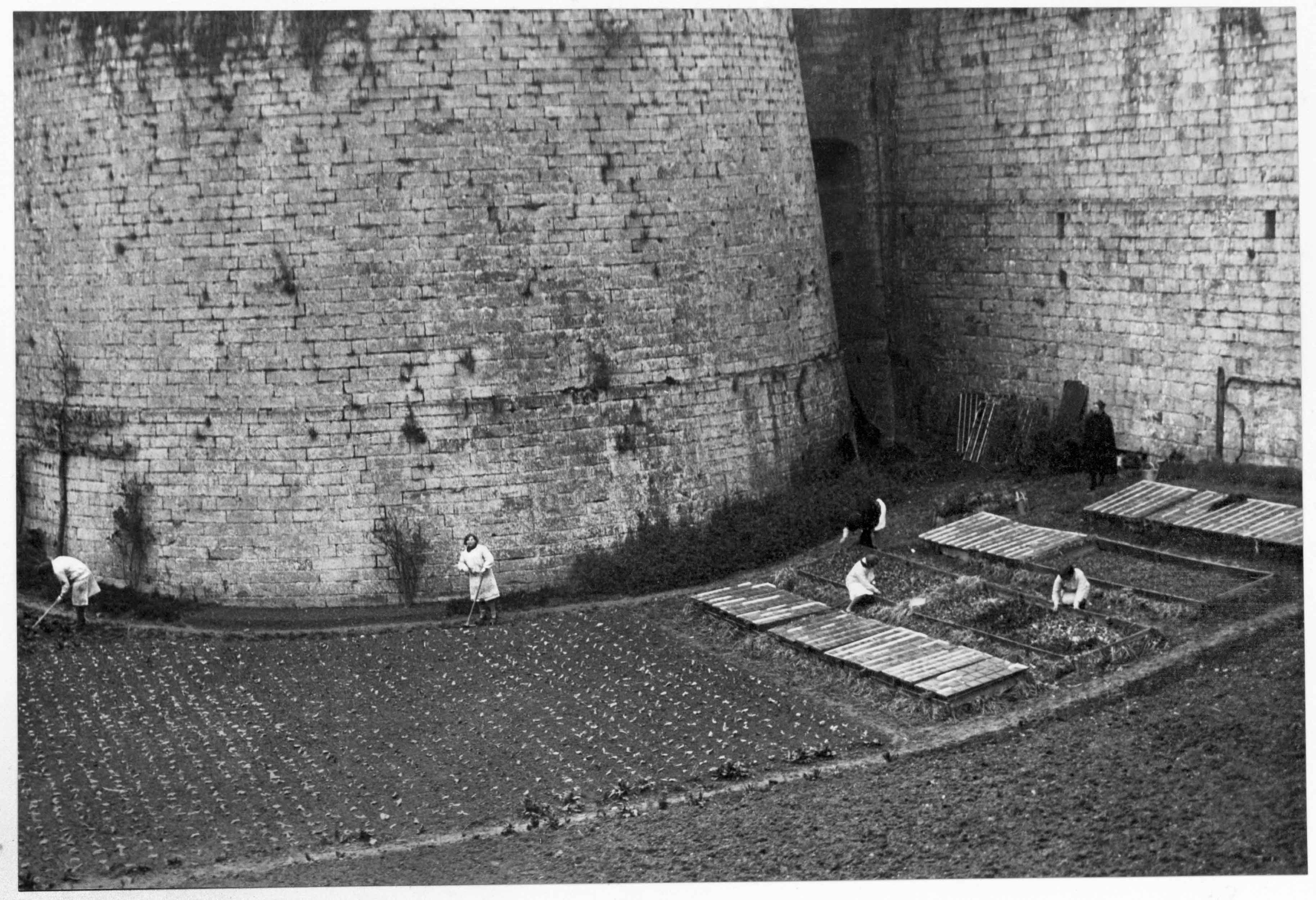





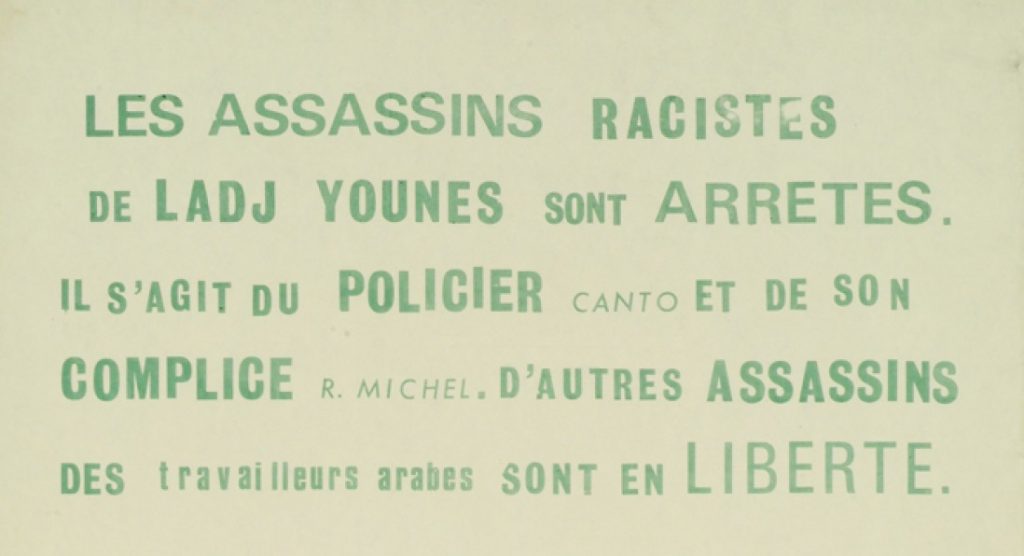




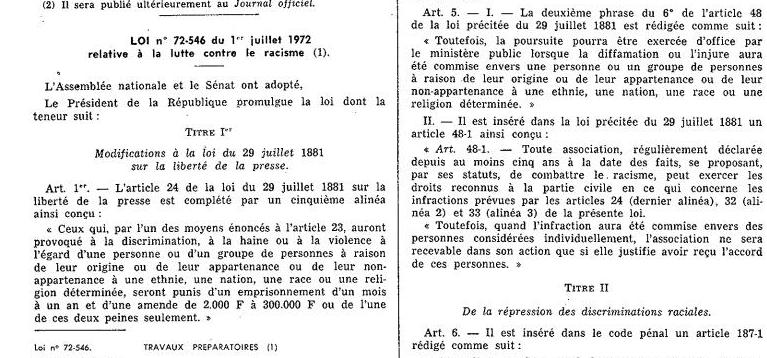


Recent Comments