by xavier | 22 mai 2018 | Le lundi au soleil, Terrains vagues
Texte original : « McDonald’s as America: A Conversation with Chris Arnade », The Revue Of Books of Los Angeles, le 5 septembre 2017
Traduit par Baptiste Miremont
Ancien de Wall Street devenu reporter atypique, Chris Arnade a une méthode propre à donner une leçon aux journalistes en herbe. Il arpente le territoire des États-Unis et se pose, au milieu des autres, sur les bancs des restaurants McDonald’s ou au coin d’une rue de banlieue, ouvert à la rencontre. Là, ce qu’il voit n’est ni révolutionnaire ni spectaculaire : des tranches de vie ordinaires, des groupes de parole et de communautés de quartier, des existences précarisées et banales. Les photos et témoignages qu’Arnade recueille dans les fast-foods – d’habitude méprisés – parlent de l’Amérique, de la pauvreté endémique de ses marginalisé·es et du soutien mutuel de ses habitant·es. Sam Jaffe Goldstein, libraire de Los Angeles, l’a interviewé – loin des sentiers battus de la gauche universitaire.
Crédits photo : Chris Arnade
Télécharger l’article en PDF.

Ancien trader, Chris Arnade a échangé sa vie à Wall Street pour devenir « documentariste-citoyen ». Il traverse le pays en minivan afin d’étudier les disparités séparant les deux Amériques : celle du haut et celle du bas. Son travail se concentre sur la seconde, sur ces populations invisibles, marginales, abandonnées par la classe managériale, qui elle ne connaît pas la crise.
Arnade n’est pas un journaliste classique. Il écrit sur l’addiction et la pauvreté, notamment, photographiant les personnes qu’il rencontre. Ses vues politiques dépassent les scénarios convenus qu’on voit sur les chaînes d’informations en continu. Il se définit comme socialiste, et bien qu’il critique les politiques d’austérité républicaines, il s’en prend également à la gauche, qu’il juge élitiste et repliée sur elle-même. Son travail n’échappe pas aux controverses : certain·es journalistes du sérail le disent peu professionnel, manipulateur et exploiteur vis-à-vis de ses sujets d’enquête.
Pourtant, Arnade réalise ce que très peu de journalistes ou de médias ont essayé : au lieu de maintenir cette Amérique du bas à distance, lui cherche à comprendre les fils mêmes de son existence. Et plutôt que de réduire les gens qu’il rencontre à des curiosités anthropologiques, Arnade les traite comme des personnes, des citoyen·nes comme lui et des ami·es.
Comme tout voyageur arrivé dans un nouveau quartier, une ville qu’il ne connaît pas, Arnade a sans cesse besoin d’une base opérationnelle. Le plus souvent, il s’installe dans un McDonald’s. Car sous les arches dorées, Arnade trouve le repos, de la nourriture bon marché, ainsi qu’un grand nombre de personnes désireuses de lui raconter leurs vies. Dans un tweet récent, Arnade écrivait : « Tout ce que vous voulez savoir sur l’Amérique peut être appris dans un Mc Donald’s. »

*
Avez-vous toujours utilisé McDonald’s comme un point d’entrée pour intégrer un quartier?
Non. Il y a dix ans, si je regarde les choses avec mon regard actuel, je dirais que j’avais de McDonald’s la vision de l’Amérique du haut : une franchise peu recommandable, servant une nourriture peu recommandable. Je n’y pensais pas, je ne m’y intéressais pas vraiment non plus. Si j’en avais eu une, mon opinion aurait correspondu à l’avis partagé au sein de la gauche : McDonald’s ? Aucun intérêt.
Cette franchise est devenue un point de référence quand je me suis lancé dans un projet traitant d’addiction et de pauvreté. Souvent, je me suis retrouvé au McDonald’s à cause de mes nouveaux et nouvelles ami·es : des personnes sans-abris, des toxicomanes. Et finalement, j’ai réalisé que je n’y allais plus seulement pour les voir, mais pour les mêmes raisons qu’eux. Parce que je profitais là-bas d’un moment de répit. Je pouvais recharger mon ordinateur et mon téléphone, utiliser le wi-fi, les toilettes. La nourriture et le café y sont bons et à bas prix. C’est là que j’ai mesuré l’existence de communautés établies à l’intérieur de chaque McDonald’s.
Au début, j’ai combattu cette envie d’écrire à propos de cette franchise, parce qu’il me semblait que c’était trop simple, bas de gamme. Je proposais aux personnes de se revoir sur le parking ou chez elles, comme ça, j’évitais de les photographier à l’intérieur du McDonald’s où l’on s’était pourtant rencontrés. Et puis je me suis demandé : « Pourquoi suis-je en train de refuser l’idée que McDonald’s constitue le véritable centre social de certaines villes ? » Je pensais aussi que le décor de McDonald’s n’offrait rien d’intéressant d’un point de vue photographique, et je voulais donc éviter de centrer mon projet autour de ces lieux. Au final, je me suis dit que telle était la réalité et que je me devais de la retranscrire telle quelle.
J’ai alors proposé un article pour le Guardian montrant en quoi les McDonald’s constituent des centres sociaux. Pendant un an et demi, j’avais essayé de l’écrire, sans jamais trouver l’angle d’approche. Je pensais que tout le monde savait : pour moi, à cette époque, McDonald’s représentait une grande part dans ma vie. De tous les articles que j’ai écrits, c’est celui-là qui a le plus fait de bruit, m’apportant aussi le plus de retours.

Vous poser dans ce genre de lieux publics ou semi-publics est-il une habitude pour vous ?
Pour plaisanter, je dis que je ne fréquente que quatre types d’endroits : les McDonald’s, les églises, les petites universités et les bars. Je passe aussi beaucoup de temps à marcher. Ma méthode de travail consiste à me garer et arpenter la ville au hasard. Si je choisis de m’installer dans un McDonald’s le temps d’une pause, c’est surtout parce qu’il y en a partout. Et j’aime les fréquenter pour la même raison que tout le monde : ils sont identiques, propres et sûrs.
Je considère toujours les histoires et les informations récoltées lors de ces haltes au McDonald’s comme plus importantes que celles collectées en me promenant. Les gens que j’y rencontre sont plus représentatifs de leur quartier, de leur communauté, tout en correspondant aux populations qui m’intéressent.
Tant d’enquêtes de terrain se sont déroulées dans des bars et des restaurants. Qu’est-ce que McDonald’s apporte de différent ?
Pour être franc, je pense que les lieux étudiés par la majorité des journalistes ne représentent pas réellement la société. Ce sont des lieux où vont les personnes dotées d’un statut socio-économique élevé, des lieux où se réunissent les preneurs de décisions. Après, ce ne sont pas des endroits à éviter : on y rencontre des gens très raisonnables.
Quand je suis allé travailler sur la Convention républicaine, je n’ai pas mis les pieds à l’intérieur du bâtiment ni dans le quartier alentour. J’ai passé une semaine et demi dans Cleveland, tournant entre quatre McDonald’s. Deux étaient situés dans le cœur de quartiers Africains-Américains, très pauvres, un dans un quartier aisé et un dans un quartier blanc ouvrier. Dans une certaine mesure, cela m’a apporté une vision équilibrée des disparités séparant ces différents quartiers. Si j’avais été à la convention et que j’avais passé du temps dans les salles de meeting, je n’aurais rencontré que des personnes souhaitant être vues.
On se concentre énormément sur ce qui se passe à Washington DC et sur l’aspect de compétition sportive de la politique, mais c’est un sport où les fans décident du gagnant. Or les fans sont des personnes moyennes trainant dans les McDonald’s, les Walmart, à KFC… Ces lieux ne représentent pas seulement des expressions banales de la réalité ; ils sont la réalité. Et la plupart de ces vies très modestes se déroulent dans des circonstances banales.

Pourquoi choisir McDonald’s plutôt que KFC ou Wendy’s ?
Essentiellement parce que le café y est moins cher. Aussi pour ce côté ubiquitaire, standardisé, et parce que McDonald’s semble s’accommoder de cet état de fait. À l’exception de quelques-uns de ses restaurants, la franchise encourage même ce phénomène. Mais pour beaucoup de client·es, il s’agit seulement d’une affaire de café. Oui, je pense que le café, à McDonald’s, est meilleur que ce qu’on en dit.
Dans les Appalaches, le même phénomène s’observe dans les Hardee’s, en partie parce que les gens aiment leurs pains briochés, en partie parce que Hardee’s, là-bas, représente une franchise importante. Dans les villes disposant d’un McDonald’s, d’un Hardee’s et d’un Dairy Queen, les gens fréquentent les trois. Cela devient parfois politique, avec des petites guerres de territoires.
Généralement, chez McDonald’s, ils ont l’habitude. Quelqu’un au sein de l’entreprise a clairement cerné ce phénomène et a voulu l’encourager, tout ne nuisant pas au business de la boîte.

On s’imagine McDonald’s comme une franchise impersonnelle et homogène. Comment des communautés aussi uniques peuvent y naître et y évoluer ?
J’aime beaucoup ce paradoxe. Je dis toujours que si l’on me bandait les yeux et qu’on me lâchait dans n’importe quel restaurant McDonald’s, il ne me faudrait pas plus de cinq minutes pour saisir au sein de quelle type communauté de quartier je me trouve. Je ne cherche pas là à dédaigner les efforts de McDonald’s, mais si on offre à des gens un unique décor standardisé, ils trouveront du sens et y feront communauté. J’ai vu des choses formidables se produire dans des McDonald’s.
Dans la partie Nord de Milwaukee, le quartier traditionnellement noir, se trouve un McDonald’s servant de point de rencontre aux personnes âgés. À partir de 23h, ils s’emparent de l’avant du restaurant, et deux gars débarquent, tous deux DJs d’un spectacle de blues. La plupart des noirs âgés de Milwaukee sont originaires du Mississippi. Et donc cette superbe musique traditionnelle, le blues, résonne dans le McDonald’s. Si vous voulez assister à l’un des meilleurs concerts blues aux États-Unis, allez au McDonald’s de North Avenue à Milwaukee, installez-vous et écoutez les CDs que passent ces gars. Ils font de ce restaurant le leur, ils lui donnent un sens avec leur musique. C’est merveilleux, et encore une fois, représentatif de cette communauté Africaine-Américaine et originaire du Mississippi. J’ai vu d’autres McDonald’s où des gens se retrouvaient pour étudier la Bible, et certains où l’on jouait aux dominos. Ces restaurants sont devenus, effectivement, des espaces publics.

Avec son histoire remplie de ségrégation sociale et raciale, y a-t-il jamais eu un « espace public » aux États-Unis ?
Je répondrais par l’affirmative. Je ne veux pas survendre la diversité que l’on peut observer dans les McDonald’s : ces restaurants ne représentent que leur quartier. Ainsi, dans les quartiers noirs, on retrouve essentiellement des noirs, dans les quartiers blancs, des blancs et dans les quartiers majoritairement riches, on y rencontre des riches – et c’est le même problème chez McDonald’s. Un restaurant situé dans un quartier pauvre offrira moins de choix et de services.
C’est triste de constater que, dès le matin, les groupes qui se forment se ségrèguent eux-mêmes, avec une table pour les Blancs et une table pour les Noirs. Une fois de plus, c’est représentatif de problèmes plus vastes propres à notre pays. En aucun cas, ce processus n’est voulu ou encouragé par McDonald’s. Il se met en place naturellement, de la même manière que s’installent les disparités entre quartiers.
Pour moi, une question plus intéressante serait de se demander pourquoi les gens préfèrent McDonald’s aux centres sociaux classiques. D’après ce que j’ai pu entendre, les bénévoles bien intentionnés de ces centres proposent les mêmes services que McDonald’s. Mais les gens n’y vont pas car ils s’y sentent jugés. Ils ont juste envie d’être tranquille, n’est-ce pas ? Donc ils n’ont pas envie qu’on leur dise ce qu’ils doivent manger : « Optez pour une alimentation faible en gras, arrêtez de manger de la viande. » Les gens veulent la paix, et McDonald’s incarne la franchise qui, de loin, est celle qui fiche le plus la paix à ses clients. Tu t’assois et tu fais ce que tu veux. J’ai même déjà vu des gens ramener leur propre nourriture.

Les bibliothèques sont-elles aussi des lieux où les gens se sentent jugés ?
Je pense qu’il y a trop de règles dans les bibliothèques. Il faut être calme. On sent bien qu’elles tolèrent moins de choses : on ne peut pas se lever et partir, comme ça, alors qu’à McDonald’s, on sort, on fume et on retourne à sa place. McDonald’s permet plus de souplesse que les bibliothèques. Je crois que d’une certaine manière, les bibliothèques ne veulent pas de ces populations. On ne peut clairement pas s’y attabler et débattre de politique entre ami·es. Du strict point de vue d’un sans-abri, les bibliothèques ont un pouvoir d’attraction identique aux McDonald’s, mais se montrent moins souples et tolérantes.

D’après vos enquêtes, à quoi ressemblerait un bon espace d’accueil pour ces populations ?
Si je devais créer une association à but non lucratif travaillant avec les populations que je connais le mieux, c’est-à-dire les toxicomanes sans-abris, j’aurai simplement une pièce avec des tables, des chaises, du wi-fi, un endroit pour recharger son téléphone et des toilettes. On servirait des sandwichs et du café sans poser de questions. On dirait seulement : « Entrez et vous échapperez à la canicule. » On proposerait des ordinateurs, avec usage limité dans le temps, pour s’informer. Les gens oublient que l’accès à l’information constitue un énorme challenge pour les personnes pauvres. Avoir un endroit où s’asseoir, recharger son ordinateur, utiliser son téléphone et bénéficier d’une connexion gratuite, c’est énorme. Et je ne parle pas d’un lieu où l’on prêche quoi que ce soit… juste d’un espace.
De plus, McDonald’s offre aux populations que j’étudie la possibilité de se retrouver en compagnie de l’Amérique mainstream : les familles, les cadres, et les employé·es – ceux qui travaillent sur place. C’est une manière de cohabiter, de manière assez égalitaire, quelque chose d’inenvisageable dans un lieu destiné aux sans-abris. McDonald’s permet en quelque sorte aux sans-abris de reconquérir une partie de la dignité induite par la fréquentation d’un espace public. C’est considérable.
Observez-vous une connexion entre les recherches que vous menez et le mouvement FightFor15$, cette lutte pour la revalorisation du salaire minimum pour les employé·es de fast-food ?
Politiquement, je suis socialiste. Mais j’essaye de ne pas trop m’impliquer, seulement parce que je considère qu’il s’agit de deux problèmes distincts. Cela dit, en tant que problème distinct, j’aimerais beaucoup voir le salaire minimum augmenté.
Pensez-vous que votre travail aille de concert avec cette lutte, dans le sens où vous essayez d’aider les Américain·es à envisager les fast-food comme faisant partie intégrante la vie des gens ?
Si une personne de gauche venait me voir pour m’interroger sur ce que j’ai appris, je répondrai que mon travail cherche à comprendre les gens que défend cette personne. Comprenez que lorsqu’on s’en prend à McDonald’s, ou à un Wallmart ou à n’importe quelle autre enseigne de ce type, on méprise une réalité vécue. Les endroits avec le plus de diversités aux États-Unis sont les Walmart et les McDonald’s. Je partage la colère de celles et ceux qui s’indignent de la manière dont McDonald’s rémunère ses employé·es, et comment notre société exploite ses travailleurs et travailleuses. Mais la réalité pour les Américain·es à faibles revenus, c’est qu’ils bénéficient aussi de ce que leur apporte McDonald’s, avec de la nourriture rapide et bon marché, et la mise à disposition d’un espace — ce qui est très important pour eux. Il faut faire la part des choses quand on s’intéresse à un problème.

Qu’est-ce qui fait qu’un restaurant soit meilleur qu’un autre ? Qu’est-ce qui marche et ne marche pas ?
Oubliez les télévisions avec le son : elles font fuir les client·es. Ce qui marche le mieux pour l’établissement des populations, c’est une organisation de l’espace laissant une aile de libre, un peu à l’écart des flux de circulation. De manière évidente, plus un McDonald’s est grand et plus ces populations trouvent des espaces où s’installer.
Ce qui fonctionne ou non dépend largement du public comme des employé·es. Si les employé·es s’investissent dans leur restaurant, ça marche. Si le turnover du personnel est élevé, l’inverse s’opère. Dans ceux que j’ai vu où les choses fonctionnaient bien, le propriétaire du restaurant s’implique beaucoup, tandis que dans les autres, les propriétaires envisagent leurs restaurants comme des rentes et n’y mettent jamais les pieds. Ceux-là périclitent. Le pire de tous les McDonald’s se trouve à Hunts Point dans le Bronx. Les managers se fichent des employé·es comme de la clientèle. Je suis perplexe de savoir que McDonald’s n’est jamais venu arranger la situation. C’est vraiment gênant. […]

Pouvez-vous me parler de la dernière personne que vous avez rencontrée à McDonald’s ?
Gloria Stapleton. Je l’ai rencontrée dans le New Hampton, chef-lieu du comté de Chickasaw, dans l’Iowa. Elle a 72 ans, des cheveux blonds coiffés en pointes – une femme hilarante. Elle et ses amies se retrouvent à une table de 11h à 17h, pour échanger des potins. Un jour, elle a voulu se faire des mèches noires, mais aucun des salons de la ville n’a accepté — ils lui disaient qu’elle ressemblerait à un putois, ce à quoi elle a répondu : « Mais je veux ressembler à un putois ! » Elle est un peu punk pour une femme de 72 ans, mais aussi adorable.
Son mari de 52 ans est mort quatre ans plus tôt. C’est une manière pour Gloria de surmonter le deuil. Sur les cinq femmes avec qui elle discute, quatre d’entre elles ont récemment perdu leurs maris. Elle m’explique que tout chez elle lui rappelle son mari. Alors pour sortir de la maison, elle va au McDonald’s. Elle connaît tout le monde, client·es, employé·es. Par bien des aspects, c’est un nouveau chez elle.

by xavier | 20 mai 2018 | Le lundi au soleil
Sous le pseudonyme de Marie-Louise Michel, de 2007 à 2014, Lise Gaignard a écrit pour Alternative libertaire des « Chroniques du travail aliéné », réunies et publiées par les Éditions d’une. Psychanalyste en ville et en campagne contre la servitude passionnelle, elle nous fait partager ses tribulations institutionnelles, passant de l’analyse des processus psychiques mobilisés par le réel du travail à la psychothérapie institutionnelle, pratique thérapeutique marchant sur deux jambes (Karl Marx et Sigmund Freud) pour tenir ensemble aliénation psychopathologique et aliénation sociale.
Le 1er épisode de ces nouvelles chroniques publiées par Jef Klak nous emmène au Boissier, local du club thérapeutique de la clinique psychiatrique de La Chesnaie (Loir-et-Cher). Ici, les habitant⋅es s’attellent au jour le jour à la fragile et précieuse tâche de vivre au milieu des autres, très loin des fantasmes orthopédiques des « conseillers en insertion ».
Télécharger l’article en PDF.
Dessins de Denis Boudouard, pensionnaire à La Chesnaie

Au bord d’un lieu de soins psychiatriques, dans une grande construction improbable datant des années 1970, qui sert de bar, de salle de concerts, de lieu de passage, toujours ouvert ; groupé·es un après-midi d’hiver auprès de la grande cheminée. J’avais été invitée pour parler du travail, dans le cadre d’un séminaire ouvert au public dans l’École de psychothérapie institutionnelle de la clinique de la Chesnaie . Dans l’élan, j’avais accepté avec gratitude de prendre le thé et des petits gâteaux en compagnie des pensionnaires de la clinique que la question du travail attirerait peut-être. On ne savait pas combien de personnes viendraient. Elles sont venues nombreuses, et sont restées suspendues aux lèvres de tou·tes celles et ceux qui ont pris la parole. Même quand il ne restait plus rien des excellents gâteaux de l’atelier pâtisserie.
Un patient ouvre la discussion : « C’est nous qui contrôlons notre corps. On est fatigué·es le soir, des efforts de la journée. » Il nous donne l’occasion de saisir l’effort qu’on fait tou·tes pour vivre avec les autres, fondé·es par les autres [2. « Fondé par les autres » signifie que tous nos gestes sont des arrangements avec les présent·es et même avec les absent·es, celles et ceux qui ont pris soin – ou pas – de nous depuis notre naissance, celles et ceux qui nettoient nos traces, qui nous supportent, nous épatent, etc.] tous les jours. Il ajoute que c’est valable pour « chaque geste que fait […] chaque humain ». Le « moindre geste » de Deligny [3. Le Moindre Geste est un film réalisé en 1971 (avec Josée Manenti et Jean-Pierre Daniel) par Fernand Deligny (1913-1996), éducateur de délinquant·es, autistes, et autres adolescent·es « irrécupérables ». Il est à l’origine de plusieurs lieux alternatifs de l’éducation spécialisée.] est ici étendu à l’ensemble de l’existence, à ses fondements. Tous les gestes sont adressés aux autres, au milieu des autres. On ne peut pas dire mieux le fondement du travail suivant la définition qu’en donnait Claude Veil [4. Claude Veil était psychiatre du travail. Pour lui, « le travail est une activité qui produit soit des objets soit des services, qui dans tous les cas implique des liens sociaux (échanges économiques et psychologiques entre personnes et groupes) qu’elle utilise et crée ». Entretien avec la rédaction de la revue Psychiatrie Française, juin 1996, volume XXVII 2/96.] : toute production de services ou de biens entraînant des liens entre des personnes. Comment faire et où trouver la force de persévérer ?

Chaque matin, la plupart du temps, quand on n’est pas sous le coup d’une angoisse majeure comme peuvent l’éprouver trop souvent les patient·es de la clinique, c’est naturel, évident, on fait comme on doit faire, on se lève le matin, on fait le café, on se lave plus ou moins, on prend les transports en commun ou on écoute la radio dans sa voiture au milieu des effluves de diesel. Et la vie passe. Sans conscience particulière de nos « moindres gestes ». Ce jour-là, au Boissier [5. Il s’agit d’un des hauts lieux de la clinique de la Chesnaie, construit collectivement dans les années 1970 par des professeur·es et étudiant·es en architecture ainsi que des soignant·es et pensionnaires de la clinique.], en compagnie de personnes qui ont des soucis avec « les évidences de la quotidienneté [6. Comme disait Jean Oury, à la suite de W. Blankenburg qui parle de « l’inévidence de l’évident ».] », celles pour lesquelles chaque détail compte, la discussion a continué à propos de la toilette, du ménage, des relations avec les autres à maintenir à bout de bras. Tous ces gestes qu’on peut aussi « oublier » pour se glisser dans le flux, en permettre et en faire durer silencieusement les rapports de production ; cet après-midi-là, tous ces gestes étaient minutieusement décrits, commentés. Faire le ménage ensemble, en parler autour d’un verre quand on a terminé, « c’est la base ».
Quelques jours plus tard, je me trouve invitée à un débat sur « l’insertion par l’économique » dans la salle comble du cinéma d’une petite ville. Tout le gratin des bonnes gens à la tête des associations du département qui accueillent des « personnes éloignées de l’emploi ». On ne saura pas – la réunion va pourtant durer plus de deux heures – qui sont ces personnes « éloignées » dont on parle. Des chômeurs et chômeuses de longue durée ? Des étrangèr·es récemment contraint·es à l’émigration ? Des supposé⋅es malades mentaux·ales ? On n’entendra parler que « d’accidentés de la vie ». Il pourrait leur être arrivé n’importe quoi, on les rassemble sous cette expression assurantielle. On gomme, on oublie, on efface. Même technique quand je demande ce que ces personnes font comme travail. On me répond que ça n’a aucune importance, que de toute façon, elles ne referont probablement pas ce qu’elles sont en train de faire, que ça dépend des contrats que les associations passent avec leurs clients. Que c’est pour leur donner « une raison de se lever le matin », leur apprendre « le savoir-être », et que les « savoir-faire », c’est autre chose, ça ne compte pas à cette étape-là, « pour ces gens-là ».
Pendant toute la soirée, seuls des directeurs ou des présidents prennent vigoureusement la parole. Les autres se taisent. Des syndicalistes présents, des militants bien connus ne comprennent pas ce qu’il se passe, pourquoi je pose des questions comme ça, après tout, c’est déjà pas mal, l’insertion, non ? Quelques notables des tutelles, invités et venus – cette soirée comptera-t-elle dans leurs heures de travail ? – ne disent rien, affligés par mes questions trouble-fête. Une jeune infirmière en psychiatrie très avisée demande pourquoi les supposé·es bénéficiaires de tant de bonnes œuvres n’ont pas participé à l’organisation de la soirée. Stupeur, incompréhension. « Il y en a peut-être dans la salle », répond un président, qui ne saisit pas la différence entre « être dans la salle », fondu dans le public, et avoir mis en place le débat, les invitations, les conditions de prise de paroles, etc. En tout cas, s’il y « en » avait, ils et elles n’ont pas bougé. Et je les comprends, si je n’avais pas été « intervenante », je serais restée sans voix devant les pires clichés du management moderne. Nous/eux. Nous supérieurs, eux inférieurs. Heureusement qu’on est là, nous, grandes âmes, plus ou moins bénévoles ou très mal payées, pour eux, le « vivier » des « éloignés de l’emploi ». « Personne n’est inemployable », dit un autre intervenant. Pas de chance.
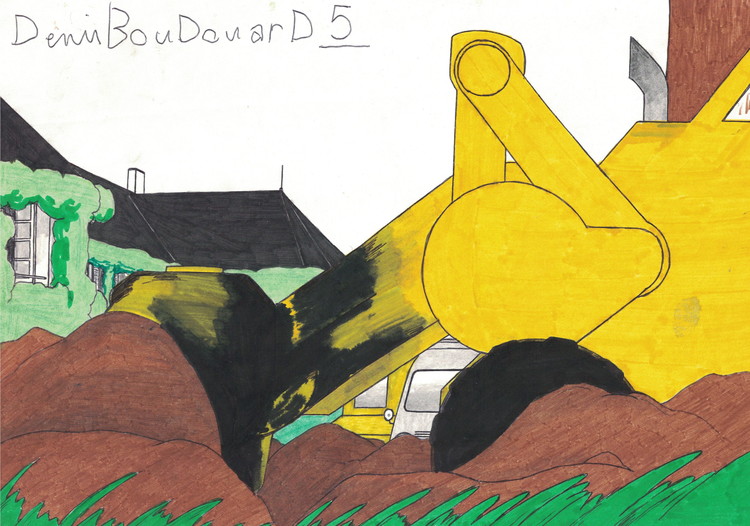
Tout cela se termina autour d’un pétillant-petits-fours, pour la touche de convivialité. Mais aucune des personnes-éloignées-de-l’emploi qui les avaient cuisinés dans une de ces entreprises-d’insertion-par-l’économique n’étaient là pour y goûter. Ils n’avaient pas, nous dit-on, de moyen de transport pour rentrer aussi tard chez eux. En aparté, un président me dit que ce qui l’inquiète, lui, c’est que « le niveau des gens qu’on accueille tire les encadrants vers le bas ». Comment ne pas vomir ?
En pensant que tout près de là, vivent, discutent des philosophes conscient·es de l’effort de la vie en communs. « Il y en a qui travaillent à des vécus… On n’est pas riches, voilà ! », avait conclu en souriant auprès de la cheminée une patiente en lutte permanente pour une vie quotidienne consciente. Tellement plus présente que ces pauvres « inséreurs » courroucées, et qui auraient bénéficié d’entendre un autre patient nous dire que « le travail est père de toutes les soumissions ». Pas près de se laisser insérer, celui-là.
by xavier | 16 mai 2018 | Le lundi au soleil
Avant de partir aux États-Unis rejoindre le penseur écologiste libertaire Murray Bookchin, Daniel Blanchard s’engagea pleinement dans le mouvement du 22-Mars, puis dans les comités d’action durant le bouillonnant printemps français de 1968. Proche un moment de Guy Debord, avec qui il rédige en 1960 les Préliminaires pour une définition de l’unité du programme révolutionnaire, Blanchard est aussi un membre actif de Socialisme ou Barbarie (1949-1967), organisation révolutionnaire et revue héteromarxiste, anti-stalinienne avant l’heure, fondée par Cornelius Castoriadis et Claude Lefort. Cinquante ans après Mai-68, loin des commémorations ronflantes et matraquantes des « évènements », Daniel Blanchard livre dans Jef Klak son regard singulier sur ce moment radical de réappropriation de la parole. Un texte qui éclaire le mouvement social en cours, plus que jamais en proie à l’autoritarisme du pouvoir étatique.
Crédits photos : Bruno Barbey, avec son aimable autorisation.

10 mai 1968 / Paris, rue Gay-Lussac (Paris 5e) / Photo Bruno Barbey.
Cinquante ans après, la répression du mouvement social contre la politique d’Emmanuel Macron démontre combien restent vivaces l’effroi et la haine suscités par Mai-68 chez les possédants, les politiciens, les bureaucrates… et les renégats. Ce n’est pas de cette actualité-là qu’il sera question ici, mais de celle qui, restant pour nous profondément positive, justifie la réaction de ces autres-là. Ce qui, de mai, reste actuel, ce sont d’abord les luttes qui ont été menées alors, tant par leurs objectifs que par les voies qu’elles ont suivies – et aussi par celles qui les ont conduites à l’échec. Ce sont ensuite certains traits essentiels de la société d’alors que ces luttes ont mis en lumière et qui continuent à marquer, souvent plus durement encore, celle dans laquelle nous vivons aujourd’hui.
Pour dégager les caractères les plus remarquables du mouvement de mai, j’ai choisi un cas qui met bien en évidence, ne s’agissant ni d’une université ni d’une usine, la diversité des secteurs de la société qu’il a entraînés. Il s’agit du Centre d’études nucléaires de Saclay (organisme d’État chargé de la recherche théorique et appliquée), une quasi ville avec des rues, des avenues, des restaurants, une gare… fréquentée chaque jour par quelque 10 000 personnes, pour la moitié d’entre elles chercheur·es et technicien·nes dépendant du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), et pour le reste, employé·es et ouvrier·es d’entreprises indépendantes, étudiant·es et chercheur·es étranger·es et innombrables vigiles. Une ville proche de Paris, mais isolée du monde par des grillages, des barbelés et des dispositifs de sécurité draconiens. Un camp retranché, donc, mais que « mai » a envahi, et très tôt.
C’est, comme partout, la répression du mouvement étudiant qui déclenche, d’abord la protestation, puis la contestation. Au départ, quelques militant·es ou sympathisant·es gauchistes se réunissent et lancent une pétition. Ils se retrouvent vite à discuter avec des dizaines puis des centaines de leurs collègues. Le 13 mai, 2 000 personnes manifestent à Saclay même, avant de se joindre à la manifestation monstre qui se déroule à Paris. Le 17, devant la contagion de contestation qui se répand dans le Centre, l’intersyndicale convoque une assemblée générale. 5 000 personnes s’y rendent, cinq ou six fois plus que d’ordinaire. Tout est mis en question à la fois : la bureaucratie, les mesures policières, les syndicats. On veut le respect des individus, la liberté de parole. Trois jours durant, les discussions se poursuivent entre quelque 1 500 participants. Peu à peu, la conclusion s’impose que tout l’ordre établi doit tomber. Et on ne revendique pas : on exige, car on est le pouvoir légitime, démocratique. Tout le monde participe sur un pied d’égalité, les employé·es du CEA comme celles et ceux des entreprises extérieures, tous niveaux hiérarchiques confondus. Ce qu’on exige ? À la tête de l’administration, un Comité d’entreprise élu et révocable, des conseils élus dans chaque service et département, la suppression des mesures policières internes, la liberté d’expression pour tou·tes…

24 mai 1968 / Rue Saint Michel – Rue de Lyon / Photo Bruno Barbey.
N’idéalisons pas, cependant, ce qui se passe à Saclay : pour autant que ma documentation m’ait permis d’en juger, les écarts – considérables – de rémunération ne sont pas remis en cause, même si certaines améliorations sont réclamées pour les salarié·es du bas de l’échelle. Plus significatif peut-être encore, on ne trouve pas trace d’une critique des finalités de cette institution… Le programme débouche sur la cogestion, et non sur l’autogestion, et sur la collaboration. C’est ainsi que tou·tes les travailleurs et travailleuses du CEA exigent de participer à l’élaboration des programmes, y compris militaires…
Il n’empêche qu’on retrouve ici bien des traits qui font la radicalité du mouvement de mai. Tout d’abord, la rapidité avec laquelle ce qu’on appelle alors d’un euphémisme, la contestation, passe du milieu étudiant à ce milieu hétérogène où se déploie un éventail extrêmement ample de qualifications et de rémunérations, depuis les scientifiques de très haut niveau jusqu’à l’ouvrier·e d’entretien.
Ensuite, la façon spontanée dont se déclenche et se développe le mouvement. Une poignée d’ « enragés », comme ils se nomment eux-mêmes, y jouent certes un rôle, mais les organisations politiques, aucun, et les syndicats ne font qu’essayer de suivre… et de freiner. Ensuite encore, le caractère global et systématique de la contestation. La bureaucratie est omniprésente, elle est partout dénoncée.
Et positivement, on exige la maîtrise collective du travail et son complément indispensable, la liberté d’expression : on exige la responsabilité. Les revendications économiques passent au second plan. La liberté, et presque le devoir, de parole – ce que Michel de Certeau a appelé « la prise de la parole » – est perçue d’emblée comme la condition de la démocratie réelle. Elle brise les cloisons entre catégories professionnelles et – dans une certaine mesure – entre positions sociales. Elle fait éclater les rôles sociaux dans lesquels chacun est enfermé, ou s’enferme soi-même. Elle introduit à la redécouverte des principes de cette « démocratie ouvrière » que le mouvement révolutionnaire a mis en pratique dans ses moments les plus radicaux : assemblée générale souveraine, conseils et délégué·es chargé·es d’un mandat défini et révocables…

28 mai 1968 / Assemblée générale dans le Grand amphi de la Sorbonne / Photo Bruno Barbey
Autrement dit, une affirmation d’égalité entre sujets politiques comme entre humains. Et celle-ci se traduit par la solidarité pratique : « Des travailleurs immigrés ont faim dans un bidonville proche. On prend un camion, de l’argent, de l’essence et l’on va chercher dans les coopératives agricoles les poulets et les pommes de terre nécessaires. Les hôpitaux ont besoin de radioéléments : le travail reprend là où l’on produit les radioéléments. Le nerf de la guerre… dans ce centre éloigné des villes… c’est l’essence. Le piquet de grève de la Finac à Nanterre en envoie 30 000 litres, ce qui permettra de continuer l’action et surtout de venir au Centre… » (Des Soviets à Saclay ?, éd. Maspéro, 1968).
Autant d’idées, d’exigences, de pratiques qui se font jour à peu près partout en 68 et qui conservent tout leur sens et toute leur vertu subversive aujourd’hui. On peut certes dire qu’elles sont pour l’essentiel nées avec le mouvement ouvrier, avec la lutte contre la société capitaliste, et que leur validité durera autant que celle-ci. Mais le mouvement de mai nous parle de beaucoup plus près, beaucoup plus concrètement, que 1848, 1871… « Ce qui fait l’importance de toutes les crises, c’est qu’elles révèlent ce qui, jusque-là, était latent », disait Lénine. Que ce soit presque un truisme ne doit pas empêcher de le prendre au sérieux. Qu’était-ce donc qui était « latent » en 68 ? Une transformation des mécanismes de la société capitaliste qui, en France, avait commencé – ou qui s’était nettement accélérée – avec l’instauration de la Ve République.
Les grèves très dures des années précédentes, comme à la Rhodiacéta, la radicalisation de certains acteurs du mouvement étudiant comme à Strasbourg, apparaissent certes après coup comme des signes avant-coureurs du séisme mais n’expliquent pas, à mon sens, comme par une montée cumulative des luttes, ces phénomènes étonnants que sont la propagation extrêmement rapide du mouvement à un vaste champ de la société française à partir de l’acte d’insubordination d’une poignée d’étudiants, la diversité apparente des secteurs touchés par cette propagation et la convergence dans la radicalité des idées et des pratiques adoptées par à peu près tou·tes les participant·es.
Ce que ces faits manifestent avec éclat, me semble-t-il, c’est une expérience commune, unitaire, d’une réalité sociale qui s’est elle-même profondément uniformisée. C’est le fait que la période qui a précédé a approfondi et systématisé les aspects totalitaires de la société capitaliste. Totalitaires non pas, évidemment, dans le sens d’un régime totalitaire, tel que le nazisme ou le stalinisme, mais dans le sens d’une intégration de tous les secteurs, de tous les aspects et de tous les acteurs de la vie sociale en une machinerie vouée à l’expansion illimitée de la production de marchandises, donc du capital et de sa domination. De la consommation aux loisirs, de l’information à la transmission du savoir, du laboratoire à l’usine, tout doit être soumis aux principes d’instrumentalité et de fonctionnalité et assujetti à cette fin, absurde et extérieure à la vie des « simples gens ». Il est clair que ce processus dévastateur n’a fait que s’approfondir depuis.

17 mai 1968 / Boulogne-Billancourt, usine Renault en grève / Photo Bruno Barbey
En France, l’instauration du régime gaulliste a inauguré une entreprise de rationalisation de la société française qui s’est traduite non seulement par la liquidation du lobby des « betteraviers » ou des « bouilleurs de cru », mais surtout par la transformation de la domination coloniale en impérialisme néocolonial et, dans le système productif entendu au sens large, par une réorganisation du travail au nom de l’impératif du contrôle et de l’efficience. De nombreux services, notamment postaux et bancaires, sont mécanisés, industrialisés ; et les emplois, prolétarisés. La définition standardisée des tâches et le contrôle bureaucratique s’étendent dans l’information ou la recherche. Dans l’université, où un début de « démocratisation » provoque un accroissement des effectifs d’étudiant·es, sévit le même esprit de « rationalisation » qui tend à modeler les contenus de l’enseignement et les profils professionnels auxquels il prépare sur les besoins de l’appareil productif en personnel d’encadrement. Même si l’on en est encore loin, on tend vers le modèle de l’« université-usine » tel que l’avait défini son prophète californien, le président de l’université de Californie à Berkeley, Clark Kerr, dont l’autoritarisme avait provoqué le soulèvement étudiant de l’automne 1964.
Aussi, partout où déferle la vague de la « contestation », et syndicats et partis n’y échappent pas, c’est au premier chef la bureaucratie que l’on dénonce, ses hiérarchies qui ne tendent qu’à diviser et qui récompensent la servilité, ses absurdités, son opacité, etc. On ne veut plus accepter les frustrations d’un travail dans lequel toute initiative, toute liberté d’expression et, à la limite, toute intelligence vous sont déniées. On ne se révolte pas contre le travail en soi, mais contre l’ineptie de ne vivre que pour travailler. On ne critique pas la consommation – le seul cas que je connaisse où la critique de la consommation ait été portée par un mouvement de masse est celui de la « contre-culture » américaine –, mais on ne la valorise pas non plus : les revendications salariales passent au second plan et les accords de Grenelle négociés entre les syndicats et le gouvernement pour mettre fin à la grève, qui font d’une augmentation de 10% le résultat essentiel d’une grève générale, sont reçus comme une insulte dans un très grand nombre d’entreprises. Le mouvement de mai est sans doute le premier qui ne soit pas une révolte du besoin, de la nécessité matérielle.
Le dernier ? Peut-être bien. Le chômage massif, la précarité et l’« exclusion » ont replongé une grande partie de la population dans le « règne de la nécessité » et font peser sur la majorité des travailleurs la menace constante – le chantage – d’une dégradation sociale et humaine. Les procédés de la domination ont évolué. Le capitalisme ne peut certes pas se passer de la bureaucratie, mais, surtout dans le monde de la production, il a combattu, non sans succès, les « irrationalités » qu’elle introduisait dans son fonctionnement. Le capital financier a repris la main sur la « technostructure » managériale. Dans le travail, le contrôle par l’autorité hiérarchique est de plus en plus remplacé par le contrat – léonin – de prestation de services, l’obligation de résultat et la codification pointilleuse des actes imposées à l’agent prétendu autonome et responsable. La captation de la force de travail par l’employeur tend à s’emparer de la totalité du temps vécu et du psychisme même de l’employé·e.
Ainsi, comme je le notais plus haut, les traits essentiels du monde capitaliste n’ont fait que s’accuser : sa tendance totalitaire, la destruction de tous les liens, de tous les rapports sociaux vivants – et d’abord du sens même qu’il y a à vivre en société. En mai, la profondeur de cette destruction et de la frustration qu’elle suscite se trahissait dans l’intense fraternisation, dans la transgression des barrières et des rôles – les rôles de jeune, de manuel, d’intellectuel, de femme… Dans la jouissance avec laquelle tout cela était vécu, on pourrait presque dire l’émerveillement de redécouvrir un monde perdu et inconsciemment désiré. Radical, le mouvement de mai l’a été en ce qu’il a mis au jour la radicalité du nihilisme capitaliste.
Mais peut-être n’en avions-nous à l’époque qu’une conscience floue : à bien des égards, l’actualité, la modernité de mai ne se constate pour ainsi dire que rétroactivement. C’est le cas notamment pour un mécanisme de la domination moderne qui commençait alors à peine à se mettre en place et qui aujourd’hui joue un rôle central. La « prise de la parole » – entendue non pas comme exhibition narcissique à la télé, mais comme échange, comme exploration du monde social, comme découverte de l’égalité des conditions, comme germe de la solidarité… – a dénoncé et subverti un dispositif de production de ce qu’on pourrait qualifier, après Armand Robin, de « fausse parole » (expression qu’il appliquait aux émissions des radios soviétiques qu’il écoutait professionnellement). Je crois que ce dispositif, complexe, mériterait d’être analysé de près et je ne me sens capable ici que d’en esquisser une image générale, et hypothétique.
On ne peut plus aujourd’hui se contenter de dénoncer, comme le fait par exemple Chomsky de façon tout à fait pertinente, le manufacturing of consent, la fabrication du consentement, par la propagande, le mensonge, la désinformation, l’occultation, etc. que produisent, avec des moyens considérables et sophistiqués, des organes spécialisés liés au pouvoir, et qui sont injectés unilatéralement dans la société. Ces procédés relativement grossiers sont complétés par des mécanismes beaucoup plus sournois et toxiques en ce qu’ils sont interactifs. Ils constituent une extension du système représentatif. Celui-ci dit au citoyen : cet État est le tien, ce qu’il fait, c’est toi qui l’a décidé, etc. De même, le marché, les sondages, les médias, les sciences sociales nous disent : ce gadget, c’est l’expression de vos désirs, cette opinion, c’est la vôtre, ce présentateur de télé ou ce politicien qui apparaît sur l’écran, c’est un autre vous-même… Et assurément, ce n’est pas un Big Brother qui profère autoritairement le mensonge officiel et nous enjoint d’y croire. Ce n’est même pas un anonyme Monsieur ou Madame Tout-le-monde, c’est un individu « personnalisé, » qui nous parle de personne à personne, et dont les propos ont été élaborés à partir d’un matériau qui nous a été soutiré par une armée de sondeurs et sondeuses, d’enquêteurs et enquêtrices, de technicien·es du micro-trottoir, etc., avant d’être traité – analysé, classé, remodelé… – pour nous être servis comme les nôtres. Une sorte de Do-it-yourself de la propagande, d’aplatissement mimétique et fallacieux du dominant sur le dominé.

Nuit du 10 au 11 mai 1968 / Boulevard Saint-Michel / Photo Bruno Barbey
Évidemment, le gadget n’a été modelé sur nos désirs – et nos désirs n’ont été eux-mêmes induits – que pour nous soutirer le maximum d’argent et de soumission en tant que consommateurs et consommatrices. Le discours du politicien n’a emprunté nos mots que pour nous obliger à « consentir » à ce qu’il nous impose : il n’y a pas de censure plus efficace. En somme, la parole fait aujourd’hui l’objet, comme le travail, d’une exploitation, pour ainsi dire : de même que la plus-value extorquée aux travailleurs et travailleuses accroît le capital et donc renforce le pouvoir du capitaliste, de même, on extrait de nous de la parole qui sert à perfectionner, affiner, ajuster les moyens de la domination que nous subissons.
Cette expropriation de la parole dominée par la parole dominante se trouve approfondie par un processus encore plus diffus et s’exerçant, pour ainsi dire, en sens inverse, puisqu’il s’agit de la pénétration dans notre for intérieur d’un langage qui n’est pas spontanément le nôtre, qui est celui, sinon directement du pouvoir, du moins de la maîtrise techno-scientifique. Nous ne savons plus parler de nous-mêmes ou du monde qui nous entoure avec des mots qui nous soient propres, qui soient ceux d’un sujet ; comme si ceux-ci étaient à nos propres yeux totalement dévalués, nous leur substituons ceux du discours donné pour objectif. Nous nous situons dans la société avec les mots et les catégories des sciences sociales, nous parlons de nos organes avec les mots du médecin, de nos états d’âme avec ceux du psychologue, le sportif traite son corps comme une machine qui lui serait extérieure. L’objet se met à parler de lui-même en objet…
Je n’aborderai pas ici évidemment la question insondable de l’intériorisation par les dominé·es des idées, des valeurs, des représentations, etc. dominantes. Je m’en tiens à des processus concrets, perceptibles, audibles dans le quotidien. Le discours objectif qui se donne pour représentation de la société et de chacun·e de nous, pour science de cette réalité-là, confisque à la source, dénature et inhibe toute véritable conscience sociale.
Or, en 68, précisément, c’est cela, une conscience sociale, qui a commencé à se reconstituer. Les sociologues, les psychosociologues, les médias… se sont tus et si les politiciens nous ont parlé, ce n’était plus pour nous séduire mais pour nous menacer : l’imposture était dissipée. La parole prise directement et égalitairement par chacun·e et par tou·tes, la propagation de l’échange horizontal et transgressif – transgressif des âges, des rôles, des sexes, des catégories, etc. – mettait à nu, dans le concret des expériences et avec les mots de la langue commune, la réalité de la société, la communauté profonde des conditions, le sens de la solidarité.
Et, au moins dans certains moments du mouvement de mai, c’est aussi l’action qui a exercé ce pouvoir révélateur. La pratique du mouvement du 22-Mars a été particulièrement significative à cet égard. Personnellement, après des années de participation au groupe Socialisme ou Barbarie, et malgré nos audaces théoriques, j’étais resté figé dans une conception traditionnelle de l’action politique : elle se réduisait essentiellement au discours. La pratique du mouvement du 22-Mars a été pour moi une révélation : je me suis rendu compte de l’influence du registre symbolique qu’un groupe restreint d’individus peut exercer sur une lutte sociale dont l’ampleur le dépasse infiniment.
Ce « mouvement » était né le 22 mars 1968, sur le campus de Nanterre (banlieue ouest de Paris) où l’agitation allait croissant, lorsqu’une centaine d’étudiant·es, majoritairement anarchistes, occupèrent le bâtiment administratif de l’université. La répression qui s’ensuivit suscita des manifestations de solidarité souvent violentes qui s’étendirent peu à peu à tout le pays et finirent par entraîner à leur suite les travailleurs et travailleuses de toutes catégories, qui se mirent en grève.
Il n’est pas question de comparer le mouvement du 22-Mars ni à Socialisme ou Barbarie ni à l’Internationale Situationniste, dont les analyses dévastatrices de la condition étudiante ont joué un rôle dans le déclenchement de la révolte universitaire. Il n’a existé que pendant quelques semaines et ce n’était pas une organisation : il n’avait pas de projet théorique, il ne recrutait pas. On en faisait partie quand on y participait et quand on était évidemment d’accord sur quelques idées fondamentales. Il s’était créé dans l’action et n’a persisté que tant qu’il a pu agir pour radicaliser les luttes dans le sens de l’unité et de l’autonomie.
Schématiquement, cette action pouvait prendre deux formes, souvent combinées : la « provocation » et l’« action exemplaire ». La provocation visait à amener l’adversaire (gouvernement, syndicats, Parti communiste – PCF… ) à se démasquer, à trahir son caractère réactionnaire. L’action exemplaire consistait à prendre l’initiative d’intervenir en son nom propre dans une lutte, par des actes significatifs et compréhensibles, afin d’inciter par l’exemple d’autres forces à étendre cette action. En somme, il s’agissait d’ouvrir la situation, de montrer des possibilités en intervenant en son nom propre, sans chercher le moins du monde à exercer une hégémonie sur le mouvement.
L’action est ainsi conçue pour éveiller, stimuler la conscience par ce qu’elle lui dit concrètement, mais aussi par ce qu’elle représente – elle est à la fois « en vraie grandeur », et en même temps, elle est une image qui synthétise un sens et le rend perceptible par la sensibilité comme par la raison. Et d’une certaine façon, au moins pendant les premiers temps, ce mouvement du 22-Mars, de par sa seule existence, a été cela aussi pour l’ensemble des protagonistes de mai, du moins ceux qui n’étaient pas enfermés dans la logique léniniste des « groupuscules » : à la fois un foyer, un moteur et une figure qui permet de se voir et de se comprendre. Une force à la fois réelle et symbolique.

Paris, 14e arrondissement / Nuit du 10 au 11 juin / Émeute au croisement du boulevard Pasteur et de la rue de Vaugirard / Photo Bruno Barbey
Plus important peut-être, il a concentré en lui et éclaire aujourd’hui encore un mode d’être paradoxal du mouvement de mai comme de tous les mouvements véritablement transgressifs : ils se produisent à la fois ici et maintenant et dans l’universel et le futur, ils vivent réellement le possible. Ils offrent une expérience et une jouissance immédiate d’une société qui n’existe pas encore, mais que préfigure une socialité authentique, c’est-à-dire sans codes qui figent et séparent, ni instrumentalisation, une perpétuelle mise en œuvre de cette « faculté de commencer » par quoi Arendt traduisait « liberté ».
La dynamique du mouvement se fondait ainsi sur cette triple exigence de l’égalité, de l’activité et de la positivité immédiate. Elle s’est brisée lorsque s’est réinstauré le régime de la hiérarchie, de la passivité et du présent toujours décevant. Dans ce processus, les syndicats ont une lourde responsabilité. La fermeture des usines en grève et l’occupation ramenée à de simples tours de garde confiés à une poignée de militants syndicaux chargés de protéger le matériel contre les vandales gauchistes n’ont pas seulement empêché les contacts entre étudiant·es et ouvrier·es. La division entre dirigeants et exécutants s’est trouvée rétablie au sein même de la communauté des grévistes et, plus grave peut-être encore, la grande majorité d’entre elles et eux, désœuvré·es, sont allé·es « pêcher à la ligne », comme on disait alors. Certes, ils n’y étaient pas contraint·es, mais puisque les syndicats affirmaient s’occuper de tout… Ainsi, ce qu’aujourd’hui ne donnait plus, il ne restait plus qu’à l’attendre du lendemain, et du bon vouloir des syndicats et des patrons.
Il y a là une rude leçon politique. On a reproché au mouvement de mai de n’avoir pas posé le problème politique comme tel. Il ne l’a certes pas posé explicitement, mais dans les faits, il a indiqué, comme bien d’autres moments révolutionnaires, la voie à suivre pour le résoudre. La subversion de la politique ne s’accomplit que par l’irruption du politique, c’est-à-dire l’invasion de la scène publique par un sujet collectif qui entreprend de gérer lui-même directement et de façon égalitaire les affaires de la société. En 68, ce sujet collectif a à peine eu le temps de commencer à se constituer sur la base d’une conscience sociale lucide et de définir les obstacles institutionnels à son action – gouvernement, partis, syndicats, incarnations autoproclamées de la conscience du prolétariat… –, mais cela avait suffi pour qu’ils perdent – au moins pendant quelques jours – tout contenu, tout sens et toute prise sur la réalité. Il semble également avoir compris (et en tout cas, il nous aide à comprendre) à quel point, dans un État moderne, il est vain de chercher à subvertir de l’intérieur la politique – ce dispositif institutionnel permettant à une fraction de la société de la diriger tout entière et impliquant la séparation entre dirigeants et dirigé·es, entre représentants et représenté·es, entre actifs et passifs, etc. Hobsbawm, dans L’Ère des empires, a bien montré comment l’invention du parti de masse avait parfaitement verrouillé le suffrage universel. Quant à l’emprise sur nous de la « fausse parole », ce n’est pas la dénonciation qui la fera taire, mais bien la prise de la parole par toutes et tous.
















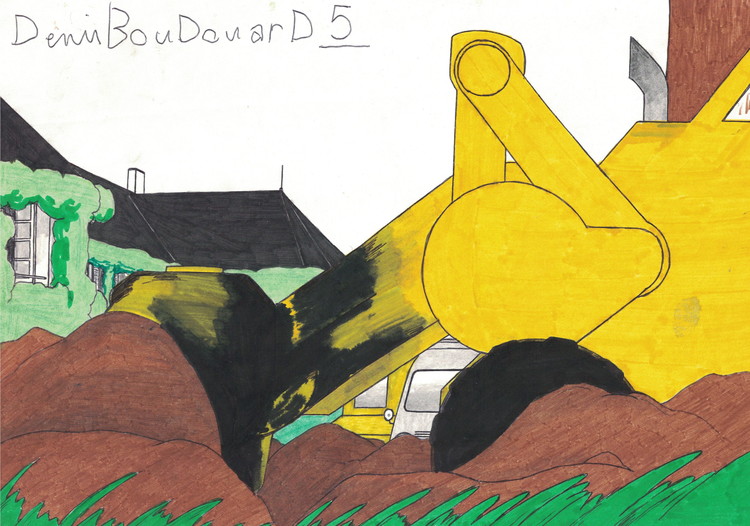






Recent Comments