by Bruno Thomé | 01 juin 2017 | Selle de ch’val
Est-ce que les primatologues revendiquent une histoire féministe ? Que se passe-t-il quand les savoirs amateurs reprennent la main sur les dogmes scientifiques ? Est-ce pertinent de se demander s’il y a une différence l’humain et l’animal ? Regarder vivre les animaux peut-il nous aider à produire un discours sur la mort ? Nous avons choisi de poser ces questions et d’autres à Vinciane Despret, auteure de Que diraient les animaux, si… on leur posait les bonnes questions ? (Éd. La Découverte, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », 2012). Où elle remet en jeu les dispositifs méthodologiques de l’éthologie, sous la forme d’un abécédaire. Depuis plus de vingt ans, elle tente de mettre à jour la rigidité des contraintes épistémologiques et dénonce la disqualification des savoirs amateurs, en particulier lorsqu’il s’agit d’étudier les animaux. Peu encline à condamner les « mauvais » résultats scientifiques, elle préfère aiguiller les chercheurs vers une science plus intéressante et plus prolifique.
Cet entretien est issu du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », traitant des relations entre les humains et les autres animaux, et toujours disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF…
Pourquoi vous êtes-vous penchée, en tant que philosophe, sur les animaux, et plus spécifiquement sur les rapports qu’entretiennent les scientifiques avec eux ?
Quand j’ai commencé à faire de la philosophie avec des cratéropes écaillés il y a vingt-cinq ans[2. Naissance d’une théorie éthologique : la danse du cratérope écaillé, éd. Synthélabo, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », 1996. ], l’animal avait un pouvoir subversif extrêmement puissant, il offrait de l’espace pour bouger les lignes : on pouvait remettre en question certaines conceptions de l’espace politique, repenser la notion d’animal humain, le statut des sujets et des objets. Dans l’espace des sciences sociales notamment, prendre l’animal au sérieux a favorisé le mouvement des anthropologues qui voulaient en finir avec l’idée de nature. Les sciences sociales, la sociologie en particulier, ne pensaient alors qu’en termes passif/actif, sujet/objet ou agent/patient et ne voyaient dans les savoirs populaires qu’un objet d’étude, voire un support de représentation. L’animal était un lieu où se cristallisaient des possibilités de remettre en cause ces méthodologies visant à séparer l’idéologie de la science, à trier le bon grain de l’ivraie.
On a alors pu contester les objections faites jusque-là aux observations de Kropotkine, qu’on jugeait idéologiquement biaisées (s’il avait vu des comportements solidaires chez les animaux, c’est parce qu’il était russe et anarchiste). Les anthropologues de ma génération ont commencé à défendre le fait que l’observation d’un animal vivant en Russie par un anarchiste favorise certaines théories, certaines observations – tout comme l’observation d’un oiseau vivant dans des conditions toutes différentes par un Britannique victorien comme Charles Darwin en favorise d’autres.Nous disions désormais qu’il fallait tenir les deux propositions ensemble, l’éthos particulier du scientifique et les conditions concrètes de vie de tel ou de tel animal. Par exemple : qu’est-ce que ça fait de vivre sur une île ? Quel type de comportement animal cela induit-il ? Quel système politique ? Observateur et observé ne sont pas déliés, ils mangent dans le même paysage.
Est-ce qu’un projet politique sous-tendait le choix de ce sujet d’étude ?
J’ai toujours eu le sentiment de faire de la politique par d’autres moyens, « politics by other means », comme disent les féministes. Je me préoccupe du fait de savoir si les scientifiques font ou non du bon travail. Je voulais donc encourager les scientifiques quand ils font des choses vraiment bien, et notamment les enjoindre à résister aux contraintes de l’épistémologie. Ma politique s’inscrivait dans le sillage des philosophes Bruno Latour et Isabelle Stengers[3. Voir l’entretien avec Isabelle Stengers « Le prix du progrès », dans Jef Klak, no 1, « Marabout ».]. Côté Stengers : montrer à quel point les animaux sont partie prenante des expériences et prennent position par rapport à ce qu’on leur demande. Ils ne sont pas des supports passifs d’action. Ce qui rejoint le projet de Latour[4. En parlant d’actants, Bruno Latour insiste sur le fait que la passivité et l’activité ne s’opposent pas, et que les capacités d’agir sont surtout distribuées dans un régime de multiples « faire faire ». ] : remettre en cause le rapport traditionnel sujet/objet qui implique un sujet actif et un objet passif. Pour lui, les choses nous font agir, et nous les mobilisons de telle sorte qu’elles nous fassent agir. Cela nous oblige à prêter une attention plus soutenue aux modes d’action des êtres non humains.
Aujourd’hui, des scientifiques, comme Ádám Miklósi au Family Dog Project[5. Éthologiste hongrois, spécialiste des canidés, Ádám Miklósi a fondé en 1994 le groupe de scientifiques Family Dog Project qui étudie les chiens au sein de familles à qui ils appartiennent plutôt que les chiens de laboratoire, afin de mieux comprendre les relations des canidés avec les humains. ], font ce que je souhaitais voir faire il y a vingt ans : travailler en étant attentifs à rendre leurs animaux intéressants.
Que diraient les animaux si… on leur posait les bonnes questions ?, paru en 2012, semble un aboutissement de votre travail sur les animaux. Quel était le projet de ce livre en forme d’abécédaire ?
J’avais envie de clôturer quelque chose, de reprendre tous les fils que j’avais suivis jusqu’alors, et d’en tirer de nouveaux. L’abécédaire était une forme qui me permettait d’arriver très vite sur les points qui m’importent et de créer des frictions. Si vous faites un livre et que vous dites page 90 le contraire de ce que vous avez dit page 30, vous êtes obligé de vous justifier, de faire savoir que vous êtes conscient de la contradiction et de la résoudre, c’est la loi du genre. L’abécédaire était une forme qui me permettait de ne pas les résoudre. Donna Haraway[6. Donna Haraway, biologiste de formation, est une philosophe des sciences états-unienne et une figure du féminisme contemporain. Elle a notamment publié en 1985 le Manifeste cyborg. La métaphore du cyborg lui permet de montrer que les contradictions (dans ce cas, entre machine et vivant) n’ont pas nécessairement à être résolues, mais peuvent se combiner dans un seul être, le cyborg. (Voir l’article « Les affinités éclectiques », Jef Klak nº 3 « Selle de Ch’val » p. 172.) ] nous montre que nous pouvons non seulement assumer, mais chérir les contradictions, assumer que deux positions peuvent être vraies également, et incompatibles.
Vous montrez dans vos ouvrages comment, au XXe siècle, le savoir scientifique sur les animaux s’est constitué contre le savoir amateur…
Il faut remonter au XIXe siècle, lire un passage de Darwin ou de Georges John Romanes[7. Georges John Romanes (1848-1894) est un psychologue et un naturaliste britannique. Ami de Darwin, il fonde la psychologie comparée, qui s’intéresse aux similitudes (et aux différences) entre les mécanismes cognitifs des humains et des animaux de différentes espèces. ] pour comprendre. Vous y trouvez des témoignages de gardiens de zoo et de propriétaires de chiens. On a là une science peuplée d’anecdotes. Les amateurs n’ont pas encore été exclus du discours scientifique. Darwin lui-même observe ses propres chiens, il va au zoo regarder les singes, il écoute les soigneurs. Il reçoit des lettres de partout dans le monde, de cette Angleterre qui explore la planète. Le témoignage est fiable, dans un sens un peu bourgeois, dans la mesure où ce sont des témoins dignes de foi – soit des gens qui s’y connaissent, comme dans le cas des soigneurs, soit des auteurs honorables qu’on estime ne pas pouvoir mentir, pour ne pas risquer leur réputation.
Darwin comme Romanes ont tendance à expliquer le comportement des animaux par des compétences très proches des nôtres. Le projet étant d’établir une filiation entre les hommes et les autres animaux, ils cherchent des analogies plutôt que des différences. Toujours est-il qu’ils manifestent à l’égard des animaux une générosité d’attribution de subjectivité qu’on qualifiera plus tard d’anthropomorphisme débridé.
Au début du XXe siècle, s’opère un grand mouvement de purification qui prend plusieurs orientations. D’abord le principe du « canon de Morgan » qui exige que, lorsqu’une explication faisant intervenir des compétences inférieures concurrence une explication privilégiant des compétences supérieures ou des facultés cognitives complexes, ce sont les explications qui font appel à des compétences inférieures qui doivent prévaloir. Si vous voulez mobiliser les capacités supérieures d’un animal, il va falloir mettre en place un dispositif expérimental pour prouver que son comportement ne peut pas être expliqué par des capacités inférieures. L’exemple le plus fréquent est d’attribuer la réussite de quelque chose qui demande de l’intelligence à du conditionnement. David Premack et Georges Woodruff ont testé la capacité de mentir chez les chimpanzés. Si un expérimentateur demande au singe de l’aider à trouver une friandise, le chimpanzé qui sait où elle se trouve lui montre la cachette. Si l’expérimentateur ne partage pas la trouvaille avec lui, le chimpanzé le leurrera à l’épreuve suivante. Pour les deux scientifiques, c’est bien l’indice d’une capacité à anticiper et à savoir que ce que l’expérimentateur sait diffère de ce que sait le chimpanzé. Pour nombre de leurs collègues, c’est une simple association, de type conditionnement, entre l’expérimentateur « malhonnête » et l’absence de récompense. On se débarrasse ainsi des explications prétendument nébuleuses que sont la volonté, les états mentaux ou affectifs, ou encore le fait que l’animal puisse avoir un avis sur la situation et l’interpréter.
À la suite de Konrad Lorenz[8. Konrad Lorenz (1903-1989) est un pionnier de l’éthologie. Lauréat du Prix Nobel de médecine en 1973, il étudie le comportement des animaux (en particulier le rôle de l’inné dans sa détermination) et notamment l’imprégnation chez les oisillons (Voir l’article « Le blues des grues blanches », Jef Klak nº 3 « Selle de Ch’val », p.54). ], les éthologistes se mettent aussi à regarder les animaux comme limités à réagir plutôt que sentants et pensants. Ils excluent toute possibilité de prendre en compte l’expérience individuelle et subjective. C’est la naissance d’une éthologie mécaniciste, qui a pour effet de scientifiser la connaissance de l’animal. L’éthologie devient une biologie du comportement obsédée par l’instinct, les déterminismes invariants et les mécanismes innés, physiologiquement explicables en termes de causes. Par ailleurs, le contrôle devient l’instrument majeur à l’œuvre dans le laboratoire, en faisant mine que ce contrôle n’affecte pas l’animal ni les résultats ; qu’il est juste une condition de possibilité.
Robert Rosenthal incarne une des apothéoses de ce mouvement du XXe siècle en psychologie expérimentale. Après avoir montré que la performance des rats dans un labyrinthe est affectée par les attentes des expérimentateurs – la performance est meilleure lorsque ces derniers sont persuadés d’avoir affaire à des rats « doués » –, il dénonce cet effet comme un parasite à éliminer. Il veut purifier le laboratoire. Il vise une situation idéale où le rat ne serait pas influencé, quitte à utiliser des robots en guise d’expérimentateurs. Ce qu’il oublie, c’est que dans l’environnement artificiel et entièrement humain qu’est le laboratoire, l’absence de relation est aussi une forme de relation, qui influence nécessairement le rat.
L’éthologie se démarque de plus en plus des amateurs, notamment en invalidant les anecdotes. Les scientifiques constituent un certain type de méthodologie pour disqualifier ceux qui n’en respectent pas les contraintes. C’est la stratégie du « faire-science » : ils reconnaissent aux amateurs un certain savoir sur les animaux, mais leur absence de méthode, de grille d’interprétation et de rigueur scientifique invalident leurs interprétations, qualifiées d’anthropomorphiques.
La primatologie permet par la suite un assouplissement progressif. Certains primatologues commencent en effet à revendiquer que leurs méthodes doivent se rapprocher de l’anthropologie, car faute d’habituation des singes à leurs observateurs, ceux-ci ne peuvent pas réaliser d’observations de qualité. Les recherches sur les chiens participent aussi de cet assouplissement. Même si le scientifique n’est pas amateur de chien au départ, il le devient rapidement ; il y a une relation qui s’installe au laboratoire. Très souvent, d’ailleurs, les scientifiques travaillent avec leur propre animal ou ceux d’amis, des bêtes avec qui ils tissent des liens.
Qu’en est-il aujourd’hui des relations entre l’éthologie et les savoirs amateurs ?
Les choses évoluent. Ádám Miklósi, spécialiste des chiens, insère dans son livre des encarts où il raconte ce qu’on appelle des anecdotes. Ce n’est pas un hasard : entre-temps, un article écrit par deux primatologues, Lucy Bates et Richard Byrne[9. Bates Lucy A. et Byrne Richard W., « Creative or created: using anecdotes to investigate animal cognition », Methods, 2007, vol. 42, no 1, pp. 12-21. ], a proposé de ne plus jeter ces histoires à la poubelle, considérant cela comme un vrai gaspillage. Pour eux, de nombreux événements n’arrivent que très rarement sur le terrain, voire une seule fois, mais ils peuvent nous apprendre des choses intéressantes sur les compétences des animaux. Pourtant, elles ne peuvent pas figurer dans les publications, et restent donc complètement ignorées. L’article a reçu un très bon accueil et eu un impact important. Il précise quand même que pour être acceptables, les anecdotes doivent être observées sous certaines conditions contrôlées : il faut qu’elles soient notées immédiatement après avoir eu lieu et que l’observateur soit scientifique et spécialiste de l’espèce considérée. On est toujours dans une routine normative et un régime d’exclusion, mais cela permet quand même de ressortir quantité d’histoires restées jusque-là dans des tiroirs ou abandonnées à la littérature populaire.
Miklósi cite deux anecdotes racontées par deux scientifiques spécialistes des chiens, observées avec leurs propres animaux. Quand le premier rentre de promenade avec son compagnon, il va chercher un drap à la salle de bain et l’essuie. Un jour, il oublie ; l’animal se met à se frotter sur le paillasson et à le regarder d’un air interrogateur, puis va lui-même chercher le drap. La petite fille du second scientifique a pris l’habitude, par jeu, de jeter un drap de bain sur leur chien et de lui crier, en imitant la voix d’Homer Simpson : « Où est-ce qu’il est Darby ? ». Un jour, Darby prend lui-même le drap et s’enroule dedans ; il initie le jeu.
Miklósi fait un truc génial : il traite ensemble ces deux histoires pour faire émerger une faculté commune. C’est stratégique, ça lui permet de réaliser un coup de force par rapport à d’éventuels détracteurs. Il y a, dit-il, deux interprétations possibles. La première illustre la posture sceptique, et affirme qu’il s’agit de coïncidences : en détournant le geste de son maître pour en faire une demande ou en imitant celui de la petite fille, le chien n’a pas vraiment eu l’intention d’exprimer une volonté quelconque. Avec cette première interprétation, on s’arrête là, on ne peut rien faire de plus. La seconde, plus généreuse (ou plus laxiste, selon les points de vue) suppose des compétences sophistiquées : le chien imite et se montre capable, en détournant le geste imité, de généraliser et d’exprimer une demande. Le scientifique est mis au travail, il a des hypothèses à vérifier: le chien est-il capable d’imiter, de détourner un geste pour en faire une modalité expressive, d’anticiper que cet acte sera compris ? La différence entre les deux hypothèses, la sceptique et la généreuse, c’est leur fécondité scientifique.
Y a-t-il une spécificité de l’éthologie quant à la disqualification du savoir amateur par rapport au savoir scientifique ?
La relation entre les savoirs scientifiques et amateurs concernant les animaux a pris une forme particulière, celle de la rivalité. Le chimiste, lui, ne se préoccupe pas de ce que pense l’alchimiste. De même, les astrologues ne vont pas voir les astronomes pour leur dire : « Je pense que vous vous trompez, vos affirmations sont fausses. » Le médecin est en revanche encore hanté par le charlatan – ce que nous rappelle sans cesse la méfiance envers l’homéopathie, ou les pratiques alternatives… L’éthologie semble se situer plutôt du côté de la médecine, alors qu’elle aurait pu se trouver du côté des disciplines comme l’astronomie ou la chimie – des sciences qui ne cherchent pas à éliminer leur rival. Sans doute en raison de sa proximité avec les amateurs : l’éthologie dialogue avec eux, elle s’en inspire, elle les pille, même, disent certains. Et eux, de leur côté, ne se gênent pas pour aller voir les éthologues, pour se mêler de ce qui ne les regarde pas.
Les psychologues aussi restent en prise avec leurs rivaux : ils n’arrêtent pas de décrier les faux thérapeutes. Comme l’éthologie et la médecine, la psychologie dénonce les savoirs populaires parce qu’ils sont trop profondément engagés dans ce monde. Le philosophe Martin Savransky parle d’épistémologie de l’étrangéité (estrangement) pour décrire, et contester, l’idée selon laquelle le savoir ne vaut qu’à condition d’aller à l’encontre du sens commun : pour connaître le monde, il faut y être « étranger », quitter les apparences immédiates pour une réalité cachée, que les gens ne peuvent saisir, pris comme ils le sont dans le monde phénoménal.
Quel est le rôle de l’accusation d’anthropomorphisme ?
Des scientifiques récusent certaines théories en les accusant d’accorder aux animaux des capacités proprement humaines, sous-entendu trop élaborées. J’ai rencontré un tel affrontement autour des cratéropes écaillés. Ce sont de petits oiseaux du désert du Néguev, à partir desquels l’ornithologue Amotz Zahavi a élaboré sa théorie du handicap, selon laquelle certains animaux affirment leur valeur en exhibant un comportement ostentatoire. Les cratéropes se font des cadeaux, se portent volontaires pour être sentinelles, nourrissent sans bénéfice apparent d’autres nichées que la leur, prennent des risques dans les combats avec les prédateurs ; et font tout cela avec une volonté explicitement exhibitionniste. Pour leur « prestige », dit Zahavi. Jonathan Wright, un autre zoologue, relativement bien formaté et qui adhère aux postulats de la sociobiologie, considère, lui, que les cratéropes sont programmés pour agir de la façon qui assure au mieux la pérennité de leurs gênes.
Un jour, Jonathan Wright et moi-même voyons un cratérope faire le petit sifflement d’appel qui indique qu’il va donner à manger à une autre nichée que la sienne. Selon Zahavi, ce sifflement veut dire : « Je suis altruiste, regardez-moi, j’ai les moyens de faire des choses magnifiques. » Il est en train de travailler à augmenter son prestige. Sauf que cette fois-là, il ne donne rien à la nichée. Wright, convaincu que le prestige n’est pas ce qui le motive, m’explique que ce cratérope est en train de mener une expérimentation sur la nichée : il veut contrôler son état de faim réel pour ne pas perdre de temps. Il lance un stimulus et regarde l’effet.
En général, Wright pense qu’on ne peut pas émettre une hypothèse si on ne l’a pas expérimentée : c’est ce qu’exige une véritable science objective. Cette fois-là, face à quelque chose d’étrange et incompréhensible à ses yeux, il se dit : c’est une expérimentation. Il semble attribuer aux oiseaux la manière dont, lui, a appris à « faire-science ». Mais c’est quelque chose qu’il refuse tout à fait à Zahavi, qu’il accuse tout le temps d’être anthropomorphe. En fait, il ne reproche pas tant à Zahavi d’attribuer aux oiseaux des intentions semblables à celles des humains – il le fait lui aussi –, mais plutôt de ne pas procéder selon la méthode scientifique habituelle, à savoir le canon de Morgan et l’expérimentation. Il cherche à disqualifier sa façon non scientifique, à ses yeux, d’attribuer des intentions aux cratéropes. L’accusation d’anthropomorphisme est en fait une accusation d’amateuromorphisme.
Quel rôle ont joué les femmes et le féminisme dans l’évolution de l’éthologie ?
L’arrivée des femmes – de quelques femmes – sur le terrain de la primatologie a tout bouleversé. Cela a été très bien analysé d’abord par Donna Haraway, dans son livre Primate visions, puis repris par Linda Fedigan et Shirley Strum dans Primate encounters. Elles ont constaté que les changements absolument remarquables qu’opère la primatologie à partir des années 1960 sont le fait de chercheuses, sous la plume desquelles sont apparues de nouvelles observations et propositions.
À partir de là, on s’est demandé si les femmes faisaient de la science différemment. Les hypothèses se sont distribuées selon deux types de postures: une plus essentialiste et une plus constructiviste ou culturaliste. La vision essentialiste affirme qu’elles travaillent différemment parce qu’elles sont naturellement plus sensibles, plus à l’écoute du matériel, moins habitées par des théories générales, soucieuses de collecter des faits et attentives aux détails, parce qu’elles auraient une grande suspicion par rapport aux généralisations hâtives. La position constructiviste, quant à elle, revient à dire : « les femmes ont été éduquées comme cela et c’est cela qu’elles mettent en œuvre sur le terrain », ou encore « les femmes occupent une position historique particulière qui produit une conscience aiguë des rapports de pouvoir, qui les rend, par exemple, plus suspicieuses vis-à-vis des généralisations hâtives. Cela favorise d’autres données et une autre manière de les mettre en histoire, une science d’une autre qualité ». D’autres, enfin, comme Shirley Strum, affirment que cela n’a rien à voir : « Ce que l’on peut dire de nous, c’est que nous sommes restées très longtemps sur le terrain et avons fait correctement notre travail. Nous sommes simplement de bonnes scientifiques. » Reste à savoir si les femmes ne sont pas davantage obligées de faire bien leur travail, du fait d’une compétition extrêmement rude. Ne sont-elles pas contraintes à une certaine forme d’excellence, à travailler plus qu’un homme, parce qu’elles sont moins entendues ?
Pour bien comprendre pourquoi les femmes sont restées longtemps sur le terrain, il faut prendre en compte le contexte socio-économique et politique des années 1960. Les hommes avaient alors toutes les chances de devenir professeurs d’université en primatologie – science émergente qui intéressait beaucoup les anthropologues –, notamment parce que les origines de l’homme étaient une question qui fascinait. Les femmes, ayant très peu de chances d’avoir des postes de ce type-là, continuaient à fonctionner avec des bourses de recherche et ne tentaient pas trop d’enseigner dans les universités. Elles voulaient travailler avec leurs singes, obtenir des bourses et une fois sur un terrain, y rester.
Qu’est-ce que ces femmes ont changé dans la primatologie ?
D’abord, elles se sont intéressées au rôle des femelles. Auparavant, on ne le faisait que pour vérifier l’attachement au rôle maternel. Elles ont décrété que la maternité, c’était bien joli, mais que ça ne faisait pas toute la carrière des femelles. L’attention qu’elles ont prêtée à la sagacité sociale des femelles, à leur importance dans les relations sociales, a complètement modifié ce que l’on savait des mâles. Le fait que les femmes restent plus longtemps sur le terrain – ce qui est statistiquement le cas dans les années 1960 – a permis de découvrir que ce sont généralement les femelles qui restent au sein de la troupe, et les mâles qui migrent. Avant, on ne savait pas cela. Parce que si vous restez trois mois, quand un mâle disparaît, vous vous dites : « Bernard n’est plus là, il lui est arrivé des malheurs. » Mais en restant des années, vous voyez de nombreux mâles disparaître et d’autres arriver, et vous finissez par comprendre que, quand un d’entre eux disparaît, c’est qu’il est parti rejoindre une autre troupe (ce qu’ils font normalement à l’adolescence). Tandis que les femelles restent sur place et assurent le social.
L’apparente inactivité sociale féminine, c’est-à-dire le fait qu’elles ne sont pas tout le temps en train de négocier, de se bagarrer, de régler des choses, signifie simplement que, quand vous vivez depuis des années avec d’autres êtres, vous n’avez plus besoin de discuter de tout, tout le temps. Les relations sont bien installées et on ne les remet en jeu que lors de conflits ou de changements importants dans la troupe. Cette apparente inactivité est en fait une activité en soi. Ce sont elles qui font société et les mâles qui viennent s’intégrer dans la troupe. Une fois que vous avez vu ça, vous comprenez autrement l’apparente activité sociale des mâles. Avant, on pensait qu’ils étaient en lutte pour obtenir une place plus haute dans la hiérarchie. Si vous partez du principe qu’une troupe est un ensemble stable d’individus et que vous y voyez des mecs se battre tout le temps, vous n’avez pas beaucoup d’autres possibilités que de penser qu’ils se bagarrent pour la domination, surtout dans les paradigmes de l’époque. Mais une fois que vous comprenez que les prémisses sont fausses, que les mâles passent d’une troupe à l’autre et doivent sans cesse s’intégrer, une autre interprétation s’impose. Ce n’est plus un problème de hiérarchie, mais d’intégration : trouver une place dans la troupe quand on est nouveau venu n’est pas facile, on n’est pas nécessairement bien accueilli.
Tout ce qu’on avait vu de relations compétitives entre mâles mal dégrossis, peu sophistiqués, était en fait un travail incessant de socialisation, de composition de ce social. Chaparder de la nourriture, pour un mâle, c’est obliger les autres à le reconnaître, à prendre sa présence en compte. Si vous n’arrivez pas à le faire sur un mode sophistiqué parce que vous êtes trop jeune, et mal équipé socialement, vous utilisez les moyens des adolescents : on ne me regarde pas, alors je vais obliger tout le monde à me regarder, je vais faire chier. Ce qui est intéressant, relève Shirley Strum, c’est qu’au lieu de faire une science matriarcale, ces primatologues attribuent à chaque catégorie (âge, sexe, etc.) des rôles sociaux particuliers, différenciés et complémentaires.
Est-ce que ces primatologues revendiquent une histoire féministe ?
Certaines oui. Elles disent qu’elles ont pu observer ce qu’elles observent parce qu’elles étaient dans une position historique très clairement déterminée, ce qui est déjà un point de vue féministe. D’autres ajoutent que nous étions plus attentives aux relations de pouvoir à cette époque. Remettre en question le rôle des femelles, c’est être attentive aux relations de pouvoir et de subordination, à la conscience de genre, à ce qui fait que nos observations nous confortent trop vite dans l’idée que les femelles sont passives. C’est être attentive aux grandes dichotomies passivité/activité, sujet/objet – catégories que le féminisme avait commencé à sérieusement remettre en cause. C’est être méfiante vis-à-vis de ces grandes théories que sont la hiérarchie et la compétition, suspectes d’un point de vue féministe, car trop proches de la manière dont les humains s’imaginent une société. C’est remettre en cause aussi les notions de harem, de guerre de tous contre tous, de mâle alpha, tout ce qui est schème guerrier, grandes épopées héroïques – l’homme qui se redresse par-dessus les herbes de la savane, invente les armes et compagnie. À cette époque, les féministes ont commencé à revisiter ces grandes histoires, et cela a nourri la primatologie.
Est-ce que ces changements au sein de la primatologie ont touché les autres animaux ?
C’est intuitif, je ne suis pas historienne, mais j’ai le sentiment que les méthodologies de la primatologie ont imprégné celles des autres scientifiques, au moins en ce qui concerne les espèces qui ne fuient pas dès que vous approchez. Il y a un effet d’émulation entre chercheurs assez remarquable : quand les singes réussissent un truc, les spécialistes du corbeau, de la baleine ou du dauphin essayent de montrer que leurs animaux peuvent y arriver aussi. Toute éthologie est comparative, même si le projet ne l’est pas au départ.
Est-ce ainsi que la primatologue Thelma Rowell en est venue à étudier les moutons ?
Thelma Rowell voulait dénoncer l’anthropocentrisme. Selon elle, les singes nous paraissent intelligents parce que nous pouvons leur poser des questions sur la base de nos fonctionnements respectifs, très similaires. Les chimpanzés ont des amis, sont capables de réconciliation, de créer des alliances, de soigner les liens, de mentir, de manifester des relations privilégiées, d’en prendre acte et de faire en sorte que ces relations restent possibles. Mais sont-ils vraiment plus malins que les autres ? On ne peut pas comparer deux êtres si on ne leur pose pas les mêmes questions. Donc il faut poser à d’autres animaux celles qu’on pose aux chimpanzés. Thelma Rowell choisit l’animal qui, parmi les mammifères, a la réputation d’être le plus idiot, docile et suiveur, le plus mal équipé socialement : le mouton.
Si on regarde la littérature scientifique, jusque-là, on demandait aux moutons : comment tu convertis l’herbe en gigot ? On leur donnait de l’herbe et on regardait comment ils grossissaient. On s’est aussi un peu intéressé à leurs relations sociales, mais on a vite décrété qu’ils n’étaient pas très doués pour ça. On n’a pas remarqué d’attachements, de préférences… rien, seulement un modèle hiérarchique. De toute façon, en général, tout comportement qui n’a pas de sens immédiat, ou dont le sens aurait demandé beaucoup plus de confiance dans la complexité des êtres, est rabattu d’emblée comme « hiérarchique ». Problème réglé.
Les moutons étaient donc très hiérarchisés : les mâles se battaient pour les femelles, et la femelle dominante, la plus âgée, conduisait le troupeau. Thelma Rowell a fait remarquer que cette littérature scientifique affirmant qu’il n’y avait pas de relations de préférence était en fait fondée sur des troupeaux constitués pour l’occasion, et très rapidement observés. Une autre explication est que les chercheurs préfèrent étudier les moutons quand il se passe beaucoup de choses, c’est-à-dire aux périodes de reproduction durant lesquelles il y a de nombreux conflits.
Elle a donc décidé de procéder tout autrement, affirmant qu’il faut poser ses questions dans un contexte favorable, prendre le temps de créer un troupeau, de l’observer, et attendre que les relations se soient installées. Ce faisant, elle a observé que les moutons avaient des préférences, des amis, et que la hiérarchie n’était pas du tout coercitive. Au contraire, pour décider des déplacements, il y avait des conversations, des négociations. À propos des combats entre mâles, Rowell raconte qu’ils ont pour but d’attirer l’attention des femelles, et que comme les moutons n’ont pas de mains pour interpeller, ils le font avec leurs cornes. Elle est arrivée ainsi à toute une série d’interprétations sophistiquées, affirmant par exemple que lorsque les moutons se frottent les joues ou le front avant ou après un combat, il s’agit de gestes de pré-réconciliation et de réconciliation. Comme si les moutons qui ont une affinité particulière se disaient avant de se battre : « Je suis obligé de faire ce que je vais faire, mais on reste amis. » Comme un salut avant un combat de boxe.
La question du propre de l’homme, de la frontière homme-animal, vous intéresse-t-elle ?
Non ! Cette question n’a d’intérêt qu’historique, pour diagnostiquer l’évolution des rapports, observer comment les positions se modifient et quels sont les bastions qui tiennent encore. Les argumentaires sur le propre de l’homme sont en général très mal documentés. En 1930, soit, je ne vais pas jeter la pierre à Freud quand il dit que l’homme est le seul à réguler les unions incestueuses. En revanche, ceux qui le citent aujourd’hui pour défendre ce genre de banalité m’irritent. Ils n’ont généralement rien à voir avec les animaux, et prennent les positions les plus radicales et généralisantes sur ces questions.
Je ne suis pas en train de faire le tri entre savoirs populaires et savoirs d’experts, savoirs légitimés et non légitimés ; la ligne ne passe pas par là. Ce sont même souvent les personnes légitimées par une posture académique ou une position sociale, culturelle, scientifique qui émettent les théories les plus stupides sur la question de la frontière homme-animal. En revanche, quand vous interrogez des propriétaires de chiens, des éleveurs, comme nous l’avons fait avec Jocelyne Porcher[10. Jocelyne Porcher et Vinciane Despret, Être bêtes, Actes Sud, 2007. ], la question de la différence ne les intéresse pas. Et quand elle les intéresse, on obtient des réponses surprenantes.
Quels remparts du « propre de l’homme » résistent encore ?
Le rire a été un rempart important, mais a été démonté quand on a vu des animaux rire. La conscience de soi comme spécifique à l’humain a aussi été invalidée : les éthologues ont monté nombre de dispositifs expérimentaux montrant que les animaux avaient conscience d’eux-mêmes, comme le test de la tache de Gallup[11. Aussi appelé « test du miroir », il consiste à placer une marque sur le front d’un animal, puis à observer sa réaction lorsqu’il découvre son reflet dans un miroir. S’il cherche à mieux l’apercevoir ou à la toucher, on considère que cet animal est capable de reconnaître son propre corps. Ce test a été développé dans les années 1970 par le psychologue américain Gordon G. Gallup. ]. Idem pour la « culture », rempart abattu après des années de controverse. On ne compte plus les « propres de l’homme » qui ont été ingénieusement remis en cause.
La conscience de la mort et de la finitude reste un bastion, sans doute parce qu’il ne sera pas facilement démenti. Aujourd’hui, certains reconnaissent bien que les animaux ressentent le chagrin dû à la perte, qu’ils font la différence entre le cadavre d’un congénère et celui d’un autre animal. Mais d’autres leur répondent que c’est peut-être de la peur ou de l’anxiété. Ils disent aussi qu’avoir conscience que l’autre est mort, ce n’est pas la même chose qu’avoir conscience de la mort. La Mort avec un M majuscule ! Et nous, humains, avons-nous conscience de la mort ? C’est complexe. Est-ce que l’on a conscience que l’on va mourir ? Pas tout le temps. On a conscience de la finitude, qu’on n’est pas là pour toujours, oui, et encore.
Pourquoi les scientifiques, les psychologues et les sociologues en particulier, ont-ils tenu et tiennent-ils encore autant à ces remparts ?
Pour des raisons historiques et politiques. Des gens ont très sérieusement pensé, à tort ou à raison, que l’affaiblissement de la frontière entre les deux pourrait entraîner des choses terribles pour l’être humain : sa bestialisation, le non-respect de la vie. Sur cette question, Luc Ferry[12. Luc Ferry, Le Nouvel Ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme, Grasset, 1992. ] a fait un très mauvais boulot : il a écrit une très mauvaise étude historique et juridique des lois nazies, en les tronquant, en les lisant mal, et sans voir que les lois de protection animale ne s’enracinaient pas dans le nazisme, comme il l’affirmait, mais avaient des origines bien antérieures. Heureusement, des gens comme Éric Baratay[13. Eric Baratay est un historien français spécialiste des relations hommes-animaux. ] et Jean Pierre Marguénaud[14. Jean Pierre Marguénaud est professeur de droit privé à Limoges et directeur de la Revue semestrielle de droit animalier. ] ont remis les choses en place. Mais la crainte de voir cette barrière tomber reste très présente. Outre cette peur, ce qui explique que ces remparts tiennent si bien, ce sont les habitudes routinières académiques. L’anthropologie s’est fondée sur l’étude de l’homme en tant qu’homme, et forcément, ça n’encourage pas à brouiller les frontières.
Qu’ont fait, selon vous, les penseurs de la libération animale par rapport à cette frontière ?
Ils n’ont pas apaisé les choses. Le système argumentatif de Peter Singer[15. Peter Singer est un philosophe australien. Il est l’auteur de La libération animale, paru en 1975, ouvrage de référence pour les mouvements en faveur des droits des animaux (Voir l’article « Je suis un terroriste parce j’ai défendu le droit des lapins »). Il a popularisé la notion de « spécisme », qui désigne un traitement discriminatoire fondé sur l’appartenance à une espèce. Peter Singer part d’une vision utilitariste, selon laquelle le but de l’action politique est la maximisation du bien-être du plus grand nombre d’êtres dotés de sensibilité. ] consiste à demander : « Pourquoi une vie d’handicapé vaudrait plus que celle d’un animal ? » C’est extrêmement dangereux et cela attise les peurs. Je crois que c’est une erreur stratégique. Il aurait dû penser aux effets de terreur qu’il allait susciter en disant cela. Pour ma part, je suis leibnizienne à la suite d’Isabelle Stengers ; je suis une pragmatiste. Si vous utilisez un argument qui suscite encore plus de peur, que vous rigidifiez les positions et que vous ne convainquez que les convaincus, il y a quelque chose à repenser. Par ailleurs, je n’ai pas de sympathie pour l’utilitarisme. Donc, je ne peux pas suivre Singer, si ce n’est sur un seul point : sa façon de déconstruire et remettre en cause les mauvaises pratiques scientifiques.
Vous avez travaillé avec Jocelyne Porcher : qu’est-ce que son approche vous a apporté ?
Jocelyne nous oblige à revisiter tout le vocabulaire utilisé pour décrire la relation entre hommes et animaux, notamment le terme d’« exploitation ». Il n’existe pas une vie qui ne repose sur la vie d’autres êtres, et voir ça automatiquement en termes d’exploitation cadenasse le débat : il y a forcément une victime et un bourreau. On ne peut plus penser, on tombe dans une éthique binaire, avec des victimes et des salopards. Mieux vaut se montrer attentif à tout ce vocabulaire de l’exploitation, parce qu’il imprègne les modes de penser.
Deux historiennes des sciences, Carla Hustak et Natacha Myers ont écrit en ce sens un très joli article sur l’évolution[16. Carla Hustak, Natacha Myers, « Involutionary Momentum: Affective Ecologies and the Sciences of Plant/ Insect Encounters », Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies 23(3), 2012. ]. Aujourd’hui, on étudie beaucoup – comme Darwin l’avait très sensuellement fait en son temps – le rapport entre les insectes pollinisateurs et les orchidées. Il y a toute une chimie écologique qui permet de mieux comprendre les rapports des parfums attracteurs, des phéromones… L’article montre que ces rapports sont généralement décrits sur le mode de l’exploitation avec un dupe et un être qui leurre. Quand la fleur crée des appâts pour faire venir des insectes, on imagine que la plante exploite l’insecte puisqu’il y va à perte, croyant féconder un être fécondable. Mais plutôt qu’un simple système d’exploitation, ne peut-on pas imaginer des relations qui se seraient instaurées, avec des plaisirs sensuels, des rencontres ? De la même manière, il faut être très attentif à ne pas penser la domestication uniquement sous le régime de l’exploitation : des tas de relations s’y créent, réciproques, asymétriques.
J’ai beaucoup d’admiration pour Jocelyne. Cela dit, nous ne sommes pas toujours d’accord stratégiquement. Elle me reproche de ne pas dénoncer, de ne pas parler de la souffrance animale. Mais que veut-on ? Que les choses changent ou que nos idées gagnent ?
Encore une fois, je pense qu’il faut être pragmatiste et accompagner les réussites : les scientifiques auront davantage envie de travailler sur des modes plus intéressants si je leur montre ce que ça produit, si je leur donne confiance en ce qu’ils font, que si je me mets à leur tirer dessus à boulets rouges, à faire peur à tout le monde. C’est aussi une question de crédibilité.
Pour mon travail, je suis allée chercher les gens qui disaient et faisaient des choses intéressantes. Jocelyne, elle, est confrontée à des éthologues positivistes, scientistes, purificateurs, et très zootechniciens[17. La zootechnie est l’ensemble des sciences et techniques utilisées pour l’élevage des animaux dans un cadre agro-industriel. ] dans l’âme. Ceux-là, je ne les fréquente pas, donc je n’en parle pas. Si je ne les critique pas, c’est pour ne pas perdre mon temps. Jocelyne considère qu’on ne perd pas son temps à critiquer. Ce sont deux stratégies différentes, et complémentaires.
Jocelyne Porcher est désespérée par la façon dont l’éthologie appliquée aux recherches sur le bien-être animal sert à valider la production animale industrielle. Les changements dans les éthologies dites naturalistes peuvent-ils être en mesure de déplacer ce type de recherches ? Le travail de Thelma Rowell sur les moutons par exemple peut-il avoir un retentissement sur la production agroalimentaire ?
Thelma Rowell n’a pas trop d’illusions là-dessus. Mais je pense que cela peut passer par d’autres voies. J’ai rencontré des scientifiques qui disent ne plus faire certaines choses après m’avoir lue, qu’ils font davantage attention à la façon dont ils s’occupent de leurs animaux. Ils réfléchissent aux conditions qui permettent à l’animal de se sentir mieux. Parfois, ça les freine un peu. Mais je pense que le fait d’être empêché est souvent le signe d’un plus grand changement que celui de commencer à faire quelque chose de nouveau. Cela manifeste une modification profonde. Ce sont peut-être de tous petits pas, mais si les moutons de Thelma Rowell n’inspirent pas d’autres pratiques dans les élevages industriels, cela a quand même des effets sur le grand public qui peut faire pression.
Comment êtes-vous passée des animaux à vos derniers travaux sur les morts ?
C’est un grand saut dans le vide. Il y a vingt-cinq ans, l’animal était l’objet le plus subversif que j’ai pu trouver ; maintenant, il n’a plus du tout cet effet. Il y a un ronronnement consensuel ; la question animale est devenue une espèce de ritournelle bien-pensante. Aujourd’hui selon moi, ce sont les morts qui sont des objets d’étude subversifs. Ce sujet diablement sulfureux permet de remettre en cause la rationalisation forcée de la société, et la laïcité telle qu’elle est pratiquée sur le mode de la neutralisation. Les morts permettent de s’attaquer au pouvoir des psys, à la normalisation et à la domestication des psychés, à l’ethnocentrisme autant qu’à l’arrogance des anthropologues et des sociologues qui se donnent pour mission de désenchanter le monde. Les scientifiques académiques ont besoin de penser que les gens croient pour pouvoir les dessiller les yeux. Quand on utilise le mot « croire » pour désigner la manière dont les gens pensent, c’est une déclaration de guerre depuis une position de surplomb[18. Voir « Quand on jette on une vierge dans un pays communiste un matin. Vie publique d’une apparition. Entretien avec Élisabeth Claverie », Jef Klak, nº 1, « Marabout », Automne-hiver 2014-2015. ].
Ce qui me passionne, ce sont les endroits où les gens sont intelligents. J’avais trouvé beaucoup d’intelligence chez ceux qui travaillent avec les animaux et j’en trouve énormément chez ceux qui cultivent des relations avec leurs morts. Ils le font avec imagination et courage, en sachant que ce n’est pas « normal », pas socialement approuvé. C’est un lieu de résistance politique : ils résistent à la théorie du deuil, à la normalisation, à la domestication de leurs expériences.
Ce qui m’importe, c’est de prendre au sérieux le fait que les gens parlent à leurs morts, que ça n’a rien de symbolique et que nous n’avons pas à statuer sur leur présence effective. Est-ce qu’ils reviennent ou pas ? On n’en sait rien. Si on sent leur présence, quel est ce mode de présence ? Ce que je fais, c’est de l’éthologie des morts, au sens de Deleuze. L’éthologie, selon lui, serait « la science pratique des manières d’être », c’est-à-dire l’étude de ce dont les êtres sont capables, des épreuves qu’ils peuvent endurer, de leur puissance. Un diamant est un être d’une exceptionnelle dureté, c’est la puissance du diamant. Un chameau peut s’arrêter de boire pendant plusieurs jours, c’est la puissance du chameau.
Je trouve cette définition de l’éthologie passionnante, car elle peut englober ce qu’on appelait trop pauvrement « biologie du comportement ». Deleuze dit que savoir de quoi un être est capable engage à des expérimentations. Quand on met un être dans un dispositif, quand on fait une expérience avec un chien, on doit se demander : de quoi es-tu capable pour aller chercher la balle, comment tu t’y prends, c’est quoi ta manière d’être ? Deleuze dit que les régimes alimentaires sont des manières d’être. C’est ça, l’éthologie : ce n’est pas seulement manger de la viande ou de l’herbe, mais tout un paysage – des manières de vivre, de penser, de bouger, d’agir, de vivre la nuit, le jour. Je dis aujourd’hui que je fais une éthologie des morts. Quelles sont les manières d’être des morts ? De quoi sont-ils capables ? De quoi rendent-ils les vivants capables ?
by Bruno Thomé | 10 avril 2017 | Selle de ch’val
Quel point commun entre un cochon élevé à la chaîne par l’industrie agroalimentaire, une professeure de musique en collège, une brebis paissant dans les alpages et un directeur des services vétérinaires pendant la crise de la vache folle ? Tous travaillent. Partant de là, se pose la question de leurs conditions de travail et de leur rapport à cette activité.
Jocelyne Porcher, éleveuse de brebis devenue sociologue, étudie les relations de travail entre humains et animaux d’élevage. Lise Gaignard est psychanalyste et chercheuse en psychodynamique du travail[2. Chroniques du travail aliéné, 2015, éditions D’une.]. Elle s’intéresse non pas à la « souffrance » ou au « bien être », mais plutôt à « la construction psychique liée à l’activité de travail ». Elles confrontent ici leurs manières de penser cette activité particulière qui lie humains et animaux plus souvent qu’on le croit.
Cet article est le deuxième d’une série de six publications issues du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », et publiées en ligne à l’occasion de la sortie du nouveau numéro, « Ch’val de course ».
Télécharchez l’entretien en PDF.
Sur quoi travaillez-vous et comment vous êtes-vous rencontrées ?
Jocelyne Porcher : J’ai été éleveuse de brebis puis j’ai dû arrêter. À 33 ans, j’ai repris un cursus de formation et j’ai obtenu un brevet de technicien agricole et un BTS Productions animales. Lors d’un stage, je me suis retrouvée dans une porcherie industrielle. La rencontre avec la violence productiviste a été un choc. Plus tard, quand je suis arrivée à l’Inra (Institut national de la recherche agronomique) pour un stage d’ingénieur agricole, j’ai découvert les recherches sur le « bien-être animal » : mettre des vaches dans des labyrinthes, infliger des chocs électriques à des moutons pour prouver leur capacité à anticiper… J’ai pu constater que les chercheurs sur le « bien-être animal » ne connaissaient ni les animaux, ni les éleveurs – qu’ils méprisaient ouvertement –, ni même l’élevage. Seules semblent compter leurs petites manip’, leurs publications scientifiques et leur place dans le monde académique. C’est en travaillant avec eux que j’ai décidé de devenir moi-même chercheuse, pour servir d’autres intérêts que ceux de l’agro-industrie. J’ai d’abord travaillé sur l’attachement entre éleveurs et animaux, ce lien formidable observé lors de mon expérience d’éleveuse, mais c’est surtout la souffrance des éleveurs qui ressortait de mes études et donc, j’ai cherché à la comprendre.
Lise Gaignard : Je suis pour ma part psychanalyste et j’ai travaillé dans des cliniques pratiquant la psychothérapie institutionnelle[3. La psychothérapie institutionnelle est une théorie et une pratique thérapeutique en institution psychiatrique qui met l’accent sur la désaliénation, la dynamique de groupe et la relation entre soignants et soignés. Selon celui qu’on considère comme son fondateur, François Tosquelles, la psychothérapie institutionnelle « marche sur deux jambes : Karl Marx et Sigmund Freud », qui permettent de penser ensemble les deux aliénations, l’une psychopathologique, l’autre sociale.]. Pendant la crise de la vache folle, au début des années 2000, j’ai été sollicitée sur la « souffrance au travail » – comme ils disent – des directeurs des services vétérinaires (DSV). Ils n’arrivaient pas à organiser les abattages de troupeaux ; cela leur faisait des cauchemars. Ils s’étaient dit qu’une psychanalyste, c’était bien, pour leur enlever les cauchemars.
J. P. : C’est à cette époque que nous nous sommes rencontrées, au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Suite à mon recrutement à l’Inra, j’avais été détachée au Laboratoire psychodynamique du travail et de l’action de Christophe Dejours : je faisais des enquêtes sur le travail dans les porcheries industrielles, et c’est en mobilisant la psychodynamique[4. La psychodynamique du travail est une discipline créée par Christophe Dejours au début des années 1970 afin d’analyser les processus psychiques mis en place par une personne face à la réalité du travail. Elle étudie les problèmes de relations entre les différents partenaires de travail et les processus subjectifs et psycho-affectifs mobilisés par les contraintes du travail.] que j’ai pu faire ces recherches en étant moi-même moins en souffrance. J’allais chez les gens, ils étalaient leurs histoires, ils pleuraient et je les laissais en larmes sur leur table de cuisine. Je me suis dit que quelque chose n’allait pas, qu’il fallait prendre les choses autrement, avoir une réponse collective à la souffrance exprimée par les éleveurs.
L. G. : L’élevage industriel est quelque chose de construit collectivement dont, au fond, tout le monde est plus ou moins responsable. Les enquêtes de Jocelyne sur la souffrance dans les porcheries ont politisé la question, laquelle est complexe, puisque les victimes sont aussi les coupables. La psychodynamique du travail montre que les victimes, ce sont aussi bien les cochons que les éleveurs ou les vacanciers qui vont sur les plages pleines d’algues vertes. Son travail permet de sortir des fausses alternatives que portent les experts du bien-être animal et les abolitionnistes de toute forme « d’exploitation animale[5. C’est-à-dire y compris l’élevage (qu’il soit industriel ou paysan) ainsi que toute forme de domestication.] ».
J. P. : Surtout que les cochons ne sont pas seulement des victimes ; ils collaborent au travail. Ils sont comme nous : ils sont trop bons, ils supportent tout par excès de gentillesse. C’est en cela que la question du travail est intéressante : les cochons perçoivent nos désirs et cherchent à bien se comporter pour nous faire plaisir.
Sur quelle définition du travail vous appuyez-vous pour questionner l’une, les animaux au travail, l’autre les salariés qui vous consultent ?
J. P. : Pour penser les animaux au travail, je me suis d’abord appuyée sur Le Manuscrit de 1844 de Karl Marx : le travail y est avant tout décrit comme un rapport émancipateur à la nature, une action sur le monde pour le transformer. Cela m’a permis de comprendre comment et pourquoi on vivait avec les animaux. Je suis partie de cette hypothèse : c’est le travail qui nous réunit et qui nous permet de vivre ensemble. Les éleveurs ne vivent pas avec les animaux pour gagner de l’argent. Ils n’en gagnent pas. Ils travaillent avec les animaux parce qu’ils veulent vivre avec eux.
Car travailler, c’est d’abord vivre ensemble, c’est chercher à s’émanciper des contraintes et de la tragédie de la vie. En élevage, le travail permet, aux animaux comme à nous-mêmes, de comprendre et d’appréhender les choses, de les maîtriser un peu pour que le moment de vie en commun entre éleveurs et animaux devienne autre chose qu’une tragédie – même si ça finit tragiquement pour les animaux et pour nous-mêmes.
L. G. : Il faut bien distinguer travail et emploi. J’utilise deux définitions. D’abord celle de Claude Veil dans Psychiatrie et milieu de travail[6. Dans Psychiatrie française, vol. XXVII/96.] : le travail, c’est toute production de services ou de biens entraînant des liens entre les personnes. Quand on emmène son gamin à l’école, on travaille. Ça permet de déstabiliser la question, de la complexifier. On sort de la définition sociologique du travail, qui est souvent recouverte par la question de l’emploi, ce qui fait qu’on ne sait souvent plus de quoi on parle dans les débats publics. Le travail pose la question de la production commune d’une société.
L’autre définition, c’est celle de la psychodynamique du travail, de Christophe Dejours : le travail est l’effort ajouté à la prescription pour qu’elle devienne réalisable. On a toujours une prescription qu’on ne pourra pas mettre en œuvre parce qu’elle est trop loin du réel, parce qu’il y a des prescriptions contradictoires – faire vite et faire bien et en toute sécurité. On doit donc arbitrer en permanence entre ce qu’on fait et ce qu’on dit. Le travail, c’est alors l’effort que je produis pour faire au mieux, c’est-à-dire au moins mal, en fonction de ce qu’on m’a demandé et de ce qui est possible. Cela dépend aussi de si je suis fatiguée ou en pleine forme, de retour de vacances ou déjà à bout le lundi. Il s’agit de réfléchir sur cet investissement, qui est totalement invisible, car les arbitrages ne durent qu’un quart de millième de seconde : on est pris dedans. Or, c’est là que réside la marge de manœuvre qui permet de ne pas laisser les gens en train de pleurer sur la table de la cuisine.
J. P. : J’ai pu aussi le vérifier dans mes recherches : le travail des vaches ne réside pas tant dans le suivi de procédures que dans leur effort pour bien faire, sans lequel ça ne marche pas. Nous l’avons montré avec Tiphaine Schmitt en étudiant le rapport des vaches au robot de traite dans une exploitation laitière[7. Jocelyne Porcher et Tiphaine Schmitt, « Les vaches collaborent-elles au travail ? Une question de sociologie », Revue du MAUSS, 2010/1 (no 35), p. 235-261.], pour lequel il n’y a pas de procédure : les vaches se débrouillent entre elles pour accéder à la machine. Nous avons montré que cet ajustement n’est pas de l’ordre du conditionnement ni de la hiérarchie, mais consiste en un ensemble d’arrangements entre les vaches elles-mêmes, assez drôle à observer. Certaines peuvent même enrayer la machine : il y en a une par exemple qui s’était arrêtée une demi-heure à l’entrée du robot, avec les autres qui piétinaient derrière. Elle a bloqué le système, volontairement.
L’enjeu est de montrer aux éleveurs qui ne le perçoivent pas que les vaches conservent une marge d’autonomie, même si elles ont l’air d’agir soit par conditionnement soit parce qu’elles sont contraintes. Les concepteurs des machines à traire s’efforcent d’ailleurs de réduire cette marge, pour que les vaches ne soient que des pions, forcées de suivre le chemin prévu. Ils s’efforcent en fait de les empêcher de travailler.
L. G. : Ici, le travail de la vache, c’est l’effort pour rendre le robot de traite à peu près utile.
J. P. : Le travail est un investissement dans la production, mais la vache ne produit pas du lait. Elle se moque de la courbe de production. En revanche, elle a conscience de toute l’organisation autour d’elle, et agit pour que tout se passe bien. C’est plus facile de parler de travail concernant les chiens de berger, les chiens policiers ou d’aveugle, parce qu’ils ont une vision de la finalité de leur travail : c’est une production de services. Mais même ceux qui forment les chiens le perçoivent souvent comme du conditionnement. Pourtant, les chiens de berger sont encore plus au fait du travail que le berger lui-même, car ils connaissent mieux les brebis. Il y a donc ceux qui prennent des initiatives et ceux auxquels le berger dit sans cesse : « À droite, à gauche, devant, derrière », qui sont finalement comme des automates. Mais on retrouve plus souvent les chiens automates dans les concours que dans les alpages.
L. G. : Au fond, la plupart des salariés ne savent pas plus ce qu’ils produisent que la vache qui produit du lait ou de la viande. Ils font, ils aménagent, souvent ils désobéissent, mais ils ne savent pas ce qu’ils produisent. Par exemple, un maître d’école n’a pas forcément conscience de participer à la production d’une société inégalitaire. On ne produit pas forcément ce qu’on croit.
J. P. : En tous cas, si on dit que les animaux travaillent, cela nous oblige à questionner l’organisation de ce travail, par exemple la question du temps de travail. Avec une vache laitière, on peut penser une organisation qui tienne compte de son statut de travailleur, y compris les pauses. En revanche, un porc charcutier est à l’usine 24 h/24. Et la seule porte de sortie, c’est l’abattoir.
Le travail est-il le seul mode de relation possible avec les animaux domestiques ?
J. P. : Le travail est partout, même dans les relations avec les animaux de compagnie. J’ai une chienne, et si son travail, c’est de me tenir compagnie, où est le champ du hors-travail ? Si je lui dis : « Aujourd’hui je travaille », et que je m’installe devant mon ordinateur, elle se met dans un coin et ne bouge plus. C’est un travail sur soi : elle est en forme, elle voudrait courir, aboyer, mais tant que je suis plantée devant mon ordinateur, elle attend. En revanche, si j’emmène ma chienne à la plage, elle fait ce qu’elle veut, et c’est moi qui suis à son service, qui surveille : c’est moi qui travaille.
À un moment, il y a du travail, de la production, de l’engagement, et à un autre du dégagement. C’est un changement de monde : les animaux sont dans le travail, dans notre monde à nous, ou plutôt le monde commun humains/animaux, et à un moment donné, ils sont dans leurs propres affaires.
Les animaux sauvages travaillent-ils aussi ?
J. P. : Pas tous. Les fourmis et moi, nous n’interférons pas. Peut-être sont-elles travailleuses, mais leur concept de travail ne regarde qu’elles. En revanche, certains animaux dits sauvages travaillent, comme les cétacés qu’on équipe d’un GPS pour surveiller le climat. On les capture, on les surveille, et les animaux le savent. Sans doute en pensent-ils quelque chose, et il se peut que cela fausse les résultats, comme dans les expérimentations animales[8. Voir Jef Klak nº 3 « Selle de ch’val »: « Les moutons ont des amis et des conversations. Comment les animaux désarçonnent la science. Entretien avec Vinciane Despret. ».]. Peut-être que ces baleines continuent leur vie comme avant de « travailler » pour nous, mais peut-être pas, ou pas autant qu’on ne le croit. À partir du moment où les animaux se demandent ce qu’on bidouille avec eux, ce qu’on leur veut, et qu’ils répondent, on peut considérer qu’ils travaillent.
Les animaux ont-ils un statut différent en « production animale » – c’est-à-dire industrielle – et dans les élevages paysans ?
J. P. : Lors de la crise porcine de 2015, un gros producteur de porc se plaignait dans la presse : « Je vais être obligé de licencier mes ouvrières. » Là, les truies renvoient à l’ouvrier aliéné, jetable, exploité au maximum. En revanche, dans l’élevage « véritable », les animaux ont un statut de travailleur, de partenaire, de collègue de travail. Un idéal de la relation de travail peut alors s’inventer, équitable dans une certaine mesure, où la coopération serait privilégiée – sans nier que nos relations aux animaux sont de toute façon asymétriques.
L. G. : Cette notion de « collègue de travail » est tout de même compliquée : normalement, on ne tue pas les collègues et on ne les mange pas à la fin de leur contrat.
Comment circule la souffrance entre salariés et animaux dans les porcheries industrielles ?
J. P. : On force la truie à produire de dix-huit à vingt-six porcelets par portée – une truie n’a que seize tétines. Par conséquent, la mise à bas est trop longue et les derniers porcelets risquent de mourir. Donc un salarié doit « fouiller » la truie, c’est-à-dire aller chercher les porcelets dans l’utérus. Ça lui fait mal. Le salarié se met à sa place. Si c’est une femme ayant des enfants, elle se dit : « Je suis mère moi aussi. » Il y a un côté charnel, une empathie de corps : on est si près des animaux qu’on ressent leur souffrance dans son propre corps.
J’appelle cela la « contagion de la souffrance ». Plus qu’une interaction, c’est une espèce de balance mutique de la souffrance, comme une contagion de quelque chose de sourd qui passe des animaux aux humains. C’est plus explicite chez les femmes que chez les hommes, qui ont des défenses viriles plus fortes[9. Ce concept de défense virile a été développé notamment par Christophe Dejours dans Souffrances en France. La banalisation de l’injustice sociale, Seuil, 1998.]. Même si les salariées essaient de maintenir un écart avec l’animal, comme un filtre, les animaux le dissolvent en se rapprochant d’elles. Cela produit une espèce de magma où la souffrance passe facilement. « On fait souffrir les animaux, et moi, je participe à ça. Les truies ne m’aiment pas, je sais pourquoi, mais j’aimerais bien qu’elles m’aiment. Je les fais souffrir, mais je fais de mon mieux. Mon chef me dit de tuer les porcelets chétifs, mais je ne le fais pas, je leur donne le biberon, j’y passe des heures. » Il y a aussi une souffrance éthique, morale, liée à la conscience de sa collaboration à un système qui génère de la souffrance.
Et les producteurs, est-ce qu’ils souffrent aussi ?
J. P. : Les producteurs sont coincés, ils ne peuvent pas quitter ce système de production. Ils ont fait le mauvais choix au mauvais moment et se sont laissé bourrer le mou, par intérêt voire par cupidité. En plus, ils ont souvent un taux d’endettement de 180% et les banquiers sur le dos. Dès lors, ils ne pensent qu’à extirper la matière animale des bestioles pour la transformer en fric et rembourser la banque. C’est pour ça qu’ils sont obligés d’aller pleurer à la télévision pour réclamer moins de normes : « Arrêtez de nous saouler avec l’environnement, avec le bien-être animal. » Le bien-être animal est bien utile à la filière dont il permet de redorer le blason, mais c’est une autre histoire pour le pauvre gars qui se retrouve bloqué par ces nouvelles contraintes, et ne peut plus inséminer ou faire ses piqûres comme il veut…
Quels sont les soubassements théoriques du bien-être animal ? En quoi consistent les études sur le bien-être animal dans les productions industrielles ?
J. P. : Le bien-être animal est directement issu de la zootechnie[10. La zootechnie est l’ensemble des sciences et techniques mises en œuvre dans l’élevage des animaux pour l’obtention de produits ou de services à destination de l’homme (viande, lait, œufs, laine, traction, loisirs, etc.).], qui cherche à rendre la machine animale productive dans un certain environnement. Il faut aussi chercher du côté des théories du conditionnement, de l’éthologie comportementale et surtout de l’éthologie appliquée, qui est devenue la véritable zootechnie du XXIe siècle : l’étude du comportement animal à visée économique – comment faire pour que la caille, le porc ou le chat produisent le plus possible dans les systèmes industriels et intensifiés, et pour que cela soit accepté socialement.
Cela fait quarante ans que l’Union européenne finance les études sur le bien-être animal en industrie. Quand j’ai commencé à travailler dans les porcheries industrielles, les truies avaient une sangle qui s’incrustait parfois dans leur chair. La souffrance était visible. Ils ont enlevé la sangle et ont mis les truies en cage. Désormais, bien-être animal oblige, ils ont aussi enlevé la cage, en partie – la truie gestante, théoriquement, n’y reste qu’un mois. Mais ils mettent huit truies ensemble dans un minuscule espace en béton, sur caillebotis, et elles finissent par se battre entre elles – par ennui. Cela nous est présenté comme une amélioration du bien-être animal.
Dans les faits, mes collègues qui étudient la question ne mettent jamais les pieds dans une porcherie ; ils collaborent jour après jour, depuis quarante ans, faisant tourner un système qu’ils prétendent améliorer mais qu’ils ne connaissent pas. Bref, le bien-être animal se résume à assurer la durabilité de cette abjection qu’est le système industriel.
Et le « bien-être au travail », quel est son origine, ainsi que son rôle ?
L. G. : Les sciences du travail et les psychologues du travail existent depuis l’avènement du taylorisme à la fin du XIXe siècle. Les premières études se sont focalisées sur la fatigue, l’engagement, les recrutements, les tests d’aptitudes. Auparavant, personne ne se préoccupait de savoir si un cordonnier aimait le cuir ou pas, comment faire pour qu’il soit tout le temps en forme psychiquement et ne se suicide pas le lundi matin. Il a fallu attendre l’ingénieur américain Frederik Taylor – puis Henry Ford et leurs successeurs – pour que soit théorisée la productivité humaine. Ils ont d’ailleurs très bien réussi : le travail humain n’a jamais autant rapporté qu’actuellement. Aujourd’hui, les psychologues du travail sont toujours au même endroit, sauf qu’ils ont deux casquettes : coachs et spécialistes de la « souffrance au travail », avec les mêmes formations, employeurs et conditions de travail. Le coaching marche moins bien ces derniers temps, mais avec la récente loi sur les risques psychosociaux[11. Le Code du travail français est longtemps resté sans inclure l’aspect mental pour définir les mesures de protection de la santé au travail. Cette idée a été introduite en 2002 par la loi de modernisation sociale, qui remplaça le mot « santé » par les mots : « santé physique et mentale » dans le Code du travail. L’employeur doit désormais prendre en compte tous les risques psychosociaux (RPS) c’est-à-dire les risques concernant non seulement l’intégrité physique des salariés, mais aussi leur santé mentale : le stress, l’épuisement, la souffrance, ou encore le harcèlement moral.], nombre de psychologues se retrouvent à travailler dans les entreprises, se spécialisant dans la filière du bien-être au travail. Ils travaillent pour EDF ou pour la Poste, et reçoivent les salariés pour leur dire : « Ayez des pensées positives ! » C’est un marché juteux.
Le changement le plus frappant dans le monde du travail aujourd’hui est justement cette idée d’envoyer les salariés « chez le psy » pour évacuer la perception de la souffrance : il faut qu’ils soient de nouveau en mesure d’exercer des techniques de travail toujours plus désocialisantes. C’est une dépolitisation totale.
Le pire, c’est que cette mascarade est parfois défendue par les syndicats eux-mêmes : au lieu de lutter sur les conditions de travail, ils voudraient que l’on dénonce les chefs harceleurs. Or, ces cadres sont eux-mêmes constamment sous pression : comme leurs évaluations, et donc leurs salaires, dépendent désormais directement de la production des autres, ils harcèlent leurs subalternes pour que ça aille plus vite, pour les pousser à enlever les sécurités, etc.
Il m’arrive de recevoir dans mon cabinet des salariés que m’envoient des médecins du travail ou des syndicalistes, mais je ne veux pas figurer sur le listing des psys spécialisés dans la « souffrance au travail ». Ceux-là se contentent de conseiller aux personnes harcelées par des chefs pervers-narcissiques de se mettre en arrêt-maladie. Mais le problème n’est pas médical. Après l’arrêt-maladie, si le salarié ne peut pas retourner travailler, la Sécu va l’envoyer à la Maison départementale des personnes handicapées avec une allocation adulte handicapé, et ses revenus vont baisser rapidement. C’est la manière la plus pratique et la plus courante de se débarrasser des travailleurs aujourd’hui. Je ne me bats donc pas tant contre le « bien-être au travail » que contre ceux qui sont obnubilés par la question de la souffrance au travail, et qui emmènent tout le monde dans ce qui est clairement une catastrophe nationale.
Comment se passe la consultation ?
L. G : Des salariés qu’on n’a pas réussi à calmer arrivent dans mon cabinet : ceux qui embarrassent tout le monde, qui parlent de se suicider au travail et risquent de faire exploser les statistiques. Pour éviter ça, certains services de médecine du travail acceptent de payer 110 euros pour qu’ils viennent passer une ou deux séances de deux heures dans mon bureau.
Ce sont en général des cadres, des professions intermédiaires, très peu d’ouvriers. Jamais des précaires. Ils commencent toujours l’entretien en racontant comment on les a rendus malades. Ils démarrent toujours de la même manière : « J’ai un chef pervers narcissique. » Ils en ont toujours un. Je leur demande ensuite ce qu’ils font comme travail. Ils répondent par exemple : « Je suis professeur de musique. » Et ils décrivent donc leur activité : « On a cinq classes de sixième la première année, on ne sait jamais le nom des élèves, on les a une heure par semaine, on n’y comprend rien. » Ils parlent ensuite des rapports de domination, de la hiérarchisation symbolique des matières : au collège, le haut, c’est les maths, après c’est la physique-chimie, puis les lettres, les langues et en dernier, il y a les arts plastiques et la musique.
Puis vient l’anecdote : elle s’est fait caillasser par des élèves avec de grosses boules de neige, jusqu’à l’intérieur de sa voiture, où elle se retrouve toute trempée le dernier jour de l’école avant Noël. Le directeur du collège passe à côté, elle lui demande de l’aide, et lui rigole. Elle a fait une dépression et n’est jamais retournée travailler.
Bref elle était désagréable avec les élèves, ces derniers étaient d’une cruauté effroyable envers elle, et le directeur également. C’était un rapport terrifiant.
Elle est donc entrée dans mon bureau avec des élèves délinquants et un principal de collège pervers-narcissique – et elle en avait des preuves. Mais elle est ressortie avec une autre vision : « Professeur de musique, ce n’est pas une vie, et les collèges, c’est l’enfer pour tout le monde. » Et c’est vrai. Elle était moins « rendue folle », mais plus embarrassée. Elle a arrêté de croire qu’on lui voulait du mal et s’est retrouvée dans une espèce d’incertitude, alors qu’avant, elle avait une solution : dresser les gosses et faire virer le principal. C’était pas compliqué – à part à mettre en œuvre –, mais le prix de tout cela, c’est qu’elle ne dormait pas, que plus personne ne lui téléphonait. Elle était seule car elle était trop pénible.
Le prix d’une vie plus lucide, c’est d’être davantage contrarié et, éventuellement, de passer à l’action. Qu’est-ce que l’action pour un prof de musique ? Se remettre au piano ? Je n’en sais rien. Ce sont les gens qui savent ce qu’il faut qu’ils fassent. Mais à un moment, on rentre dans l’embarras de la question de la société, du vivre ensemble au sens noble. Comment faire pour ne pas s’entretuer ? Comment faire un collège ? Il y a des établissements où ça se passe extrêmement bien. Même avec les profs de musique !
Au début des années 2000, tu as enquêté sur la « souffrance au travail » des directeurs de services vétérinaires pendant la crise de la vache folle. Peux-tu nous raconter cette expérience ?
L. G. : Les directeurs de services vétérinaires (DSV) ressentaient de la « souffrance au travail » parce qu’ils devaient abattre des troupeaux entiers à la moindre alerte, alors que, ne sachant pas comment la maladie se propageait, ils étaient scientifiquement contre les abattages. Mais ils étaient obligés.
Ces directeurs sont des hauts fonctionnaires qui travaillent avec le préfet pour faire appliquer les réglementations étatiques à propos du commerce de la viande : en temps normal, ils ne s’occupent pas d’animaux mais uniquement de produits animaux.
Peu de temps avant, on leur avait demandé d’organiser la mise à mort de tous les veaux d’un jour[12. Les éleveurs pouvaient à l’époque bénéficier de « la prime Hérode », une compensation financière européenne accordée pour l’abattage des jeunes veaux.], ce qui ne leur avait pas posé trop de problèmes ; il suffisait de signer un bout de papier pour les envoyer à l’abattoir. Mais cette fois, on leur demandait d’organiser l’abattage eux-mêmes, dans des équarrissages[13. L’équarrissage est le lieu où on traite les cadavres d’animaux morts hors des abattoirs.] qui n’étaient pas assez grands. Il fallait inventer. Ils ont dû faire appel à des gens qui savent tuer les bêtes – ceux qui avaient travaillé toute la semaine à l’abattoir rempilaient donc le dimanche – et ils abattaient aussi dans les champs. Et puis les bêtes ne sont pas si bêtes que ça : par exemple, des veaux d’un jour dont on venait de tuer la mère passaient à travers les clôtures. Bref, ç’a été un merdier total.
Pour les DSV, voir arriver sur leur écran : « Il y a un sérodiagnostic positif dans l’élevage de M. Machin, trois cents vaches », c’était l’angoisse. Comment faire alors pour ne pas souffrir ? D’autant qu’on leur demandait de faire couper toutes les têtes pour prélever un bout de cerveau et l’envoyer à Paris : il pouvait y avoir de grandes tables avec trois cents têtes de vaches. Les DSV n’ont jamais eu les résultats des examens.
Après ça, ils devaient répondre aux médias et raconter qu’ils donnaient des biftecks hachés à leurs propres enfants. On allait manger au restaurant La Boucherie le midi avec eux et ils commandaient du tartare… Une vétérinaire avait même dit : « Je suis prête à me faire filmer en train de mettre du sang de vache dans le biberon de mon bébé. » C’est un réflexe défensif : comment faire quand on réprouve son travail ? Il faut aller jusqu’au bout, sinon c’est trop dur. Les éleveurs, quant à eux, souffraient énormément. Or la consigne du préfet était « Aucun suicide d’éleveur ». Et ils ne se sont pas suicidés !
J. P. : Pas tout de suite !
L. G. : Les autorités ont proposé de leur offrir deux fois le prix du troupeau en compensation. Mais les éleveurs disaient : « Ce n’est pas une histoire de fric ! Comment vais-je refaire un troupeau ? Celui-là, ça fait trente ans que je le fabrique ! »
Est-ce pour des raisons similaires que certains éleveurs de brebis refusent une compensation financière quand quelques bêtes sont tuées par des loups – ce qu’on appelle la « part du loup » ?
J. P. : Pas exactement. Les brebis ont été domestiquées il y a 8 000 ans, c’est l’animal d’élevage par excellence. La brebis fait confiance à l’éleveur pour pâturer tranquillement, pour échapper à son destin de proie. Le premier engagement de l’éleveur est de protéger ses bêtes de la tempête, des ravins, de la maladie, du loup. Si une brebis se fait manger, c’est le troupeau entier qui est stressé, les liens entre les brebis et l’éleveur sont pulvérisés. Les éleveurs s’en fichent du chèque de compensation ; au contraire, c’est le prix de leur trahison. Je me suis appuyée sur la théorie du don de Marcel Mauss[14. Marcel Mauss, « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », L’Année sociologique, 1923-1924.] pour penser l’élevage : nous mangeons les animaux domestiques, en échange de quoi nous sommes tenus de leur offrir une belle vie. Et la mort des animaux n’est pas le but du travail mais le bout. Aujourd’hui, les éleveurs ont l’impression de ne plus être à la hauteur de ce que donnent les animaux.
Je n’ai rien contre les loups, mais ils ont compris qu’ils étaient protégés : puisqu’on élève des brebis pour eux, pourquoi se fatigueraient-ils à chasser d’autres animaux ? Ils sont eux aussi domestiqués, mais contre les brebis.
Tu dis souvent que travailler avec des animaux, c’est aussi se coltiner la mort, et par extension le vivant, question qu’écartent selon toi les véganes et les abolitionnistes…
J. P. : Le problème, c’est que les abolitionnistes croient avoir la solution : c’est mal de faire souffrir et de tuer les animaux, donc il faut arrêter de les manger, de les élever, de se les approprier. Il y aurait le bien d’un côté et le mal de l’autre. Il suffirait d’abolir l’élevage, y compris pour les animaux familiers. Comme le bien-être animal, qui consent à la violence du système industriel, la libération animale se donne comme vertueuse envers les animaux, mais consent de fait à leur disparition – avec pour logique implicite « Si tu ne nais pas, tu ne souffres pas ».
Selon moi, le véganisme rejoint les intérêts de ceux qui veulent prendre en main l’élevage, en l’occurrence les multinationales et les fonds d’investissement. La Fondation Bill Gates soutient par exemple des entreprises[15. Beyond meat et Hampton Creek Foods. Hampton Creek Foods est également soutenue par des fonds d’investissement comme Khosla Venture. La firme multinationale Cargill, de son côté, a breveté un substitut de fromage, le Lygomme ACH Optimum, essentiellement constitué d’amidons.] qui proposent des ersatz de poulet sans poulet, du bœuf sans bœuf, du fromage sans lait, de la mayonnaise sans œufs… Ça les arrange qu’on soit convaincus que c’est mal de manger des animaux : cela leur permet de nous vendre leurs nouveaux produits.
On arrive au bout du bout de notre rapport industriel aux animaux, que ce soit au niveau de l’éthique, de l’environnement, de la santé… Mais nous vivons dans un monde capitaliste où la solution est une nouvelle industrialisation. En plus de ces succédanés de viande, les multinationales et les fonds d’investissement cherchent à créer une industrie de la viande 2.0, à produire une viande sans animaux, car les animaux restent un frein à la production. En défendant le projet d’une production de viande in vitro (élaborée en cultivant des cellules souches en laboratoire), les abolitionnistes ne font pas le service après-vente, mais le service avant-vente. Les consommateurs de viande industrielle consentent tout de suite à un système industriel qui a cours, alors que les véganes militants consentent à un système qui arrive.
Bien sûr, les productions animales font souffrir horriblement les animaux et les salariés, elles contribuent à la destruction de la biodiversité et ont un impact réel sur le climat. Mais ce sont les systèmes industrialisés qui en sont responsables, pas l’élevage. Depuis 10 000 ans, l’élevage est, au contraire, en harmonie avec la planète. L’élevage, c’est vivre et travailler avec des animaux. Faire naître et élever. C’est un métier de la reproduction et de la relation. Une relation entre humains et animaux, et une relation commune à la nature. Les vaches font la prairie, comme les moutons dessinent les pentes de la montagne. Sans les animaux d’élevage, la forêt est à la merci des incendies : ils rendent notre environnement habitable, varié, beau.
La filière bio ne s’est que tardivement intéressée à l’élevage. Pourquoi ?
J. P. : La viande bio est commercialisée comme bonne pour la santé et l’environnement, pas pour la qualité du travail des éleveurs et des animaux. Quand je travaillais à Ecocert[16. Organisme de certification de l’agriculture biologique.], lors de sa naissance au début des années 1990, j’étais étonnée que beaucoup de maraîchers soient végétariens et considèrent les éleveurs comme des « viandards ». La filière bio est née des enjeux de la relation à la terre, à la plante, sans considérer tout de suite – sauf les biodynamistes – la relation homme-animal-plante. Aujourd’hui, ce secteur s’intéresse à l’élevage, notamment sous l’impulsion des consommateurs, depuis que les pratiques des systèmes industriels se sont ébruitées, et bien sûr à cause des scandales sanitaires.
Quand on vit en ville, sans contact avec des éleveurs, on n’a quasiment pas d’autre choix que de ne pas manger de viande si on ne veut pas alimenter l’industrie de production animale…
J. P. : Il est plus compliqué de vendre une viande saine et de qualité en circuit court que des légumes bio, notamment parce que la viande et le fromage doivent être réfrigérés pour le transport et la conservation. Mais pourquoi ne pas mettre en commun une camionnette frigorifiée et s’organiser avec des éleveurs ?
L. G. : La question de l’élevage concerne la vie quotidienne de tout le monde. Comment fait-on au jour le jour ? Que promouvoir de façon collective ? Les Amap fonctionnent bien pour les légumes, les petits maraîchers se sont bien débrouillés pour se rendre accessibles, pourquoi pas les éleveurs ? Des listes de psychanalystes féministes, non homophobes, élaborées par des usagers circulent sur Internet, et c’est une très bonne chose. On pourrait s’inspirer de ça pour les bouchers, les éleveurs. On ne s’organise pas assez sur la viande.
Ne devrait-on pas repenser aussi l’abattage ?
J. P. : C’est une question centrale, qui revient sans cesse chez les éleveurs que je connais : comment faire pour abattre à la ferme ? C’est pourquoi je participe à la création d’un groupe avec des éleveurs, des vétérinaires, des journalistes et la Confédération paysanne, pour faire changer la loi qui oblige à passer par les abattoirs[17. À ce sujet, lire J. Porcher, E. Lécrivain, S. Mouret, N. Savalois : Livre blanc pour une mort digne des animaux, Les Éditions du Palais, 2014. ]. Aujourd’hui encore, certains se risquent à abattre à la ferme, ni vu ni connu. Quand j’étais éleveuse, je ne suis jamais allée à l’abattoir, mais je n’aurais pas tué mon mouton moi-même : il faut un tueur pour cela, c’est un métier, et il y en a de moins en moins.
Pour ma part, je défends l’abattage à la ferme, mais mes collègues scientifiques défendent au mieux l’abattoir de proximité. L’Institut technique du porc (ITP) veut court-circuiter les résistances en créant des abattoirs de proximité dépendants de la filière industrielle. C’est ce qui m’étonne toujours avec l’industrie, et le capitalisme en général : pourquoi veulent-ils tout ? Pourquoi forcent-ils les petits bergers du Lubéron à passer par des abattoirs industriels ?
L. G. : Le capitalisme n’existe pas, ce ne sont que des gens qui le mettent en œuvre, comme dans l’exemple des Directeurs des services vétérinaires. Ce sont eux qui font appliquer les lois et les réglementations commerciales, et toute alternative leur donne des cauchemars, surtout si ça concerne la vie et la mort. Vu que ce ne sont pas les petits éleveurs qui nourrissent la France, ils peuvent les faire fermer. C’est ça le progrès, c’est ça la vie hygiénique.
J. P. : J’essaie de travailler la question du rituel avec les éleveurs. Une d’entre eux m’a dit récemment : « À l’abattoir, on n’a même plus la place de parler une dernière fois aux animaux. » Avant, au moment de laisser l’animal, son mari récitait une poésie indienne rituelle, à voix haute. Depuis que je travaille sur cette question, je me suis rendu compte que beaucoup d’éleveurs font ça. Moi, je le faisais aussi, dans ma tête. Et quand je mange de la viande, je visualise l’animal. J’en mange en conscience, en lien avec les animaux.
L. G. : Notre rapport au monde est fondé en premier sur notre rapport au vivant. Les animaux sont là, qu’on les mange, qu’on les tape ou qu’on les caresse, et nos relations avec eux sont fondatrices. Les psychanalystes nient trop souvent ce qui est de l’ordre de l’environnement et de l’expérience vécue, au bénéfice de relations strictement familiales de type père-mère-enfant. Alors que sur le divan, les gens nous parlent de leurs nourrices, de leurs maîtresses d’école, de leur chien, de leurs vaches. Cela a longtemps été considéré comme des résistances au triangle œdipien, mais la théorie psychanalytique est en train de changer. Il est courant que quelqu’un ait bien tenu le choc suite à la mort d’un proche, mais s’effondre deux ans plus tard suite à la mort de son chat, pour les deux. Et d’autres assument qu’ils ont eu plus de mal à faire le deuil de leur chien que celui de leur mère. Tout le monde le sait, mais on ne l’écrit jamais.
J. P. : Ce que je me demande, c’est comment ça se passe pour les animaux. Les animaux engagés dans le travail rêvent-ils du travail ? Est-ce que les vaches rêvent du travail ?
L. G. : De quoi d’autre veux-tu qu’elles rêvent ?
by Bruno Thomé | 05 janvier 2017 | Culture de base, Marabout
Écrivain de comics célèbre pour ses scénarios virtuoses qui mettent en scène la violence du pouvoir de l’État, ainsi que celle des super-héros, Alan Moore se déclare anarchiste, mais également adepte de la magie, qu’il pratique – et qu’il vulgarise dans nombre de ses histoires. Ainsi La Ligue des gentlemen extraordinaires, fresque séculaire qu’il a initiée il y a désormais quinze ans, met en abyme les mythes individualistes et scientistes de l’époque victorienne à nos jours ; l’occasion aussi pour Moore d’approfondir son exploration des mondes magiques.
Cet article est issu du premier numéro de Jef Klak, « Marabout », toujours disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF.
« L’Humanité entière durant son évolution copie les fables. D’où vinrent vos fusées si ce n’est du Nautilus et de la cavorite ? La matière repose sur les rêves. Deux mains se dessinant l’une l’autre, les fantasmagories que vous avez façonnées vous façonnent »
Prospero, Le Dossier noir
Alan Moore est l’un des rares scénaristes de comic books connu au-delà du petit milieu des lecteurs de comics américains. Les adaptations cinématographiques de ses livres, From Hell, V pour Vendeta, The Watchmen, et La Ligue des gentlemen extraordinaires, ont assuré sa notoriété internationale, même s’il les considère toutes plus mauvaises les unes que les autres. Passionné par la magie, et plus généralement par toutes les cosmogonies, croyances païennes et autres pensées non « rationnelles », son premier grand succès américain fut la reprise de La Créature du marais, dont il transforma radicalement le mythe fondateur.
Jusqu’alors, le monstre croyait être un scientifique que l’explosion de son laboratoire avait transformé, motif on ne peut plus banal dans les histoires de super-héros. Moore fait de la créature un « Élémental », un Esprit des éléments qui se prend pour un humain. C’est aussi dans cette série qu’il crée le très british John Constantine, Hellblazer, qui deviendra le spécialiste de la magie noire et de l’occulte pour l’écurie DC[2. DC, « Detective Comics », est l’une des principales maisons d’édition américaine de comics, avec au catalogue des poids lourds comme Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, et Green Lantern.].
En 1993, pour son quarantième anniversaire, Moore annonce à sa famille et ses amis qu’il va devenir magicien : « Pas le type : “Choisissez une carte”, plutôt le type : “Je converse avec les démons”. » Au-delà de la provocation et d’une volonté de casser son image de génie en prenant les habits du fou, Alan Moore ne fait que radicaliser une idée déjà prégnante dans toute son œuvre : la nécessité de dépasser la rationalité pour penser le monde et créer des idées originales : « Je suis dépendant de l’écriture pour gagner ma vie, alors il est vraiment à mon avantage de comprendre comment fonctionne le processus de création. Un des problèmes est que quand vous commencez à le faire, il vous faut quitter le bord de la science et la rationalité[3. Entretien avec Steve Rose pour le journal anglais The Guardian, février 2002.]. »Son homonyme et ami de longue date, Steve Moore[4. Steve Moore n’a aucun lien de parenté avec Alan Moore, mais est son « plus vieil ami dans la profession ». C’est lui qui l’a fait entrer à l’hebdomadaire anglais 2000 AD, qui publia ses premières histoires. On lui doit notamment les aventures de Jonni Future et des récits sur la jeunesse de Tom Strong pour la collection ABC créée par Alan Moore. Il vient de décéder ce 16 mars 2014. R.I.P.], également auteur de comics et adepte de la magie, lui montre alors une pièce de monnaie frappée à l’effigie d’un Dieu oublié : Glycon, serpent à visage humain et chevelure blonde. Profitant de la crédulité de ses contemporains, le prophète grec Alexandre d’Abonuteichos avait inventé cette divinité au IIe siècle pour créer une secte[5. Selon le satiriste du IIe siècle Lucien de Samosate, dans Alexandre ou le faux prophète.]. « Pour moi, c’est parfait. Si je dois avoir un Dieu, j’aime autant que ce soit un canular. Comme ça, je n’irai pas croire qu’une marionnette a créé l’univers ou un autre délire du genre[6. Entretien pour l’hebdomadaire culturel américain LA Weekly, janvier 2002.]. » Le Dieu-serpent chevelu devient le Dieu personnel d’Alan Moore.
Héros de la Science & Monde des Idées
En 1999, Alan Moore accepte la proposition de la maison d’édition WildStorm de scénariser une collection entière de comics. Ce sera America’s Best Comics (ABC), « les meilleurs comics d’Amérique », avec pas moins de cinq titres différents : La Ligue des gentlemen extraordinaires, Tom strong, Promethea, Top Ten et l’anthologie Tomorrow stories.
Dans ces séries, Moore développe sa vision de la magie, ainsi qu’une critique du scientisme des comics, préférant le terme de « héros de la science » à celui de super-héros. Ainsi Jack B. Quick[7. Seule des quatre courtes séries de l’anthologie Tomorrow stories à avoir été publiée en français.] est un petit génie à lunettes et salopette du Midwest américain, qui ne cesse de provoquer des catastrophes avec ses expériences scientifiques, tel ce mini-trou noir où reste coincée la vache Bessie. Top Ten suit le quotidien du commissariat de Neopolis, ville où sont relégués tous les êtres « extraordinaires » : « héros de la science », mais aussi extraterrestres, robots, dieux, magiciens, vampires de la Causa Nosferatu, etc. Tom Strong, « élevé dans la raison pure, loin de l’influence de la société », a grandi dans une chambre d’hypergravité, et développé sa masse musculaire de manière extraordinaire. Mais s’il incarne l’Esprit rationnel et progressiste du siècle, c’est à la tribu de l’île Attabar Teru, qui l’a recueilli après la mort de ses parents scientifiques, qu’il doit son humanisme et sa longévité exceptionnelle (il vivra plus d’un siècle et demi). S’attaquant à l’hégémonie de la pensée scientifique et du pouvoir de la technologie dans nos sociétés, Moore ne prône pas l’abandon de la raison pour la pensée magique. Il préfère en appeler à de nouvelles synthèses.
Dans Promethea, il précise sa vision du rapport entre magie et art. L’adorateur de Glycon décrit un personnage-idée, Promethea, qui s’est incarné dans diverses femmes au cours des siècles. Chaque avatar est devenu une histoire, un poème, un conte, un comic strip ou un pulp, et a atteint l’immortalité, au sein d’Immateria, le royaume de l’imagination. Moore relie le processus créatif à celui de la magie, et expose une sorte de théorie de la création artistique, inspirée de Platon et Carl Jung : les créateurs n’inventent rien ex nihilo, mais puisent leurs idées dans un plan mental partagé, un « monde commun des idées » (Ideasphere). Dans cette espèce d’espace, les idées remplacent la matière, leurs associations forment des continents, et les dieux sont des amas d’idées devenus conscients par leur densité, qui infectent de plus en plus d’esprits.
Davantage que son exposé métaphysique, ce sont les expériences narratives du scénariste et de son dessinateur, J.H. Williams III, inspirées de rituels magiques, qui font de Promethea une série exceptionnelle. Le douzième épisode, où la dernière incarnation de Promethea visite le « théâtre de la pensée », est à ce titre exemplaire. Chacune de ses vingt-quatre pages est construite à partir de l’association de quatre lignes narratives : anagramme du nom Promethea en lettres de scrabble, l’histoire de l’Univers racontée en vers par deux serpents jumeaux, une parabole sur la magie adressée au lecteur par Aleister Crowley, et une arcane de Tarot. Le tout forme une frise ininterrompue, chaque page rejoignant la suivante.
La Ligue
Débutée avec Kevin O’Neil en 1999, La Ligue des gentlemen extraordinaires est la seule série ABC que ses auteurs poursuivent encore aujourd’hui[8. La Ligue des gentlemen extraordinaires a été la toute première publication du label ABC. Elle sera surtout la seule série que poursuivra Alan Moore après le rachat de WildStorm par DC, devenu éditeur et propriétaire de tous les titres ABC. Or malgré l’engagement de DC de ne pas intervenir sur ce label, tout le premier tirage du cinquième épisode de la Ligue fut mis au pilon à cause d’une (vraie) réclame victorienne pour une poire vaginale à jet tourbillonnant appelée « The Marvel ». DC craignait en effet d’offenser son principal concurrent, Marvel Comics, mais renforça ainsi définitivement Alan Moore dans sa haine des gros éditeurs. Dès que son contrat le lui permit, Moore passa avec sa Ligue chez un éditeur plus modeste, Top Shelf Productions.]. Son principe de base, simplissime, semble inépuisable : faire comme si toute la fiction populaire de la fin du XIXe et du début du XXe siècle décrivait un seul monde. Moore y creuse ses obsessions sur la science et la magie, mais sans les cantonner à des mondes immatériels, puisqu’il s’agit de faire une histoire et une géographie physiques de l’univers de la fiction victorienne.
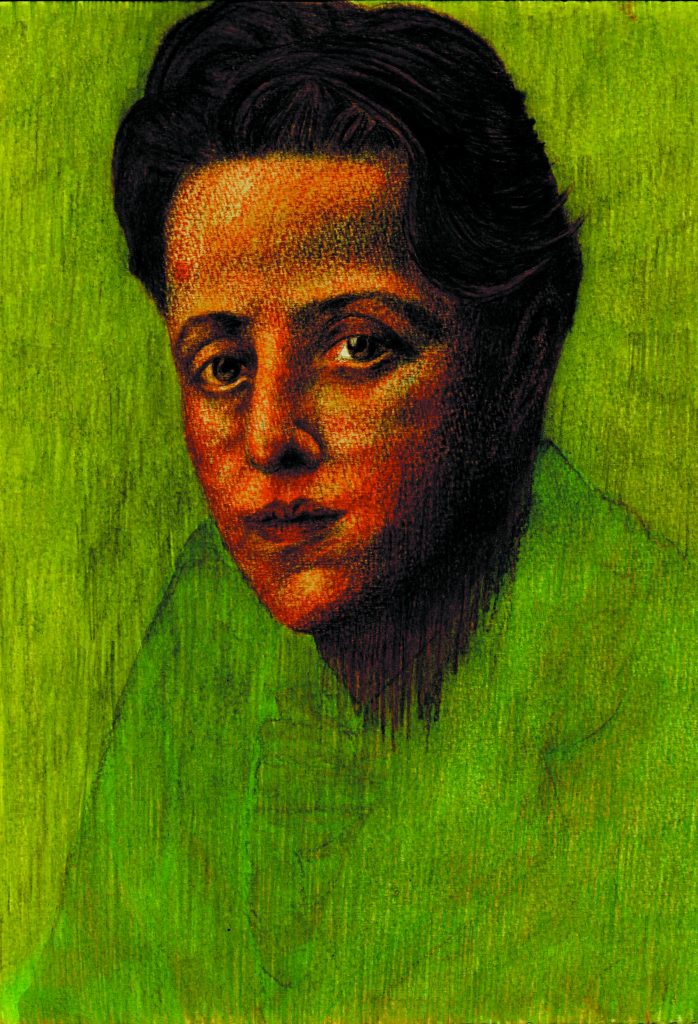
1898
À l’aube du XXe siècle, le mystérieux « M », chef du renseignement militaire de l’Empire britannique, s’inquiète des avancées scientifiques et de l’apparition d’aventuriers impitoyables, savants fous et autres brigands scientifiques. Les Services secrets de Sa Majesté décident de créer une équipe d’individus extraordinaires qui lutterait clandestinement pour la Couronne contre ces dangers d’un nouveau genre. L’agent secret Campion Bond confie la délicate mission de recruter et de diriger cette équipe à Wilhelmina Harker, née Murray, pour avoir survécu à sa rencontre avec un comte transylvanien d’une espèce dont on avait toujours réfuté l’existence, et prouvé sa force de caractère par son divorce.
Punk à vapeur
Le monde de la Ligue[9. Par commodité et haine des acronymes (LGE), je parlerai de La Ligue pour désigner tantôt la série de Moore et O’Neil, tantôt l’équipe dirigée par Mina Murray. Rien à voir avec la Ligue communiste révolutionnaire, donc.] ressemble au nôtre, à ceci près que la révolution industrielle et le progrès technologique y sont exacerbés. Une multitude d’inventions se font la guerre. Ainsi va la conquête du ciel, où s’affrontent engins volants « plus lourds que l’air » et aérostats « plus légers que l’air ». Un pont sur la Manche est en chantier à Douvres, et Londres foisonne d’inventions pittoresques qui alimentent en vapeur le fameux smog victorien.
Certains parlent de steampunk, en référence au cyberpunk, pour qualifier une telle uchronie inspirée de la révolution industrielle anglaise. Ou encore de « rétro-futurisme », puisque sont mises en scène des visions du futur élaborées dans le passé, des « futurs antérieurs », avec un goût prononcé pour le laiton, les boiseries, les architectures de verre et de métal, et l’Art nouveau. Mais ce qui caractérise le steampunk, c’est surtout la prédominance dans le développement technologique de la machine à vapeur sur le moteur à essence et l’électricité, qui induit une tendance au gigantisme des machines plutôt qu’à leur miniaturisation via l’électronique.
Cette esthétique a contaminé tous les pays et tous les domaines : cinéma, séries télés, bande dessinée, manga, jeux vidéo, musique, design, architecture[10. Quelques exemples, sans distinguer les précurseurs et les rejetons : Brazil de Terry Gilliam, La cité des enfants perdus de Caro et Jeunet, Sherlock Holmes de Guy Ritchie, Steamboy de Katsuhiro Otomo, Laputa, le château dans le ciel de Hayao Miyazaki, la mini-série TV anglaise The Secret Adventures of Jules Verne, Les cités obscures de Schuiten et Peeters, Adèle Blanc-Sec de Jacques Tardi, Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa, Métropolis des époux Lofficier et Ted McKeever. De nombreux westerns contemporains sont aussi contaminés par les caractéristiques du steampunk, de la série TV Les mystères de l’Ouest, qui fait figure d’ancêtre du genre, à sa ridicule adaptation pour le cinéma, ou au tout récent Lone ranger.]… Il existe même des communautés de fans qui ne jurent que par le steampunk, avec leur code vestimentaire, leurs sites et forums internet, leurs magazines, leurs expositions d’objets autoconstruits… Ces fans de petits génies, savants fous et pirates technologiques revendiquent un rapport individuel au bricolage technologique qui renverrait à l’esprit DIY – Do it yourself – du mouvement punk. « Love the machine, hate the factory[11. « Aime la machine, déteste l’usine », c’est en tout cas la devise de Steampunk Magazine, revue anglaise semestrielle, en ligne et sur papier.] » définirait leur éthique. Une autre révolution industrielle était possible serait sans doute une devise plus juste pour cette littérature à vapeur, qui reconduit dans un futur antérieur l’idéologie libérale et le scientisme du XIXe siècle. En tout cas rien à voir avec le « No Future » punk de la fin des seventies…
Histoires à 1 penny
Érudit et surtout monstre de travail, Alan Moore pousse à son paroxysme l’utilisation du fonds victorien dans La ligue. La diversité des sources convoquées est impressionnante, et les grandes figures de la littérature britannique côtoient les personnages apparus dans d’obscurs penny dreadful, ces romans d’horreur à deux balles, ou plutôt un penny, destinés aux adolescents de la classe ouvrière. Il convoque largement toute la « littérature d’imagination scientifique » (H.G. Wells, Robert Stevenson, Jules Verne), mais sans limiter la science à la physique et à la chimie. Il pioche tout autant dans les aventures coloniales de Ridder Haggard, premiers récits géographiques anglais se déroulant en Afrique, ou chez les auteurs en train d’inventer la police scientifique et la criminologie, comme Conan Doyle. Les aventures de la Ligue sont aussi dès le départ habitées par les sciences occultes et les récits fantastiques d’Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft et Bram Stocker. C’est ainsi que Mina Murray, qui a survécu à une créature pour le moins surnaturelle, dirige une équipe composée de l’explorateur Allan Quatermain (ancêtre colonialiste d’Indiana Jones), du prince Dakkar (technopirate sikh anti-impérialiste plus connu sous le nom de capitaine Nemo), du docteur Henry Jekyll (qui libère de plus en plus souvent son côté obscur, Mister Hyde), et du libidineux mâle invisible Hawley Griffin. Ces protagonistes annoncent la venue des super-héros, héros de la science et autres créatures extraordinaires qui conquerront les imaginaires des siècles suivants.
Grim & gritty
Alan Moore s’est fait connaître comme expert en déconstruction des genres de la BD, et il le regrette aujourd’hui. Sa série des années 1980, The Watchmen, ainsi que Batman : The Darknight returns, de son alter ego réactionnaire Frank Miller, sont considérées comme les deux œuvres clés ayant le plus contribué à déconstruire le mythe du super-héros. Décrivant des surhommes manipulés, manipulateurs, ou complètement maboules, ces histoires ont, chacune à leur manière, inauguré l’ère grim and gritty, « dure et sombre », des comics. Un peu comme les films de Sam Peckinpah, Clint Eastwood, ou Sergio Leone sonnèrent le glas de l’âge classique du western. De la fin des années 1980 jusqu’à aujourd’hui, se sont imposées des versions noires et ultra-violentes du genre super-héroïque, prétendument plus réalistes et destinées à un lectorat adulte, avec des personnages désabusés, dépressifs ou psychotiques, à l’opposé des archétypes positifs qui avaient dominé jusqu’alors. Le mur de Berlin est tombé, et il n’y a plus à opposer à la menace révolutionnaire des héros symbolisant la justice de l’Occident. « There is no alternative », martèlent Thatcher, Reagan et Mitterrand, et il va falloir que tout le monde s’habitue à l’empire dur et sombre du capitalisme mondial.
Après des années sans publier d’histoire de super-héros, Alan Moore prend le contre-pied de cette mode grim & gritty qu’il a contribué à créer quand il reprend de fond en comble la série Supreme, en 1994, puis quand il écrit sa collection ABC. Décidé à ne plus nourrir le cynisme et la dépression des quarantenaires encore fans de comics, il développe un imaginaire poétique et « lumineux », destiné à muscler l’imagination des jeunes lecteurs. Que ce soit avec Supreme, clone de Superman en encore plus terne, ou Tom Strong, croisement de Tarzan, Doc Savage et Flash Gordon, Alan Moore cherche clairement à renouer avec la fraîcheur et la créativité débridée des comics des années 1930 à 60. Ces personnages sont des archétypes idéaux, qui lui permettent de parcourir toute l’histoire du siècle à travers celle des super-héros. Ses dessinateurs empruntent le style des différents « âges » du comics, rendant des hommages souvent appuyés aux grands auteurs du passé[12. Tel le dernier épisode publié de Supreme scénarisé par Moore, où celui-ci traverse le « monde des idées » du créateur ici littéralement démiurge Jack « The King » Kirby.]. Et avec ses histoires de paradoxes temporels, de civilisations extra-terrestres et d’univers alternatifs, Alan Moore retrouve pour le coup l’inventivité des scénarios de science-fiction de ses débuts, quand il écrivait pour l’hebdomadaire britannique 2000 AD au début des années 1980.
Solve & coagula
Pour parler de ses scénarios, Alan Moore aime convoquer l’alchimie et ses deux principes fondamentaux : solve – dissoudre, démonter, déconstruire –, et coagula – réassembler, reconstruire, synthétiser. Avec les Watchmen, il a complètement déconstruit le mythe du super-héros, pour voir comment il fonctionnait, avant de le laisser agoniser dans un coin, comme un enfant avec un vieux jouet. Avec Supreme et ses séries ABC, Moore est passé à l’étape suivante : coagula, la synthèse, pour revitaliser l’imaginaire super-héroïque.Son travail autour de la Ligue s’inscrit dans ce geste. Avec son acolyte dessinateur, ils créent des ponts entre une multitude d’univers fictionnels de prime abord incompatibles, et leur enthousiasme et leur inventivité sont contagieux. L’introduction martienne du volume deux, quasi muette (ou plutôt en dialectes martiens) où le John Carter d’Edgar Rice Burroughs, le Gulivar Jones d’Edwin Arnold, et les Sorn de Clive Lewis se rassemblent pour assaillir les Tripodes d’H.G. Wells, venus sur Mars préparer l’invasion de la Terre, en est un magnifique exemple[13. Ce prologue fait la synthèse de diverses planètes Mars de fiction, à partir de quatre romans : Une princesse de Mars (1912) d’Edgar Rice Burroughs (le créateur de John Carter et Tarzan), Lieutenant Gullivar Jones (1905) d’Edwin Lester Linden Arnold, Au-delà de la planète silencieuse (1938) de Clive Staples Lewis (ami de Tolkien et auteur du cycle Le Monde de Narnia), et La guerre des mondes (1898) d’Herbert George Wells, une source majeure de la Ligue, puisqu’y sont développées deux autres histoires de Wells : L’île du docteur Moreau (1896) et L’homme invisible (1897). Dans le monde de La ligue, cependant, les mollusques qui envahissent la Terre ne sont pas originaires de Mars : ils y font seulement escale, le roman de Wells étant trop incompatible avec les versions de ses confrères.]. Alan Moore ne se contente pas de déconstruire cette littérature d’imagination et de mobiliser la connivence culturelle du lecteur : il invente de nouveaux récits et de nouvelles images à partir de celles du siècle passé. À force de multiplier les hommages, il réussit à incarner tout un panthéon de figures mythiques et à créer une cartographie de l’imaginaire de l’époque. Les deux premières aventures de la Ligue, qui se déroulent durant l’été 1898, croquent le monde rêvé par la littérature victorienne et mettent à jour une mythologie qui a sans doute nourri le XXe siècle tout autant que celles du Christ ou de l’Économie. Mythologie pour le moins équivoque, porteuse d’affects dont l’Europe semble loin d’être débarrassée : individualisme exacerbé, désir de contrôle et de technologie toute puissante, peur de tout ce qui est étranger ou déviant – les femmes, les homosexuels, les Chinois…
Losers extraordinaires
Sous prétexte de coloniser la Lune, les services secrets britanniques employant la Ligue encouragent la fabrication de la cavorite[14. La cavorite est un métal anti-gravité inventé par le professeur Selwyn Cavor, personnage du roman Les premiers hommes dans la lune, de H.G. Wells.], un alliage antigravité, et construisent en secret des chars d’assaut volants. L’État victorien cache le docteur Moreau dans une forêt isolée, et le laisse créer toutes sortes d’animaux hybrides (l’ours Ruppert, le baron Tétard, Tiger Tim et leurs amis), mais surtout des armes biologiques, comme cet hybride de streptocoque et d’Anthrax que l’armée n’hésitera pas à lancer sur le sud de Londres lors de l’invasion de mollusques venus de l’espace.
Quant aux membres de la Ligue, que jamais personne n’appelle « gentlemen », ce sont des marginaux, des exclus, des loosers. Henry Jeckyll est un savant guindé qui, voulant séparer chimiquement son « bon » et son « mauvais » côté, a créé Edward Hyde qui sème la mort dans le quartier de Whitechappel à Londres, puis rue Morgue à Paris. Le capitaine Nemo est un petit génie de la science détestant les Anglais, d’inclinaison essentiellement militaire : son Nautilus et ses lance-harpons à répétitions sont dévastateurs. L’homme invisible est un chimiste pervers qui utilise sa formule pour sévir dans une maison de correction pour jeunes filles du monde. Le célèbre Allan Quatermain, « fils préféré de l’Empire », est opiomane et se sent déjà d’un autre siècle. Tous sont pleins de préjugés misogynes, racistes, colonialistes, bellicistes, xénophobes. Seule la frêle Mina Murray ne se départit jamais de son flegme et de son foulard tutélaire même dans l’adversité la plus extraordinaire, et fait tenir ensemble cette ménagerie et ses aventures. À force de faiblesses, cette engeance de monstres finit par se rendre attachante. Alan Moore parvient ainsi à mettre en scène la société victorienne dans ce qu’elle portait de plus monstrueux, tout en rendant hommage aux femmes et aux gentlemen d’exception qui ouvrirent le XXe siècle.
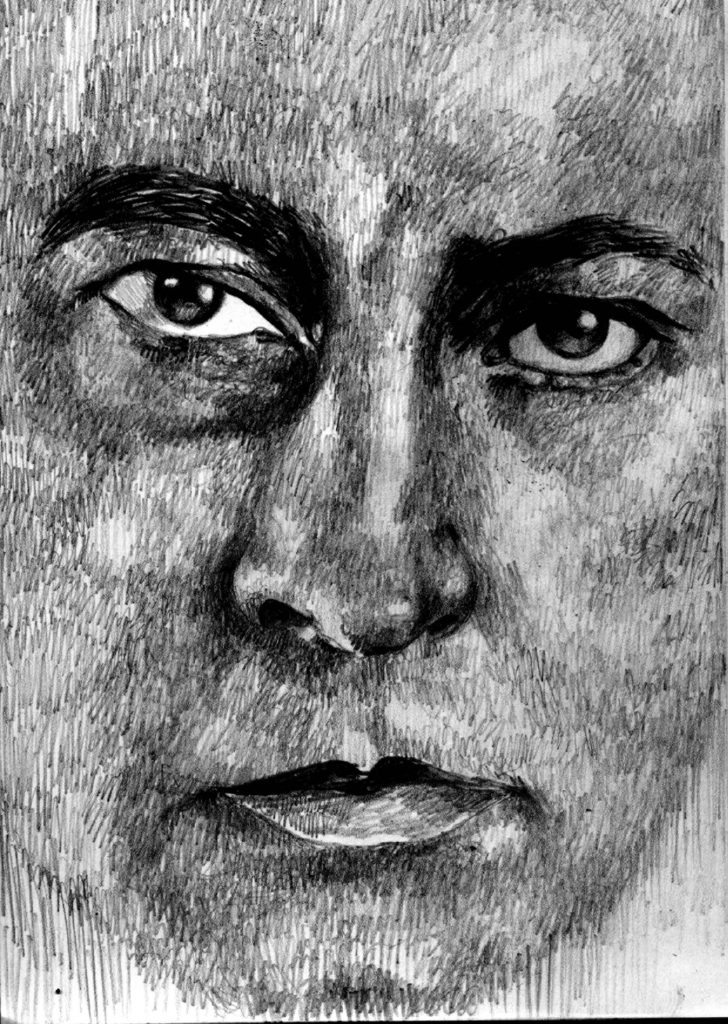
1910
La reine Victoria, le roi Edward VII, Mister Edward Hyde et Hawley Griffin sont morts. Le capitaine Nemo agonise à Lincoln Island et Allan Quatermain est censé avoir péri lors d’une dernière expédition africaine en compagnie de Mina. Bref, cette dernière est officiellement la seule rescapée de la Ligue de 1898, même si son nouveau compagnon, Allan Quatermain Junior, n’est pas vraiment le fils miraculeusement retrouvé juste après la mort de son père. Le couple est rejoint par Orlando, « l’éternelle ambiguïté », Thomas Carnacki, chasseur de fantômes, et Arthur J. Raffles, gentleman cambrioleur qui précéda de quelques années son concurrent français Arsène Lupin.
Sympathy for the devil
Les deux premiers volumes de la Ligue se déroulaient en 1898. La trilogie qui lui fait suite, Century, parcourt l’histoire de l’Angleterre en trois dates clés, qui donnent chacune son nom à un album : 1910, 1969, et 2009.Après la mort de la plupart des membres du « premier groupe Murray », la géographie et l’histoire de ce monde se complexifient. Ou plutôt après que Mina et Quatermain deviennent immortels pour s’être baignés dans la « Marre de vie » en Afrique, et découvrent l’existence d’autres immortels : le sorcier Prospero, Gloriana, reine d’Angleterre et des fées, et surtout leur futur équipier et amant Orlando, qui ne cesse de changer de sexe au cours des siècles. Sont alors intégrés au monde de la Ligue d’autres récits que ceux de la période victorienne, aussi bien mythologiques que cinématographiques ou télévisuels. Certaines figures historiques sont fusionnées aux personnages de fiction qu’ils ont inspirés : Adolf Hitler s’appelle ici Adenoïd Hinkel, le Dictateur joué par Charlie Chaplin, Élisabeth 1ère a pour nom de sacre Gloriana, la reine des fées éternellement jeune du poème d’Edmund Spenser et de l’opéra de Benjamin Britten, et l’occultiste Aleister Crowley devient Oliver Haddo, son avatar dans un film de 1926 : The magician, de Rex Ingram. Identifier certains personnages de fiction peut s’avérer d’autant plus difficile que leur « vrai » nom (c’est-à-dire leur nom dans la fiction) est déformé lorsque le copyright de leurs créateurs n’a pas encore expiré. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle la période victorienne (libre de droits) fut le point de départ de la série.
Toute l’intrigue de la trilogie Century tourne autour d’un complot magique. La première page de 1910 expose le rêve prémonitoire du médium et détective Thomas Carnacki : Oliver Haddo et quatre disciples encapuchonnés préparent l’invocation d’un « enfant de Lune », annonciateur d’« un nouvel âge étrange et terrible ». Durant cette aventure, le « deuxième groupe Murray » enquête sur cette conspiration, sans le moindre succès. Certes, ils retrouvent le mage noir Haddo, mais c’est pour lui donner l’idée du projet d’antéchrist, qu’il n’avait jamais envisagé. Dans 1969, le trio rescapé de la Ligue reprend la même mission, après l’échec de la conception d’un nouvel antéchrist aux États-Unis, bébé d’une certaine Rosemary. L’album 2009 marque la fin de ce cycle de réincarnations en série et l’avènement de l’antéchrist, dans une apocalypse de couleurs à la craie délavée qui n’a plus rien à voir avec le trip pop de 1969.
Alan Moore use souvent du complot comme trame narrative, ne serait-ce que dans son autre grande œuvre sur l’époque victorienne, From Hell, qui digresse largement à partir de la théorie du complot royalo-maçonnique de Stephen Knight[15. Jack the Ripper: The Final Solution, de Stephen Knight.]. Mais la conspiration est toujours une excuse pour aborder de biais une plus grande histoire.Century a pour point de départ la figure mythique, mais réelle, d’Aleister Crowley, et traverse les représentations culturelles de la magie à travers le siècle : l’occultisme quasi scientifique du début du siècle, l’ésotérisme hippie des années 1960, le manichéisme primaire qui préside l’enseignement de la magie dans une fameuse école de sorciers au début du XXIe siècle.
Écrivain, joueur d’échecs, alpiniste, poète, peintre, astrologue, aimant se faire appeler « la Bête », l’Aleister Crowley qui inspire le personnage d’Haddo fut au centre de nombreux scandales et procès tout au long de la première moitié du XXe siècle, accusé de magie noire tout autant que de perversion sexuelle ou d’espionnage. Même s’il en fait le « méchant » de sa trilogie, Alan Moore retient essentiellement de ce provocateur ses pratiques liant la magie à une sexualité débridée. On retrouve ce lien entre expérimentations sexuelles et mondes magiques dans nombre de ses comics, à commencer par le controversé Lost Girls, aventures pornographiques de Wendy de Peter pan, de Dorothy du Magicien d’Oz et d’Alice d’Au pays des merveilles
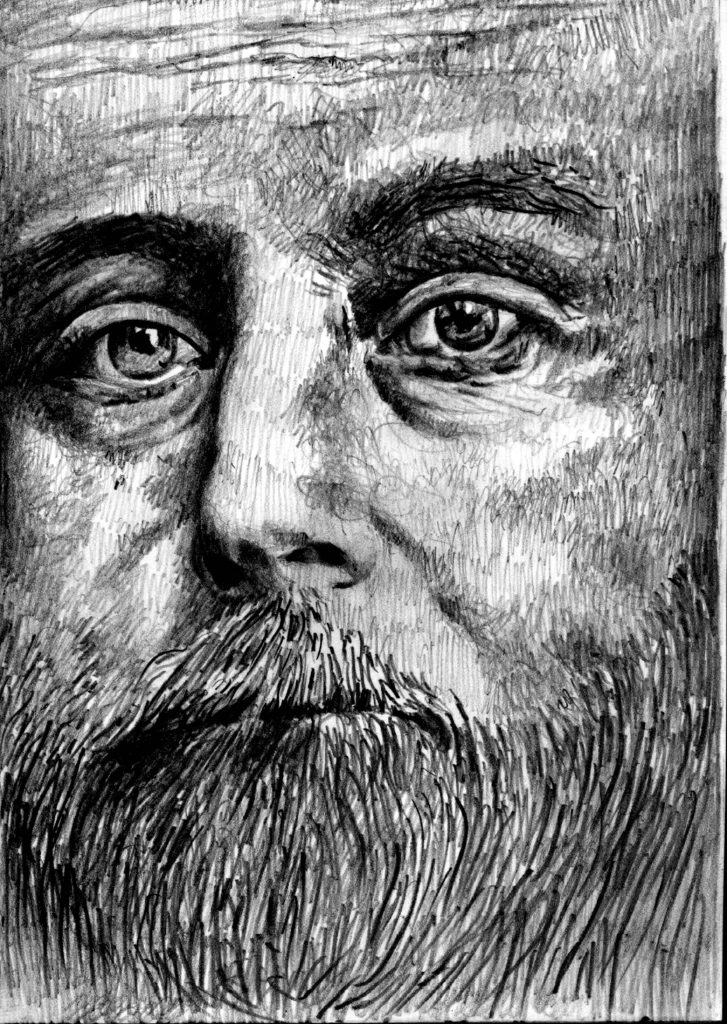
1969
Mina, Quatermain et Orlando sont de retour à Londres, qu’ils avaient quitté juste après la Seconde Guerre mondiale. La ville a retrouvé de la couleur : Swinging London expérimente la musique pop, les drogues, l’ésotérisme et la libération sexuelle. Les anciens membres de la Ligue sont à nouveau à la recherche de l’esprit du mage noir Oliver Haddo qui cherche à engendrer un antéchrist.
Opéra-rock de quat’ sous
Évoquant les relances des feuilletons radiophoniques, un petit commentaire très victorien soulignait chaque fin de chapitre des aventures de 1898 : « Quelles horreurs se préparent ? Est-ce bien ici Albion, l’île qui a maté le Français insolent, l’Espagnol libidineux, l’Allemand arrogant ? Est-ce bien notre Angleterre, assiégée par ces étrangers, venus du grand vide par-delà le cosmos connu ? Vous n’allez pas en rester là, lecteurs ! La suite vous attend dans le chapitre II. »
L’album 1910 abandonne cette forme de roman-feuilleton pour ponctuer l’action par des extraits réécrits de L’Opéra de quat’sous de Berthold Brecht et Kurt Weil, seuls auteurs crédités de toute la série. Comme les acteurs de L’Opéra prenant à partie le spectateur pour casser l’identification aux acteurs, les personnages regardent le lecteur en chantant la Complainte de Jenny-des-corsaires et le Deuxième finale des quat’sous ; la Jenny-des-Lupanars de Brecht étant ici Janni Dakkar, fille du capitaine Nemo.Dans 1969, c’est un événement « historique » qui guide la narration : le concert gratuit des Rolling Stones à Hyde Park le 5 juillet 1969, devant 500 000 personnes, en hommage à Brian Jones retrouvé mort dans sa piscine deux jours plus tôt. Sauf qu’ici, Brian Jones s’appelle Basil Thomas, personnage d’une série de romans illustrés[16. Basil Fotherington-Thomas est un personnage d’une série de romans britanniques de Geoffrey Willans illustrés par le génial Ronald Searle, mettant en scène les aventures à la première personne de l’écolier Nigel Molesworth.], et Mike Jagger & The Rolling Stones deviennent Terner & The Purple Orchestra, d’après un film de 1970, Performance, où Jagger joue la star de rock Purple Turner. L’histoire commence par l’assassinat cérémonial de Basil Thomas dans sa piscine et se dénoue au concert de Hyde Park (appelé ainsi en hommage au sacrifice d’Edward Hyde lors de l’invasion des mollusques). La chanson Sympathy for the devil devient une prière à Satan, et le poème de Percy Shelley lu par Mike Jagger en hommage à Brian Jones un rituel de réincarnation. Ce concert rituel offre l’occasion d’une longue séquence mettant en scène le bad trip de Mina Murray, affrontant sur le plan astral l’esprit d’Haddo qui cherche à se réincarner. Le talent du dessinateur Kevin O’Neill explose alors en un style pop halluciné, proche de Yellow Submarine des Beatles et des Zap comics de Robert Crumb.

2009
Redevenant femme, le soldat Orlando revient à Londres après avoir craqué et tiré sur tout ce qui bouge lors de l’opération Simbad au Qmar. Mina est internée au « Centre Coote pour le bien-être psychiatrique ». Quatermain est devenu clochard et ne veut plus entendre parler de la Ligue ni d’aventures. Mais l’antéchrist est né, et Prospero exige qu’Orlando retrouve ses confédérés et l’enfant-Lune.
Harry Potter versus Mary Poppins
La dernière partie de Century est l’occasion pour Moore de faire le point sur le siècle naissant – et le constat est clairement dur et sombre, grim & gritty. Loin du Swinging London de 1969 et son ésotérisme hippie flashy, le Londres de 2009 apparaît d’emblée glauque et délabré. Des flics en armures tabassent les gens dans les rues et la TV ressasse en boucle ses reportages sur le terroriste nucléaire Jack Nemo. Différence remarquable avec le Londres « réel » d’aujourd’hui : malgré l’omniprésence d’écrans TV et autres pubs ou injonctions lumineuses dans la rue, on n’aperçoit jamais un ordinateur. L’informatique et Internet ne semblent ici pas indispensables au régime sécuritaire[17. Alan Moore pioche dans un spectre très large de la littérature fantastique, y compris contemporaine,avec des personnages fantastiques créés par des amis à lui comme Jeremiah Cornélius de Mickael Moorcock ou Andrew Norton, le prisonnier de Londres, de Ian Sainclair. Il écarte en revanche tout un pan de la science-fiction, à savoir le cyberpunk. Sans doute la référence originelle à la littérature victorienne l’oblige à suivre le principe de base du steampunk, à savoir que la révolution industrielle n’aboutit pas à l’électronique et la miniaturisation qui permettront d’inonder le monde en ordinateurs et autres smartphones.].
Si les références à Harry Potter sont on ne peut plus évidentes, il est clair qu’Alan Moore ne porte pas un grand intérêt aux romans à suivre de J.K. Rowling. Il ne s’y réfère que pour mettre en abîme la pauvreté de la littérature fantastique et enfantine, et donc la pauvreté du siècle lui-même. Et pour faire la leçon à un antéchrist égocentrique et pleurnichard, il convoque même « Celui qui est dans toutes les pages de la Bible », sous la forme d’une héroïne de la littérature enfantine du siècle dernier. Une manière, un peu facile cette fois, de rendre hommage au passé et de condamner le présent.Selon la dernière incarnation de « la Bête », qui n’est plus qu’une tête qui parle dans une cage à oiseau, « le nouvel âge étrange et terrible est inéluctable ». Le troisième millénaire sera grim & gritty. Un catastrophisme pas forcément messianique, mais qui n’a d’autre issue que l’Apocalypse, et qu’on retrouve dans de nombreuses œuvres de Moore, des Watchmen à Promethea. « Si vos histoires reçoivent des critiques favorables pour leur tonalité sombre, qui fait réfléchir, alors il est grand temps de commencer à vous demander si vous ne devriez pas faire quelque chose de plus léger et d’idiot », écrivait-il pourtant il n’y a pas si longtemps[18. Extrait de la postface à la réédition en 2008 d’Alan Moore’s Writing for comics, d’Alan Moore.].
Lost Girls
L’anarchiste barbu défend clairement des valeurs libertaires, voire féministes. Ses personnages féminins ont toujours tranché dans la production testostéronée de comics. Dans les années 1980, Halo Jones était déjà la première héroïne de comics à ne pas faire du 95D, et la famille Strong constitua la première superfamille métisse. L’évolution au cours du siècle de la chef de la Ligue, Mina, pimentée par sa jeune immortalité, guide toute la série, qui suit ses relations avec les extraordinaires gentlemen, notamment son histoire d’amour avec le vieux Quatermain, dont elle lisait avec admiration les aventures étant enfant. Et c’est sur le couple à trois qu’elle finira par former avec Quatermain rajeuni et le queer Orlando que se fonde la trilogie Century. Le rapprochement d’Orlando en pleine transformation transsexuelle, et de Quatermain, vivant symbole de la virilité impériale de l’ère victorienne, est savoureux. La plupart des récentes œuvres de Moore se caractérisent d’ailleurs par un certain optimisme amoureux, une croyance dans la longévité et la force du couple – qu’il soit hétéronormé comme la famille Strong, homosexuel comme dans Top Ten, ou queer comme dans la Ligue.
Anarchy (in the UK)
En pleine contre-révolution culturelle réactionnaire[19. Mouvements contre les homosexuels et les juifs en France, projet d’interdiction de l’avortement en Espagne, ostracisme des Roms dans toute l’Europe, repli paranoïaque aux États-Unis…] et dans un champ aussi viriliste que l’industrie du comics, défendre la liberté et l’inventivité dans les relations amoureuses n’est pas rien. Mais s’il a toujours insisté sur la nécessité d’une révolution culturelle des mœurs, Moore porte dans ses histoires un anarchisme pour le moins antipolitique. Certes il prenait encore récemment parti pour les manifestants d’Occupy Wall Street, contre son collègue réac Frank Miller[20. Sur son blog, Frank Miller qualifie le mouvement Occupy Wall Street de « tentative de retour à l’anarchie de la part d’une bande de gars équipés d’iPhone, d’enfants gâtés à l’iPad et qui feraient mieux de se trouver un emploi. (…) Rien qu’une bande de branleurs, de voleurs et de violeurs. Une foule indisciplinée biberonnée à la nostalgie de Woodstock et à une conception putride de ce qui est juste. » Alan Moore lui répond directement dans une interview accordée à Honest Publishing : « C’est tout ce qu’on peut attendre d’un type comme Miller qui considère que l’Amérique est en guerre contre un ennemi sans foi ni loi, Al Qaida ou l’islam. Pour dire la vérité, Frank Miller est quelqu’un dont j’ai à peine regardé le travail au cours des vingt dernières années. J’ai toujours pensé que Sin city est un monument de misogynie, et 300 une saga barbare, pas historique pour deux sous, homophobe, et complètement à côté de la plaque. Il y a une forme de rationalité froide et désagréable qui ne me plaît pas dans l’œuvre de Miller depuis pas mal d’années. »]. Et le masque du héros de V pour Vendetta est devenu le symbole international de la gauche anticapitaliste[21. Le Masque de V dans le comics de Moore et David Lloyd est inspiré du visage de Guy Fawkes, martyre de la « conspiration des poudres », c’est-à-dire la tentative d’incendier le parlement britannique et le roi Jacques Ier d’Angleterre. Guy Fawkes n’avait rien d’un anarchiste : il s’agissait de provoquer une insurrection contre le roi protestant afin de créer un État catholique.], même s’il y a malentendu : sa bande dessinée était une réflexion plutôt complexe sur le fascisme et l’anarchie, alors que le film manichéen qui l’a popularisée, scénarisé par les auteurs de Matrix, n’est qu’un spectacle pyrotechnique faisant l’hagiographie d’un super anarchiste individualiste masqué.
La traversée du siècle à travers sa culture populaire proposée dans la Ligue, comporte un grand absent : le mouvement révolutionnaire ouvrier[22. Seule référence à l’histoire du communisme dans le monde de la Ligue : un journal télé évoque dans 1969 un président américain communiste après-guerre, Mike Thingmaker, inspiré d’une trilogie d’anticipation, Mess-Mend publiée entre 1923 et 1925 en URSS, et écrite par Marietta Shaginian sous le pseudonyme de Jim Dollar. Staline força celle-ci à abandonner l’anticipation, ce genre bourgeois. Lui succède à la présidence américaine la rockstar Max Foester, véritable « fasciste hippie » qui envoie en camp de rééducation tous les coincés de moins de 35 ans, inspiré du film de Barry Shear de 1968 : Wild in the street.]. Des auteurs aussi orientés que Berthold Brecht sont convoqués[23. Après 1910 où ils guidaient toute la narration, les chants remaniés de l’Opéra de quat’sous reviennent sur un air des Sex pistols dans l’épilogue de 1969 (« huit ans plus tard », en 1977 donc), et en fond télévisuel dans 2009.], mais c’est pour chanter le triomphe de la barbarie capitaliste et de la guerre de tous contre tous. La Ligue porte le rêve progressiste de la littérature victorienne, mais totalement épuré du contrepoint qui l’accompagnait sans s’y identifier : le rêve communiste de progrès social, ce spectre qui hanta l’Europe au moins jusqu’aux années 1970. Comme le rappelle le capitaine Nemo lors de son recrutement : « Les livres d’Histoire sont écrits par les vainqueurs, Mlle Murray. »
Alan Moore vit encore aujourd’hui dans la cité industrielle où il a grandi, Northampton, l’une des villes les plus pauvres d’Angleterre. De 2009 à 2011, il y a même publié un fanzine très localiste, Dodgem Logic, mêlant informations sur la ville, comics, et même musique, et dont il utilisa les ventes pour soutenir la communauté locale : distribution de repas et de vêtements, financement d’une crèche dont la municipalité avait coupé les subventions, sponsor de l’équipe de basket des Northampton Kings. Une fidélité qui rend d’autant plus étrange cet effacement de l’histoire du mouvement révolutionnaire dans la fresque historique que constitue la Ligue.
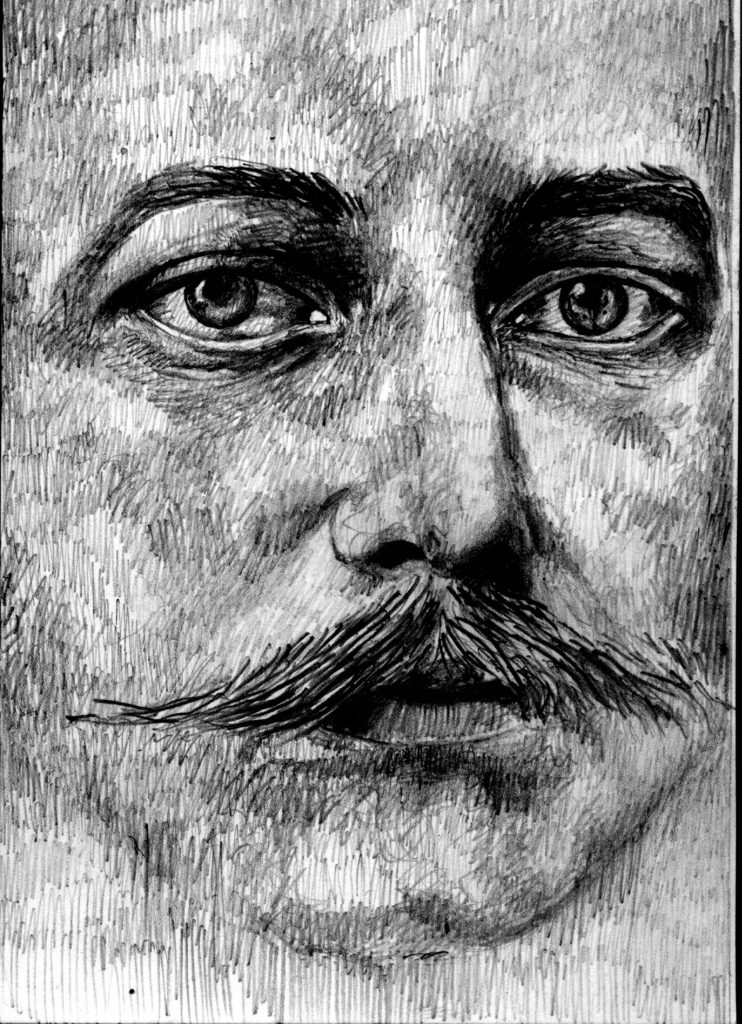
1260 av. J.-C
Bio naît à Thèbes. À l’adolescence, la jeune fille hérite de la malédiction de son père, le devin aveugle Tirésias : changer régulièrement de sexe. Elle devient immortelle en se baignant dans la même « Marre de vie » que Quatermain et Mina des siècles plus tard, et portera dès lors de nombreux noms : Vita, Vito, Bion, Bio, Roland. Combattant émérite, de la guerre de Troie aux conquêtes d’Alexandre et aux croisades, elle porte Excalibur depuis les guerres Arthuriennes. Quand les sarrasins le rebaptisent Orlando, ille décide de ne plus changer de nom, en hommage à l’amour d’une vie rencontré alors : Simbad le marin. C’est elle qui pose pour la Joconde de Léonard de Vinci, un jour où elle commence à redevenir homme. D’où son sourire.
Le ministère de l’Amour
Depuis « L’almanach du Globe-Trotter », longue annexe du volume deux de la Ligue, Moore a commencé une description précise de la géographie et des lieux où résident des créatures magiques sur l’ensemble de la planète, dont le plus exemplaire serait le « Monde radieux » au pôle Nord[24. Ce Monde radieux a été évoqué pour la première fois dans une satire utopique de 1666, souvent considérée comme la toute première œuvre de science-fiction :
The Description of a New World, Called the Blazing-World, de l’aristocrate et scientifique anglaise Margaret Cavendish.]. Ainsi, dès les premières pages de 1969 comprend-on que Mina et ses hommes ne travaillent plus pour les services secrets anglais depuis le coup d’État de Big Brother en 1948, mais servent désormais le Monde Radieux, sous l’autorité du sorcier Prospero. Celui-ci est le fondateur de la première Ligue au XVIIe siècle, il s’est installé dans le Monde flamboyant en 1616, et est toujours vif en 2009, quand il apparaît à Orlando avec ses lunettes 3D et ses familiers Ariel et Caliban. Il faudra lire entre les lignes des différentes aventures de la Ligue et leurs nombreuses annexes pour en savoir davantage sur ce mystérieux Monde Radieux.La publication française, fin 2013, du Dossier noir[25. DC a longtemps ralenti la publication du Dossier noir, écrit juste après le volume deux, et dernier album de la Ligue qu’Alan Moore lui devait par contrat. DC refusa cependant toujours de fournir avec le livre un 45 tours vinyle d’une chanson d’un groupe pop imaginaire, écrite et interprétée par Moore.] complète ce travail de cartographie et d’histoire des mondes extraordinaires. Or ce livre ressemble bien peu à ce que l’on appelle habituellement « bande dessinée. » Certes, Moore et O’Neil racontent et dessinent une histoire sous forme de comics : en 1956, Quatermain et une Mina teinte en blonde volent aux Services secrets anglais le Dossier noir, qui contient des informations sur les différentes Ligues. Poursuivis par des agents secrets, ils cherchent à rallier le Monde radieux, et chacune de leurs haltes est l’occasion de plonger dans la lecture des archives. L’Angleterre ici mise en images et en bulles est clairement inspirée de la célèbre dystopie de Georges Orwell 1984, qui devait initialement s’appeler 1948. Le MI5 est donc devenu « Miniam » ou « ministère de l’Amour », certains documents du Dossier noir sont en novlangue, des mots d’ordre comme « La liberté c’est l’esclavage » ornent encore les murs. En outre, la plupart des documents du Dossier sont annotés par un certain « GOB », qui se révélera être Gerry O’Brian, personnage du roman d’Orwell, qui devient ici le successeur de Big Brother à la tête du parti et du pays à sa mort en 1953[26. Big Brother, O’Brian et le nouveau « M », viennent en outre de la même école privée : Greyfriars school, en référence aux aventures de Billy Bunter et des autres élèves de cette école, histoires écrites par Charles Hamilton et publiées de 1908 à 1939 dans l’hebdomadaire pour garçons The Magnet, vendu à 250 000 exemplaires, y compris en Australie et en Nouvelle-Zélande. En 1939, la série fut l’objet d’une critique acerbe de George Orwell, qui attaqua le romantisme de cette description des établissements privés réservés à la haute société, où « tout est sûr, solide, sans remise en cause possible ». Cette série est en tout cas typique des Schools stories, ce sous-genre de la littérature anglaise pour enfant, dont Harry Potter est un descendant direct. On imagine aisément le plaisir d’Alan Moore à boucler ainsi ses boucles pour en renouer d’autres au fur et à mesure de ses recherches.].
The Blazing World
Ce fil rouge est surtout prétexte à offrir aux lecteurs nombre d’expérimentations narratives plus audacieuses les unes que les autres : rapports secrets sur les missions des différentes Ligues, y compris leurs homologues français ou allemands, traité ésotérique, roman érotique, nouvelle beatnik sans ponctuation, pièce de théâtre inédite de Shakespeare, autobiographie illustrée d’Orlando, cartes postales, brochures touristiques, plan du Monde Glorieux… Qui d’autres que Moore oserait écrire un faux prologue à La Tempête de Shakespeare en vieil anglais[27. Saluons l’édition française de Panini, que ce soit pour sa traduction (qui nous épargne le pastiche en vieux françois) ou la qualité de l’objet lui-même, avec ses types de papiers et formats qui diffèrent selon le document. D’autant que Panini se distingue d’habitude par son incompétence éditoriale.] ?
Or l’expérimentation, loin de se limiter à la jouissance esthétique de la parodie, est entièrement au service de la narration. Relectures et allers-retours entre les pages permettent de tisser une chronologie et une géographie précises de ce monde : Cthulhu et les Grands Anciens ont toujours côtoyé l’Humanité, et la guerre de Troie a bien été orchestrée par des Dieux antiques voulant éliminer leur engeance hybride : les Héros (Orlando y participa aux côtés d’Énée) ; la Lune a été foulée à grands pas bien avant Cyrano de Bergerac, et l’Angleterre était peuplée de fées et de géants jusqu’à la mort de leurs biographes, Shakespeare et Cervantès en 1616.
La fin de l’album est l’occasion de découvrir enfin le Monde Radieux en bande dessinée, et non plus simplement évoqué dans des documents. Or si ce monde magique est bien physique, matériel, il n’obéit pas aux mêmes lois physiques que le nôtre. C’est un monde à quatre dimensions, où le temps est une dimension physique, et où tout arrive en même temps (ce qui peut entraîner de sévères troubles digestifs). Il se situe au pôle Nord, mais s’étend en même temps au pôle Sud, sous le nom de Mégapatagonie, où l’on parle à l’envers le Français. Géométrie non euclidienne ou magie, il faudra au lecteur de comics à deux dimensions comme au personnage visitant ce monde en 4D, un accessoire pour l’appréhender : des lunettes 3D.
Le conteur anglais utilise ainsi sa renommée pour imposer ses expérimentations à l’éditeur DC, le forçant à publier un objet qui a sans doute eu bien du mal rentrer dans la chaîne de production très standardisée de l’industrie du comics. Car, contrairement aux studios de cinéma qui s’en servent pour vendre toute une nouvelle technologie, la « 3D » n’est pas une valeur ajoutée pour la bande dessinée
Le Grand grimoire de la Lune et du Serpent
Moore a souvent déclaré publiquement sa volonté de ne plus écrire de comics mainstream[28. Dans une interview accordé à The Guardian en janvier 2014, il qualifiait par exemple de « catastrophe culturelle » le succès actuel des super-héros.]. Il est cependant toujours aussi prolifique et créatif pour l’industrie, et semble plus que jamais passionné par la magie, comme le montrent les nombreuses parutions françaises de l’année dernière. Après le Dossier noir et la fin de la série Century, la publication du premier épisode de la nouvelle trilogie du monde de la Ligue (mais sans la Ligue), Nemo, centrée sur la fille du capitaine, Janni Dakkar, tout en intégrant cette fois la littérature populaire américaine[29. Ainsi Janni Dakkar est-elle poursuivie en Antarctique par trois aventuriers américains à la solde du magnat de la presse Charles Foster Kane : Tom Swift Junior, personnage central de cinq séries américaines de science-fiction pour enfants (représentant un total de cent volumes, publiés de 1910 à 2007) ; ainsi que Jack Wright et Frank Reade Junior, deux personnages de dime novels (romans à dix cents de la fin du XIXe siècle, ancêtres des pulps), créés par Luis Senarens, le « Jules Verne américain ». Le personnage de Tom A. Swift, inspiré des figures d’Henry Ford, Thomas Edison et Glenn Curtis (pionnier de l’aviation) est armé d’un fusil électrique et qui a donné son nom au tristement célèbre TASER, qui signifie : Tom A. Swift Electric Riffle.], renoue avec l’aventurisme des voyages extraordinaires de Jules Verne et plonge plus profondément dans les mondes fantastiques d’Edgar Poe et Lovecraft. Neonomicon est lui aussi un superbe et paradoxal hommage à Lovecraft, où Moore représente la face cachée de ses écrits : une sexualité monstrueuse. Enfin, La coiffe de naissance est une très belle mise en image par Eddie Campbell d’un monologue d’Alan Moore, lu sur la scène du vieux tribunal de Newcastle-upon-Tyne après la mort de sa mère. Ayant découvert dans les affaires de celle-ci une « coiffe de naissance », fragment de la poche des eaux qui recouvre parfois la tête du nouveau-né, il la déchiffre comme une carte magique de l’humanité, et parcourt à rebours son histoire personnelle, mais aussi l’histoire collective de sa ville et de la classe populaire anglaise de la fin du siècle.
Son éditeur américain Top Shelf annonce surtout la sortie imminente du grand projet qu’il mène avec son complice Steve Moore depuis des années, The Moon and Serpent Bumper Book of Magic : « Un grimoire clair et pratique des sciences occultes qui permet à toute la famille de s’amuser avec la nécromancie. » Les deux Moore veulent traduire le sentiment d’émerveillement propre à la magie, souvent occulté justement par les occultistes contemporains : « Nous avons voulu nous débarrasser de l’atmosphère prétentieuse, ténébreuse et gothique dans laquelle les gens semblent désireux d’enfermer la magie. Nous pensons que la magie est quelque chose de profond, d’humain, de magnifique et parfois de très, très amusant, et nous voulons faire un livre qui reflète cela[30. Interview au magazine anglais The Edge]. » Ce livre devrait combiner fiction, théorie et pratique de la magie, avec « La Vie des Grands enchanteurs par le Vieux Moore », un temple portatif, un jeu de société inspiré de la Kabbale, et un Tarot inédit.
Bref, Moore continue de creuser une idée primordiale dans toute son œuvre : la nécessité de dépasser la rationalité pour penser et agir sur le monde : « Pour moi, la magie est une chose très politique, c’est la politique ultime. Vous ne vous demandez pas seulement comment l’État est gouverné, vous questionnez la réalité, les fondations sur lesquelles elle est bâtie[31. Interview au magazine américain Wired, février 2009.]. »
Illustrations : portraits libres de La ligue des gentlemen extraordinaires, par Anne-Claire Hello.
Dans l’ordre : Orlando, Arthur J. Raffles, Allan Quattermain, Mina Harker (née Murray), Thomas Carnacki.
by Bruno Thomé | 23 mars 2016 | Bout d’ficelle, Contrôle continu, Culture de base
Considéré comme le premier véritable super-héros, Superman apparaît en avril 1938, avec sa cape, ses bottes et son slip rouges, son « S » frappé sur un écu de poitrine jaune, et son justaucorps bleu, en couverture du mensuel Action Comics nº1 – édité par le futur DC comics. Face à un succès immédiat, le même éditeur publie un an après un autre personnage en cape et costume, mais sombre et masqué : The Bat-Man , qui fait la une du no 27 de Detective Comics. Si de nombreux autres super-héros apparaissent dans la foulée, Superman et Batman s’imposent comme les plus populaires et les plus emblématiques. Contrairement à la plupart de leurs congénères costumés, la publication mensuelle de leurs aventures ne connaîtra quasiment pas de pause. Ils ont créé et maintenu une véritable industrie, tout en alimentant régulièrement de nombreux autres médias de masse : feuilletons radiophoniques, cartoons, romans, serials, séries TV, jeux vidéos ou superproductions hollywoodiennes. Depuis plus de 75 ans, et alors que Batman V Superman : L’aube de la justice est sorti au cinéma ce mercredi 23 mars, c’est aussi deux visions de l’idéal américain de justice, des mesures antiterroristes ou des dispositifs de maintien de l’ordre qui se confrontent dans les sagas de ces super-héros.
Ce texte est issu du deuxième numéro de la version papier de Jef Klak, « Bout d’ficelle », paru en mai 2015 et encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF
« J’ai croisé beaucoup d’hommes. Certains étaient fringants, d’autres montaient un cheval blanc. Certains portaient même une couronne. Mais porter une cape sans avoir l’air stupide, voilà qui est intéressant. »
Lois Lane, Superman for all seasons
En septembre 2010, l’exposition « Habiter poétiquement (le monde) » marqua la réouverture du LaM de Villeneuve d’Ascq[2. LaM : « Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut », situé à Villeneuve-d’Ascq. Sa collection d’art brut est une donation du musée L’Aracine.]. Rapprochant des œuvres de ses collections d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, elle donnait à voir les impers que portait le plasticien Willem Van Genk pour se protéger des ondes nuisibles lorsqu’il arpentait la ville, et les robes, capes et tentures cousues et brodées dans les années 1940 par une femme anonyme de l’hôpital de Bonneval pour rejoindre son époux dans la mort.
Dans le catalogue de l’exposition, un article de Frédéric Logez[3. Frédéric Logez est écrivain et dessinateur. Il a publié en 2014 La Bataille-Arras 1917, aux éditions Degeorge, très bel album de bande dessinée sur l’offensive britannique contre les lignes allemandes en Artois, qui mobilisa tunneliers néo-zélandais, soldats australiens, terreneuviens, canadiens, anglais, gallois,…] intitulé « Seconde peau » décrit fait une anatomie comparée entre ces vêtements et les costumes collants des super-héros : « Première ou seconde peau, d’origine terrestre, extraterrestre ou divine, colorée ou non, de nature physique, technologique ou surnaturelle, le super-héros hors du commun enfile toujours un costume hors du commun. […] Pour [Superman et Batman], le processus est exactement inversé. L’un est lunaire, l’autre est solaire, mais tous deux usent d’un super-costume contre les forces du Mal. L’un, Batman, vient de la rue et utilisera l’ingénierie fine et la science pour confectionner son super-costume, sa seconde peau ; l’autre, Superman, vient de l’espace et son super-costume est sa force brute, sa seule et première peau. »
Habiter poétiquement la ville
Comme le cinéma, la bande dessinée naît avec la métropole moderne, et plus que tout autre genre, les comics de super-héros inventent un nouveau rapport à la ville. Ce n’est pas un hasard si la cité fictive où s’installe Superman s’appelle Métropolis, comme la ville à deux niveaux du film éponyme de Fritz Lang en 1927, vision pessimiste de l’avenir de l’homme. La Métropolis de Superman représente d’ailleurs uniquement la ville haute du film de Lang, baignée de lumière et occupée par une élite de privilégiés, alors que Gotham City[4. Gotham est un des surnoms de New York, attribué à Washington Irving, auteur américain du début du XIXe siècle. De mai 1939 à décembre 1940, Batman rend la justice dans les rues de New York. Il ne devient le protecteur de la ville fictive de Gotham City qu’en janvier 1941. Or Gotham City s’inspire tout autant de Chicago que de New York, et serait située sur la côte Nord-Est des États-Unis, dans le New Jersey, à 60 miles au nord de Métropolis.], territoire du Batman, évoque la ville basse où sont reléguées les masses laborieuses. Son architecture, ses lumières et sa météo brumeuse s’inspirent d’ailleurs de l’expressionnisme allemand, quand la ville de Superman rappelle plutôt les architectures futuristes. Deux faces de la cité moderne, environnement naturel des super-héros – lesquels créent des manières désirables de l’habiter : perché sous la lune en haut des plus hautes tours, ou survolant les gratte-ciel en plein soleil[5. L’éditeur de comics Marvel a utilisé à fond ces nouvelles manières d’habiter la ville dans les années 1960, en choisissant comme cadre des aventures de ses nouveaux personnages, non plus des cités imaginaires comme Métropolis ou Gotham, mais New York. Et nous sommes nombreux à connaître intimement la fameuse Grosse Pomme sans y être jamais allés, grâce aux acrobaties de Spiderman ou Daredevil.].
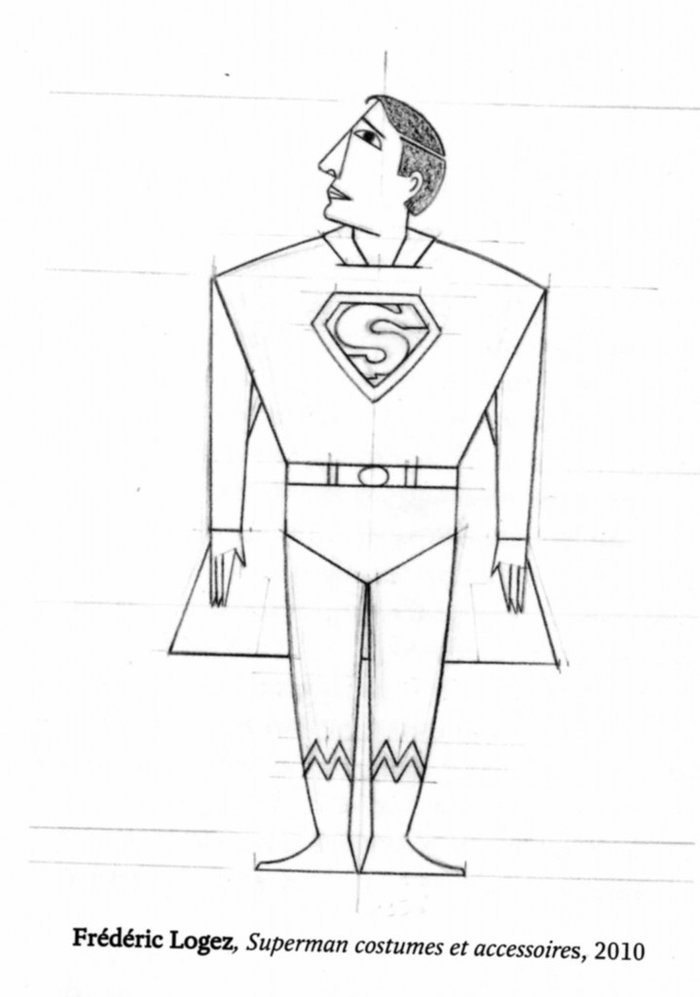
Slips & freaks
En 1933, Jerry Siegel et Joe Shuster, publiaient dans un fanzine une première version de Superman : un personnage malfaisant, ivre de pouvoir et de conquêtes, avec des pouvoirs télépathiques nés de l’expérience d’un savant fou. Cinq ans plus tard, les deux juifs new-yorkais assistent à l’arrivée de réfugiés fuyant la montée du nazisme en Europe. Face aux fantasmes de race pure et de surhommes virils aux chemises brunes et noires, Siegel et Shuster inventent un super-héros alien en costume moulant aux couleurs saturées.
Le justaucorps bleu, l’insigne et la ceinture jaune, les bottes, cape, et slip rouges de Superman s’inspirent aussi directement du costume de « L’Homme fort » des spectacles de foire. Encore une fois comme le cinéma, dont les images muettes des débuts sont commentées en direct par un bonimenteur, les comics entretiennent une filiation directe avec le cirque et les arts forains. Les super-héros jouent sur un mélange de fascination et de répulsion envers leur altérité radicale, comme les monstres de foires exhibés dans les freak shows et autres cirques Barnum au début du XXe siècle.
Les couleurs criardes de tant de costumes de super-héros s’expliquent aussi par la qualité médiocre des comics bon marchés (Detective comics valait 10 cents). Les grosses trames bavaient tellement qu’il fallait des couleurs vives pour reconnaître immédiatement les héros. Le blanc fut longtemps évité – ce qui explique peut-être que Superman ait remplacé le blanc du drapeau américain par du jaune[6. C’est pour la même raison qu’Hulk et Iron Man, qui apparurent tous deux gris et risquaient de finir imprimés en gros pâtés noirâtres, devinrent rapidement vert, et rouge et or.].
Big Blue & Red Son
Depuis plus de 75 ans, des centaines de dessinateurs et écrivains ont pris en main les aventures de Superman, faisant évoluer son apparence dans les séries régulières, mais aussi dans de nombreuses versions alternatives ou projections futuristes[7. Les aventures de super-héros quasiment invulnérables pouvant se révéler à la longue quelque peu rébarbatives, les éditeurs ont vite publié des aventures exceptionnelles se déroulant dans le passé des personnages (les untold tales, comme les aventures de Superboy, version enfantine puis ado de Superman inventée en 1945, ou Batman : année Un qui narre les premières fois où Bruce Wayne enfile son costume de chiroptère), mais aussi des histoires présentant des versions alternatives de ces héros (les Imaginary stories, équivalents des What if de Marvel, qui mettent en scène ce qui pourrait se passer si certains détails avaient été différents, comme Superman : Red Son).]. La plupart des super-slips[8. Le terme « super-héros » est depuis 1979 une propriété de marque conjointe des deux plus gros éditeurs de comics américains : Marvel et DC. Ce sont donc les seuls à pourvoir imprimer le terme sur les couvertures de leurs magazines, ce qui oblige leurs concurrents à inventer des synonymes : ultra-héros pour Malibu, méta-humains chez Wildstorm, « Héros de la science » pour America’s Best Comics, la collection d’Alan Moore. Mais dans toutes les publications, indépendantes ou non, les super-héros sont communément désignés par des expressions ironiques se référant à leurs costumes, telles « encapés », « masques », ou même « super-slips ».] ont fini par abandonner la cape[9. Au moins depuis que Bill Dollar, super-héros d’opérette au service d’une banque, est mort abattu par des gangsters parce que sa cape était restée coincée dans un tourniquet, dans The Watchmen d’Alan Moore et Dave Gibbons, 1987.] – pas Superman. Le bleu et le rouge de son costume ont parfois changé de nuance, mais le slip est resté au-dessus du froc. La taille de l’écu s’est agrandie pour couvrir l’ensemble de la poitrine musclée. Les cheveux ont subi les effets de la mode (Ah, le « mulet » des années 1980, tempes courtes et nuque longue !), sans perdre la mèche en « S » sur le front. L’histoire de la provenance du costume et de la signification du « S » pectoral ont été révisées[10. John Byrne et George Pérez modifièrent la provenance du costume et la signification du « S » pectoral lorsqu’ils « modernisèrent » les origines de Superman en 1986 avec la mini-série Man of Steel. À l’origine, le costume et la cape ont été cousus par sa mère adoptive, et le « S » pectoral dessiné par son père adoptif en hommage à l’un de ses ancêtres, qui avait tenté de sauver des Indiens d’une épidémie : l’image est censée représenter un serpent, symbolisant la guérison. Désormais, comme dans la version cinéma de Richard Donner en 1978, le costume est une relique de la planète Krypton, dont est originaire Superman, et le « S » rouge sur fond jaune l’emblème de la dynastie El, (c’est-à-dire de la famille de Kal-El, le vrai nom de Superman), un symbole kryptonien signifiant « Espoir ». En tous cas, dans aucune version il ne s’agit vraiment d’un « S », et dans toutes, c’est l’éternelle fiancée du boy-scout en bleu, la journaliste arriviste Lois Lane, qui invente le nom de Superman à partir de ce malentendu.], mais le costume reste très proche de ses premières apparitions – contrairement à beaucoup de super-héros aux goûts plus versatiles, tels les X-men, dont l’accoutrement ne cesse de changer au gré de la mode, passant allègrement du lycra au latex ou des vêtements civils aux costumes punk, voire aux armures.
Certains dessinateurs ont réussi à livrer des images du plus puissant des Supers réellement marquantes. Ainsi Tim Sale avec son épuré Superman for all seasons, où le Grand S se fait pure ligne bleue, rouge et jaune. Ou Alex Ross et ses couvertures peintes inspirées de Norman Rockwell, mais aussi sa version de l’avenir, Kingdom come, où le passage du jaune au noir suffit à suggérer l’austère maturité de l’Homme de Demain. Sans oublier Frank Quitely avec All star Superman, dans la mise en scène d’une possible mort du Kryptonien, qui réussit à rendre crédible la double identité de Clark Kent et Superman, en opposant la puissance contenue du Grand Bleu aux postures exagérément maladroites de Kent, inspirées de la gestuelle du théâtre yiddish.
Des versions alternatives, il faut aussi retenir le savoureux Superman : Red Son où l’Homme d’Acier, s’étant à l’origine écrasé dans un kolkhoze en Ukraine au lieu d’un champ au Kansas, devient le super-héraut du communisme. Il succède à Staline, et convertit au socialisme l’ensemble des États de la Terre, à l’exception du Venezuela et des États-Unis. Ici, Superman est tout de gris et de rouge vêtu, la faucille et le marteau remplaçant le « S » sur la poitrine de son uniforme soviétique, tandis que son adversaire Batman, chapka sur les oreilles de sa cagoule, arbore « le noir de l’anarchie ».
La Vérité, la Justice et l’Idéal américain
Superman est souvent qualifié de personnage « iconique », ce qui en soit ne veut rien dire. Ou alors pour signifier qu’il est davantage une image qu’un personnage : son costume n’est pas seulement sa propre peau, il est tout entier une image animée. Une idée de l’Amérique en technicolor. L’icône est née durant la montée du nazisme en Europe, et en pleine crise économique aux États-Unis, sous la politique de « New deal » menée par le président Roosevelt. Dès la première page d’Action comics nº1, il se présente comme « champion des opprimés, la merveille physique qui a juré de vouer son existence à aider ceux dans le besoin ». Justicier progressiste, apôtre de l’individu et de l’action, sa première aventure dénonce la peine de mort, et il s’attaque aux maux de la Grande Dépression : mafia organisée, syndicats marrons, corruption politique, violence conjugale, alcoolisme, etc.
« Plus rapide qu’une balle, plus puissant qu’une locomotive, capable de sauter par-dessus des gratte-ciels d’un bond[11. Les pouvoirs de Superman sont à l’origine calqués sur ceux de John Carter, le héros d’E. R. Burroughs dans Princess of Mars (1917) et ses suites. Mars ayant une gravité moindre par rapport à la Terre, lorsque John est téléporté sur cette planète, il se retrouve doté d’une force herculéenne qui lui permet de faire des bonds gigantesques. De même Superman, qui vient de Krypton à la gravité plus élevée, ne vole pas à ses débuts, mais fait des bonds au dessus des gratte-ciels.] », il représente la modernité, tout en défendant les valeurs rurales de l’Amérique aux dépens de la ville et de ses dangers. Élevé dans la petite ville de Smallville au Kansas par un couple de vieux paysans tout droit sortis d’un film de John Ford, le bon « Supes » a grandi au biberon de leur morale manichéenne : « la Vérité, la Justice et l’idéal américain » qui devient sa devise. Mais en tant qu’alien adopté par les États-Unis, il représente surtout l’Amérique des immigrants, et revendique un humanisme multiculturel radical, sorte de politiquement correct avant l’heure.
Le gendarme de l’espace
Lors de la Seconde Guerre mondiale, Superman se fait « porte-drapeau de l’Amérique », et délaisse les problématiques sociales pour combattre les nazis et les Japonais. Dès 1940, il s’envole même en Allemagne et en Russie, pour attraper Hitler et Staline par le col et les livrer au jugement de la Société des Nations à Genève. Après-guerre, l’Homme de Demain reconstruit quelques quartiers vétustes, mais passe surtout son temps à combattre des super-vilains à sa mesure, comme Lex Luthor.
À cette époque, les aventures de super-slips ne font plus recette, et la guerre froide s’accompagne d’une autocensure paralysante. En 1954, le psychiatre Fredric Wertham accuse les comics de pousser au crime leurs jeunes lecteurs[12. La campagne de Wertham contre les comics concerne tous ceux qui représentent des scènes de crimes, qu’ils soient consacrés à des histoires de gangsters et d’affaires de meurtre (un genre très populaire à l’époque), de super-héros ou d’horreur. Il insiste notamment sur l’ambiguïté de la relation affective entre Batman et Robin, son Garçon prodige.]. Les éditeurs préfèrent anticiper sur la censure gouvernementale ou parentale, et créent eux-mêmes un label de bienséance, le Comics Code Authority, qui prohibe toute représentation de la violence, de la sexualité, de la religion, du racisme, de la drogue, des vampires, loups-garous ou zombies, et impose au Bien de triompher du Mal. Ces règles poussent les encapés à se tourner vers la science-fiction. Le Kryptonien se fait alors gendarme galactique, porte l’idéal américain dans l’espace, et protège la Terre de menaces venues de lointaines planètes, comme le robot Brainac, collectionneur de villes qu’il miniaturise dans des bouteilles.
Dans les années 1970, les super-héros reprennent pied sur Terre, et le Comics Code Authority est peu à peu abandonné. Une nouvelle génération d’auteurs, qui a grandi avec ces mythes, porte un regard plus critique sur le genre. Le boy-scout en bleu commence à se poser des questions sur sa politique et sa manière manichéenne de traiter tous les problèmes à coup de bourre-pifs. Dans un épisode de 1972, « Superman est-il nécessaire ? », les Gardiens de l’Univers – extraterrestres qui surveillent les cent milliards d’étoiles de la voie lactée – accusent Superman de contribuer au « retard culturel des terriens » par son ingérence dans leurs affaires. De retour sur Terre, il défend un jeune Mexicain en grève contre son patron. Alors que les immigrants du bidonville l’acclament et demandent son aide, il commence par la leur refuser avant d’intervenir contre un séisme, puis de reconstruire leurs maisons. Mais le doute est en lui.
Iconique ta mère patrie
Dans les années 1980, le Champion de l’Amérique a de plus en plus de mal à assumer son humanisme candide. Toujours fidèle à « l’idéal américain », il apparaît souvent comme le valet servile de la politique va-t-en guerre de Ronald Reagan, que ce soit dans ses aventures ordinaires ou dans des futurs alternatifs, comme celui imaginé par Frank Miller dans The Dark Knight returns, où s’affrontent Batman et Superman : dans un avenir où les super-héros ont été interdits à l’exception de Supes, celui-ci attaque les troupes soviétiques pour protéger les intérêts américains (qui lui répondent à coup de missile thermonucléaire, provoquant un hiver nucléaire sur Gotham), et obéit à l’ordre de Reagan d’arrêter le vieillissant Batman, mort ou vif.
Dès lors, Superman, dont les pouvoirs n’ont cessé de croître (soulevant des immeubles à ses débuts, il peut désormais porter des planètes entières sur son dos), est de plus en plus dépeint comme inhumain plutôt que surhumain. Nombre d’aventures et de parodies insistent sur la dangerosité d’une telle puissance, tout en raillant son inefficacité devant la violence du monde. Dans les années 2000, Sentry[13. The Sentry est un personnage créé par Paul Jenkins et Jae Lee dans la mini-série homonyme publiée en 2000. D’abord présenté comme un héros du passé oublié de tous, même par son créateur, Stan Lee, il fut révélé par la suite qu’il ne s’agissait que d’une stratégie marketing de Marvel Comics.], la version Superman de Marvel, a la puissance d’« un million de soleils explosant », mais souffre d’un dédoublement de personnalité. Omni-man[14. Omni-Man : parodie de Superman et père d’Invincible, super-héros et titre de la parution homonyme écrite par Robert Kirkman, dessinée par Cory Walker puis par Ryan Ottley et publiée par Image Comics.], celle d’Image comics, est un extraterrestre qui se fait passer pour Protecteur de la Terre dans le seul but de la coloniser. Quant à The Authority, parodie de la Ligue de Justice[15. The Authority est une équipe de super-héros créée par Warren Ellis pour WildStorm, parodiant la Ligue de Justice d’Amérique, équipe réunissant les plus célèbres super-slips de l’éditeur DC comics : Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash…] qui réunit dans la même équipe les caricatures de Superman et Batman sous les noms d’Apollo et Midnighter (lesquels se marient et adoptent un enfant), cette série est souvent qualifiée d’anarchiste du fait de son irrévérence et de l’interventionnisme de l’équipe à un niveau mondial, ses membres n’hésitant pas à s’opposer aux États-Unis, à l’ONU ou à la France[16. Un épisode d’Action comics, daté de mars 2001, réaffirme les vieilles valeurs de Superman, en parodiant à son tour le discours anarcho-punk de la parodie. Dans cette aventure, intitulée « Qu’est-ce que la Vérité, la Justice, et l’idéal américain ont de si drôle ? », The Authority devient « l’Élite » et voici son manifeste : « Nous ne croyons pas aux Nations. Nous ne croyons pas aux traités. Ni aux frontières, aux classes ou aux programmes… Il y a d’un côté les bons, c’est-à-dire nous, et de l’autre côté les méchants, c’est-à-dire tous ceux qui traitent les autres comme de la merde pour satisfaire leurs petits besoins. Le monde nous attendait. Maintenant, il nous a. Soyez gentils ou nous raserons votre maison avec une bombe anti-connard à fragmentation. Gros bisous. » Supes finira évidemment par vaincre ces petits prétentieux et réaffirmer son rêve d’un monde de Vérité et de Justice.].
La fête est finie
Face à cette inflation de Supers toujours plus brutaux et amoraux, le boy-Scout en bleu continue de défendre ses valeurs, mais en s’éloignant de sa nation d’adoption. Déjà dans l’adaptation cinématographique réalisée par Richard Donner en 1978, il avait commencé à promouvoir « la Vérité, la Justice et l’idéal humain », au lieu de « l’idéal américain ». Dans « L’incident » – épisode anniversaire publié dans Action comics no 900 en juin 2011 –, il va jusqu’à renoncer à la citoyenneté américaine quand des agents de la sûreté nationale lui reprochent d’avoir participé à une manifestation pacifique en Iran : « Je suis las que mes actes soient associés à la politique américaine. “La Vérité, la Justice et l’idéal américain”… Cela ne suffit plus. »
En septembre de la même année, les éditions DC décident de faire repartir à zéro les aventures de tous ses super-héros, et toutes ses publications au nº1, y compris Action comics et DC comics, dont la numérotation courrait depuis les années 1930. Ce reboot est nommé « Renaissance DC », ou « New 52 », puisque le lifting concerne alors 52 séries. Les nouvelles origines de Superman version « Renaissance » sont réécrites par Grant Morrisson, scénariste écossais qui réalise un pont entre l’Amérique de la Grande Dépression du Superman originel et celle de la crise économique des années 2010. Il renoue ainsi avec le concept fondateur : la défense des opprimés contre les élites corrompues autant que contre les savants fous, quitte à affronter les autorités.
Le jeune Superman recommence sa carrière en jean et T-shirt bleu, et seule sa cape kryptonienne raccorde avec le costume classique. Adulte, il porte un costume bleu, rouge et or, mais bien loin des collants d’avant-guerre : désormais, il s’agit d’une bio-armure kryptonienne, à la texture métallique et aux formes bodybuildées, comme dans la pesante adaptation cinématographique de Zack Znider en 2013. La référence au cirque se perd et le costume devient uniforme de combat. Fini le slip, même si une fine ceinture rouge lui dessine une sorte de tanga autour de la taille.
The Dark Knight begins
Bravant les impératifs techniques qui poussèrent les dessinateurs à donner des couleurs vives au costume de Superman, The Bat-man est lui aussi vêtu d’une cape et d’un slip porté au dessus de collants, mais cette fois dans des couleurs sombres, allant du gris souris au bleu nuit – à l’exception de sa bat-ceinture jaune aux sacoches pleines de gadgets. Alors que Superman se contente d’enlever ses lunettes et de changer de coiffure pour protéger son identité civile, le Batman cache son visage derrière une cagoule aux oreilles pointues. Apport essentiel à la mythologie du super-héros, le masque permet à la fois l’anonymat et la reconnaissance : il préserve l’identité secrète du super-héros, tout en donnant une visibilité à ses actions.
Si Superman s’inspire de héros de pulps et de comic strips comme Tarzan, Doc Savage ou Flash Gordon, l’homme chauve-souris tire du même fond populaire des influences plus sombres comme le célèbre The Shadow ou le Dracula des films de Tod Browning ; sans pour autant rompre avec ses origines foraines, notamment à travers le costume jaune, vert et rouge de son apprenti, Robin[17. Superman, lui, n’a pas d’apprenti costumé, mais une cousine kryptonienne, Supergirl, habillée quasiment comme lui : la jupette remplace le slip. Ainsi qu’un super-chien, Krypto, venu de la même planète et portant une cape rouge. Steaky et Comet, respectivement le super-chat et le super-cheval de Supergirl, portent eux aussi une cape et volent, tout comme le super-singe en slip Beepo. Batman s’entourera quant à lui de toute une Bat-famille amatrice de collants et cagoules à cornes : en sus d’épuiser plusieurs Robin, Batgirls, et Batwomen, il se fera également accompagner dans ses aventures d’un Bat-molosse nommé Ace, qui ne porte pas de cape mais un masque, pour ne pas qu’on le reconnaisse à partir d’une tache caractéristique sur son museau.]. Comme Superman et Batman, Robin le « jeune prodige » est d’ailleurs un orphelin, dont les parents étaient acrobates dans un cirque. Son slip à grosses mailles vertes, porté à ses débuts sans collants, est particulièrement osé.
Lors de la révision de 2011, « Renaissance DC », Batman n’adopte pas d’armure intégrale comme dans les adaptations pour le cinéma de Christopher Nolan. Il conserve sous sa cape un costume gris, désormais en nomex ignifugé, mais toujours moulant. Cependant, lui aussi abandonne le slip et les collants pour un treillis gris avec une coquille blindée protégeant ses Bat-organes reproducteurs.
Guerre au crime, paix au manoir
Superman a souvent été comparé au président Roosevelt, tous deux prétendant lutter contre des forces hostiles, pour sortir l’Amérique de la crise et créer une société plus juste. Batman, lui, renvoie plutôt au parcours d’Edgar Hoover, qui fonda le FBI cinq ans avant la naissance du justicier masqué, et se fit le héraut de la « guerre au crime », versant policier du New Deal, censée démanteler les cartels mafieux au lendemain de l’abolition de la prohibition. Dans les années 1930, Edgar Hoover s’était fait une réputation médiatique et politique en mettant fin aux carrières de « Machine Gun » Kelly, Bonnie Parker et Klyde Barrow, John Dillinger, « Baby Face » Nelson, « Ma » Barker et Alvin Karpis – tous des bandits isolés, sans lien avec la mafia organisée en entreprises intégrées à la métropole.
Le Batman s’est quant à lui donné pour mission de venger la mort de ses parents, tués par un malfrat sur Crime Alley, en menant une lutte sans merci contre le crime. Or dès 1940, quand il prend pour partenaire le fringuant Robin et rencontre le Joker, « le Clown Prince du Crime », il devient le recours ultime contre les criminels extravagants. Véritable auxiliaire de la police (un « Bat-signal » est installé sur le toit du commissariat de Gotham en 1942), Batman mène dès lors la même politique qu’Edgar Hoover : s’attaquer aux criminels isolés ou regroupés en petites bandes, sans jamais vraiment toucher le crime organisé.
Le « plus grand détective » participe ensuite à l’effort de guerre en combattant nazis et vampires. Alors que les ventes chutent après la Seconde Guerre mondiale, il reste une des rares séries de super-héros publiées. Comme celles de Superman, ses aventures se tournent vers la science-fiction, et après l’instauration du Comics Code Authority, le ton vire à l’humour et à la dérision. En 1966, le succès de la série télé mettant en scène Batman et Robin renforce encore ce côté « second degré », et il faut attendre les années 1970 pour que le Chevalier noir revienne à des enquêtes plus sérieuses : Robin part à la faculté et Batman reprend « sa guerre au crime » en solitaire, notamment dans les aventures gothiques du jeune tandem Dennis O’Neil et Neal Adams.
Terroriser les terroristes
En 1986, Frank Miller et David Mazzuchelli revisitent les origines du personnage dans Batman : Année Un. Ils renouent avec l’influence du roman noir par des dessins sombres et épurés, et la description minutieuse de Gotham à travers les regards croisés du Batman et du commissaire Gordon. Sans costume mais grimé, fausse cicatrice et fond de teint, le justicier échappe de peu à l’emprisonnement lors de sa première mission, et rentre en son manoir blessé. Ruminant son échec dans son fauteuil de maître, il hésite à sonner son domestique pour se faire soigner, quand une énorme chauve-souris brise la vitre de son bureau et se pose sur le buste de son père. Se rappelant la terreur qu’il avait éprouvée enfant en tombant dans une grotte pleine de ces bestioles (qui allait devenir la Batcave), il prend la décision de se déguiser en chiroptère pour insuffler cette terreur enfantine à tous les criminels.
Miller réaffirme ainsi le mythe originel de l’Homme-chauve-souris, sa doctrine politique : non pas la vengeance, mais la terreur. Pour lutter contre le crime, il ne s’agit pas d’éliminer quelques criminels par la force ; il faut inspirer en leur corps une profonde terreur. Ne pas tuer, mais frapper. Mutiler certains pour donner l’exemple à tous. Comme dans ses premières aventures, Batman n’affronte pas des bandits bariolés, mais des familles mafieuses, des flics pourris et des élites corrompues. Cela dit, dès son premier combat, ce sont bien les os de jeunes ados qu’il brise, ce qui n’est pas sans rappeler les véritables effets de toute politique sécuritaire menée sous couvert de lutte contre le terrorisme ou le crime organisé.
Alors que le costume flashy de Superman, sa « première peau », ne fait que signaler son exception, celui de Batman a dès le début une toute autre fonction symbolique : inspirer la peur. C’est dans ce sens que lors de sa création, le scénariste Bill Finger convainc le dessinateur Bob Kane de passer au gris les collants de l’Homme-chauve-souris, qu’il avait imaginé rouges, et de tracer des ovales blanc en guise d’yeux sur la cagoule à pointes. Des choix ouvrant de formidables possibilités graphiques pour les dessinateurs futurs, leur permettant d’abstraire la Créature de la Nuit dans un travail de l’ombre et de la lumière. Le plus radical dans cette voie reste sans doute Dave McKean avec son mélange de peinture, photos et collages, dans le magnifique roman graphique publié en 1989 et écrit par Grant Morrisson : Arkham Asylum.
Night symbol
Au fil des ans, le gris souris des dessous du Chevalier noir et le jaune de sa bat-ceinture évoluent assez peu, alors que la couleur de sa cape, sa cagoule, son slip, ses bottes et ses gants se nuancent indéfiniment, du bleu nuit au violet jusqu’au noir profond[18. Un des rares avatars vraiment coloré du Batman vient de la reprise de la série par Grant Morrisson entre 2006 et 2011. Lors de ce long run, le scénariste écossais s’ingénia à convoquer les histoires passées de l’Homme-chauve-souris comme si elles décrivaient une même biographie, multipliant les allusions aux histoires les plus extravagantes. Il exhuma par exemple une scène de 1958 : le « Batman de Zur-En-Arrh ». De ce personnage issu d’un univers alternatif, la Terre X, Morrisson fait une sorte de personnalité de rechange créée par Bruce Wayne par auto-hypnose pour se prémunir des attaques psychologiques. S’il perd la mémoire ou devient fou, l’entité prend le contrôle le temps que Bruce Wayne reprenne ses esprits. Ce qui finit par arriver : Wayne devient le Batman de Zur-En-Arrh, se confectionne un costume aux couleurs criardes, rouge, jaune, et violet, et attaque ses ennemis de manière bien plus violente que sa version grise.]. Ce sont surtout la taille de ses fausses oreilles et le dessin de chauve-souris sur sa poitrine qui sont sujettes à interprétation. Ainsi Julius Schwartz, éditeur du Batman, invente en 1964 le logo noir en forme de chauve-souris dans un cercle jaune, repris dans la série TV à succès de la fin des années 1960. L’icône, à la fois logo et écu de chevalier, s’impose plus tard à l’ensemble de la planète lors de la colossale campagne marketing pour l’adaptation cinéma de Tim Burton mise en musique par Prince en 1989.
Le Chevalier de la nuit utilise aussi régulièrement différents Bat-costumes spécifiques (aquatique, volant, ignifugé, blindé…), plus proches de l’armure que du collant. Mais contrairement aux sept dernières adaptations cinématographiques de ses exploits, où les acteurs qui l’incarnent portent des combinaisons noires aux muscles dessinés, il n’abandonne jamais vraiment les collants gris souris dans les comics, et encore moins la cape, métonymie du super-héroïsme autant que motif visuel passionnant pour tous les dessinateurs amateurs de drapés et de plis.
Slip Gadget
Au-delà de sa fonction symbolique, le casque-cagoule protège identité et crâne, et assure une liaison permanente avec le majordome-à-tout-faire Alfred. Ses lentilles blanches confèrent au Batman une vision nocturne. La cape permet de planer, et dans certaines versions de voler. Les collants deviennent peu à peu pare-balles et ignifugés. Les gants sont pourvus de trois Bat-lames et divers gadgets de rechange. Surtout, la Bat-ceinture jaune, qui ressemble à celle d’un charpentier, contient dans ses sacoches autant d’armes et d’objets insolites que le sac sans fond de Mary Poppins.
Le plus célèbre de ces gadgets est un boomerang en forme de chauve-souris, le Batarang, de divers types : tranchant, explosif, électrifié, sonique, télécommandé. Mais les sacoches contiennent davantage : Bat-grappin, Bat-griffe, Bat-bombe, Bat-gel explosif, Bat-tyrolienne, Bat-taser, Bat-filtres à airs, Bat-lanceur de bombes collantes, Bat-séquenceur cryptographique, Bat-scanner portatif, Bat-brouilleur, Bat-grenade givrante, Bat-capsules de gaz (fumigène, lacrymogène, narcotique), drogues en tous genres, médicaments et antidotes… Impossible non plus de dénombrer tous les joujoux high-tech qui encombrent la Batcave : les différentes Bat-armures, le Bat-ordinateur à émetteur holographique, le Bat-gyro (en fait un Bat-hélicoptère), le Bat-plane, la Bat-moto, les innombrables Batmobiles (62 versions entre 1941 et 1990)… D’abord équipé de simples gadgets conçus pour blesser sans tuer, Batman utilise une technologie de plus en plus sophistiquée, développant par exemple des drones de combat à oreilles de chauve-souris. Il n’est pas seulement millionnaire et ingénieux, mais dirige un conglomérat d’entreprises lui permettant d’être toujours à la pointe de l’innovation technologique, et politique[19. Selon un petit manifeste politique à la mode sur certains plateaux, À nos amis, du Comité invisible (La Fabrique), la politique révolutionnaire doit réunir les qualités du prêtre, du guerrier et du producteur. Autrement dit, articuler trois dimensions : l’esprit, la force et la richesse. L’intelligence déductive et l’imaginaire de la peur, l’entraînement intensif et la violence cathartique, la fortune et la logistique capable de financer une ingénierie high-tech : Batman mène une politique révolutionnaire.].
Batman Incorporated
En 2011, le passage de Grant Morrisson comme scénariste de la série régulière du Chevalier noir, qui avait débuté en 2006, s’achève sur la création de Batman, Inc., une entreprise de sécurité internationale. À la mondialisation du crime organisé, Batman répond par la mondialisation du Batman. Après avoir orchestré la (fausse) mort de Bruce Wayne et sa succession dans le costume gris souris par Dick Grayson (le premier Robin), Grant Morrisson fait revenir l’original[20. Dans la série « Le retour de Bruce Wayne », Batman, que tout le monde croit mort, mais qui a en fait été projeté dans le temps, traverse les siècles de la préhistoire jusqu’à nos jours, en passant par les époques de la piraterie, de la chasse aux sorcières, du western et de la prohibition.
Grant Morrisson affine le mythe du costume du Batman : il le fait remonter à la préhistoire, où Bruce Wayne endosse une peau de chauve-souris géante, qui deviendra une relique sacrée veillée par une tribu vivant dans la grotte qui abritera la Batcave des siècles plus tard.], mais dans un autre rôle que celui de Protecteur de Gotham. Bruce Wayne décide de laisser cette fonction et son uniforme à son ancienne pupille, Robin, et d’endosser un nouveau costume, sans slip, afin de se consacrer à l’international à travers Batman Inc., nouvelle filiale de Wayne Entreprise.
Il recrute donc à travers la planète de nombreux super-héros et leur fournit logo chauve-souris et logistique. Il engage ainsi toute la Bat-family recomposée : Robin, Red Robin, Batgirl, Batwoman, Batwing, Huntress, Oracle, James Gordon, et parcourt le monde pour disposer d’agents dans chaque pays : Frère Chiroptère et Corbeau rouge (réserves indiennes), M. Inconnu (Japon), Black Bat (Hong Kong), Wingman (Mtamba, Afrique), Dark Ranger (Australie), El Gaucho (Argentine), Le Chevalier et l’Écuyer (GB), Nightrunner (Seine-St-Denis)[21. Nightrunner, lourdement traduit en « Parkoureur » est un super-héros français créé par le scénariste anglais David Hine et le dessinateur Tom Lyle en décembre 2010, et recruté pour Batman, Inc. en France. Son identité secrète est Bilal Asselah, jeune français d’origine algérienne et de confession musulmane, habitant Clichy-sous-Bois et adepte du Parkour (discipline sportive de déplacements dans l’espace urbain). Son frère est mort tué par la police au cours de violentes émeutes, et il n’aura alors de cesse de protéger les siens de la police… et la police des émeutiers. Ses premières apparitions dans les comics déclenchèrent une vive polémique chez les conservateurs américains qui n’apprécient pas qu’un musulman représente Batman. Malgré quelques apparitions furtives dans Batman, Inc., son histoire n’a toujours pas été publiée en France.]. Son principal critère de recrutement : des héros qui n’utilisent pas d’arme à feu et ne passent jamais la ligne éthique qu’il s’est fixée – ne pas tuer. À terme, le but est de développer des drones domestiques avec fonction de gardes du corps, bon marché : « Un Batman dans chaque maison. »
Le Vigilant en noir n’a pas toujours refusé les armes à feu. Dans ses premières aventures, il menace de mort les criminels, porte parfois un flingue, et ses adversaires meurent souvent au combat (mais toujours par accident). Fin 1941, craignant les associations de parents, le directeur de publication de DC décide que Batman ne doit plus jamais utiliser d’arme. Ceci est annoncé clairement dans le quatrième numéro du magazine Batman : « Batman ne tue jamais ni ne porte d’arme à feu ». Bob Kane et Bill Finger obtempèrent, et l’adversaire qu’affronte Bats pour la première fois dans ce numéro, le Joker, survit, et reviendra encore et encore.
Gardiens de la paix : mon œil
Comme le New Deal de Roosevelt et la politique sécuritaire d’Edgar Hoover, Superman et Batman s’opposent moins qu’ils ne se complètent. Indépendamment de la sensibilité des auteurs qui les animent, ils incarnent chacun à leur manière l’éthique individualiste de l’Amérique, l’un en technicolor, l’autre en noir et blanc, ainsi qu’une politique d’exemplarité. Le Grand Bleu avec ses grosses valeurs cherche à donner l’exemple à tous les humains, à inspirer les futurs défenseurs du Bien. Le Justicier de la nuit veut insuffler l’effroi aux suppôts du Mal. Deux faces de la même morale manichéenne, deux instances complémentaires de jugement et de maintien de l’ordre social.
L’alien devenu Champion bariolé de l’Amérique incarne depuis sa création un universalisme candide, politiquement aussi correct qu’inoffensif. Ce qui ne l’empêche jamais d’agir en super-flic : Superman s’oppose à la peine de mort, mais ne rechigne pas à condamner régulièrement ses ennemis à l’enfermement à perpétuité dans une « dimension de poche » : la « Zone fantôme ».
Le Batman a, quant à lui, « inventé » la doctrine de la police moderne : ne plus tant entretenir une image de respectabilité, de proximité avec la population comme Superman ou le gendarme de Saint-Tropez, mais s’imposer par la peur dans la rue. Terroriser pour dissuader. Mutiler pour faire exemple. Certes, les pratiques de la police américaine, par l’usage banal de l’assassinat par arme à feu, semblent démentir cette politique de cruauté raisonnée. Dans les faits, le développement d’armes dites « non létales » n’a diminué nulle part le nombre de gens tués par la police, ni le recours aux armes à feu. Il ne fait que banaliser et raffiner les « violences légitimes » exercées par la police. En France, le récent meurtre de Rémi Fraisse à la grenade, après tant d’éborgnés au flashball dans les rues et les manifestations, nous le rappelle brutalement[22. La brutalité assumée du Batman (comme celle de la police) n’a cependant rien à voir avec le fascisme comme on l’y réduit trop souvent. Elle est profondément liée à la démocratie et à la république. Le Justicier masqué est celui qui suspend la loi pour la défendre, la « force obscure » de la démocratie. Comme le dictateur que convoquaient les citoyens romains pour sauver la république menacée (référence explicite dans le film The Dark Knight rises).].
Aucune police au monde ne s’est mise à se vêtir de collants aux couleurs primaires. L’équipement et les vêtements des forces de l’ordre, de plus en plus conçus pour l’activité physique sinon militaire, se rapprochent davantage de ceux de Batman, et plus précisément des versions cinéma de la trilogie réalisée Christopher Nolan. Les costumes des SWAT américains sont tissés des mêmes matières que les costumes du Batman de Nolan : Nomex résistant aux flammes et Kevlar pare-balles[23. Le site internet <moneysupermarket.com> a calculé le prix de la combinaison et des accessoires de Batman dans The Dark Knight rises. Devenir Batman coûterait 562 millions d’euros, construction du manoir Wayne comprise. Le costume coûterait 870 000 euros, dont la quasi-totalité pour son masque, qui vaut à lui seul 820 000 euros. Le bustier pare-balles en Kevlar vaudrait 2 500 euros, plus 950 euros de renforts en carbone ainsi qu’une coquille à 850 euros pour protéger le système reproducteur de l’Homme-chauve-souris. La cape infroissable : 32 000 euros. Pour les gadgets, 133 000 euros, l’équipement le plus cher étant le pistolet lance-grappin à 41 000 euros. Vu l’évolution du budget de l’État, même avec le développement de la politique sécuritaire, l’équipement de la police française n’est cependant pas prêt de suivre. C’est déjà ça.].
Heureusement, ce n’est sans doute pas la niaiserie du discours de Superman et le délire sécuritaire de Batman qui marquent le plus les imaginaires collectifs depuis plus de 75 ans. Comme les western, les histoires mythiques de super-héros sont en définitive moins des apologies du « vigilantisme » que des réflexions sur la puissance, la loi et la société. Ainsi, à côté des réquisitoires pour l’autodéfense de Frank Miller, d’autres auteurs, comme Alan Moore et son fameux Killing Joke, interrogent la violence abusive et la folie obsessionnelle de Batman, qui le rapprochent tant de ses vilains ennemis. Cette approche récurrente, au cœur de la trilogie Nolan, rappelle que l’action du premier super-héros de Gotham a entraîné l’apparition de super-criminels d’un degré de violence qui n’existait pas avant lui. La violence de la rue dépend directement du niveau de la « violence légitime », dans les comics celle des super-héros, en réalité celle de l’État.
Mais au-delà des interprétations contradictoires des mêmes mythes, la force politique de ces historiettes tient aussi simplement dans la puissance des images d’envol au dessus des gratte-ciels et de plongées dans les ruelles obscures, la force de l’ombre et de l’invisibilité, l’impertinence du slip et de la couleur.
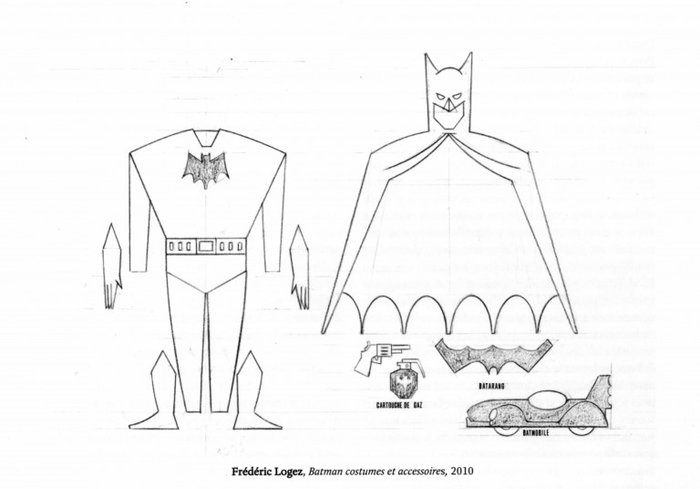
Occupy Gotham
La dernière adaptation cinématographique de Batman, The Dark Knight rises, qui clôt la trilogie réalisée par Christopher Nolan, a été à la fois taxée de pro-démocrate par les Républicains, et de pro-républicaine par les Démocrates. Les Républicains considèrent que le super-méchant Bane fait référence à Bain Capital, le fonds d’investissement dirigé par leur candidat à la présidentielle, Mitt Romney. The Guardian (17 juillet 2012) estime que le film contient au contraire une « vision audacieusement capitaliste, radicalement conservatrice, et justicière qui propose de façon sérieuse, frémissante, que les souhaits des riches soient défendus dès lors qu’ils œuvrent pour le Bien. ».
En tous cas, quand le super-terroriste Bane, hybride entre un géant russe et un arabe voilé (toutes les peurs de l’Amérique condensées) commence par attaquer la Bourse pour la pirater, avant de proclamer (sous la menace d’une arme nucléaire) « rendre Gotham au peuple », difficile de ne pas voir une charge contre le mouvement Occupy Wall Street. Surtout en regard de l’insurrection qui vient ensuite, où les 99% vont allègrement expulser les riches de leurs manoirs, leur arracher leurs colliers de perles, et acclamer les Tribunaux populaires parodiant la Terreur qui suivit la Révolution française. Or même au cœur de ce chaos, Batman refuse jusqu’au bout les armes à feu. C’est sans doute une raison pour laquelle les Républicains américains, si liés aux lobbies des marchands d’armes, ne sauraient s’y reconnaître.
« The Dark Knight Rises n’est pas politique », affirme Christopher Nolan dans Rolling Stones magazine en juillet 2012. Comme la plupart des productions hollywoodiennes et des comics américains, le film est conçu pour que tous les publics s’y retrouvent, au moins partiellement. La satire d’Occupy Wall Street pour les Républicains, le discours de classe de Sélina Kyle (Catwoman, même si son nom de scène nocturne n’est jamais évoqué) pour les spectateurs marxistes, et la jouissance cathartique des scènes de destruction de la métropole participent de cette identification largement partagée. Il n’empêche, Nolan a beau jeu de proclamer ne pas délivrer de message particulier, son apologie de l’alliance des bons capitaliste et de la brave police, couplée à son mépris de classe pour ces 99% si facilement manipulables par le moindre fanatique, est franchement nauséabonde.

Histoire de la pacification, par Guillaume Trouillard pour Jef Klak.

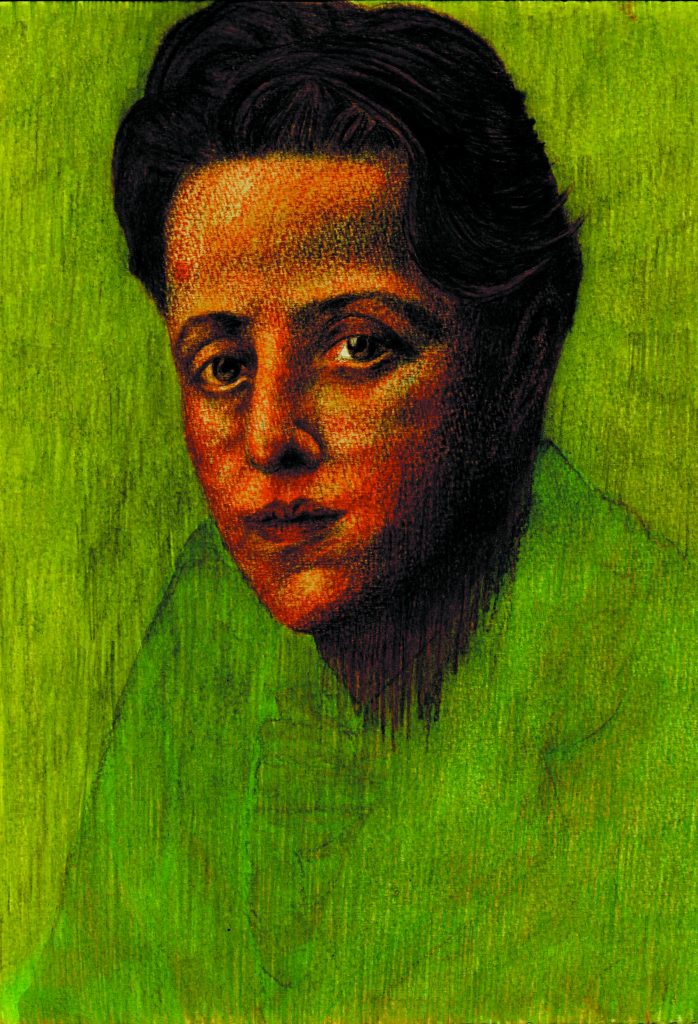
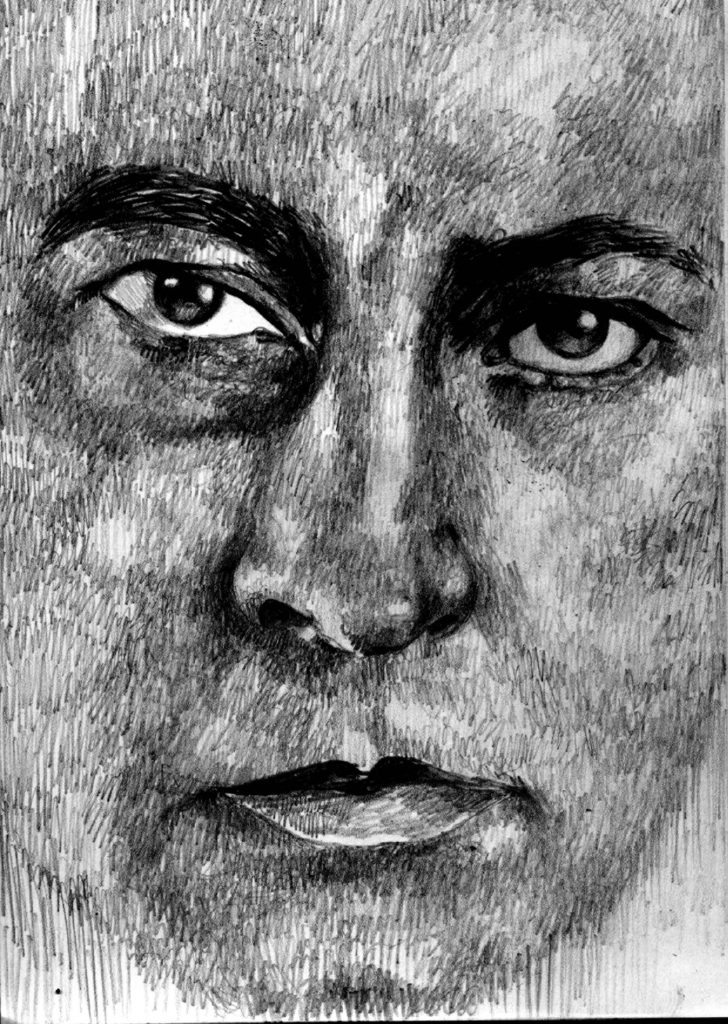
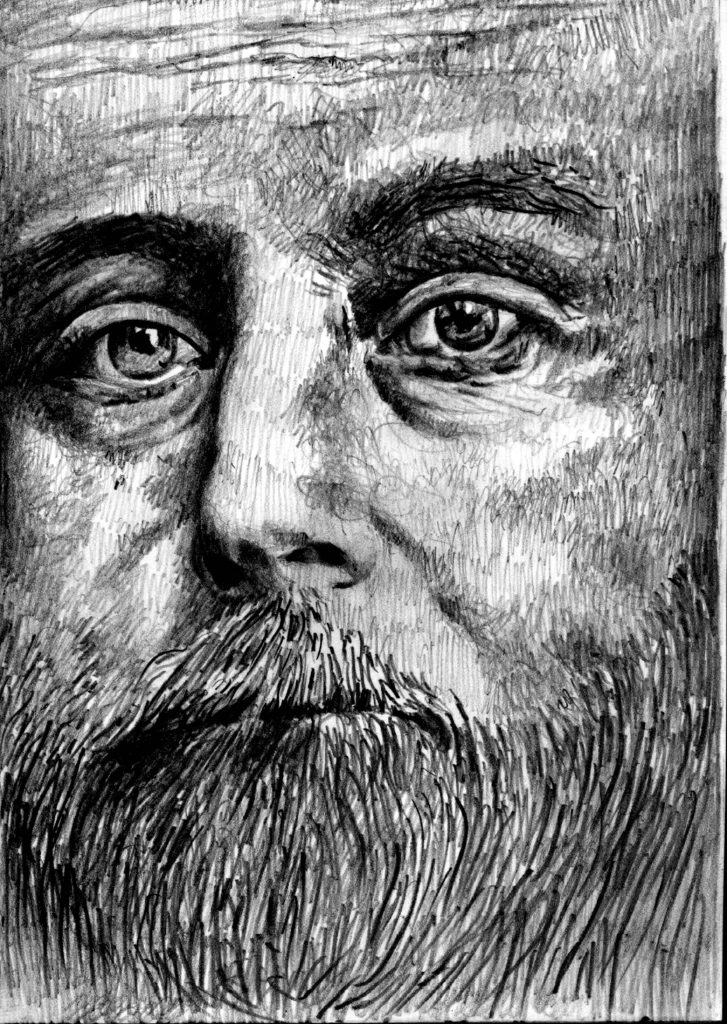

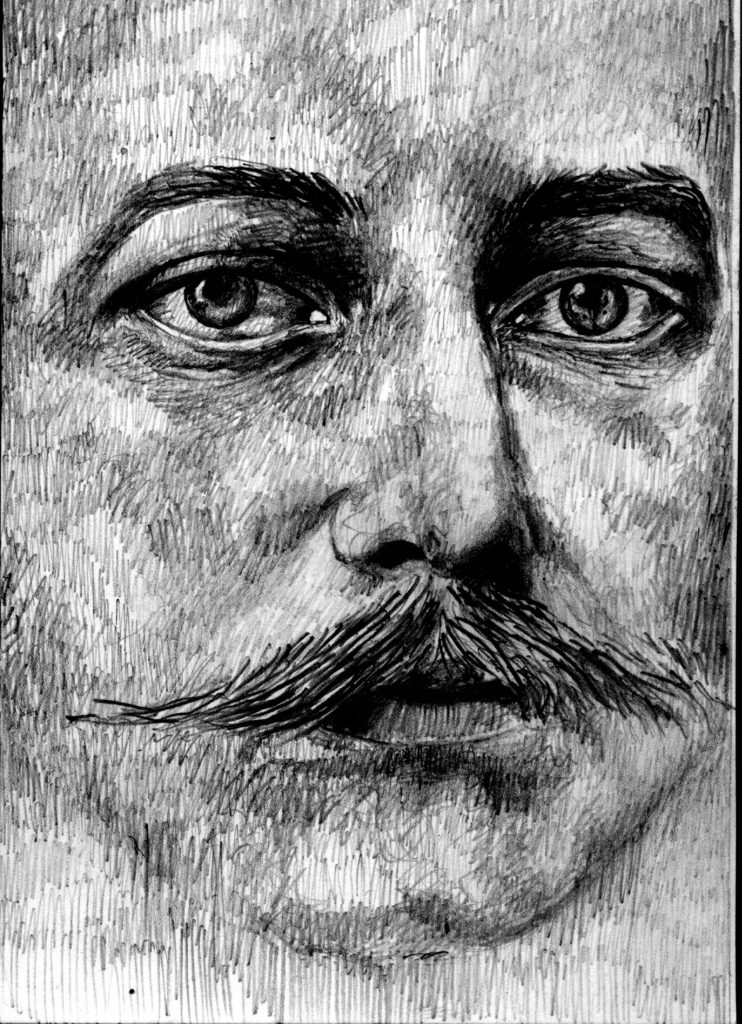
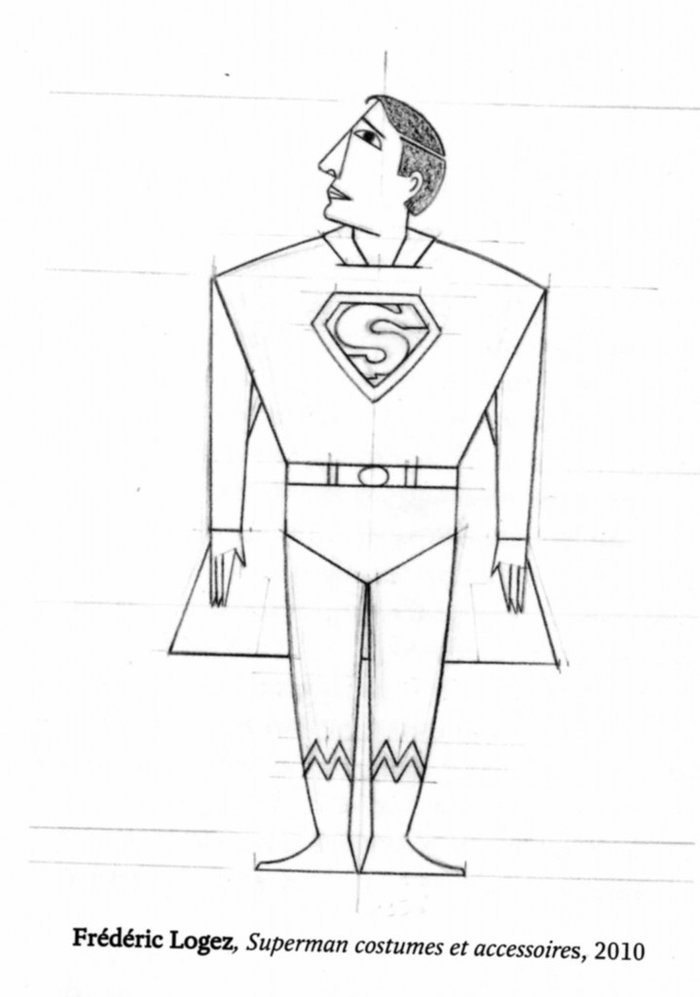
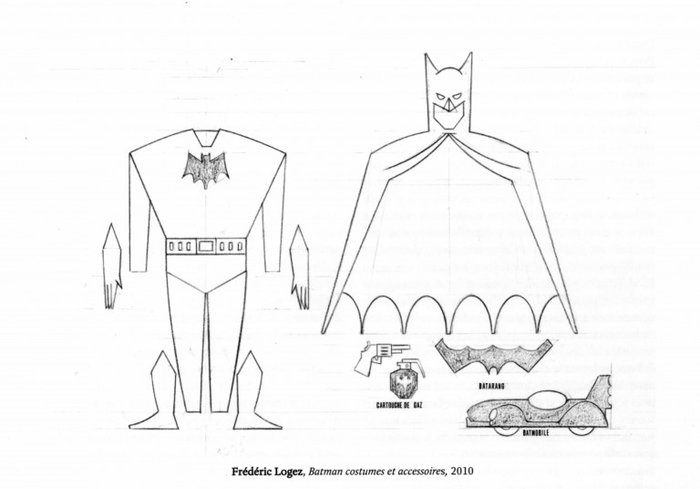

Recent Comments