by Ferdinand Cazalis | 30 juin 2015 | Dé-colonialités
Qu’est-ce que les migrant-e-s extra-occidentalisé-e-s nous apprennent en arrivant en Europe de l’Ouest ? Cette question n’est presque jamais posée, selon le philosophe Jérémie Piolat.
L’auteur du Portrait du colonialiste, L’effet boomerang de sa violence et de ses destructions (éd. La découverte, coll. Les empêcheurs de penser en rond, 2011) a travaillé avec des associations liées à l’alphabétisation des migrant-e-s. Il y a tenté d’apprendre sur lui-même et sur la disparition des cultures populaires dans les pays occidentalisés. Durant ce terrain, il a pu se rendre compte à quel point les intentions émancipatrices des logiques d’accueil restent empreintes de colonialité et de domination culturelle. L’enjeu est alors, au-delà de la décolonisation, la « décolonialisation ».
Ce texte est une transcription reprise par Jérémie Piolat, à partir d’une discussion proposée par les Ateliers d’histoires populaires de Vaour, dans le Tarn, en septembre 2014 (Voir présentation en fin d’entretien).
Texte établi avec le concours d’Alexane Brochard.
*
Télécharger le texte en PDF.
*
Même si cela semble impossible, pourrais-tu tenter de définir ce qu’est une culture populaire ?
Je peux essayer, à partir de mon expérience et de mes rencontres. À chaque fois que je suis parti quelque part, je connaissais des gens sur place – comme à la fin des années 1990, lorsque je me suis rendu à Yeumbeul, un quartier de la banlieue de Dakar. Là-bas, j’ai été marqué par la rage des jeunes, et l’incroyable manière qu’ils ont de rapper. Mais j’ai surtout été sidéré par leur puissance intellectuelle. Venant de porte de la Chapelle à Paris, j’ai moi-même pu fréquenter ce lieu mis au ban qu’on appelle la banlieue. J’y ai rencontré des gens très intéressants, mais jamais cette force, trouvée à 40km de Dakar, où la situation économique est très difficile, avec 80% de chômage.
Quand je suis parti, je voulais entamer un doctorat en philosophie sur la manière dont les danses populaires ont disparu d’Europe de l’Ouest. J’avais en tête deux ou trois terrains pour montrer ce qu’était une danse populaire : les gitans de la banlieue de Paris, le hip-hop avant qu’il n’entre dans l’arène du marché (bien que tout ce qui se produit dans cette arène ne soit pas déplaisant, loin de là) et les jeunes de Yeumbeul. Un ami franco-Sénégalais m’y a invité pour que je voie comment ça se passe, en me proposant d’apporter une caméra. J’y ai finalement réalisé un film – qui est plutôt bon, non pas parce que je l’ai fait, mais grâce à ceux qui sont dedans, ces jeunes qui tiennent des discours extrêmement complexes.
Je me rappelle par exemple de ce type de 19 ans, Alassane N’Diaye, qui, sachant que j’avais fait des études de philosophie, était venu me voir en me disant que la philosophie était « une matière très prenante » et qu’il avait déjà écrit 200 pages sur « les vertus de l’imperfection humaine ». Il m’a expliqué en quoi l’imperfection est ce que nous avons tous en commun : « Que le blanc sache, m’a-t-il dit, qu’au-delà de tous les paramètres qui constituent l’ensemble de son univers restrictif, il a quelque chose en commun avec celui qu’on appelle “nègre”. Et ce quelque chose, c’est son imperfection. » Nous sommes là en présence d’une pensée complexe, nourrie entre autres, par la pratique de l’Islam. Dans le film, Allassane N’Diaye va assez loin, avec d’autres aussi, sur ce qu’est la danse, le rapport entre banlieue et centre-ville ou sur la manière dont la philosophie occidentale a cloisonné le corps et l’esprit. Ce philosophe de rue, manager à cette époque d’un groupe de rap, développait déjà en partie une des thèses relatives à la mise à distance et la mécanisation du vivant que l’on retrouve par exemple dans l’ouvrage extraordinaire de David Abram, Comment la terre s’est tue[2. Comment la terre s’est tue, Pour une écologie des sens, David Abram, trad. D. Demorcy, I. Stengers, éd. La découverte, Les empêcheurs de tourner en rond, 2013.]. À ce moment-là, j’ai senti être confronté à ce qu’était une culture populaire.
La puissance intellectuelle de ces jeunes de Yeumbeul que j’ai appelés des « philosophes de rue » ne venait pas seulement de l’école (y compris en ce qui concerne leurs lectures), mais aussi et surtoutde leur propre culture, de la manière dont ils dansaient, pensaient, de leur appétit intellectuel insatiable. Cet appétit m’est apparu à l’évidence comme un pouvoir transmis par leur culture, saisie au sens mouvant, évidemment – je préfère d’ailleurs de plus en plus au mot « culture » les mots « pouvoirs[3. Au sens où l’entend Starhawk : «pouvoir du dedans» et non «pouvoir sur». Voir Rêver l’obscur. Femmes, Magie et Politique, éd. Cambourakis, 2015.] » et « savoirs ». Leur puissance vient également de la mémoire – et de leur capacité à l’exercer – qu’ils ont de leur communauté. Je pense notamment aux Peuls, qui connaissent en général toute l’histoire de leur communauté, proche et lointaine ; même quand ils sont ou ont été balayeurs ici. Moi, je suis incapable de faire l’histoire de ma propre famille. Il ne s’agit pas d’idéaliser les Sénégalais ou d’autres peuples, mais en France, nous avons souvent tendance à stigmatiser ce qui fait problème chez les migrants ou les extra-occidentaux, en oubliant de mettre en valeur ce qu’il y a d’éblouissant et de puissant chez eux.
Une culture populaire, pour répondre donc à votre question, c’est quelque chose qui ne s’apprend ni dans les conservatoires ni à l’école, en cours de philosophie ou de civisme, mais bien d’abord dans la famille, dans la rue, dans les fêtes cérémonielles, dans les quartiers. Elle n’est évidemment pas atemporelle, mais bien en relation avec les processus historiques et politiques en cours. Elle n’est pas non plus un ensemble de représentations et pratiques inconscientes dont seuls les anthropologues occidentaux seraient à même de dévoiler les véritables tenants. Une culture populaire, c’est quelque chose qui se transmet et se transforme en même temps, de génération en génération. Cela peut toucher à l’art d’accueillir, à celui d’habiter un environnement, de danser, de chanter, de conter, d’accueillir les nouveau-nés, de prendre en compte les étapes majeures de la vie.

En quoi cette vision de ce qu’est une culture entre-t-elle en jeu dans ton travail associatif avec les migrant-e-s ?
Disons que c’est sur cette base culturelle que je travaille avec les migrant-e-s, dans des espaces où, loin de chez eux, ils sont censés se retrouver et s’approprier une langue commune, le français. Ça, c’est le discours officiel, mais ce qui m’intéresse vraiment dans les ateliers que je mène, c’est la mise en lumière de leurs cultures (ou plus exactement des savoirs et pouvoirs issus de leurs cultures, en jeu dans leurs pratiques culturelles) et du regard qu’ils portent sur l’Europe de l’Ouest. Ce que j’ai vu au Sénégal, et dans différents endroits ici, m’a fait comprendre que les « blancs » (comme dirait le Parti des indigènes de la République (PIR), mais moi je préfère dire les « occidentalisés ») n’ont plus de culture populaire.
J’ai senti une absence. En France, il y a des résistances, des renaissances qu’il faut saluer, mais on ne peut nier un certain vide. Certaines régions ont résisté, comme le Pays Basque, la Corse, la Bretagne ou le monde occitan, mais ce n’est pas le cas de toutes les régions de France et d’Europe de l’Ouest. Tout au long de ma vie, les plus grands processus de solidarités auxquels j’ai assisté venaient toujours des immigrés. Ce sont des immigrés algériens qui m’ont appris, par exemple, qu’on pouvait aimer ses parents. Avant de les rencontrer, je n’étais pas au courant : je pensais que la relation aux parents était nécessairement pénible. Un autre rapport à la famille leur a été transmis, que moi et mes collègues européens de l’Ouest, pour la plupart, ne soupçonnons même pas. Le mot même de « parent » n’a pas le même sens, évidemment, là où l’on met les enfants en crèche dès trois mois, se condamnant soi-même à une inquiétante et violente solitude, et là où on les porte, les allaite et les garde près de soi.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problèmes liés à la parentalité ou à l’éducation ailleurs, où tout serait gentiment parfait. Mais cet « ailleurs », et les pratiques qui ne nient pas les besoins de l’être qui vient de naître et de son ancrage corporel, permettent de pointer certains dysfonctionnements d’ici, en Europe de l’Ouest, particulièrement fascinants.
C’est ce genre de rapports que les Européens ont perdu à travers leurs empires coloniaux ?
Ce que je considère comme le fondement du colonialisme, c’est d’abord une mise à distance, puis à disposition, du vivant, relative aux besoins du marché et de l’« oscultation » mécaniste du monde qu’on appelle « science du vivant ». Ensuite, le fondement du colonialisme, c’est une destruction des cultures qui sont rétives à cette mise à disposition. Ça s’est passé d’abord en Europe de l’Ouest (Voir Starhawk, Femmes, magie et politique), puis ça s’est exporté ailleurs, avec une violence exponentielle. Voici l’hypothèse à partir de laquelle je travaille. Je n’étudie pourtant pas vraiment l’histoire du colonialisme ; ce qui m’intéresse, c’est l’observation du quotidien fabriqué par l’absence de culture populaire. Comment cette déculturation se fait-elle sentir dans le rapport à la danse, à la langue, et à l’éducation des corps ?
Comment les migrants vivent-ils au quotidien les formes de stigmatisation dont ils sont les cibles ?
Par exemple, dans la famille d’une amie proche, française, on en vient à parler de l’islam et de jihad. J’explique – ce qui est selon moi la base – que le mot désigne d’abord un combat sur soi. Ce à quoi la mère de mon amie répond : « En tout cas, je préfère être une femme en Europe, qu’une femme en Afrique noire ou au Maghreb. » Il y a des évidences comme ça, qui circulent, sur lesquelles sont fondées les stigmatisations, profondément et très tranquillement racistes et qu’il nous faut déconstruire. Pour cela, on ne peut faire l’économie de prendre le temps d’étudier, de décortiquer, de comprendre ce qu’elles impliquent en terme de regard et d’ignorance sur les autres et sur soi.
Cette persistance de préjugés en tous genres est particulièrement visible dans des lieux associatifs où l’on affirme travailler pour le bien-être, le droit et l’émancipation des migrants. Je trouve en fait déjà cela incroyable en soi que des associations prétendent « émanciper » des êtres humains adultes. J’ai donc expliqué à l’institution qui m’engageait que ce qui m’intéressait, c’était de mettre en lumière les cultures populaires de ces femmes migrantes. Ce à quoi les femmes qui dirigeaient l’association, très sympas au demeurant, m’ont répondu : « Mais ces femmes n’ont pas de culture. Elles sont taiseuses, opprimées à la maison. » J’ai alors réalisé qu’en 2006, des personnes pensaient encore que des femmes maghrébines ou africaines noires n’avaient pas de culture : elles donnent des cours de français à des gens qu’elles pensent privés de culture, des « sans-culture ».
Or, comme je le disais au départ, quand je parle de « culture », c’est dans un sens très précis, comme pratiques culturelles conscientes des communautés. Si quelqu’un danse, il sait qu’il danse. Je ne savais pas, lors du premier atelier que j’ai donné, que c’était dans le cadre d’un programme d’alphabétisation. À la fin de cet atelier, ces femmes migrantes ont commencé à prendre la parole en public, alors qu’on me les avait décrites comme taiseuses. Elles parlaient aussi très bien français. Cependant, ce qui m’intéressait dans ces ateliers, ce n’est pas que les migrants s’améliorent en français, mais qu’ils m’apprennent quelque chose, à moi, pour m’apporter un regard neuf sur la société dans laquelle je vis.

L’apprentissage de la langue française serait donc une fausse bonne idée pour les migrant-e-s qui arrivent ici ?
Je ne dis pas forcément cela, mais si ces ateliers leur ont permis d’apprendre le français, c’est selon moi un « dégât collatéral », car je n’ai pas forcément voulu œuvrer à ça. On m’a même demandé de donner des formations pour les gens qui alphabétisent les migrants : des formations un peu particulières, pour sensibiliser à la créativité linguistique des migrants qui apprennent – ou plutôt se battent avec la langue française. En utilisant des textes écrits dans mes ateliers, édités sans corrections, textes où en général celui qui écrit retranscrit – entre autres – son accent, sa musicalité orale, je voulais faire comprendre aux professeurs de français pour étrangers qu’à l’intérieur des « erreurs » de langage que peuvent faire les migrants qui écrivent en français, il y a quelque chose de beau, qui nous renseigne souvent sur la langue de la personne, sur sa culture, son imaginaire, et surtout sur comment notre langue à nous est faite. Il s’agit donc d’un échange. Je pense que ces écrits non corrigés relèvent d’une sorte (entre guillemets, j’insiste) de « créole immigré ». C’est un phénomène incroyable, une langue qui s’invente, et qui procède de la créolité, en référence avec la manière dont s’est construit le créole antillais, par différents peuples qui se sont retrouvés ensemble dans une même situation d’exploitation et qui ont dû trouver une langue commune.
Un jour, dans un atelier, une femme, Sabah, a écrit « J’ai boucop d’histoire dans mon corps à dire ». Au cours de la formation que j’ai donnée aux professeurs de français, j’ai lu strictement ce qui était écrit sur la feuille, sans chercher à imiter d’accent. Mais pourtant, en m’en tenant à la stricte lecture des sons écrits, l’accent a jailli de ma bouche, malgré moi ; l’accent, une part de la voix de celle qui avait écrit. Face à cette langue, tous les professeurs ont dit y trouver une respiration : « C’est une littérature dans laquelle on entend le corps de celui qui écrit », m’a dit une enseignante. Les personnes migrantes se permettent d’écrire comme ça dans mes ateliers, car je leur dis de ne pas penser aux fautes. Et j’appuie cela sur ma propre expérience : moi, quand j’écris, je peux faire dix fautes par phrase. Si je commence à penser aux fautes et pas à ce que je suis en train de dire, je ne suis pas bon, je n’ai aucune idée. De même, quand ces personnes ne pensent pas aux fautes, elles couchent leur accent sur du papier, et avec lui une part de leur musicalité propre, de leur force la plus intime.
Concrètement, qu’apprends-tu des migrant-e-s dans ces cours que tu es censé leur donner ?
J’ai par exemple pris la mesure du fait que le français est une langue à graphie étymologique : on n’écrit pas les mots en fonction de leur son, mais de leur histoire. Si on écrit « dent » et pas « dan », c’est parce que dent vient d’un mot latin (dentis) dans lequel on prononçait le « t ». Les créoles antillais qui utilisent le vocabulaire français ont refusé cette grammaire. C’est le signe d’une résistance de l’imaginaire, très complexe et fort puissante : ils ont gardé le vocabulaire français, avec des sons issus du croisement des langues africaines, syrienne, chinoise, etc., et écrivent ainsi avec une graphie phonétique.
Prenons un autre exemple très simple avec le mot « oiseau ». Un jour, à Bruxelles, au cours d’une présentation publique d’un recueil écrit par des migrants, un homme d’origine hongroise m’explique qu’il est arrivé en France à l’âge de 10 ans, et qu’il a dû apprendre le français – « une langue horrible », dit-il. Le pire de tous les mots était pour lui « oiseau » : dans ce mot, aucune lettre ne se prononce comme elle le devrait ! La question est : qu’est-ce que cela crée pour nous, qui passons notre temps à lire des sons qui ne s’écrivent pas ? Nous apprenons à associer des sons à des lettres, a, b, c, i, etc. qui ensuite à l’écrit, une fois assemblées, cessent de se prononcer ainsi. Si l’on faisait la même chose avec nos perceptions, on se retrouverait dans ce genre de situation : en voyant une maison verte, je ne devrais pas penser à une maison verte, mais, je ne sais pas, moi, à un carrosse, avec une chauve-souris qui passe par-dessus, et un char d’assaut en-dessous. Ce serait une expérience proche du psychédélique ! Or c’est ce qui se passe en permanence quand nous lisons en français. Les créoles, eux, ont refusé cette dissociation entre signe et son : c’est pourquoi « oiseau » s’écrit « wazo ». La même résistance s’opère chez les migrants, quand ils ont simplement la possibilité d’écrire en pensant au sens, et pas seulement à la grammaire. Ils phonétisent la langue, pour s’en sortir.

Le colonialisme culturel est-il répandu parmi les travailleurs associatifs qui travaillent avec des migrant-e-s ?
Pour répondre à cela, j’aimerais vous lire un court extrait écrit par une formatrice en alphabétisation dans une grande association belge (qui fait par ailleurs un très bon travail) : « Je ressens chez la plupart d’entre eux une réelle soif d’apprendre. J’apprécie beaucoup quand, entre eux, ils s’expliquent des choses que l’un n’aurait pas comprises. Tout comme quand deux apprenants de même nationalité se parlent en français. »
En lisant cela, on dirait que les migrants, dépourvus de culture, sont en train de découvrir le savoir. Mais ils ne sont pas dupes : ils s’adressent à l’institution de la manière dont celle-ci veut qu’ils s’adressent à elle. On croit souvent que le silence des migrants vient d’une faiblesse liée à la précarité inouïe dans laquelle ils se trouvent, mais on oublie en quoi il vient aussi, sinon d’un sage et docte mépris, du moins d’un étonnement sans cesse renouvelé face au regard que portent sur eux les institutions qui se pensent émancipatrices. À cause de cela, pour faire plaisir à leurs alphabétiseurs, on entend parfois des migrants eux-mêmes dire : « Je suis comme un enfant qui apprend à marcher, avant je ne connaissais rien. » Tout se passe comme si se jouait une grande pièce de théâtre où les personnes blanches joueraient le rôle de ceux qui savent, et les migrants celui de ceux qui apprennent.
Pour moi, nous sommes ici dans une situation certainement pas postcoloniale, ni même néocoloniale, mais tout simplement supracoloniale, dans le sens où ne se pose même pas la question : « Et si les personnes qui sont en face de nous n’étaient pas comme on les pense a priori ? » Pas plus que : « Pourquoi, moi qui les rencontre, je pense qu’elles sont comme ça ? » Les chirurgiens ont fini par accepter de se laver les mains en se rendant compte qu’ils étaient vecteurs de mort s’ils ne le faisaient pas, comme le rappelle Isabelle Stengers[4. Dans sa préface à Nous ne sommes pas seuls au monde de Tobie Nathan, éd. Les empêcheurs de penser en rond, Seuil, 2007. ]. On peut aussi être vecteur de mort, de dissolution de la personne quand on prétend vouloir la soigner, l’émanciper, sans se laver les mains de sa colonialité, sans s’interroger sur son propre conditionnement.
Enfin, ce qui m’intéresse, c’est comment nous pouvons relier cette déculturation, à l’œuvre dans certains cours d’alphabétisation, avec celle que nous, Européens de l’Ouest, avons vécu et vivons encore. Le processus est à présent très avancé et dans une phase « résiduelle », mais il y a toute une histoire vécue dans les régions, qu’on appelait autrefois des « pays ».

Ce colonialisme culturel concerne-t-il seulement la langue ou traverse-t-il d’autres manières d’être ?
Disons que langue, écriture et modes de vie sont très intimement liés. Par exemple, certaines associations refusent de faire des groupes non mixtes, au prétexte qu’il faut libérer les femmes. Ces associations font comme si elles ne savaient pas que, pour les groupes féministes des années 1960, l’un des premiers actes était de se retrouver en groupe non mixte, sans les hommes. Pour les migrants, il faudrait un autre régime de parole, comme si l’on ne pouvait émanciper les femmes qu’en les mixisant, alors qu’elles sont parfois victimes de machisme à la maison. Pense-t-on que les hommes qu’elles rencontrent dans leur cours, eux, ne sont pas machistes ?
Les femmes migrantes avec qui je travaille parlent très rapidement des problèmes qu’elles ont avec leur mari – comme si c’était ce que je voulais entendre (elles ont compris que l’institution a des oreilles pour ce genre de problèmes, les confortant dans l’opinion qu’elle se fait des hommes arabes, africains et en particulier musulmans). J’ai lu des textes de femmes sur leur mari qui disaient que, lorsqu’elles sont arrivées en Europe dans les années 1970, le système était catastrophique, pas les maris, mais le système : les regards, les préjugés qu’on pouvait émettre sur elles si elles faisaient telles ou telles choses. Ce qu’elle mettent en cause, c’est avant toute chose la précarité de la situation d’immigration et d’exil, au sein de laquelle le rapprochement avec la communauté d’origine et le regard de chaque membre de cette communauté sur autrui compte alors énormément.
Un jour, en atelier, une femme, Zoubida Ben, a écrit un magnifique texte appelé « La statue immigrée ». Elle parlait d’une statue, très belle, dans un jardin, avec de beaux cheveux, les joues roses, etc. Un jour, un homme la voit, la met dans une boîte et l’emmène, la plongeant dans la solitude. Zoubida témoignait ici d’un traumatisme dans l’immigration, qui ne vient pas forcément de la méchanceté de son mari, mais du fait qu’elle n’aimait pas sortir, qu’elle avait peur, qu’elle se sentait seule, car elle ne parlait pas français ; elle restait donc chez elle toute la journée. Elle avait quitté un univers avec des couleurs, de la rue, des bruits, pour se retrouver dans celui du cloisonnement.
Les personnes des institutions qui ont lu ce texte m’ont dit « C’est extraordinaire ce que tu as fait Jérémie, de les faire écrire ». Ce à quoi je leur ai répondu « Je ne les ai pas fait écrire, elles ont écrit » ; « Oui, mais tu te rends compte de ce que génère l’alphabétisation : cette femme, qui avant ne faisait que passer le balai chez elle, tout à coup, elle écrit des poèmes. » Ils ne se sont jamais dit que sa puissance expressive pouvait venir de sa culture orale – en l’occurrence, Zoubida est berbère et utilise beaucoup de métaphores charnelles, vivantes. Dans la tête de l’institution, ces textes ne peuvent pas être le fruit de quelque chose qu’elle avait avant d’être alphabétisée – et c’est justement ce regard déculturant qui met en danger les personnes issues de l’immigration.
Quand je demande à certaines femmes « C’est quoi ta langue ? », il leur arrive de me répondre « Mon dialecte ? ». Je me demande où ces femmes, qui ont connu la colonisation de leur pays, ont appris qu’elles n’avaient pas une langue, mais un dialecte, sinon en cours d’alphabétisation ? Il y a une foule de confusions dans leur tête, transmises par les associations d’accueil des migrants. La première langue qu’elles découvrent serait le français, tandis qu’avant, elles devaient se contenter d’un dialecte. Or, du point de vue occidental, ceux qui n’ont pas de langue sont en filigrane ramenés au statut d’animaux, d’où la violence de ces évidences.
Bref, je crois que je ne fais rien de spécial, si ce n’est tenter d’adopter un regard décolonial, sans prétendre être pour autant exempt de colonialité. Mon parcours fait que, quand je travaille avec les migrants, je pense vraiment qu’ils vont m’apprendre quelque chose. Je pense qu’ils ont des réponses à mes problèmes, et à ceux de ma société. C’est ce changement de regard qui fait que, tout à coup, des choses se disent, quand on arrête de les subjectiviser seulement comme des « sans » quelque chose. Quand je rencontre des migrants, je me nourris, et quand je me nourris, je ne les dévore pas. Que s’est-il passé dans l’histoire pour que certains en arrivent à croire que des personnes issues de civilisations où tout n’est pas fondé sur l’écrit, qui ont vécu la violence coloniale, qui n’ont pas su gagner la guerre face à la colonisation, sont des personnes à qui l’on s’adresse comme si on devait les émanciper ?
Oui, mais par rapport à ton expérience, on se dit qu’il y a quand même quelque chose à changer dans ces grands programmes d’alphabétisation…
L’alphabétisation m’intéresse, mais « par ailleurs », en quelque sorte. C’est un terrain qui révèle des choses, justement parce qu’il prétend être émancipateur. Le premier acte militaire de la guerre d’Algérie a été la mise en place de campagnes d’alphabétisation. Il y a des textes sur l’alphabétisation de l’époque expliquant qu’il s’agit seulement d’enseigner le nécessaire de la langue pour que les indigènes puissent travailler sur les tâches auxquelles on les a assignés[5. À ce sujet, voir Léon-Jean Calvet, Linguistique et colonialisme. Petit traité de glottophagie, éd. Petite Bibliothèque Payot, (1974), 2002.]. Or il y a encore des associations aujourd’hui pour dire la même chose. Ça s’appelle l’« insertion professionnelle » : quand on demande de donner des cours pour apprendre aux gens à lire ce qu’il y a d’écrit sur les produits nettoyants et les cartes de métro.
En France et en Belgique, il y a des méthodes d’alphabétisation qui ont été créées pour des adultes occidentaux. Ce sont souvent des gens avec des histoires de vie très difficiles, de précarité, de viol, d’alcoolisme. Or ce sont ces mêmes méthodes qui sont aujourd’hui utilisées pour alphabétiser les migrants. Quand on reçoit un Peul de Mauritanie – qui connait le Coran par cœur, qui te raconte toute l’histoire de sa lignée, qui connait plein de gestes hérités de génération en génération – avec les mêmes méthodes que pour quelqu’un du Quart-Monde français qui ne sait pas lire et écrire, on fait rentrer ce Peul dans la même misère, on lui demande de revêtir un vêtement psychique et misérable qui n’est pas le sien. Quand la personne migrante est lettrée dans sa langue, on appelle d’ailleurs cela un « analphabète partiel ». Il y aura toujours des termes comme ça, très insultants de fait.
Nous en sommes amenés à considérer que nous existons seulement parce que nous savons lire et écrire. En dehors de cela, on est nul. Ma propre famille était composée de paysans installés sur les hauteurs de Nice. Beaucoup de gens vivaient de la terre, des jardins qu’ils cultivaient. Tous leurs enfants ont fait des études, et ont grandi dans la honte de leurs parents qui ne savaient pas bien lire et écrire. Le message est passé. Si tu ne sais pas lire et écrire, tu n’es rien, et si tu n’es rien, c’est qu’en dehors de la lecture et de l’écriture, il n’y a pas grand-chose. On comprend alors la déculturation à laquelle sont confrontés les migrants, et à laquelle ils résistent. Elle rend compte du fait qu’on a le sentiment, sans doute fondé sur une réalité partielle et pragmatique, qu’il n’y a rien en dehors de la culture que l’on reçoit à l’école.

Quel lien fais-tu entre la colonisation des pays du Sud et celle, plus interne, qui a été menée à l’intérieur même des empires comme la France, lorsqu’on a interdit aux Occitans, aux Bretons ou aux Basques de parler leur langue et de faire vivre leur culture ?
Dans mon livre[6. Portrait du colonialiste, L’effet boomerang de sa violence et de ses destructions, éd. La découverte, coll. Les empêcheurs de penser en rond, 2011.], j’aurais pu parler de la Corse, du Pays Basque, etc., mais je ne l’ai pas fait, car j’avais peur de ne pas assez maîtriser le sujet. À la base du livre, il y a la certitude que, par exemple, si des résistances armées – ou, du moins, fermes – ont existé, et ont parfois remporté des victoires contre la culture dominante, c’est parce qu’il y avait une protection communautaire. S’il n’y a pas cette protection communautaire, il n’y a pas de résistance qui incite l’État à négocier. Le fait que cette résistance existe dans certains pays de France, c’est très important.
On peut partir des traces culturelles qui existent encore en Europe de l’Ouest, dans un travail de reconquête, de recréation communautaire et culturelle. À propos des bals traditionnels, par exemple, j’ai reçu plusieurs messages de danseurs en colère, car j’ai dit que nous n’avions plus de danses populaires. Je pense en effet que les danses populaires ont fini par être cadrées, et ont perdu de la fluidité, de la subtilité dans le rapport aux rythmes. Je ne dénigre pas ces danses, je pense même que c’est à partir de ça qu’on reconstruira quelque chose, mais il serait intéressant de se demander comment elles peuvent se refluidifier…
Quasiment presque toutes les danses extra-occidentales utilisent les hanches, c’est-à-dire libèrent le haut du corps en permettant à l’énergie de circuler. Les hanches sont le centre du corps, le lien entre le bas et le haut. Même dans les danses khmers où les mouvements de hanches sont peu présents, il y a de la fluidité, une fluidité incroyable liée à l’extrême précision de la diversité gestuelle et à l’implication de chaque partie détaillée du corps : le visage, les yeux, le cou, les épaules. Dans la danse, le maître mot est selon moi celui de « fluide » : la manière dont circule l’énergie d’une partie du corps à l’autre.
En Martinique, par exemple, ils ont le Bèlè, qui était une danse cadrante issue des danses de cour occidentales. Les Martiniquais ont créolisé les quadrilles, avec des mouvements fluides, en réintroduisant les mouvements de hanche, sans lesquels l’énergie ne circule pas du bas vers le haut du corps. Ils se sont réapproprié cette danse. Je pense que, comme eux, il faut partir des bals trad’, et les créoliser. Une question de réappropriation des cultures populaires serait donc : comment réintroduit-on les hanches dans les danses bretonnes, qui se dansent pourtant sur une musique fortement pulsionnelle ?
Tu parles beaucoup de l’Occident, et des parcours des migrants vers l’Europe de l’Ouest. Mais même quand on est occidental et que l’on migre vers un autre pays, on subit ce phénomène. Ce rapport n’est pas propre à l’Occident…
C’est vrai qu’en Espagne, par exemple, il y a une ambiguïté, beaucoup de choses hybrides, avec la culture arabe, le flamenco, etc. Mais même sans cela, ils auraient été traités comme des chiens en arrivant en France. Ce regard colonial, déshumanisant, n’existe pas que sur les migrants lointains. Le philosophe Bernard Andrieu[7. Bernard Andrieu, Le Monde corporel, préface d’Alain Berthoz (Collège de France), Lausanne, éd. L’Âge d’Homme, 2010.] explique qu’en Occident, il y a une sacralisation du corps, mais à partir du moment où tu deviens malade, chômeur, tu es en voie de déshumanisation, tu n’as pas le droit à ce respect au corps. Les philosophes de la décolonisation, comme Frantz Fanon, Albert Memmi ou Édouard Glissant, ont identifié les conséquences des formes d’oppression infériorisante, qui laissent des traces autant psychologiques que physiologiques – et cela ne concerne évidemment pas que les personnes issues de pays colonisés. L’enjeu pour moi aujourd’hui est d’étudier le colonialisme, peut être dans une sorte d’anthropologie inversée de celui-ci, c’est-à-dire des conséquences du colonialisme sur nos corps d’occidentalisés et nos modes de vie.
La critique du colonialisme ne serait-elle pas qu’un aspect de la critique de la domination en général ? La honte d’être italien ou espagnol ressemble à la honte qu’on retrouve chez les Occitans de parler leur langue, par exemple…
Oui : nous sommes nous-mêmes des colonisés. Je le répète : à l’origine du colonialisme, il y a une mise à disposition du vivant et de toutes les cultures rétives à cette mise à disposition. Le phénomène des enclosures[8. C’est-à-dire la mise en clôture des cultures paysannes en Angleterre, dépossédant le peule des « communs » et achevant la chasse aux « sorcières », guérisseuses installées dans les zones non appropriées par les possédants. À ce sujet, voir Starhawk, op. cit., et Isabelle Stengers avec Philippe Pignarre, La sorcellerie capitaliste, éd. La découverte, 2005. ] en est le révélateur. L’aliénation culturelle commence quand on accepte de travailler la terre selon les exigences du marché, et non plus pour se nourrir. La chasse aux sorcières, c’est avant tout le massacre de toutes les personnes qui ont une pratique thérapeutique, femmes ou hommes, en dehors des exigences du capitalisme. Cela a provoqué entre 500 000 et un million de morts, et c’est un des socles culturels de l’Europe de l’Ouest.
Or les premières victimes de cette histoire, ce sont les Européens de l’Ouest eux-mêmes. Ils ont été obligés d’accepter cette domination, de dénoncer les sorcières, de se couper d’elles pour survivre. On a introduit en nous la haine de notre propre culture, et en cela, on peut parler de fait colonial. C’est ce que dit Starhawk dans son livre Femmes, magie et politique : « Pour tuer une culture, il faut tuer ses thérapeutes. »
*
En guise de conclusion, j’aimerais revenir sur le concept de « culture » en rappelant les définitions assez symptomatiques que le Petit Robert donne du terme. J’en retiendrai trois :
1. Action de cultiver (la terre).
2. Ensemble des aspects intellectuels, artistiques d’une civilisation.
3. Ensemble des formes acquises de comportement dans les sociétés humaines.
Ces trois sens sont à la fois potentiellement complémentaires et conflictuels. Le premier sens est somme toute le plus important : l’action de cultiver une terre, car cela implique la création d’un ensemble complexe de procédés dépassant largement le seul geste agricole, et la capacité d’écoute du vivant, de transmission, dans un réglage des comportements humains permettant d’éviter par exemple l’impossibilité de la culture (de la terre). L’action de cultiver la terre implique la seconde définition : l’ensemble des aspects intellectuels, artistiques d’une civilisation, car ce sont ces aspects qui conditionnent et sont déterminés par la culture de la terre.
Ensuite, la condition sine qua none d’une approche non coloniale d’une culture extra-occidentale est de la considérer sans oublier la seconde définition, soit comme une civilisation productrice de savoirs. Dire cela peut sembler une évidence. Je relativiserais cette impression d’évidence en rappelant qu’actuellement, dans diverses universités, on demande aux anthropologues en construction de bien faire attention aux représentations se cachant derrière les faits, les productions et pratiques culturelles observées. Ce qui revient au final à continuer d’adopter la posture de celui qui pense pouvoir penser pour l’autre. L’autre « fait », tandis que l’anthropologue révèle et « fait savoir ». Au regard de l’histoire, toute approche d’une culture extra-occidentale, sur quelque point que ce soit – l’union, l’échange, l’agriculture, les mythes contemporains – qui ne prendrait pas en compte les aspects intellectuels et artistiques (les réduisant à leur fonctionnalisme par exemple), et qui en cela ne cesserait de les « inconscientiser », aurait bien du mal à se départir d’une certaine forme imposante de colonialisme et de tentative renouvelée de chosification de l’extra-occidental.
Il ne faut pas sous estimer notre propre « enculturement » colonial, même s’il n’est jamais très agréable, évidemment, de le constater. Ce que je dis là relativement à la notion de culture, à travers laquelle on choisit d’appréhender une culture ou une société, me fait penser à ce que dit Alban Bensa quand, dans son ouvrage Après Lévi-Strauss[9. Alban Bensa, Après Lévi-Strauss. Pour une anthropologie à taille humaine, éd. Textuel, coll. Conversations pour demain, 2010.], il évoque l’avalement par la structure ou la réduction à la structure des mythes et des dynamiques sociales indigènes par Lévi-Strauss :
« (Lévi-Strauss) s’est dit influencé par Marx… J’ai les plus grandes réserves sur ce point. Mais par Platon et Kant, assurément. La montée rapide en généralités pour rejoindre des schémas interprétatifs englobant quantités de cas concrets est encore très représentée dans les sciences sociales : beaucoup d’analyses actuelles projettent sur des sociétés ou des situations des idées simples, voire simplistes. (…) Il faut aussi reconnaître un déni de communication partagée, qui produit un effet de lecture saisissant : face à l’anthropologue tout puissant, l’observé est généralement mutique – aussi silencieux qu’une structure. Cette privation de principe de sa parole dans le texte final ne va pas sans poser des questions hautement politiques. »
En revanche, pour ce qui concerne l’investigation anthropologique du monde occidentalisé, il peut être très intéressant et même salutaire de s’en tenir à la troisième définition du mot culture : Ensemble des formes acquises de comportement. Car si les extra-occidentaux ne sont certainement pas en besoin d’explications relatives à leurs formes acquises de comportement – ils en sont, je pense, au contraire, saturés –, les occidentalisés, eux, en ont terriblement besoin. Il s’agit là de révéler l’« enculturement » colonial de nos modes de vie. Si les Européens vivent les conséquences d’une forme de colonisation qu’ils ignorent, elle est doublée et recouverte d’une colonialisation (fait de rendre colonialiste). La décolonisation passe par la « décolonialisation » en ce qui concerne les Européens de l’Ouest.
*
Ateliers d’histoires populaires de Vaour : présentation
C’est surtout l’histoire des puissants que l’on apprend à l’école, que l’on nous raconte dans les grands médias : celle des « grands hommes » et des grands événements, celle du Progrès, celle des vainqueurs, en fait. Une histoire officielle, monolithique et inévitable.
Les histoires des gens ordinaires, de leur quotidien, de leurs tentatives pour s’organiser entre eux, pour résister, sont le plus souvent ignorées. Certains chemins ont été laissés de côté par la majorité, certaines manières de vivre et certains savoir-faire ont été mis au rancart par les pouvoirs en place. Pourtant les brèches, parfois incroyables, ouvertes par des mouvements populaires ou intellectuels qui ont ensuite été étouffés, sont dignes d’intérêt. C’est à ces brèches et à ces chemins d’une surprenante actualité, que les Ateliers d’ histoires populaires de Vaour (Tarn) sont consacrés. Les conférences sont ouvertes à tous et visent à susciter le débat, y compris sur notre époque et notre avenir.
*
Illustrations : Henry Ray Clark (1936-2006) – Surnommé « The Magnificent Pretty Boy » dans les rues de Houston, il est condamné à 25 ans de prison après un meurtre commis au cours d’un deal de drogue. C’est derrière les barreaux qu’il développe son art, dont quelques toiles ici présentées.

by Ferdinand Cazalis | 19 mai 2015 | Terrains vagues
Comment Paris s’est-elle transfigurée au cours des derniers siècles pour finir vidée de ses habitants les plus pauvres, emportant avec eux les amorces de mutuellisme et de solidarité populaire qu’ils avaient élaborés ? Comment s’est jouée en détail la gentrification depuis Belleville jusqu’aux couronnes qui entourent la capitale ? Que laissent présager les projets urbanistiques du Grand Paris en termes de nouveaux déplacements de populations, mais aussi de rapports de forces à réinventer ?
Entretien croisé avec Anne Clerval, géographe auteure de Paris sans le peuple aux éditions de La Découverte (2013) et Eric Hazan, auteur de L’invention de Paris (Seuil, 2002), Paris sous tension (La Fabrique, 2011) et plus récemment La dynamique de la révolte (La Fabrique, 2015). Eric Hazan est par ailleurs le fondateur des éditions La Fabrique qui viennent de publier un précieux travail sur l’histoire ouvrière de Paris d’Alain Rustenholz : De la banlieue rouge au Grand Paris (2015).
Télécharger l’article en PDF
Quelles sont les grandes politiques urbanistiques qui ont transformé le Paris populaire en le détruisant ? Comment peut-on se figurer aujourd’hui ce qu’a pu être ce Paris populaire ?
Eric Hazan : Le grand moment de bascule date des années Malraux-De Gaulle-Pompidou. Avant, on ne construisait pas grand-chose dans Paris. Les premiers coups ont été portés dès le début des années 1960 dans les « quartiers rouges », le 13e et le haut du 20e, qui avaient le tort de voter communiste. L’opération Malraux a eu un énorme impact sur les quartiers populaires : on a tout blanchi, tout rénové, et du coup les loyers ont massivement augmenté ; la population a changé. Dans les années 1950, le Marais que j’ai connu était un quartier noir de suie, sale et pauvre. Les hôtels historiques étaient en pleine décrépitude. Les cours étaient encombrées de charrettes à bras et d’appentis en tôle. Le quartier juif – la rue des Rosiers, la rue Ferdinand-Duval, la rue des Écouffes – était misérable. C’était d’ailleurs un phénomène ancien : dans Le cousin Pons, Balzac décrit déjà la décadence du Marais, depuis sa splendeur au XVIIe siècle, du temps de Madame de Sévigné. Sous Henri IV, sous Louis XIII, pendant la Fronde, le Marais était le centre politique et intellectuel du pays. Et puis, vers la fin du XVIIe siècle, la noblesse et la haute bourgeoisie en ont eu assez de ces rues étroites et sans lumière et ont émigré vers l’Ouest, où ils ont fait construire le faubourg Saint-Germain. Tout ce beau monde est parti vers les quartiers aérés, et le Marais est tombé en déshérence.
Je pense aussi à la Montagne Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement, dont l’histoire est bien décrite dans Paris insolite de Jean-Paul Clébert . J’ai vécu dans cette rue dans les années 1960 : le quartier était un domaine de clochards, qui faisaient leur toilette sur la petite fontaine en face de ce qui était l’École Polytechnique, dominant la place de la Contrescarpe.
Les années Pompidou ont davantage transformé Paris que l’ère Haussmann. Certes, Haussmann a commis deux crimes urbanistiques impardonnables : il a détruit l’île de la Cité et ses dix-sept églises pour en faire un désert où règnent le sabre – la Préfecture de Police –, le goupillon et le bistouri avec l’Hôtel-Dieu. Il a creusé un immense trou dans le quartier turbulent du Temple, trou qui est devenu la place de la République. Récemment, on a bien essayé de la ressusciter, mais d’un trou on ne peut pas faire une place. Cela dit, ailleurs, Haussmann faisait attention à limiter les dégâts. La percée emblématique du boulevard de Sébastopol a évidemment démoli une partie du quartier, mais de part et d’autre, à 50 mètres, on a la rue Saint-Martin et la rue Saint-Denis à peu près intactes. L’urbanisme de Haussmann ne visait pas à détruire des quartiers, mais à créer des axes de circulation, avec un objectif militaire évident : de la caserne de la place de la République (du Château-d’Eau à l’époque), on pouvait faire partir la cavalerie et l’artillerie dans toutes les directions, aussi bien vers Montmartre que vers Belleville.
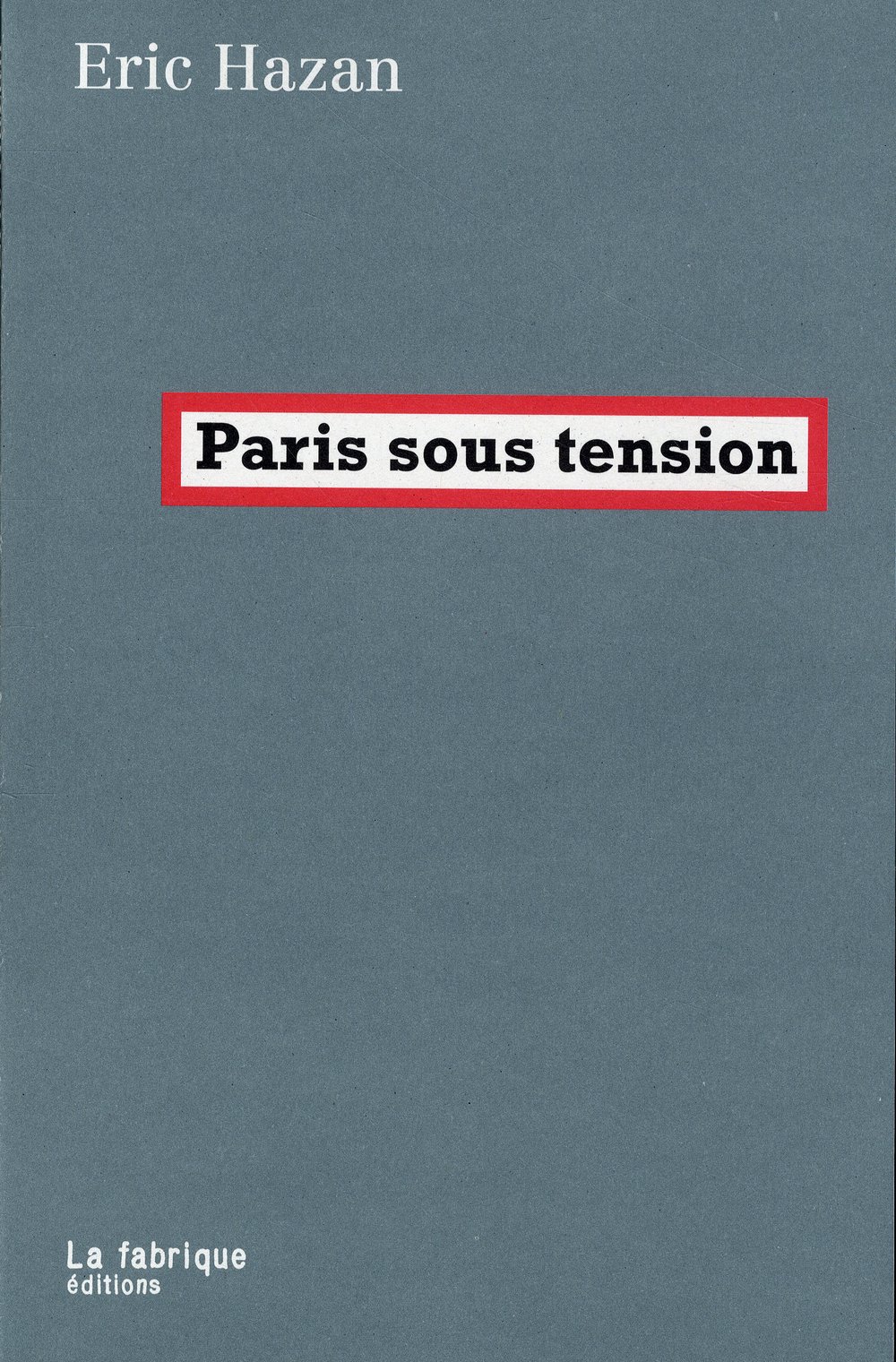
Avec Pompidou, cet aspect militaire de l’aménagement urbain disparaît ?
Anne Clerval : Sous Haussmann, on est en plein boom industriel. Il y a un afflux énorme de ruraux et d’immigrants qui viennent renforcer la classe ouvrière parisienne. Quand, un siècle plus tard, Pompidou intervient, ce n’est pas du tout le même contexte : la désindustrialisation commence, le tissu d’activités se relâche. La réorganisation de la production a été un mouvement lent et progressif, mais elle a contribué à évincer de Paris les classes populaires. Pompidou est un accélérateur de ce phénomène, mais on y avait déjà pensé avant. Il y a une citation dans le livre d’Eric Hazan (L’invention de Paris), qui remonte aux années 1850 : « Paris n’a pas besoin de posséder en son sein tant de manufactures, tant de grandes usines. La destination de notre capitale, c’est d’être une ville de luxe et de plaisir. » (Auguste Chevalier) [2.Auguste Chevalier, Du déplacement de la population, de ses causes, de ses effets, des mesures à prendre pour y mettre un terme, 1850.]. Cela permet de comprendre l’édification des grands magasins sous Haussmann, mais les quartiers de misère ont continué d’exister, alors qu’ils furent peu à peu évincés sous Pompidou.
Or ces quartiers étaient tenus par un tissu social riche de sens, caractérisé par une forte interconnaissance locale et par des pratiques quotidiennes d’entraide et de solidarité (ce qui n’empêchait pas malgré tout les concurrences et les rapports de force, y compris violents). C’est ce tissu social qui a servi de creuset pour la politisation du peuple parisien. Du mouvement des associations ouvrières des années 1840 (associations de consommateurs permettant de baisser le prix d’achat des biens de première nécessité, et associations de producteurs qui sont les premières formes des coopératives) est né une multitude d’organisations collectives ouvrières dans la deuxième moitié du XIXe siècle. En plus des syndicats de travailleurs (légalisés en 1884), la vie quotidienne des ouvriers s’organise en marge du capitalisme – à travers les sociétés de secours mutuel, les coopératives d’achat, les cantines populaires autogérées (notamment inspirées du « mutuellisme proudhonien »). Les quartiers populaires parisiens, comme dans d’autres villes industrielles telles que Barcelone un peu plus tard [3. Voir notamment l’excellent petit livre de Chris Ealham, Barcelone contre ses habitants. 1835-1937, quartiers ouvriers de la révolution, Éditions CMDE, Collectif des métiers de l’édition, 2014.], ont amorcé des pratiques d’auto-organisation sur une base de classe, qui donnaient corps au quotidien à une perspective révolutionnaire socialiste non autoritaire [4. Sur les prémices de cette conscience de classe ouvrière parisienne, voir la somme impressionnante de Maurizio Gribaudi, Paris ville ouvrière. Une histoire occultée (1789-1848), La Découverte, 2014.].
Outre les entraves et la répression qu’ont connues ces pratiques d’auto-organisation ouvrière au XIXe siècle, la désindustrialisation, et avant elle, l’atomisation des lieux et des collectifs de travail, ainsi que la rénovation urbaine pompidolienne ou l’éviction d’une partie du peuple parisien en banlieue, tous ces facteurs ont convergé vers l’affaiblissement de ces pratiques. De ce point de vue, la préoccupation sécuritaire (à des fins contre-révolutionnaires) n’a jamais disparu des politiques d’urbanisme, même si elle s’est euphémisée ou masquée. Mais l’hygiénisme est toujours à la fois sanitaire et moral, donc éminemment politique.
C’est tout ce tissu social et ces pratiques d’auto-organisation qui faisaient un quartier populaire et dont on ne retrouve que des traces dans ceux d’aujourd’hui, à travers des formes de solidarité quotidienne, des pratiques économiques autonomes, y compris illégales, dans un contexte de chômage de masse, et des associations locales, qui ne sont d’ailleurs pas toujours tenues par les classes populaires elles-mêmes.
EH : Mais pas intra-muros.
AC : Intra-muros, il y a encore aujourd’hui des formes de solidarités populaires, par exemple sur la base de l’origine nationale ou régionale des migrants (comme les Chinois de la région de Wen Zhou dans le 3e arrondissement et à Belleville). Ces formes de solidarité, non exemptes d’exploitation entre migrants de la même origine, permettent notamment aux commerçants chinois de réunir les sommes nécessaires à l’achat de commerce et la force de travail requise (en général fondée sur l’exploitation de la famille) pour faire tourner ce commerce. Comme on le voit dans cet exemple, il ne s’agit plus de formes de solidarités qui pouvaient se poser volontairement en rupture ou en marge du capitalisme et qui visaient l’abolition des rapports de classes. Cela n’est pas directement lié aux politiques d’urbanisme qui ont transformé les quartiers populaires, mais au contexte politique qui n’est plus le même, notamment en termes de mobilisation des classes populaires.
La désorganisation de la classe ouvrière est due à de multiples facteurs comme la réorganisation du travail sur un mode flexible, la désindustrialisation, la crise de la reproduction ouvrière à travers la massification scolaire, celle de la représentation ouvrière, elle-même liée à l’évolution bureaucratique des principaux syndicats, aux trahisons électoralistes des partis politiques sociaux-démocrates, et à l’histoire nationale et internationale du communisme autoritaire. Cette désorganisation a aussi une dimension spatiale, à travers la diversité de trajectoires résidentielles au sein des classes populaires entre les trajectoires des immigrés en France (nombreuses discriminations au logement qui confinent les primo-arrivants au logement privé dégradé ou sans confort et les cantonnent ensuite dans certains segments dévalorisés du parc social), celles des fractions stables des classes populaires (y compris immigrées ou issues de l’immigration) qui peuvent accéder à la propriété de plus en plus loin du centre, et celles des locataires du parc privé, souvent repoussés en périphérie par la hausse des prix immobiliers. Or ces trajectoires résidentielles sont de plus en plus contraintes par les pouvoirs publics [5. Voir à ce sujet, une bonne synthèse des recherches en sciences sociales au sujet des mobilités résidentielles des classes populaires : Sylvie Fol, Yoan Miot et Cécile Vignal (dir.), Mobilités résidentielles, territoires et politiques publiques, PU du Septentrion, 2014].
De telles divisions, exploitées de toutes parts, s’inscrivent aussi dans l’espace : ce sont des gens qui n’habitent pas forcément les mêmes quartiers ; par ailleurs, habiter un pavillon de banlieue, un grand ensemble d’habitat social ou un petit appartement parisien, ce n’est pas la même chose. Ce sont des clivages très forts. Ce n’est pas ce qu’on observait dans le Paris ouvrier. Certes, le peuple de Paris était composite, fait d’ouvriers de divers secteurs, d’employés du commerce et de domestiques mais aussi d’artisans et de petits commerçants indépendants, sans compter la diversité des origines géographiques. Pourtant, par la cohabitation dans les mêmes quartiers, par la diffusion des pratiques quotidiennes de solidarité et d’auto-organisation, et par la mobilisation politique, il y avait une vraie cohésion de cet ensemble hétérogène.
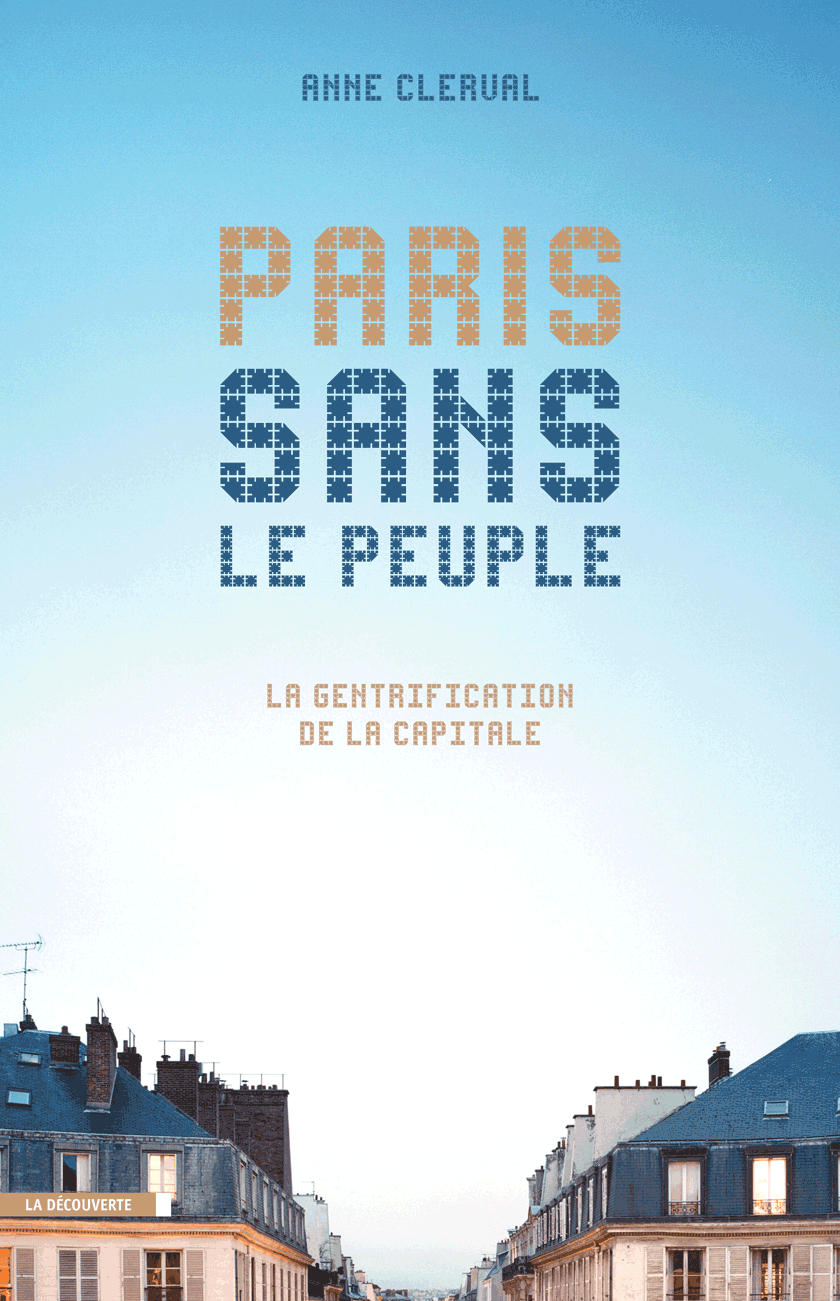
Aujourd’hui, quel est le rôle des pouvoirs publics dans la transformation urbaine et sociale de Paris, notamment celle des quartiers populaires ?
AC : Je ne crois pas que les choses aient été « planifiées » en région parisienne : le processus de gentrification, c’est-à-dire l’embourgeoisement des quartiers populaires par la transformation matérielle du quartier (notamment de l’habitat), est avant tout lié au marché immobilier privé et à la réhabilitation des logements par des ménages ou par des promoteurs, avec l’aide des banques (notamment à travers la baisse des taux des prêts immobiliers permettant la diffusion de l’accession à la propriété dans les classes intermédiaires). L’agrégation de tous ces facteurs a bien plus transformé les quartiers populaires de Paris que les politiques de rénovation urbaine des années 1970-1980. Disons simplement que les pouvoirs publics peuvent être des facilitateurs à certains moments.
À Paris, ils ont mis un certain temps à comprendre qu’il y avait une opportunité pour eux à soutenir ce processus. Jusqu’au milieu des années 1980, ce sont même des mesures de réglementation des loyers comme la loi de 1948 (qui encadrait strictement les loyers dans les logements construits avant cette date) qui ont freiné la gentrification. Jusqu’à la libéralisation des loyers par la loi Méhaignerie de 1986, redéfinie par la loi Malandain-Mermaz de 1989, la spéculation immobilière passait surtout par la démolition d’un immeuble entier et son remplacement par un immeuble neuf où les loyers étaient libres. On voit bien ce type de résidences privées haut de gamme des années 1970 dans le 15e arrondissement ou le long du canal Saint-Martin (10e) par exemple. Dans les années 1980, des ménages de la petite bourgeoisie intellectuelle ont commencé à accéder à la propriété dans des logements anciens des quartiers populaires qu’ils ont fait réhabiliter. La libéralisation des loyers et l’augmentation qui en a découlé, parallèlement à la baisse des taux des prêts immobiliers, ont accéléré ce processus. Ce faisant, ils valorisaient, symboliquement et financièrement, les logements anciens, même dans un tissu urbain de piètre qualité comme celui qu’on dit « faubourien ».
Or, dans le même temps, les pouvoirs publics (l’État, puis la mairie à partir des lois de décentralisation de 1982-1983) ont mené une politique de rénovation urbaine, c’est-à-dire de démolition/reconstruction d’îlots entiers, dits insalubres depuis la fin du XIXe siècle, et dont on considérait que le tissu urbain n’avait aucune valeur. La rénovation au bulldozer côtoyait déjà la patrimonialisation de tissus urbains « nobles » comme le Marais ou le faubourg Saint-Germain (préservés et réhabilités suite à la loi Malraux de 1962). C’est assez tardivement par rapport aux débuts du processus de gentrification que les pouvoirs publics ont compris que le tissu urbain populaire, faubourien, pouvait lui aussi favoriser l’accumulation de la rente foncière.
En 1995, le nouveau maire de Paris, Jean Tiberi (RPR) abandonne officiellement la politique de rénovation pour des raisons d’abord liées à des rapports de forces politiques (six arrondissements du Nord-Est parisien étaient alors passés à gauche). Le faubourg Saint-Antoine est un bon exemple de ce virage : jusqu’ici, les plans d’urbanisme prévoyaient de détruire les cours intérieures utilisées par l’artisanat du bois, pour reconstruire en ouvrant de nouvelles rues ou en comblant les parcelles. À partir de 1995, un plan d’occupation des sols spécial est mis en place pour préserver ces cours. Ce tissu urbain est ainsi revalorisé, c’est-à-dire les formes urbaines, mais pas le tissu social – car l’artisanat du bois est mourant et les classes populaires ont déjà commencé à partir, du fait de la hausse des loyers. On a donc préservé la forme, les cours artisanales, mais il n’y a plus d’ouvriers ni d’artisanat du bois, seulement des plaquettes publicitaires et un guide Gallimard sur l’histoire du quartier. Cette histoire n’est plus vivante, elle n’est plus qu’une queue de comète, une trace de ce qu’ont emporté la réorganisation mondiale de la production de ces trente dernières années et la nouvelle division internationale du travail.
Néanmoins, la rénovation urbaine s’est en fait poursuivie dans les quartiers de friches industrielles de l’Est parisien comme les ZAC Bercy (12e arrondissement) et Rive gauche (13e). Elle est encore à l’ordre du jour, dans le nord de Paris cette fois, avec le vaste projet de reconversion urbaine « Paris Nord-Est », le long du périphérique, à cheval sur les communes de Paris et d’Aubervilliers. Il s’agit de créer un nouveau pôle d’affaires dans un quartier de logements sociaux. L’originalité consiste à changer complètement la nature du quartier sans détruire pour l’instant les logements sociaux. On commence par construire des bureaux pour des cadres, des commerces destinés à cette nouvelle clientèle et des logements privés neufs (par des promoteurs immobiliers qui récupèrent l’augmentation de la rente foncière) et même un peu de nouveaux logements sociaux (dont une partie pour les classes moyennes). On modifie le quartier non pas en déplaçant les gens, mais en changeant l’équilibre de la composition sociale du quartier, ce qui transformera à terme la norme dominante dans l’espace public. Il s’agit d’une opération de gentrification planifiée par la reconversion d’anciennes friches industrielles et la démolition/reconstruction.
Dans le cadre de friches industrielles de l’ampleur de l’ancien entrepôt Macdonald, situé dans l’ancienne zone des fortifications de Paris où les logements sociaux dominent, le risque financier est trop important pour qu’un opérateur privé se lance dans l’opération. D’où l’appui des pouvoirs publics, à la fois pour récupérer les terrains, assumer le risque financier, notamment durant le temps important nécessaire à l’opération, et piloter le projet d’aménagement (en concertation étroite avec les investisseurs privés). Mais l’opérateur principal du projet Paris Nord-Est est BNP-Paribas, déjà auteur de la reconversion en bureaux (pour une de ses filiales financières) des anciens Moulins de Pantin le long du canal de l’Ourcq. Ce projet est révélateur d’un changement d’échelle de la gentrification : l’acteur principal n’est plus l’accédant à la propriété de classe intermédiaire mais un grand groupe financier de rang international. Et ce changement d’échelle s’appuie sur l’intervention publique.
Même s’il est difficile de généraliser pour ce qui concerne la banlieue, chaque municipalité menant sa propre politique, on constate qu’il y a souvent un appui public à l’augmentation de la rente foncière dans des quartiers populaires où elle était jusque-là sous-évaluée (extension d’une ligne de métro, projet urbain sur une friche industrielle comme les Docks de Saint-Ouen par exemple). À Montreuil, Bagnolet, Aubervilliers ou Saint-Denis, le Plan national pour la rénovation des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), une aide publique à la réhabilitation privée, a été un facteur déterminant. De tels plans sont des accélérateurs, ils permettent notamment de mettre dehors de petits propriétaires qui n’ont pas les moyens de faire des travaux, ou de virer les occupants sans-titre.
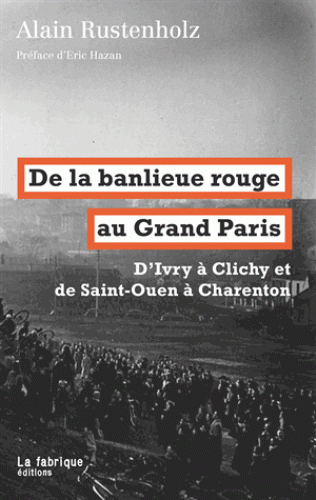
Pour bien se repérer, quelle définition pourriez-vous donner des notions de « tissu urbain » et de « tissu social » ? Quelles différences et imbrications mutuelles comportent-elles ?
AC : À mon sens, le « tissu urbain » désigne le bâti d’une ville, habitat, équipements, bâtiments d’activité, espace public et notamment réseau viaire. La métaphore du tissu rappelle que cela forme un tout, auquel l’histoire confère une certaine cohérence (ou incohérence pour les tissus dits hétéroclites et entrecoupés de ce qu’on nomme des « coupures urbaines », voie de chemin de fer ou autoroute par exemple, qui entravent la circulation piétonne d’un endroit à un autre). Mais cette image du tissu renvoie aussi à la représentation organique de la ville comme s’il s’agissait d’un être vivant. Cette représentation de la ville comme un organisme est discrètement réactionnaire : elle justifie les hiérarchies sociales (il y a une tête qui ordonne et des membres qui exécutent) et, plus généralement, naturalise les inégalités sociales qui se manifestent dans l’espace urbain. Les dysfonctionnements de la ville qui en découlent sont considérés comme des maladies : on parle de métastases urbaines, de thrombose des axes de communication. Et on peut continuer de filer la métaphore avec la médecine et la chirurgie : plutôt que de remettre en cause le mode de production capitaliste de la ville, il s’agit de la soigner, s’il le faut avec l’aide du bistouri (comme le dit l’historien Louis Chevalier dans L’assassinat de Paris). Il faut donc être vigilant quant à l’emploi de ce terme, notamment quand il est utilisé à la place de tissu social, charriant l’idée fausse selon laquelle on pourrait régler les questions sociales par une intervention sur l’espace urbain.
La notion de « tissu social » renvoie aux personnes qui vivent dans cet espace (pour ce qui nous occupe ici) et à l’ensemble des rapports sociaux qui les relient et les divisent. La gentrification a comme caractéristique de transformer à la fois le tissu urbain et le tissu social, révélant ainsi leur interaction.
EH : J’entends bien le danger du mot « tissu », si on le prend au sens de partie d’un corps vivant : ça tendrait à faire de la ville un organisme. Moi, je l’emploie au sens textile : une ville, ça se tricote, ce qui signifie d’une part lenteur – pour faire le beau centre d’Ivry, Renaudie a mis plus de vingt ans – et d’autre part échelle réduite. Les bonnes opérations d’urbanisme sont de petite taille, avec comme ancêtre l’axe Place Dauphine-Pont-Neuf-rue Dauphine, première opération d’urbanisme concerté à Paris.
Les différentes étapes de gentrification qui ont commencé dans les années 1980, au faubourg Saint-Antoine puis à Belleville, se sont-elles faites en douceur ?
EH : Au début des années 1990, il y a eu une résistance organisée autour de l’association La Bellevilleuse, dans le bas-Belleville. Le processus de démolition était pourtant bien engagé, avec l’ensemble du Nouveau-Belleville, la rue du Pressoir, le long du boulevard de Belleville – qui est un désastre urbanistique total. L’idée de base était que tout le bas du quartier, entre la rue des Couronnes et la rue de Belleville devait être détruit. Et là, on a connu une résistance, pas extrêmement structurée, mais qui a rassemblé les gens du quartier, jusqu’à l’abandon du projet, il y a 10 ou 15 ans. Récemment, tout le monde s’attendait à ce que soit détruit le petit immeuble à l’angle de la rue Ramponneau et du boulevard de Belleville, un relais de poste du XVIIe siècle en quasi ruines. Sous la pression du quartier, je pense, il a été retapé, et pas si mal. Aujourd’hui, il existe donc une sorte de résistance informelle, qui reste relativement efficace.
AC : Ce qu’il est néanmoins important de relever dans cette histoire, c’est qu’il ne s’agissait pas d’une lutte contre la gentrification, mais contre la rénovation. La victoire a consisté à arrêter le projet de démolition/reconstruction. Mais ceux qui ont mené cette lutte étaient les premiers gentrifieurs de Belleville, c’est-à-dire des gens qui avaient acheté et investi dans ce quartier très populaire, parfois délabré. Ils risquaient d’être expropriés et ont voulu défendre leur bien. Comme ils étaient de gauche, ils ont eu l’intelligence de tenir un discours sur la mixité sociale et sur l’importance de maintenir sur place tous les habitants pour préserver le quartier. Il y avait donc un double discours, non pas ambivalent, mais sur deux axes : la préservation du tissu urbain d’un côté et le maintien de la population sur place, du tissu social, de l’autre. Les arguments sur le tissu urbain ont fait mouche ; le 20e arrondissement est passé à gauche en 1995, et Tiberi a abandonné la rénovation en partie à cause de ce rapport de forces.
Pour autant, une fois que le projet a été abandonné, une Opération programmée de l’amélioration de l’habitat (Opah) a été lancée pour aider à la réhabilitation, sans préoccupation pour le maintien des habitants sur place : de fait, les loyers ont augmenté et le quartier a pris de la valeur. L’ambiance du quartier a progressivement changé, les cafés à la mode ont fleuri, puis le street art. Le ver était dans le fruit, puisque ceux qui ont mené la lutte ne faisaient pas partie des classes populaires – ils avaient bien une stratégie d’alliance de classes, mais que voulaient-ils sauvegarder le plus ? Le tissu urbain ou le tissu social ?
EH : Aujourd’hui, quand on se promène dans le quartier ou quand on y habite, on a l’impression que la rue ne représente pas l’habitat. Les gens viennent là parce qu’ils ont leurs habitudes, leurs cafés, leur marché, mais souvent ils habitent ailleurs, plus loin, en banlieue.
AC : Les vieux chibanis ont été obligés de déménager, mais ils reviennent tous les matins prendre leur café, parce que cela reste leur tissu social. Du coup, la rue renvoie l’impression d’être dans un vrai quartier populaire, mais quand on regarde la composition sociale des résidents, la part de cadres qui se sont installés là depuis une vingtaine d’années est sans commune mesure avec les banlieues populaires.
EH : Il y a cinq ans encore, l’idée qu’il puisse y avoir un jour une galerie d’art rue Ramponneau paraissait insensée. Aujourd’hui, il y en a moins cinq sur moins de 300 mètres. Depuis que j’y habite, il y avait une grande vitrine toujours fermée par un rideau de fer, une boutique d’articles religieux juifs. Et puis soudain, le rideau s’est levé sur une galerie d’art ! Rue Jouye-Rouve, qui est une petite perpendiculaire du boulevard de Belleville qui va vers le parc, c’est la même multiplication de galeries. Je ne comprends pas quelle est leur économie, leur public, comment elles survivent. Mais ce qui est sûr, c’est que les galeries d’art et les magasins bio sont deux signes symboliques et matériels de la gentrification.
AC : Matériels surtout, car concrètement, cela fait augmenter le prix des baux commerciaux et cela transforme la fréquentation. Il faut ajouter à cela l’effet de concentration : plusieurs galeries au même endroit, cela attire d’autres galeries. Or celles et ceux qui viennent dans ces galeries sont issu.e.s de la petite bourgeoisie intellectuelle, pas des classes populaires.
Par ailleurs, tous les logements sociaux ne sont pas bon signe : à Paris, beaucoup de « logements sociaux » sont destinés aux classes moyennes et contribuent donc à la gentrification. Ce qui se joue dans la question du maintien ou non d’une pratique ouverte au street art dans la rue Denoyez à Belleville relève d’une concurrence interne à la même classe : la petite bourgeoisie intellectuelle des artistes s’oppose à la petite bourgeoisie intellectuelle au pouvoir à la mairie. Les classes populaires n’ont pas grand-chose à voir là-dedans et ont toutes les chances d’être perdantes quelle que soit l’issue de ce conflit. En particulier, les demandeurs de logement sociaux, dont l’écrasante majorité appartient aux classes populaires, ne sont jamais consultés dans les projets urbains.
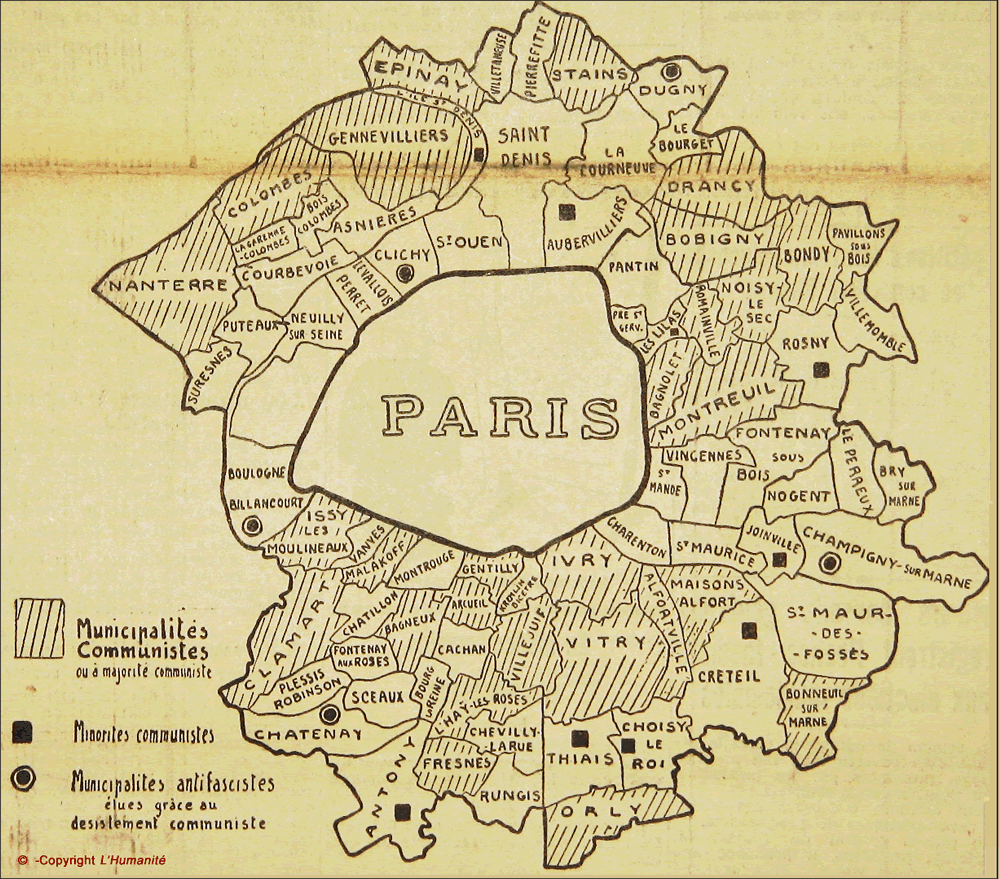
Que va modifier de plus le Grand Paris pour la ville et sa banlieue ?
EH : Je ne pense pas qu’il faille traiter la banlieue comme un tout, ce qu’on a tendance à faire dans trop de débats. La première couronne est en voie de gentrification ; par endroits, c’est déjà bien fait. Quand j’étais interne dans les années 1960, Levallois était un immense garage : de l’automobile d’occasion à perte de vue. Quand on voulait frimer, on allait acheter une décapotable là-bas. Aujourd’hui, c’est Thalès, la Sous-direction anti-terroriste (Sdat) et des résidences pour cadres.
Le bas d’Issy-les-Moulineaux était une grande friche jusque dans les années 1980, puis ça s’est transformé en zone de bureaux à toute vitesse. Ce phénomène ne se restreint plus à l’Ouest, il fait le tour, au Sud, Malakoff, Montrouge. Les éditions du Seuil sont boulevard Romain-Rolland, juste de l’autre côté du périphérique, mais toujours dans le 14e. Flammarion est au-delà de la BNF dans le 13e, presque à Ivry. À l’Est, ce n’est pas encore tout à fait le cas, Montreuil est sur la voie, mais pas entièrement. Pour la bourgeoisie, intellectuelle ou pas, il y a encore beaucoup à gagner dans l’Est parisien.
Ces avancées des classes moyennes signifient qu’une grande partie de la population qui habitait là est repoussée vers la couronne suivante. Chasser progressivement les pauvres vers la périphérie est un phénomène vieux d’au moins quatre siècles : c’est un processus historique lent, avec des moments d’accélération comme celui qu’on vit aujourd’hui, mais c’est un processus continu. Il n’y a jamais eu de retour des classes populaires vers le centre, pour l’instant.
AC : La banlieue n’est pas homogène, c’est vrai, de même que Paris. À Neuilly, on ne parle pas de gentrification, ç’a toujours été d’emblée une annexe des beaux quartiers. D’autres villes dans le prolongement, jusqu’à Saint-Germain-en-Laye ou Versailles, n’ont jamais vraiment été populaires. Ces beaux quartiers continuent de s’embourgeoiser, avec un renforcement de la présence des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Dans leur cas, on peut parler de filtrage social par le haut et de renforcement de leur exclusivité sociale. Le peu de classes moyennes et populaires qui y vivaient s’en va.
À Boulogne-Billancourt, à la fois ville bourgeoise et ouvrière, la fermeture des usines Renault et le projet d’aménagement de l’île Seguin ont joué le rôle d’accélérateurs. À Issy et Levallois, la gentrification a été planifiée par la droite. On a démoli puis construit des sièges d’entreprises et des logements haut de gamme.
Le projet du Grand Paris est un projet d’intensification de la gentrification, dans un contexte de métropolisation, c’est-à-dire de concentration des activités tertiaires stratégiques (finance, assurance, conseil, conception, etc.). Les futures gares du réseau Grand Paris Express s’accompagnent d’un Contrat de développement territorial (CDT), c’est-à-dire d’un projet d’aménagement urbain, de création ou de restructuration des nouveaux quartiers de gare : ce sont souvent des espaces peu denses qu’on va densifier. Les projets annoncent des bureaux, du logement haut de gamme, des équipements pour les nouvelles populations que l’on souhaite attirer, et aussi des logements sociaux. Tout le monde débat : y en aura-t-il 50%, 30% ou bien 20% ? Dans tous les cas, même si on en fait 50%, la moitié qui reste sera du logement privé neuf, donc cher et destiné aux cadres. Comme pour Paris Nord-Est, cela contribuera à la gentrification des quartiers actuellement populaires où est prévue l’implantation d’une gare du nouveau réseau.
EH : On a une chance, c’est qu’il n’y a plus d’argent public. Le drame des années 1960 dont on parlait, c’est que l’argent coulait à flots. Il y a eu un mécanisme de ciseaux malencontreux entre cette période où l’argent abondait et le moment le plus bas du niveau de l’architecture et de l’urbanisme français.
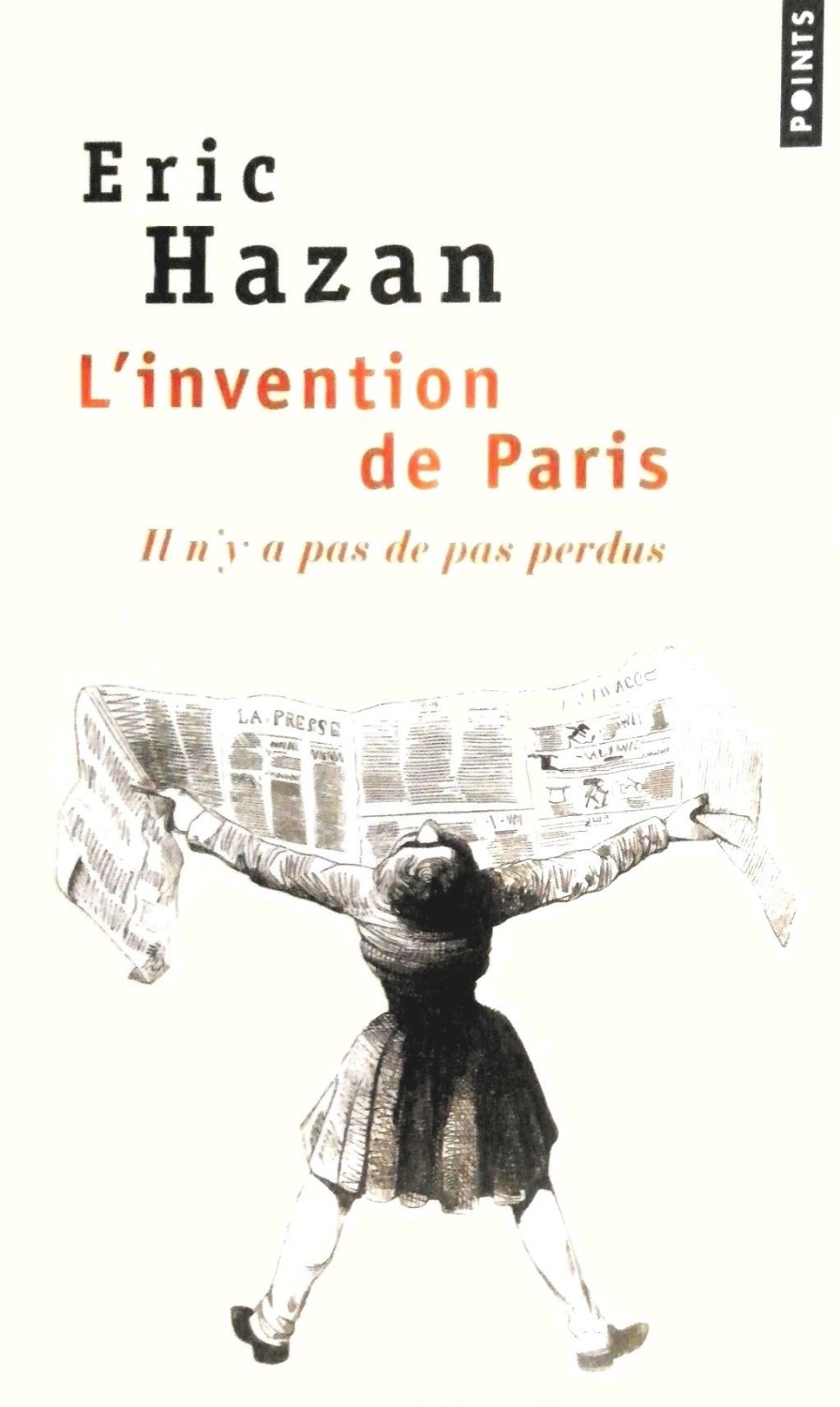
Sous Mitterrand, l’architecte Roland Castro est chargé en 1983 dans la banlieue lyonnaise de réaliser « l’achèvement du tissu urbain ». Est-ce que cette idée de « tissu urbain » n’intervient pas justement au moment où tout se désagrège ? Quel est ce lien entre tissu urbain et tissu social ? Quand on voit l’histoire des squats parisiens, à un moment donné, ce n’était plus possible, un squat ne tenait même pas un jour, donc forcément, on les trouve désormais à Montreuil, à Ivry, à Saint-Denis. Comment recréer une logique de tension, un rapport de forces avec le pouvoir ? Est-ce qu’on peut reprendre Paris ou bien faut-il lâcher le terrain ?
EH : C’est par la périphérie qu’on reprendra la ville. Paris ce n’est pas foutu, ce n’est pas irréversible. Il ne s’agit pas de l’abandonner, mais de la reprendre par une offensive venant de la périphérie. L’idée en vogue dans les milieux révolutionnaires, celle d’abandonner les métropoles, de partir vers d’autres territoires, ne me semble pas juste.
AC : Ça me fait penser à une planche de L’An 01 de Gébé, au moment où l’on construit les grands ensembles en banlieue : il représente Paris avec plein de tours autour, et puis un personnage dit : « Merde, on s’est encore fait virer de Paris ! », et un autre répond : « Non, mais ils sont complètement cons : on les encercle ! »
À partir de là, on peut réfléchir à comment relier tissu urbain et tissu social. Les quartiers populaires n’ont quasiment jamais été construits par les classes populaires elles-mêmes, sauf peut-être en banlieue, dans les petites zones pavillonnaires ; sinon, il s’agit de promoteurs privés, de petits-bourgeois qui ont créé des immeubles de rapport voués à la location. Cela dit, vu le manque d’intervention des pouvoirs publics et des propriétaires, les classes populaires ont tissé des formes sociales à partir de ces formes urbaines de piètre qualité et vite dégradées. C’est ce que je disais tout à l’heure à propos des pratiques d’auto-organisation ouvrière à Paris ou à Barcelone. Elles permettaient d’envisager ce que Lefebvre appelle le « droit à la ville », c’est-à-dire la capacité de décider collectivement de la façon de produire la ville et de ses finalités (versant urbain de la récupération et de l’autogestion de la production, afin de l’adapter aux besoins réels). Ce qui compte dans une perspective émancipatrice, ce n’est pas tant le tissu urbain que la capacité collective des habitants d’une ville à décider de la façon dont on le produit et l’utilise.
Au contraire de cette perspective, les urbanistes parlent de faire de la « couture » urbaine entre Paris et la banlieue. C’est une vision purement formelle qui n’a rien à voir avec le tissu social : il s’agit de recouvrir le périphérique, de faire de petits immeubles entre les grands immeubles pour recréer de la « continuité urbaine . On fétichise la forme urbaine comme si elle était productrice de tissu social sans remettre en cause le mode de production technocratique de la ville au service des classes dominantes et des intérêts du capital. Et tout cela est enrobé de discours sur le lien social, le vivre ensemble ou la mixité sociale, héritiers d’une pensée de collaboration de classe venue du catholicisme social au XIXe siècle pour faire barrage au socialisme. L’État n’a jamais autant mis en avant la mixité sociale que depuis le tournant de la rigueur du Parti socialiste en 1983 : depuis que le PS s’est rallié au capitalisme dans sa version néolibérale, le désengagement de l’État des structures keynésiennes de redistribution (relative) des richesses n’a pas cessé de s’approfondir. Or, plus les inégalités sociales augmentent, plus on exhorte au vivre ensemble des groupes sociaux de plus en plus antagonistes.
Remettre en cause la mixité sociale comme un dispositif de fabrique du consentement est déjà un premier élément de lutte contre la dépossession des classes populaires dans l’espace urbain. Mais en termes de stratégie politique, la priorité devrait être de retisser des solidarités de classe, par des pratiques d’entraide au quotidien, dans une perspective de lutte contre un régime politique et économique inégalitaire. Reprendre Paris semble pour l’instant difficile, mais il y a des choses à faire dans les banlieues populaires, notamment là où se trouvent les squatteurs, qui révèlent souvent malgré eux l’avant-garde du front de gentrification.
Aujourd’hui, on observe parfois un hiatus entre des gens qui sont héritiers des pensées et des pratiques du mouvement ouvrier, mais qui font le plus souvent partie de la classe intermédiaire, et les classes populaires, où la conscience de classe est très affaiblie. Pour retisser du lien social sur une base de classe et dans une perspective politique (ce qui est le contraire du lien social dépolitisant et consensuel que prônent les pouvoirs publics), il me semble qu’il faut s’appuyer sur ce qui existe déjà dans les banlieues populaires, notamment à partir des luttes de l’immigration et des descendants des immigrés. La défiance envers l’État est forte parmi les classes populaires racisées, il y a un travail de lien politique à faire avec elles. Mais pour cela, il faut accepter de partir des objectifs de lutte des classes populaires, qui peuvent aller de l’accès au logement social à la négociation avec les pouvoirs publics. Il y a parfois des refus dogmatiques de soutenir ce type de démarche au nom d’une certaine pureté politique. Or, historiquement, le mouvement ouvrier a politisé un nombre conséquent de personnes qui ont commencé à se battre pour seulement réduire le temps de travail, améliorer leurs conditions de travail et leur vie quotidienne. La radicalisation ne peut être un préalable aux luttes, elle se gagne dans les luttes.
Stratégiquement, on pourrait partir de là où sont les gens des classes populaires. Le but, c’est qu’ils s’organisent collectivement. Même si c’est juste pour un logement décent ou pour obtenir une indemnité de licenciement, le plus important, c’est le développement des pratiques d’auto-organisation collective et la politisation qui se fait à travers ces luttes. Et dans ces luttes, les militants comme des squatteurs peuvent se mettre d’emblée en position d’alliés et non de meneurs, pour ne pas reproduire les rapports de domination de classe et bien souvent de « race » – sans parler de la place que prennent les hommes dans ces luttes.

Pour aller plus loin :
Anne Clerval, Paris sans le peuple, éd. La Découverte, 2013.
Eric Hazan, L’invention de Paris, éd. Seuil, 2002.
Eric Hazan, Paris sous tension, éd. La Fabrique, 2011.
Eric Hazan, La dynamique de la révolte, éd. La Fabrique, 2015.
Alain Rustenholz, De la banlieue rouge au Grand Paris, éd. La Fabrique, 2015.
Chris Ealham, Barcelone contre ses habitants. 1835-1937, quartiers ouvriers de la révolution, éd. CMDE, Collectif des métiers de l’édition, 2014.
Maurizio Gribaudi, Paris ville ouvrière. Une histoire occultée (1789-1848), éd. La Découverte, 2014.
Sylvie Fol, Yoan Miot et Cécile Vignal (dir.), Mobilités résidentielles, territoires et politiques publiques, éd. PU du Septentrion, 2014.
Jean-Paul Clébert, Paris Insolite, éd. Attila, 2009.
Louis Chevalier, L’assassinat de Paris, éd. Ivréa, 1997.

by Ferdinand Cazalis | 25 avril 2015 | Marabout
Dire que l’on entend des voix, c’est souvent mettre un pied dans l’hôpital psychiatrique – or cela concernerait une personne sur dix. Enseignante à l’université Paris 8-Saint-Denis et à la Cornell University aux États-unis, Magali Molinié, psychologue de formation, a décidé de prendre au sérieux les entendeurs de voix. Plutôt que d’imposer un savoir universitaire et des catégories psychiatriques pour établir des diagnostics médicaux, elle participe à la création de groupes de personnes partageant une même expérience de perceptions inhabituelles et y faisant face ensemble. Ces groupes renouent avec des pratiques alternatives à la médicalisation psychiatrique, jusqu’à parfois faire de leurs voix des alliées précieuses.
Ce texte est extrait du numéro 1 de la version papier de Jef Klak, « Marabout », toujours disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF
Comment vous êtes-vous intéressée à l’entente de voix ?
Au cours de mes études de psychologie, j’ai rencontré les travaux de Tobie Nathan sur l’ethnopsychiatrie. Alors que je faisais une thèse sous sa direction, j’ai intégré sa consultation au Centre d’ethnopsychiatrie clinique Georges-Devereux et rencontré les familles migrantes qui y étaient accueillies. C’est dans ces conditions que j’ai découvert la richesse du dispositif de Nathan : accueillir les gens et discuter avec eux à partir de leurs théories à eux, celles qui existent dans le monde d’où ils viennent, et non à partir de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Les considérer comme des « experts », s’appuyer sur les richesses dont ils sont porteurs plutôt que se focaliser sur leurs carences.
À partir des questions qui étaient débattues au Centre à l’époque, sur des êtres tels que les djinns, les vents, les génies de l’eau qui s’invitaient dans les consultations, je me suis demandé si nous avions des êtres comparables dans notre monde. C’était le moment où, après un « stage » au Centre Devereux, l’anthropologue et sociologue des sciences Bruno Latour posait la question : Quels sont nos invisibles ?
Pour ma part, je me suis demandé s’il était possible de considérer les morts comme des êtres qui pouvaient eux aussi être convoqués dans un dispositif de recherche ou de soin. Un mort, certains d’entre nous peuvent l’entendre, le voir, lui parler, vouloir faire des choses pour lui. Il a un mode d’existence qu’il s’agit de comprendre dans ses singularités et qui se manifeste dans la relation nouée avec lui par l’endeuillé, le « deuilleur », comme j’ai préféré l’appeler.
C’est dans ce contexte, toujours au Centre Devereux, que j’ai entendu parler pour la première fois des entendeurs de voix, au début des années 2000. Nous avions reçu le petit livre de Paul Baker : La voix intérieure, Guide à l’usage (et au sujet) des personnes qui entendent des voix traduit à l’époque par des membres du Réseau suisse sur l’entente de voix (Reev). Mais, jusqu’à ma rencontre en 2010 avec le psychologue Yann Derobert, ces contacts avec l’entente de voix n’étaient que des prémisses qui auraient pu rester sans suite. Il avait noué des relations avec les animateurs du réseau international d’entendeurs de voix, Intervoice, et il nourrissait le projet de créer quelque chose de similaire en France.
Quelles sont les origines du mouvement Intervoice ?
On doit la création du mouvement à Marius Romme, un psychiatre néerlandais, en 1987. L’une de ses patientes, Patsy Hague, avait des voix très envahissantes qui l’empêchaient de faire ce qu’elle désirait, ainsi que des idées suicidaires. Il s’est rendu compte que ses outils traditionnels ne marchaient pas avec elle, et a décidé de changer d’approche. Pour rompre son isolement, Romme lui a proposé de discuter avec des personnes vivant une situation similaire. Il assistait aux discussions, et c’est comme ça qu’un embryon de groupe s’est mis en place, avec des échanges sans tabou au sujet de leurs perceptions inhabituelles.
En collaboration avec Sandra Escher, ils sont allés participer à une émission de télévision à grande audience, au cours de laquelle Patsy a exposé son problème en vue d’un appel à témoin. Plus de 700 personnes ont appelé, dont 450 avaient une expérience d’entente de voix. À partir de là, Romme et Escher ont mené des entretiens approfondis avec des gens qui arrivaient à faire face à leurs voix, et ils ont ainsi développé leurs connaissances sur le sujet. D’autres recherches l’ont confirmé depuis : le fait d’entendre des voix n’est pas en soi un signe de maladie mentale, environ une personne sur dix connaît cette expérience. Certes, il y a généralement une phase de choc, de surprise, la première fois que ça arrive ; les gens peuvent être déstabilisés. Mais beaucoup parviennent à trouver une explication satisfaisante à ces phénomènes et à s’en accommoder. C’est parfois plus problématique que ça, mais les différences ne se situent pas dans la manière dont on entend les voix ni dans ce que ces voix disent. Tout se joue plutôt dans la forme de relation entretenue avec elles : être effrayé ou non, se laisser envahir ou poser des limites, tenter d’ignorer les voix, ou les accueillir et interagir avec elles. Ce qui peut poser problème, en somme, c’est être démuni pour faire face aux voix.
Cette expérience et ces rencontres se passent à la fin des années 1980. Est-ce qu’avant cela l’entente de voix a toujours été psychiatrisée ?
L’histoire a retenu le daimôn de Socrate, les voix de Jeanne d’Arc… Un collègue philosophe me rappelait récemment que Descartes entendait une voix. Plus près de nous, Amélie Nothomb, Bill Viola, Zinédine Zidane ont fait état d’expériences de cet ordre.
Pendant longtemps, les voix étaient comprises à l’intérieur de cadres religieux et culturels, du côté des extases, des phénomènes de possession ou de voyance. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le spiritisme a fait éclore des médiums qui étaient en relation avec des défunts ou avec des entités de mondes extra-terrestres. La manière de catégoriser ces expériences comme relevant d’une pathologie médicale est historiquement liée à la naissance de la psychiatrie, à la même époque. Mystiques, possédées ou hystériques ? C’est la grande question que se posent les fondateurs de la psychiatrie et de la psychologie, comme Charcot ou Janet.
Cette transition historique tient à la construction de la psychiatrie comme profession, c’est-à-dire aussi comme pouvoir, et de son ambition d’enlever à l’Église le monopole qu’elle détenait jusqu’alors sur la charge des âmes. Dès les débuts de la psychiatrie, avec Pinel, et plus tard avec le paradigme de la maladie mentale, quelque chose s’est construit, encore très actif aujourd’hui : l’idée qu’il revient à une branche de la médecine, qui s’appelle psychiatrie, de catégoriser certains vécus et comportements comme relevant d’une maladie mentale dont la cause se situerait dans le cerveau. C’est dans un tel cadre que le fait d’entendre des voix est conçu comme l’un des symptômes-clés pour envisager un diagnostic de psychose, de schizophrénie.
Du coup, le mouvement des entendeurs de voix a pour objectif d’aider ces personnes sans passer par la case psychiatrie ?
L’intention première est d’offrir les moyens à des personnes qui entendent des voix de redevenir acteurs et auteurs de leur existence, de trouver les soutiens et les ressources, en elles et autour d’elles, pour construire la vie qu’elles estiment digne d’être vécue – à partir de leurs propres critères, et non de ceux imposés par des modèles de normativité extérieurs, qu’ils soient médicaux ou sociaux. Les personnes qui font ces expériences ont besoin de leur trouver un sens et de pouvoir en discuter librement, sans être immédiatement renvoyées à un diagnostic psychiatrique. Pouvoir en parler dans un climat de sécurité et de confiance – que ce soit avec des pairs, des proches, des soignants : tout cela permet aux personnes de se réapproprier cette expérience, les évènements de vie et les émotions qui y sont liés, et de trouver des stratégies pour y faire face.
Vous dites « faire face », est-ce que ça veut dire qu’il y a toujours un aspect agonistique ou tyrannique dans l’entente de voix ?
Ça dépend… Les gens peuvent avoir des voix sympa, qui peuvent être soutenantes, rassurantes, ou qui peuvent basculer dans quelque chose d’effrayant, harcelant, injurieux ou autoritaire. Ce ne sont pas toujours des voix personnifiées. Ça peut être des bruits, des murmures, une voix féminine ou masculine, une voix d’enfant. Pour d’autres, ce n’est pas simplement une voix, mais une personne, située dans la tête ou bien en dehors. Ou encore d’autres perceptions, comme le fait d’être touché, frappé, de sentir des odeurs…
Si on s’attache à leurs vécus, les personnes entendent vraiment les voix. Patsy Hague a réussi à convaincre Marius Romme sur ce point : les voix sont réelles, les gens les entendent réellement. Partant de là, tout ce qui est habituellement mis en œuvre par les soignants ou les médecins pour dire « Vous savez bien que c’est votre maladie, tout ceci n’existe que dans votre tête, vous l’imaginez, mais ça n’est pas réel », équivaut à un déni de la perception des personnes. C’est le début d’une longue série de malentendus qui ne favorisent pas l’établissement d’une relation authentique.
Au lieu de nier, on pourrait tout aussi bien dire : « D’accord, vous entendez une voix ; de quoi s’agit-il ? De qui s’agit-il ? Que dit-elle, comment le dit-elle ? À quel moment est-elle apparue ? » C’est souvent une expérience fondamentale pour les personnes, centrale dans leur vie. Elles ont plus que tout besoin que leur expérience soit reconnue, entendue, validée. Prendre en considération les voix et leurs contenus permet de les remettre en contexte dans l’histoire de vie de la personne qui les entend. À l’origine des voix, il y a certes souvent des expériences traumatiques, mais alors ce n’est plus la personne qui est « malade », c’est plutôt qu’elle a été blessée par des personnes ou par des évènements. C’est différent.
Les différents mouvements d’entendeurs de voix semblent s’organiser autour d’un dispositif en trois étapes : comprendre les voix, les accepter et s’y adapter. On retrouve là deux types de thérapie : un semblant de comportementalisme, dans le sens où l’on s’adapte aux voix, et une approche plus psychanalytique, dans l’exploration de la personne, de son histoire, qui vise à comprendre les voix…
Paul Baker et Marius Romme insistent tous deux pour dire que le mouvement sur l’entente des voix n’est pas une nouvelle proposition thérapeutique – c’est une proposition d’émancipation. Romme a dit un jour à Baker : « Nous n’allons pas changer la psychiatrie, nous n’allons pas changer les parents, mais offrir aux personnes qui entendent des voix une organisation à partir de laquelle ils peuvent s’émanciper eux-mêmes. Organise des groupes, et les psychiatres suivront. » Ils aiment tous deux rappeler qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle proposition thérapeutique, mais d’un nouveau paradigme. Surgit alors un nouveau régime d’obligations, pour reprendre un terme d’Isabelle Stengers. Parmi celles-ci : ne rien faire sans les entendeurs de voix – qui deviennent ainsi les contributeurs incontournables de la définition du changement qu’ils souhaitent pour eux –, faciliter leur mise en relation et auto-organisation, instaurer leurs savoirs expérientiels comme une expertise à part entière dont chacun peut bénéficier (y compris les experts « par formation »), valider l’existence des phénomènes qu’ils vivent, les « dépathologiser » (en les resituant dans un continuum avec des expériences de vie ordinaires)…

Qu’y a-t-il de nouveau ici par rapport à l’antipsychiatrie des années 1960-70, et sa démarche anti-médicament, anti-asilaire et anti-autoritaire ?
C’est que la proposition d’émancipation émane des entendeurs de voix eux-mêmes. C’est un mouvement qui vise à s’organiser « par le bas ». Beaucoup de ses animateurs sont des femmes et des hommes qui ont eu des diagnostics de schizophrénie, un long parcours en psychiatrie avant de s’engager dans leur parcours de rétablissement. Ils sont aujourd’hui des formateurs en santé mentale reconnus, certains sont devenus psychologues et chercheurs. Eleanor Longden, Jacqui Dillon, Ron Coleman, Peter Bullimore, et tant d’autres encore. Autant d’entendeurs de voix assumés qui témoignent de leur expérience de la folie et du rétablissement, et militent pour que les entendeurs de voix se donnent les moyens de leur auto-organisation. Un de ces moyens, outre les conférences publiques, les formations, les rassemblements et les congrès, c’est la mise en place de groupes sur l’entente de voix.
Il y a beaucoup de groupes d’entendeurs de voix en France ?
De plus en plus. Deux ou trois dans le Nord, deux à Paris, deux à Marseille, un à Nancy, d’autres en gestation – comme à Montpellier ou à Bordeaux. Donc entre six et neuf en France, pour l’instant…
Concrètement, comment ça s’organise ?
Avec notre secrétaire général, Vincent Demassiet, et avec Yann Derobert et d’autres, on tente de faciliter le fonctionnement du groupe et la poursuite des buts qu’il s’est fixés : prendre en considération les entendeurs de voix et leurs expériences, soutenir les initiatives locales qui vont dans le sens de leur mise en relation, diffuser les informations, mettre en place des formations. En fait, favoriser la mise en place de tous les dispositifs dont les entendeurs de voix pourraient avoir envie de se saisir, en particulier les groupes. Que ceux-ci dépendent ou pas d’une institution psychiatrique, l’idée est qu’à terme tous s’autonomisent, et qu’ils soient régulés (nous préférons dire : « facilités ») par des entendeurs eux-mêmes.
Mais ça commence toujours avec des personnes qui entendent des voix et d’autres qui les entourent (proches, etc.). À Paris, nous avons commencé comme ça, il y avait parmi nous Sonia et Christian qui entendaient des voix. On avait envie de créer un groupe, on se demandait comment faire, comment contacter les gens que ça pourrait intéresser… On tournait un peu en rond, on n’avait pas l’habitude.
Vous n’aviez pas envie d’aller à la télé comme Marius Romme et Patsy Hague ?
On n’y a pas pensé, non ! Je ne connaissais pas encore l’histoire à l’époque, et Sonia et Christian n’étaient pas en détresse par rapport à leurs voix. Christian n’avait pas d’histoire avec la psychiatrie ; Sonia, oui, et elle facilitait déjà un groupe. Finalement, nous avons organisé une journée de formation avec Ron Coleman à Paris. Ron est un survivant de la psychiatrie qui a rencontré dans son parcours de « schizophrène » un groupe d’entendeurs de voix à partir duquel il a pu commencer à se rétablir. Aujourd’hui, il est devenu formateur de premier plan dans le champ de l’entente de voix et du rétablissement. Nos formations incluent toujours les entendeurs de voix. À l’issue de la formation, on a pu commencer à mettre sur pied le premier groupe parisien avec des personnes qui étaient venues pour l’occasion.
Qu’est-ce qu’il se passe dans ces groupes ?
Ce sont des groupes d’entraide et non des groupes cliniques ou d’intervention thérapeutique. C’est le soutien entre pairs qui est actif, la considération respectueuse pour l’expérience vécue par autrui. Chaque groupe, du moment qu’il est formé, se dote de ses propres règles : comment parler en sécurité et en confiance, quelles sont les conditions à poser pour cela ? Ça débouche souvent sur des règles posant que ce qui se dit reste entre nous, que les convictions de chacun doivent être admises et respectées, qu’on parle à partir de soi, sans faire un discours sur l’autre, sans interprétation. On peut parler d’autre chose, mais ça reste principalement des groupes focalisés sur l’entente de voix, les stratégies pour composer avec elles, la compréhension qu’on en a, le sens qu’on leur donne.
Les groupes n’ont pas forcément pour objectif de se rétablir des voix ?
En effet. C’est important à préciser, parce que depuis tout à l’heure, j’emploie le terme « rétablissement » et il faut que je m’explique. Ces groupes n’ont pas pour objet de supprimer les voix. Eleanor Longden, par exemple, explique qu’on peut considérer les voix comme des messagères, porteuses de sens. Ce sens n’est pas forcément identifiable d’emblée – ça peut demander un long travail d’investigation –, mais les voix peuvent finir par se révéler des alliées précieuses.
Le terme « rétablissement » vient du mot recovery en anglais. Même si aucun des deux n’est totalement satisfaisant, on les utilise principalement pour marquer le contraste avec les termes médicaux de « guérison », « rémission » ou « stabilisation ». Le « rétablissement », pour nous, cela signifie qu’il appartient à chacun de définir ses propres critères de la vie, telle qu’elle lui parait digne d’être vécue.
Ce que vous dites porte une critique contre l’institution, et l’on pense alors à un projet d’autonomie, au refus d’une loi qui viendrait du pouvoir médical ou politique, et qui forcerait à s’adapter à un ensemble de règles décidées d’en haut ou d’on ne sait où. On a l’impression que dans le mouvement des entendeurs de voix, il y a un geste politique, sous-jacent, mais très présent…
C’est vrai qu’il y a de ça, mais j’ai appris à me méfier du mot « autonomie », parce que dans plein d’endroits, on fait des injonctions à l’autonomie sans donner aux gens les moyens d’y parvenir réellement, et ça finit par être très violent. Il y a sans doute un autre mot à trouver autour du pouvoir d’agir, de reprendre de la puissance… Pour l’instant, je préfère dire « auteur » ou « acteur » de sa propre vie, parce que cela met en relief la créativité nécessaire à ce qui se joue là. On est obligé d’inventer des choses pour devenir auteur de sa vie, ce n’est pas donné d’emblée, ça demande quelquefois un véritable effort, d’investigation, de réflexion, de pratiques… Mais aussi de sortir de la solitude et de pouvoir s’appuyer sur les autres. Les groupes sont utiles pour cela.
Il y a une forme de collectif qui se crée là…
C’est ça… Des alliés… La récupération d’un pouvoir d’agir, et en même temps des capacités de trouver des appuis, de s’offrir soi-même comme appui, des étayages, des solidarités – et tout cela produit des effets sur notre sociabilité. On n’est pas seuls, on est tous embarqués, à partir de nouvelles manières de fonctionner, d’être, de vivre.
Est-ce que vous percevez une continuité entre les groupes d’entendeurs de voix et vos premières recherches concernant les morts, les invisibles ?
Bien sûr, il y a des différences : j’ai appris sur les relations avec les morts en conduisant des entretiens individuels avec des personnes recrutées dans un cadre de recherche en psychologie, alors que le REV est un collectif dans lequel j’interviens plutôt en tant qu’activiste, et dans lequel ma formation de psychologue ne m’est pas très utile.
Mais il y a aussi des continuités. Certaines personnes vivent avec des êtres que les autres ne voient peut-être pas, mais qui sont pour eux très importants, avec qui se tissent des relations très investies. Si je veux pouvoir en parler avec eux, j’ai intérêt à respecter ce qu’ils me disent, à ne pas le mettre en doute, ne pas le critiquer ou le catégoriser comme un symptôme de maladie. Si je veux discuter avec quelqu’un sérieusement, honnêtement et authentiquement, je ne peux pas disqualifier ses convictions.
Ça veut dire qu’on donne une existence à l’objet de la croyance de l’autre…
Si ça existe pour la personne, alors je n’ai aucune raison de le remettre en cause. C’est un préalable à la possibilité d’un échange avec elle et pas seulement une question de respect pour ses croyances. Pourquoi parleriez-vous à quelqu’un de quelque chose qui vous importe plus que tout, si cette personne s’évertue à vous expliquer que vous vous trompez, que c’est un effet de votre imagination ou d’un déséquilibre chimique dans votre cerveau ?
Comment peut-on alors expliquer ce mépris généralisé pour des croyances qui, finalement, sont extrêmement partagées ? Ce sont des choses très diffuses et pourtant rabrouées, méprisées, invalidées. C’est étonnant comme paradoxe…
On hérite d’une histoire où toutes ces choses ont été comprises comme des signes, des messages à décrypter, comme ça peut encore l’être dans certains mondes : ces voix sont des messages envoyés par un être, et il s’agit d’identifier l’être, de décrypter le message qu’il envoie, etc. Le décryptage psychiatrique est tout autre, l’expérience inhabituelle n’y est plus un signe des relations qu’on peut entretenir avec des présences invisibles, mais un symptôme de maladie mentale.
Récemment, lors d’une formation, Peter Bullimore nous demandait de faire un petit exercice en exposant une croyance inhabituelle, qui serait la nôtre. On était en petits groupes, et je me suis rendu compte qu’il était très difficile de trouver une croyance inhabituelle… Par exemple, si je dis que je crois à la télépathie, est-ce si inhabituel que ça ? La transmission de pensées, tout le monde y croit un peu, non ? Certains en ont fait l’expérience… Une dame nous a dit qu’elle croyait au diable. Moi, comme ça, spontanément, je ne crois pas au diable ; mais si je réfléchis bien, je peux comprendre pourquoi on y croit, et ça me parait parfois très pertinent.
Je cherchais une croyance qui me serait propre et j’ai dit : « Je crois aux fantômes. » Finalement, on peut avoir mille manières de croire aux fantômes. Bref, je pense que Peter voulait attirer notre attention sur le fait que toutes les croyances qu’on peut catégoriser un peu vite comme délirantes sont aussi présentes dans le monde ordinaire. On m’a raconté récemment l’histoire d’un jeune qui a été déclaré délirant parce qu’il ne supportait pas la wifi : il éteignait celle de ses parents la nuit. Or, combien sommes-nous à penser qu’il est dangereux de s’exposer à ces fréquences ?
Comme vous dites, il y a mille manières de croire aux fantômes. Ce qui nous empêche d’assumer cette croyance, c’est souvent l’image médiatisée du fantôme, le drap blanc… Les espaces de la pensée sont très étroits…
Il est important d’arriver à transformer ces expériences, ces convictions en sources d’enseignement. Quelqu’un comme Eleanor Longden dont je parlais tout à l’heure, qui est passée par des moments très difficiles avec ses voix, affirme souvent qu’il n’est pas question pour elle aujourd’hui de s’en séparer. Elles sont devenues ses meilleures alliées pour la guider dans l’existence, pour comprendre des choses qui lui arrivent, et prendre les bonnes décisions. Elle explique par exemple que quand elle entend une certaine voix, elle sait qu’il est temps pour elle de faire un break, d’arrêter de travailler.
Illustration : Sup Umbra, par Yann Bagot

by Ferdinand Cazalis | 17 octobre 2014 | Contrôle continu, Terrains vagues
Non loin de Toulouse et d’Albi, dans le Tarn, tout est réuni pour un nouveau scandale écologique et politique. Une société d’économie mixte (CACG) juge et partie pour la construction d’un barrage destiné à l’agriculture industrielle, des violences policières inacceptables, des milices venues « casser du jeune », des enjeux au plus haut sommet de l’État où l’on voit le Parti radical de gauche (PRG) et son président Jean-Michel Baylet s’entendre avec le PS pour l’exploitation de quelques hectares de forêt…
Là où coulait un tranquille ruisseau, une lutte voit le jour contre le saccage des terres et pour une organisation sociale sensible à la notion de « bien commun ». Avant le rassemblement national du 25 octobre dans le Tarn, Jef Klak a rencontré deux opposant⋅e⋅s au projet de barrage pour comprendre les raisons et les enjeux de cette nouvelle ZAD (Zone à défendre).
Télécharger l’article en PDF
Est-il possible de nous faire un très bref historique du projet de barrage du Sivens ?
Dans le Tarn, entre Gaillac et Montauban, un ruisseau nommé Tescou traverse la forêt de Sivens et la zone humide du Testet. Une vallée tranquille où l’on venait se balader ou se ressourcer, chasser ou cueillir des champignons – des usages vernaculaires, non marchands et, dans un certain sens, vecteurs d’autonomie. Bref, le profil type d’un bout de territoire « qui ne sert à rien » pour les élus et les technocrates ; dans leur tête, l’idée trotte depuis soixante ans de « valoriser » cette terre pour en faire quelque chose qui serve au développement économique. Les rapports se sont succédé au bal des projets inutiles : plan d’eau, centre de loisirs, déchetterie… Le type de chantiers qui demandent de ravager un territoire jusqu’ici préservé, le mettre au service d’autres portions de territoire déjà saccagées, que ce soit par l’agriculture intensive, l’urbanisation ou le tourisme…
En 2001, une enquête d’utilité publique est lancée sur le « confortement de la ressource en eau du Tescou », jetant les prémices d’un projet de barrage dans la vallée du Tescou. En 2009, une seconde enquête est censée remettre à jour les résultats de 2001, mais les données n’ont pratiquement pas été modifiées, alors qu’en neuf ans le débit du Tescou s’est transformé, les besoins en irrigation et en dilution des pollutions ont évolué, de même que le nombre d’agriculteurs ayant besoin d’irriguer. Ensuite, le projet a reçu plusieurs avis défavorables de la part d’instances chargées du patrimoine et de l’environnement : le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) en 2012, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) en avril et en septembre 2013.

Télécharger la petite chronologie réalisée par Jef Klak
À quoi correspond l’appellation « zone humide » ?
À une stratégie environnementaliste de « zonage du territoire » (assez comparable à celle des gestionnaires) pour essayer de préserver des niches écologiques face à la bétonisation généralisée. Mais elle s’est montrée incapable d’enrayer un système qui détruit la nature. « Zone humide » renvoie à des endroits marécageux accueillant une faune et une flore particulièrement riches, mais cette catégorie ne vient pas du parler paysan lié aux usages vernaculaires du territoire : ici, on parle de « bouilles » et il s’agit de terre sans grande valeur économique (d’où le nom du collectif d’occupation « Tant qu’il y aura des bouilles »). Les bouilles, c’est les mauvaises terres où pousse la « mauvaise herbe »… Le terme « zone humide » renvoie au contraire à l’idée de « conservatoire » chère à certains écologistes. Depuis que la forêt a été ravagée, certains voudraient en ce sens forcer l’État à replanter et restaurer la zone dans son état d’avant la déforestation – un état qu’ils s’imaginent sauvage ou vierge.
Quand on traverse la région, beaucoup de forêts et de bois semblent épargnés, et la retenue d’eau concerne une petite superficie[2. La zone concernée est d’environ 40 hectares. Pour comparaison, la zone ciblée par le projet d’aéroport nantais s’étale sur presque 1500 hectares.]… Pourquoi ce projet a-t-il été décidé ici ? Y a-t-il d’autres enjeux qui font que c’est spécifiquement cette portion de territoire qui est visée depuis 30 ans ?
C’est vrai que de là où nous parlons, dans la région de causses et de forêts un peu plus au nord de Sivens, on a l’impression d’être dans une région préservée. Mais autour de la forêt de Sivens, c’est les plaines du Tarn et du Tarn-et-Garonne, avec leur agriculture et leur arboriculture intensives, des tournesols et des champs de maïs à perte de vue… Sivens est le début de cette zone de forêts et de collines qui remonte au Nord vers la Grésigne, puis s’étend vers l’Aveyron jusqu’au centre de la France. En terme géographique, géopolitique même, la signification pratique de ce barrage est que la « Beauce » du Tarn et du Tarn-et-Garonne étend son emprise sur un territoire qu’elle n’avait pas encore défiguré.
Il y a aussi cette histoire d’industrie laitière : l’un des arguments en faveur du barrage consistait à dire que l’eau du Tescou n’était pas utilisable par les agriculteurs parce qu’une industrie laitière Sodiaal y déverse ses déchets toxiques. Contrairement au discours ambiant qui s’émeut des catastrophes écologiques en cours, on préfère donc diluer les pollutions plutôt que les stopper[3. « Dans le Tarn, les citoyens font barrage pour sauver une zone humide », Pierre Souchay, Reporterre]…
L’agriculture industrielle est au cœur de cette lutte. Le conseil général martèle que la « retenue » servira à 70% pour l’irrigation et à 30% pour « soutenir l’étiage » du Tescou. C’est-à-dire qu’on aurait besoin du barrage pour la maïsiculture (très forte consommatrice d’eau), mais aussi, cerise sur le gâteau, pour diluer les pollutions d’une coopérative laitière industrielle (Sodiaal, c’est tout de même la cinquième coopérative de lait mondiale) et d’une station d’épuration. En effet, « soutenir l’étiage » du Tescou signifie faire en sorte qu’il y ait en été un niveau d’eau suffisant dans le Tescou, ruisseau qui a tendance à s’assécher, ce qui concentre les pollutions.
Qui est à l’origine de ce projet de barrage ?
L’initiative vient d’une compagnie d’économie mixte (public-privé), la CACG (Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne[4. La Société anonyme d’économie mixte CACG est à la fois une Société anonyme par action, de droits et de gestion privés et une Société d’aménagement régional (SAR).]), et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne – c’est-à-dire les deux sociétés qui gèrent le potentiel hydraulique de tout le bassin de la Garonne autour de Toulouse, en aval et en amont. La CACG a construit beaucoup de barrages et de retenues, à des fins différentes : certaines ont été faites pour la centrale nucléaire de Golfech et d’autres pour l’agriculture. Cette compagnie a 17 autres barrages dans les tiroirs pour les années à venir. Dans son conseil d’administration siègent beaucoup d’acteurs publics : André Cabot (vice-président du conseil général du Tarn et membre du conseil d’administration de l’Agence de l’eau Adour-Garonne), Christian Astruc (conseiller général du Tarn-et-Garonne), Jean-Louis Guilhaumon (vice-président de la région Midi-Pyrénées), Henri-Bernard Cartier (président de la Chambre régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées), Yannick Villeneuve (directeur du Centre d’affaires Gascogne Bigorre de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées), Bernard Lalane (Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées), etc.
Le projet est porté par les conseils généraux du Tarn et du Tarn-et-Garonne, avec l’appui de l’Union européenne. Un des détails que mettent en avant une partie des opposant⋅e⋅s, c’est que la CACG a mené à la fois l’étude d’utilité publique en 2001, et le chantier. C’est donc la même compagnie qui justifie le projet et qui le réalise, en plein conflit d’intérêts…
Quand l’opposition au projet de barrage s’est-elle mise en route ?
Basé à Lisle-sur-Tarn, le collectif de Sauvegarde du Testet (collectif-Testet) s’est créé en 2011 autour d’environnementalistes – Ben Lefetey (un ancien de Greenpeace) en est le porte-parole –, et ils réalisent un énorme travail de contre-expertise et de contestation du dossier, point par point.
Sur place, l’opposition a vu le jour en 2013, lorsque les travaux étaient censés commencer. Un petit groupe de gens a alors occupé la forêt, dont une ferme du conseil général préemptée il y a 30 ans : la Métairie Neuve. Les élus ont été pris au dépourvu et rappelés à certaines règles qu’ils n’avaient pas jugé bon d’appliquer, comme le fait de ne pas pouvoir déboiser pendant la nidification de certains oiseaux. Ainsi, grâce à l’action conjuguée des occupants et des écologistes, le chantier a été repoussé d’un an, jusqu’en septembre 2014.
Donc les opposant⋅e⋅s ont été expulsé⋅e⋅s à cette date-là ?
L’occupation a commencé le 23 octobre 2013 et un cycle expulsion-réoccupation-expulsion a débuté, avec des coups de force qui ne venaient pas toujours de la police ou de la gendarmerie.
De petites milices pro-barrage, ou anti-ZAD, se sont constituées dans la région, et ont procédé à l’expulsion de la ferme le 23 janvier dernier. Une vingtaine de personnes, arrivées dans cinq voitures aux plaques d’immatriculation cachées, cagoulées pour la plupart et avec des tronçonneuses pour masquer les bruits, ont envahi la maison et plaqué au sol les deux ou trois personnes présentes. Ils ont ensuite tout détruit à l’intérieur, cassé les portes et fenêtres, et répandu à l’intérieur un très puissant répulsif pour animaux.
Ce coup de force est parvenu à faire fuir les opposant⋅e⋅s ?
C’est plutôt l’inverse qui s’est passé : une telle violence a suscité pas mal d’émotion dans la région, c’est-à-dire que de cinq ou six personnes à rester sur place, on est vite passé à une vingtaine !
Avec le printemps s’est achevée la période légale de défrichement et les travaux ont été repoussés au mois de septembre. Fin août, plein de gens ont débarqué, et non seulement la Métairie Neuve a été réoccupée, mais on s’est mis à faire des camps dans différents endroits de la forêt : La Bouillonnante, Woodstock, etc.
Dès lors a débuté la valse des procédures d’expulsion qui concernaient d’une part des campements installés dans des zones expulsables – qui, après avoir été expulsés, étaient réoccupés le lendemain –, et d’autre part des campements situés dans des terrains non expulsables, c’est-à-dire qui appartiennent à des privés (comme une famille de paysans, opposée au barrage, qui a mis à certains moments des parcelles à disposition). Les opposant⋅e⋅s déposaient une caravane avec une boîte aux lettres dessus et faisaient constater leur présence sur les lieux, ce qui ouvre une procédure qui peut durer des mois avant l’avis d’expulsion légale.
Certaines parcelles occupées ne sont pas expulsables pour le moment. Celle nommée « Gazad » par exemple : c’est un petit terrain qui, à l’heure actuelle, est enclavé en plein cœur de la zone, et littéralement assiégé par les gendarmes mobiles. Les opposant⋅e⋅s restent dans des caravanes et des tentes toute la journée, parce que dès qu’ils sortent, ils se font menacer, molester ou interpeller sans motif, au beau milieu des travaux. Cette parcelle d’un demi-hectare était très belle. Désormais, c’est juste un désert : il n’y a plus un seul arbre autour, seulement des caravanes et des tentes en plein cagnard – et la violence des gendarmes mobiles 24h/24, menant la guerre des nerfs avec les « zadistes » (les occupants de la « Zone à défendre »).
Concrètement comment se sont déroulés les travaux de déforestation et la résistance ?
La zone comprend trois entrées : par Barat qui donne sur la Métairie Neuve, par la D999 où il n’y a jamais eu de campement durable, puis par la forêt de Sivens, où il y a des jeux pour enfants, des sentiers de promenade et un espace d’accueil des groupes scolaires pour initier les enfants à la « protection de l’environnement » – quel cynisme de déboiser pile à cet endroit, à moins que cela ne révèle la vraie nature des politiques d’éducation à l’environnement. Là, il y a eu un gros campement avec quelques dizaines de personnes.
Le 1er septembre dernier, les travaux ont recommencé. La première semaine, il s’agissait d’un travail d’approche : les gendarmes ont commencé à arriver sur le terrain, il y a eu des naturalistes pour prélever les espèces à déporter dans l’archipel de « mini-zones compensatoires ». Les autorités se sont alors rendu compte qu’il y avait de l’opposition : les travaux préparatoires ont été sabotés, des barricades sont apparues, le pont a été endommagé.
La déforestation massive a commencé ensuite, jusqu’à fin du mois. Il y avait à ce moment-là entre 70 et 80 personnes qui vivaient sur la zone, recevant le soutien moral, matériel et physique de plusieurs centaines de personnes du coin. Parfois, une partie d’entre elles venaient dès 5h du matin, mais en général, le soutien des locaux vient soit en début de semaine de façon ponctuelle, soit en fin d’après-midi, après les heures de boulot. Ils et elles passent sur la zone pour apporter à manger, du matériel, des fringues, ou tout ce qui est susceptible d’aider les zadistes dans leur occupation.
La CACG, qui est le maître d’œuvre, a fait appel pour le déboisement à l’entreprise Sebso, basée à Saint-Gaudens, près de Toulouse et spécialisée dans le commerce du bois industriel. Au début du chantier, ils ont abattu les gros arbres à coups de tronçonneuses. Très vite, une partie des opposant⋅e⋅s a tenté de piéger la forêt, en plantant des clous dans les troncs pour forcer les tronçonneurs à changer de lames, à les réaffûter régulièrement, dans l’espoir de rendre les travaux plus difficiles, plus lents, plus coûteux.
Ensuite, d’énormes machines sont entrées en action : des « abatteuses » qui tombent les arbres comme tu cueilles une fleur – l’arbre est saisi par le pied avec une pince, puis coupé par un gros sécateur, et posé dans un coin en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. Puis une autre machine le dépose dans un camion ; tout autour, des broyeuses transforment immédiatement les sous-bois et les taillis en un désert de copeaux. Toutes proportions gardées, ce sont à peu près les mêmes méthodes de déboisement qu’en Amazonie…
Face à cette violence, les opposants ont paraît-il continué à piéger la forêt en clouant des barres de fer sur les troncs et en reliant les cimes des arbres entre elles (pour rendre dangereuse leur chute). Mais manifestement, il était trop tard pour empêcher la déforestation.
Quelles ont été les autres techniques de résistance ?
Le plus frappant a été la construction de cabanes dans les arbres : des opposant⋅e⋅s se sont perché⋅e⋅s à différentes hauteurs dès l’aube, pour gêner le travail des tronçonneurs et obliger à faire intervenir le GIGN. Quelques dizaines de personnes très débrouillardes apprenaient aux autres à se servir de baudriers, de cordes, sachant que c’est le truc le plus embêtant pour la police. Vers le 10 septembre, le GIGN est arrivé avec une grosse équipe. Avec leur nacelle, il leur a fallu une journée pour faire descendre de force deux personnes installées à 18 mètres du sol, et ils n’ont pas réussi à faire descendre la troisième personne, perchée à 28 mètres de hauteur.
Il y a eu aussi un petit peu de guérilla champêtre, des jets de cocktails Molotov en réponse aux agressions policières… Le 8 septembre, des gens se sont enterrés vivants jusqu’aux épaules pour retarder l’arrivée des machines. Tant qu’il y avait des caméras sur les lieux, les forces de l’ordre ne pouvaient pas s’en prendre à ceux-là. Mais une fois que les journalistes sont partis, il n’a pas fallu attendre plus d’un quart d’heure pour que la charge soit lancée : les gendarmes mobiles ont gazé tout le monde et ont piétiné les gens qui s’étaient enterrés sans aucun ménagement. Une femme a même été hospitalisée. Puis, le saccage de la forêt a recommencé jusqu’à la nuit. À partir de ce jour-là, les machines sont restées sur place et étaient gardées chaque nuit, rendant plus difficile le sabotage des travaux. Tout cela a duré jusqu’à fin septembre. C’est à peu près fini aujourd’hui, il ne reste plus qu’un petit bout de forêt qui devrait être massacré incessamment sous peu.
Pendant toute cette période post-15 août, le mouvement d’opposition au barrage était composé d’associations citoyennistes et environnementalistes, et de personnes plus indépendantes et engagées physiquement sur le terrain…
Il y a d’une part le collectif Testet, qui a fait des recours juridiques, lancé une grève de la faim et tente de négocier au plus haut niveau de l’État, auprès du cabinet de la ministre de l’Écologie Ségolène Royal[5. Laquelle ministre se moque royalement de toute cette affaire, comme l’a montré le site Reporterre « Ségolène Royal ne connait pas le dossier du Testet et s’en lave les mains », Barnabé Banctin, Reporterre]. D’autre part, les zadistes occupent les lieux. Ce sont des gens souvent plus jeunes, plus enclins à la résistance physique, pacifique ou non.
Ensuite, il y a la population locale, qui s’est mise en branle à partir de début septembre. Certains sont en grève de la faim dans des villages alentour, d’autres font cause commune avec les zadistes : ils et elles amènent aux occupants de la nourriture, du vin, des couvertures, du matériel, des tentes, des soins, et participent aux opérations contre les travaux. Même si tout le monde ne partage pas les mêmes idées, ça marche relativement bien, main dans la main, avec parfois de petits heurts sur certains points. En tous cas, le rassemblement national du 25 octobre est organisé par une coordination unissant toutes les composantes de la lutte.
Une partie de la population locale est cependant favorable au projet, puisqu’il y a eu ces milices qui ont attaqué la Métairie Neuve par exemple…
En face, il y a les décideurs locaux, le Parti socialiste (PS) et le Parti radical de gauche (PRG), qui ont le Tarn et le Tarn-et-Garonne pour fiefs depuis des décennies. Il y a aussi l’État, par le biais de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, plus la CACG. Ensuite, on a l’Union européenne qui finance, mais qui va peut-être retourner sa veste puisqu’elle a émis des doutes sur le fait que le projet respecte la directive-cadre sur l’eau de la Commission européenne[6. Directive-cadre sur l’eau 2000/60/CE. La Commission a demandé à la France de voir si le projet respecte oui ou non cette directive.].
Enfin, le projet est massivement soutenu par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), syndicat majoritaire agricole, favorable au productivisme agricole, au machinisme, et à l’agro-industrie… Ils ont d’ailleurs publié un communiqué le 2 septembre dernier dans lequel ils revendiquent leur légitimité à bénéficier du projet et conspuent ceux qui empêchent « la France de se bouger »[7. Communiqué du 2 septembre 2014 de la FNSEA].
C’est ensuite qu’est apparue la milice, qui la nuit se mettait aux carrefours dans la zone et agressait les voitures de passage, en défonçant les pare-brise à coups de batte de baseball, en jetant des cailloux, en tabassant les opposant⋅e⋅s, en tirant des coups de feu en l’air. Au début, on pensait que c’étaient des paysans ou des chasseurs ; finalement, on s’est aperçu que la société de chasse de Sivens avait d’abord été hostile au projet – ce qui semble logique, puisqu’il s’agit d’un territoire de chasse. D’où l’idée que l’appellation « pro-barrage » peut induire en erreur, puisqu’il y a probablement des gens dans ces milices qui n’en ont rien à cirer du barrage, et en sont ni chasseurs ni paysans. Leur « trip », c’est surtout de « casser des jeunes », des gens qui ont des dreadlocks ou au look punk… C’est plutôt un truc fascistoïde.
Y a-t-il une solidarité avec ceux qui résistent au-delà des environs ?
Oui, on reçoit des communiqués de soutien venus de différents endroits de la France : il y a eu des actions de soutien en Bretagne, à Nantes, à Auxerre, un peu partout… Des liens se tissent : dans l’appel pour la manif du 25 octobre, il est très clairement fait référence à Notre-Dame-des-Landes ou au Val de Suze. Mais il ne s’agit pas d’implanter un aéroport ni une ligne TGV, puisque c’est d’un barrage destiné à l’agriculture intensive dont il est question ici. Dans les textes, plutôt que d’élargir la lutte à un combat un peu fantasmatique entre David « le Protecteur de la Nature » et Goliath « le Méchant forestier », il y a la volonté de garder l’aspect local, sans le noyer immédiatement dans le combat contre le système : essayer de garder en tête les enjeux propres à ce territoire, en luttant à notre niveau et en insistant sur la spécificité du projet de Sivens et ses problématiques.
Comment pourrait-on décrire la couverture médiatique du mouvement, à la fois en termes d’étendue et de contenu ?
Au départ, les médias locaux n’étaient pas entièrement mensongers. On a été assez étonnés, puisque le président du conseil général du Tarn-et-Garonne, qui a pris l’initiative du projet et le finance également, n’est autre que Jean-Michel Baylet, PDG du groupe La Dépêche, qui possède La Dépêche du Midi, l’un des journaux les plus lus dans le coin. Il est aussi président de la communauté de communes des Deux Rives, sénateur sortant du Tarn-et-Garonne, président du conseil de surveillance de la centrale nucléaire de Golfech, président d’un syndicat d’irrigation, et surtout président du Parti radical de gauche (PRG) qui est le seul allié du gouvernement en ce moment.
Son influence explique pourquoi le premier ministre Manuel Valls, son ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll et le gouvernement dans son ensemble soutiennent le projet. Garder le PRG, qui menace de rompre son alliance avec le PS, en se pliant à ses exigences, est la seule manière d’avoir un semblant de majorité à l’Assemblée nationale pour les socialistes. C’est vous dire si le sujet du barrage du Sivens est sensible.
Au début, la couverture médiatique était plutôt importante et donnait la parole aux différents protagonistes, mais très vite, les articles dans La Dépêche du Midi sont devenus complètement partisans, décrivant les zadistes comme de violents étrangers venus envahir nos paisibles contrées. Et puis, histoire d’en rajouter une couche, il y a eu une lettre destinée à tous les Tarnais, écrite par le président du conseil général du Tarn, Thierry Carcenac alors candidat aux sénatoriales (et qui a depuis été élu, mais avec quelques copmtes à rendre[8. Son élection fait l’objet d’un recours en annulation à cause de ces lettres envoyées en pleine période électorale. Il a également été accusé de fraude en matière de propagande électorale, en faisant publier dans La Dépêche du midi des publi-communiqués du conseil général favorables au barrage Voir le journal de France 3 du 7 oct. 2014]). L’autre journal local, Le Tarn libre, est resté plus neutre dans son traitement de l’affaire.
En parallèle, la lutte a pris une dimension un peu spectaculaire, avec les cabanes dans les arbres, la guérilla champêtre et les gens qui s’enterraient – ce qui a attiré les médias nationaux (Le Monde, La Croix, L’Express…), avec une déferlante de reportages sur ce « nouveau Notre-Dame-des-Landes » ! Les articles étaient moins nettement orientés et se montraient plus sensibles aux arguments des anti-barrages. Mais en ce moment, les médias nationaux n’en parlent plus : les travaux avancent, et même s’il y a toujours plus de violences, ça ne fait plus la une. Libération a même fait une double page pour expliquer que la cause était perdue, qu’il n’y avait sur place qu’une poignée de zadistes sans soutien local, dans une ambiance de fin du monde… C’est une logique classique dans les grands médias : on en parle à pleins tubes pendant une semaine, et d’un coup on n’en parle plus, ce qui donne l’impression que c’est fini. Alors que vu d’ici, on pourrait dire que tout re-commence maintenant.
Pour la suite de la lutte, justement, un rassemblement national est organisé le 25 octobre. N’est-ce pas trop tard, étant donné que la déforestation a déjà eu lieu et que la zone est déjà ravagée ?
Les travaux sont prévus jusqu’en juin 2015. La lutte prend de l’ampleur, les autorités paniquent et les surcoûts s’accumulent. Il y a aussi des échéances liées aux subventions de l’Union européenne. Si le département veut toucher le pactole de l’Europe, ils doivent achever les travaux avant le 21 juin 2015. Or, selon les propres aveux du conseil régional, il est à présent devenu impossible de tenir ces délais – et les opposant⋅e⋅s sont déterminé⋅e⋅s à tout faire pour que cela devienne impossible, en inscrivant la lutte dans la durée
Dans une logique écologiste axée uniquement sur la préservation des zones humides, de la forêt et des espèces, la lutte n’a plus de raison d’être ou presque. La forêt est rasée, la zone humide dévastée, avec des tractopelles et des bulldozers qui achèvent d’éliminer toutes les espèces qui n’ont pas été déportées par les naturalistes, dans des endroits où elles vont crever parce que ce n’est pas leur milieu naturel. Bref, si le but de la lutte était de faire un conservatoire environnemental, nous avons perdu.
Le collectif Testet maintient malgré tout la lutte. Car il y a d’autres bonnes raisons de s’opposer au barrage, plus politiques : le rêve qu’il y ait toujours et partout des « bouilles », des espaces inexploités où aller rêver et expérimenter, la volonté de résister aux arrogantes élites locales, de s’opposer ici aussi aux politiques nationales d’aménagement du territoire, de bétonisation, d’industrialisation. Mais maintenant, il va falloir réinventer autre chose, sur les ruines de la forêt. Par ailleurs, il faut bien se rappeler qu’il y a une ribambelle d’autres barrages en projet dans les années à venir : plus ce barrage-là sera cher, plus les autres seront durs à faire passer.
Comment est censée se dérouler la suite du chantier ?
Seuls les décideurs le savent… Selon ce qu’on a compris du programme initial (qui a dû être chamboulé), après la déforestation vient le « décapage » : il s’agit d’enlever l’humus, la terre fertile, dans toute une zone qui sera alors « stérilisée », pour préparer les travaux du barrage à proprement parler, prévus pour commencer fin octobre : une tranchée de 7 mètres de profondeur sur 260 mètres de long, dans laquelle ils vont constituer la « clé d’étanchéité », c’est-à-dire un énorme mur de béton qui montera à 14 mètres de haut. Ils devraient ensuite rabattre sur ce mur la terre décaissée pour masquer le béton et faire une digue qui aura l’air vaguement « naturelle » dans 50 ans…
Donc oui, la lutte continue, contre les élites locales, contre la violence qui est exercée, et pour d’autres types d’usages de la vallée : on pourrait y imaginer une ZAD qui se pérennise, on y replanterait des arbres, on y ferait pousser des légumes, comme les bouilles l’ont fait… On essaierait de ramener de la vie au Testet, dans tous les sens du terme, et de renouer avec les usages non prédateurs de ce territoire.
L’appellation et le principe de « ZAD », tels qu’ils ont été développés à Notre-Dame-Des-Landes et se sont diffusés à plusieurs endroits en France (comme La ZAD du Bois du Tronçay dans le Morvan[9. ZAD du Bois du Tronçay]), sont-ils appropriés à la situation du Testet qui a une dimension très locale ?
La ZAD signifie que nous bénéficions d’une nouvelle arme dans notre répertoire d’action politique – tractage, grève, pétition, etc. Cette forme de mobilisation qu’est la « Zone à défendre » permet de rassembler sur le terrain des personnes qui ne sont a priori ni voisins ni collègues de travail, motivées par des intérêts écologiques et d’opposition au système, et qui se retrouvent pour se battre contre ces grands projets d’aménagement du territoire – qui consistent toujours à imposer d’en haut un certain usage de la terre contre les usages de ceux qui viennent d’en bas, de ceux qui y vivent ou le voudraient bien.
L’expression « grands projets » est d’ailleurs tautologique : à partir du moment où c’est un « grand projet », il est forcément imposé de loin et d’en haut, à ceux d’ici, d’en bas. Face à cela, l’occupation semble tout à fait pertinente comme arme politique en plus des moyens traditionnels (manifs, syndicats, réunions publiques, etc.). Elle traduit bien l’idée que le capitalisme est prédateur, que l’impératif de croissance, d’accumulation du capital, implique de grignoter de plus en plus de territoires. Elle manifeste le fait que les politiques d’aménagement du territoire ne sont que le versant géographique du management généralisé qui dépossède les travailleurs de toute maîtrise de leur activité – ici, l’aménagement du territoire nous prive de la vallée de Sivens, il suppose que la vie en ait été « déménagée ». Aménagement du territoire et management des activités : voilà comment le système étatique et capitaliste s’attaque à nos formes de vie, nos manières de faire, de travailler, et aux territoires où elles fleurissent.
Il s’agit le plus souvent de territoires ruraux, qui depuis les années 1970 sont devenus le refuge de personnes qui s’opposaient aux modes de vie urbains basés sur la consommation de masse et le salariat, et ont essayé de trouver des refuges dans les interstices des grandes métropoles. Il y a un nouveau front qui s’ouvre à cet endroit-là, et qui se traduit par des oppositions à des projets tous plus absurdes les uns que les autres : aéroports, fermes-usines de mille vaches, parcs d’éoliennes industrielles… Il s’agit de résister contre un capitalisme qui ne consiste pas seulement dans l’exploitation des travailleurs, mais aussi dans l’« aménagement du territoire », sa destruction sur l’autel du Progrès. L’occupation physique et l‘organisation sur place répondent au ras le bol d’une génération qui recherche, parfois hors des villes, un espace libéré de l’argent et de la police, des syndicats et des partis, de l’esprit d’entreprise et de la passion gestionnaire des étatistes.
Le « principe ZAD », comme vous dites, a enfin le mérite de dépasser l’alternative stérilisante entre la volonté de détruire le système (qui peut vite tomber dans un léninisme suicidaire qui reconduit toutes les formes de domination auxquelles on prétend s’opposer) et celle de construire un autre monde (qui peut vite conduire à se constituer des « niches » où il fait bon dormir, loin de l’horreur du monde). La ZAD permet au contraire, tout en s’opposant concrètement au système, d’inventer de nouvelles formes de vie fondées sur l’entraide, le partage, la discussion collective et l’horizontalité.
Propos recueillis le 10 octobre 2014
Pour aller plus loin :
Collectif Tant qu’il y aura des bouilles
Collectif Testet
Appel national à soutenir la ZAD du Testet – Samedi 25 octobre 2014


Vidéo :
Le conseiller général,
l’arbre et le débat démocratique







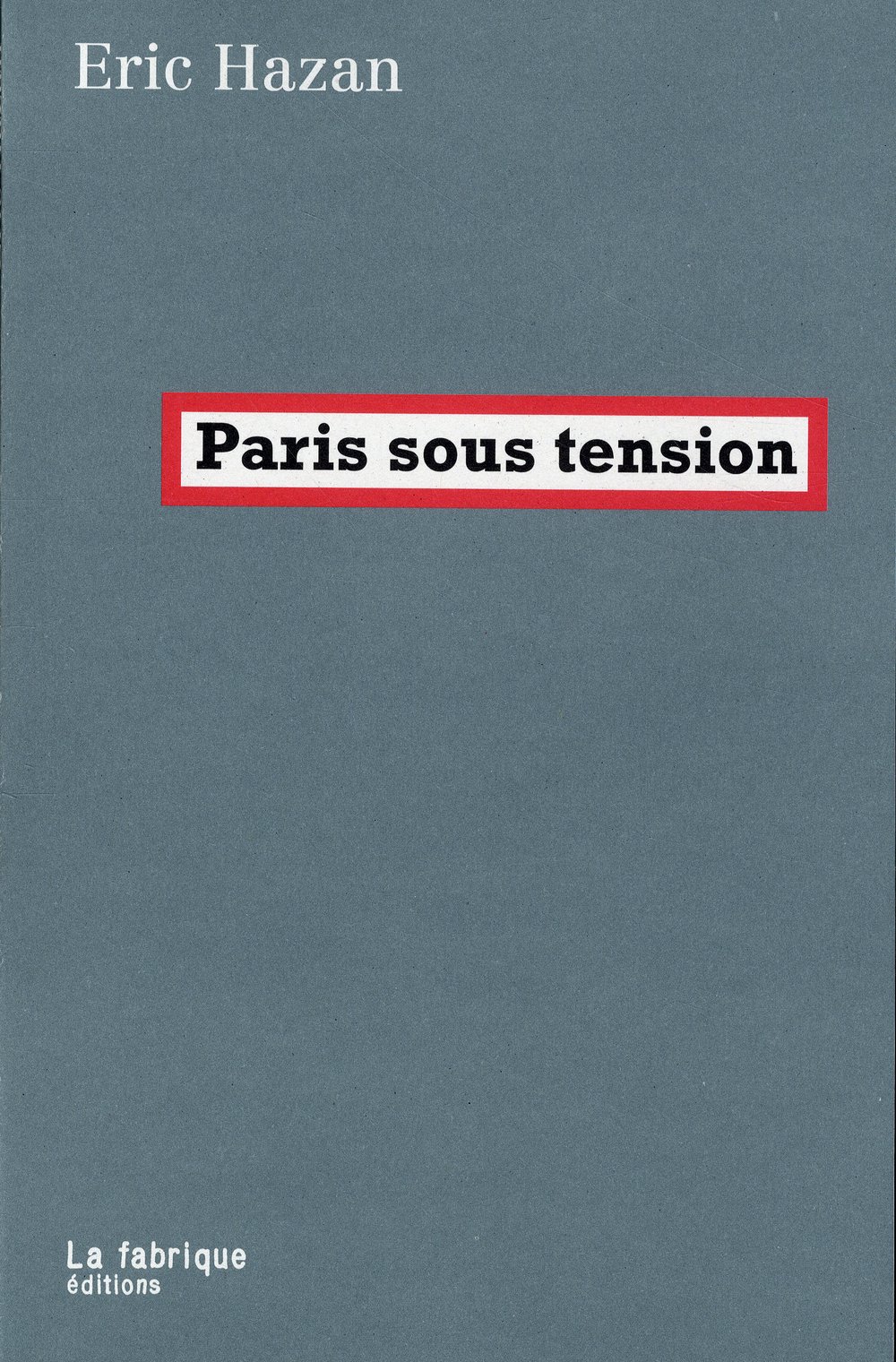
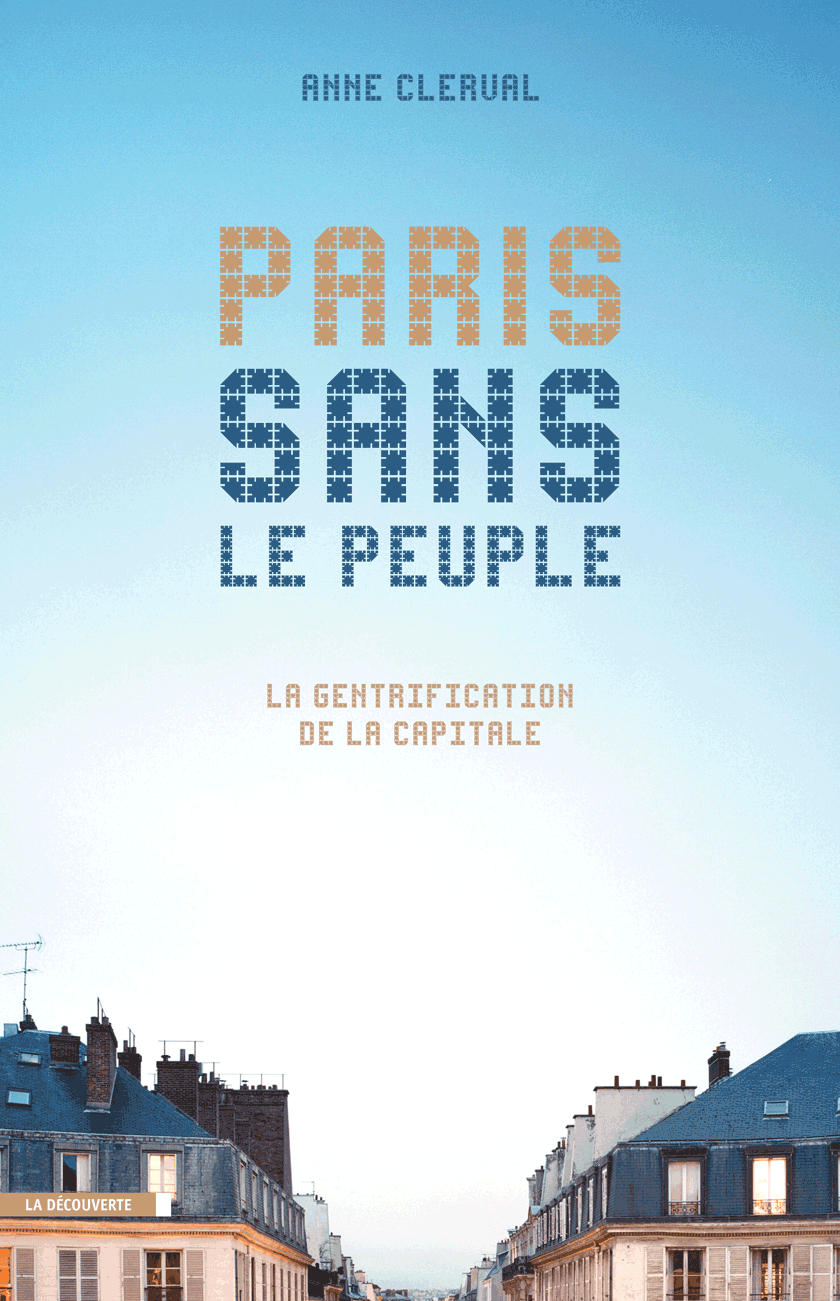
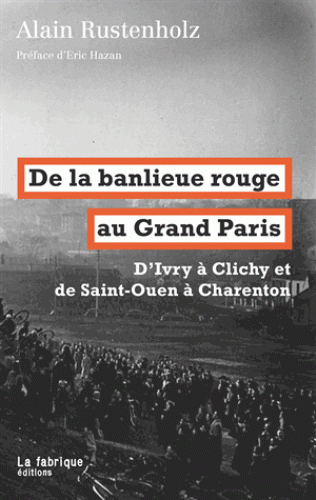
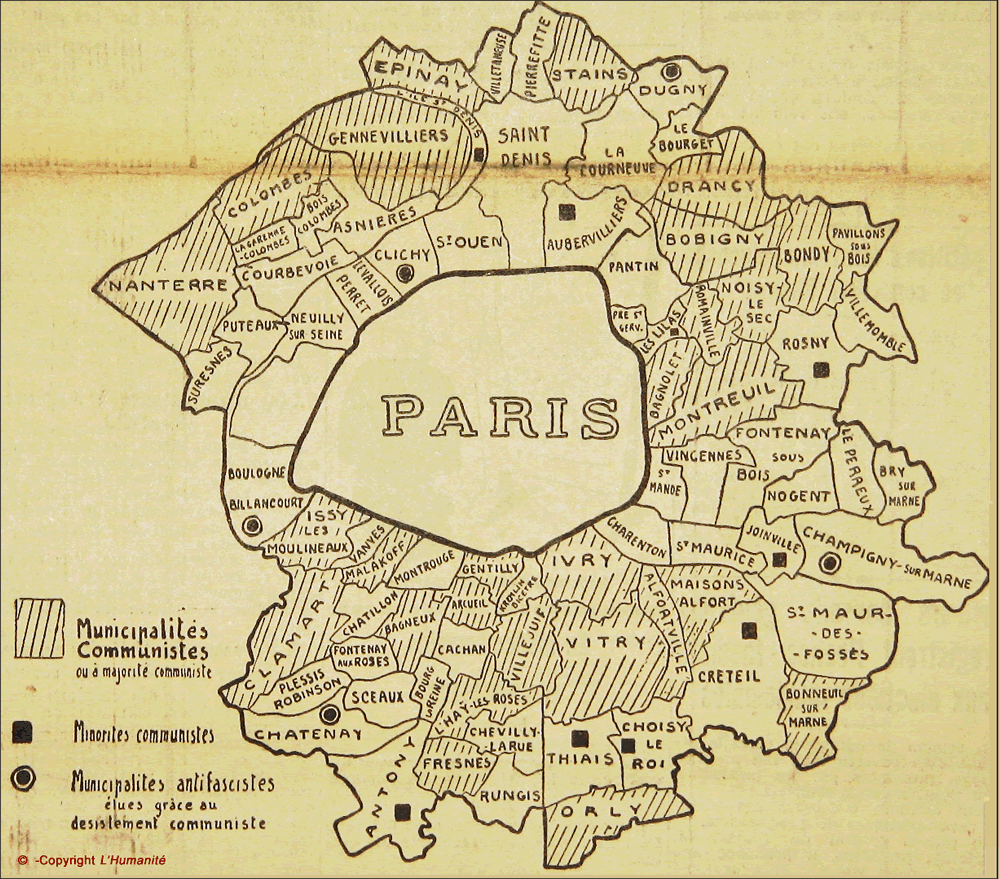
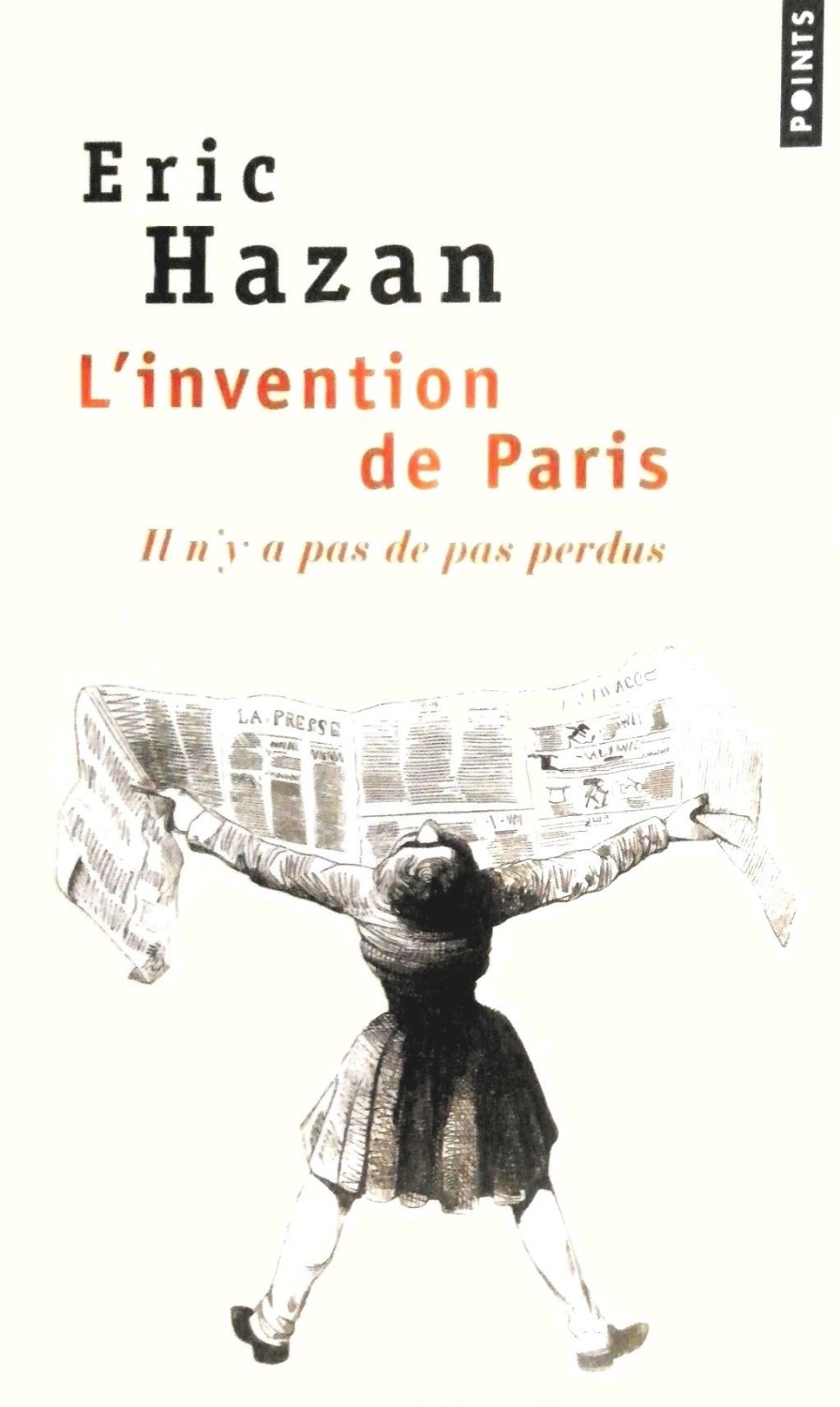







Recent Comments