Nuclear History X
Début mai 2017, un tunnel rempli de déchets radioactifs s’est effondré sur le site de Hanford, dans l’État de Washington, à 275 km de Seattle. Depuis 1943, les réacteurs nucléaires et les usines de retraitement de ce complexe ont généré soixante tonnes de plutonium, équipant les deux tiers de l’arsenal nucléaire américain. Cette production, extrêmement polluante, a créé d’immenses quantités de déchets chimiques et radiologiques qui empoisonnent encore aujourd’hui les rives du majestueux fleuve Columbia, si bien que ce gigantesque combinat, seize fois plus grand que Paris, où s’agitent aujourd’hui 9 000 décontaminateurs, est considéré comme le plus grand dépotoir nucléaire du continent américain.
Télécharger l’article en PDF.
Mardi 9 mai, un trou de six mètres de large est découvert dans une tranchée couverte de Hanford. Les alarmes du site résonnent et poussent la plupart des employés à évacuer le complexe nucléaire.
En 1965, on avait « garé » dans ce tunnel huit wagons télécommandés remplis de 600 m3 de déchets nucléaires issus de l’usine de retraitement attenante, avant de recouvrir le tout de sable et de graviers. Ce moyen de stockage devait être temporaire : les ingénieurs finiraient bien par trouver une solution aux déchets de forte activité ! Problème : avec le temps, les rayons gamma ont attaqué le bois de soutènement qui a fini par céder. Heureusement, les trois mètres de poussières et de sables, tombés sur les wagons lors de l’effondrement semblent avoir fixé la contamination au sol. Dans les jours qui ont suivi, les ingénieurs du site ont recouvert d’une bâche toute la longueur du tunnel et ont parlé de combler la cavité béante avec des gravats. Moins d’un mois plus tard, le 8 juin, les alarmes se sont affolées à nouveau à Hanford. Cette fois, c’est la destruction d’une usine de retraitement de plutonium datant de la fin des années 1940 qui a dispersé des contaminants et forcé les ouvriers à se calfeutrer pendant plusieurs heures. Ces accidents répétés ont exposé médiatiquement Hanford et ses activités, mais le site est depuis retourné à l’anonymat. Pourtant, malgré leur côté spectaculaire, les deux incidents n’ont mis en jeu que de faibles quantités de polluants radioactifs. Le site a connu, sur son histoire, des contaminations beaucoup plus sérieuses et le pire est peut-être à venir, avec le chantier de « remise en état » censé durer plusieurs décennies… Voici l’histoire terrible de cette catastrophe rampante…

Naissance du site
En 1942, Leslie Groves, le riant directeur militaire du projet Manhattan 1 Nom de code du projet américain de construction d’une bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le projet Manhattan employa plus de 120 000 personnes sur une trentaine de sites., veut obtenir quelques dizaines de kilogrammes de plutonium avant la fin de la guerre, de quoi assembler deux bombes atomiques. Son problème est que le plutonium, inexistant dans la nature, ne se fabrique qu’en laboratoire, dans des quantités de l’ordre du microgramme. Sous ses ordres, les scientifiques du MetLab de Chicago et de Los Alamos au Nouveau-Mexique sont chargés de concevoir un procédé capable de fournir les quantités requises de plutonium. Sur le papier, rien de trop complexe : on irradie de l’uranium dans une pile nucléaire – ce qu’on appelle aujourd’hui un réacteur. Une partie de cet uranium se transmute par capture neutronique en plutonium. On récupère ensuite ce mélange uranium/plutonium qu’on sépare par des procédés chimiques. Mais Groves, lui-même ingénieur de formation, sait que les théoriciens du projet Manhattan, aussi brillants soient-ils, ne s’y connaissent pas suffisamment en ingénierie et en chimie, et que le passage du laboratoire à l’échelle industrielle n’est pas dans leurs cordes. Aussi confie-t-il la construction du site de production de plutonium à l’entreprise chimique DuPont, seule capable, selon lui, d’assurer la faisabilité du projet [2. Sur DuPont et son implication dans le projet Manhattan, lire l’excellent livre de Pap Ndiaye. Du nylon et des bombes : Du Pont de Nemours, le marché et l’État américain, 1900-1970. Belin, 2001.].
Fin 1942, le colonel Matthias, factotum de Groves, et des ingénieurs de DuPont cherchent un lieu où bâtir le complexe nucléaire. On imagine déjà, à l’époque, qu’un réacteur au système de refroidissement compromis puisse exploser et répandre des radionucléides des dizaines de kilomètres à la ronde. On sait aussi que l’usine de retraitement envisagée dégagera des effluents gazeux très radioactifs à chaque étape de la chaîne de production. Groves insiste pour que le futur complexe soit bâti loin de la côte Est et du Midwest et envisage la construction dans les zones faiblement habitées de l’Ouest américain. Matthias et les ingénieurs de DuPont survolent six sites en quelques jours, et c’est celui de Hanford qui retient leur attention. Situé sur les rives du fleuve Columbia, au sud-est de l’État de Washington, il est à plus de 250 kilomètres des centres urbains les plus proches, Spokane et Seattle. Par ailleurs, le débit du fleuve est suffisant pour refroidir les réacteurs ; et le barrage de Grand Coulee, en amont peut assurer un apport d’énergie électrique au site.
En mars 1943, le site étant choisi, le projet Manhattan achète 1 600 km² de terres et donne trois mois aux quelques milliers d’habitants qui y vivent pour décamper, en échange d’une indemnisation, sans leur expliquer pourquoi ils sont expropriés.

Malgré la pénurie de main d’œuvre, courante en temps de guerre, on attire jusqu’à cinquante mille ouvriers venant de tout le pays avec des prospectus vantant des salaires mirifiques et un cadre de vie en pleine nature. Mais ceux-ci ne découvrent qu’un pays aride, soumis à des tempêtes de sable continuelles, avec pour seuls lieux de loisir les saloons sordides installés par DuPont près des baraquements d’habitation. Les nombreux départs sont compensés par du sang neuf et, en mois de deux ans, on construit trois réacteurs s’égrainant tous les huit kilomètres le long du Columbia, plus deux usines de retraitement quinze kilomètres plus au sud. Une fois les bâtisseurs partis, arrivent ingénieurs et techniciens, responsables de la production de plutonium. À la fin de la guerre, le travail à Hanford s’effectue dans le secret le plus absolu, par peur de l’espionnage nazi et soviétique. Les mots uranium et plutonium sont proscrits et remplacés, dans les rapports internes, par des noms chiffrés. Les ingénieurs de DuPont se voient interdire les prises de note et jusqu’à la possession d’un journal intime. Le travail est tellement compartimenté qu’à part les hauts gradés et les huiles de DuPont, les employés du site ne connaissent pas la finalité de leur travail. Même Truman, alors vice-président, n’est pas au courant de ce qui se passe à Hanford, et il devra attendre d’arriver à la magistrature suprême pour connaître l’existence du complexe et son but.

Après la guerre, encore la guerre
Après la destruction de Nagasaki, le 9 août 1945, Hanford et Richland, la ville attenante qui héberge les ingénieurs, se retrouvent sous les projecteurs. La presse américaine salue les ingénieurs et leur œuvre épatante, la bombe. Dans l’euphorie patriotique qui gagne le pays suite à l’écrasement du Japon, la ville de Richland se pare de symboles guerriers : l’équipe de football locale choisit pour nom The Bombers et pour logo, un champignon nucléaire… Le job accompli, DuPont peut partir la tête haute, et laisse la gestion du site à General Electric.
Jusqu’en 1949, la production de plutonium baisse, ce qui ne manque pas d’inquiéter les employés qui ont peur de perdre leur gagne-pain. Mais le 29 août de cette année, l’explosion de la première bombe nucléaire soviétique – que l’on n’attendait que dix ou quinze ans plus tard – et les tensions relatives à la guerre de Corée relancent le complexe. En une quinzaine d’années, on y construit six réacteurs supplémentaires, ainsi que deux nouvelles usines de séparation du plutonium. Le site atteint alors sur la période 1960-1965 son pic de productivité : 5 tonnes de plutonium par an – de quoi équiper trois bombes de Nagasaki par jour ! Au cours des années 1970, l’activité du complexe de Hanford diminue sensiblement, au gré des accords de désarmement signés avec les Soviétiques, avant de connaître un bref regain sous la présidence du cow-boy en chef Reagan. Le dernier réacteur est arrêté en 1987. Quant à la seule usine de retraitement alors encore en activité, elle fermera ses portes en 1990.

Un secret qui fuite
Au cours des quatre décennies de son fonctionnement, Hanford a généré d’innombrables pollutions chimiques et radiologiques sous formes solide, liquide et gazeuse. Le sentiment d’urgence inhérent à la Seconde Guerre, puis à la Guerre froide, ainsi que l’atmosphère de secret qui entourait les activités du site ont augmenté dramatiquement ces contaminations.
Entre 1944 et 1988, les usines de retraitement de Hanford ont produit des millions de mètres cubes de déchets liquides radioactifs, sous-produits de l’extraction du plutonium. Les moins actifs furent disposés dans 1 200 tranchées, juste à côté des usines de séparation. Comme le raconte en 1948 le principal expert en radioprotection de Hanford : « Cette méthode est un expédient temporaire, mais nécessaire […] permettant d’éviter des coûts absurdes de mise en cuve de ces déchets [3. H. Parker, Speculations on Long-Range Waste Disposal Hazards, HW 8674 (RL : HEW, January 26), 1948.]. » Depuis le début des activités, pas moins de 500 milliards de litres de déchets de faible activité ont ainsi été enterrés dans le sol, dans des fosses ou en tranchées couvertes…

Les déchets les plus radioactifs – dits de haute activité – ne pouvant être simplement déposés, on a construit, entre 1944 et 1964, 149 cuves d’aciers entourées de béton pour les stocker. Initialement conçues avec une espérance de vie de vingt ans, ces cuves ont été rapidement détériorées par la corrosivité des déchets. Les premières fuites ont été détectées en 1956. On estime aujourd’hui que 70 de ces cuves ont fuit, libérant dans le sol un cocktail délétère de produits de fission fortement radioactifs (césium 137, strontium 90, etc.). Dans les années 1970, on a installé 28 cuves à double coque, d’une capacité de trois millions de litres chacune pour y transférer les liquides des réservoirs qui fuyaient. Censée régler le problème des déchets de haute activité, une de ces nouvelles cuves, elle aussi corrodée, fuit dès 2012.
Les radionucléides issus de ces fuites migrent lentement – mais sûrement – vers le fleuve Columbia par le sol et la nappe phréatique et 105 km2 d’aquifère sont d’ores et déjà contaminés à Hanford [4. Goswami, D. D. A Sitewide Approach to Clean up the Groundwater at the Hanford Nuclear Facility, Washington State. In 2015 NGWA Groundwater Summit. Ngwa.].
Le Green Run
À côté des déchets liquides, les usines de retraitement de Hanford sont aussi responsables de contaminations atmosphériques, majoritairement libérées entre 1944 et 1965, sous formes de gaz, de vapeurs et de particules. Le combustible usé qui arrivait dans l’usine était placé dans des bains acides pour dissoudre la gaine d’aluminium qui l’entourait et atteindre le plutonium. Cette réaction relâchait dans l’atmosphère de l’iode radioactif, mais aussi des particules fines de plutonium, de strontium 90, etc. Au cours de la phase de production de Hanford, environ 800 000 curies [5. Le curie est une unité de mesure de la radioactivité. Un curie correspond à la radioactivité d’un gramme de radium. Aujourd’hui, le curie a été remplacé officiellement par une autre unité de mesure, le becquerel, mais il continue d’être utilisé, car il est adapté à la mesure des fortes radioactivités. ] d’iode 131 ont ainsi été relâchés par les cheminées des usines de retraitement. La majorité de la contamination atmosphérique date des trois premières années, quand les cheminées de ces usines n’avaient pas encore de filtres. Ainsi, pour la seule année 1945, on rejeta 340 000 curies d’iode 131 à Hanford [6. Ces chiffres sont à mettre en balance avec les 14 curies d’iode 131 ayant fuit lors de l’accident nucléaire de Three Mile Island…].

Un de ces dégazages radioactifs d’iode 131 mérite une attention particulière, tant par son ampleur que par l’intentionnalité écervelée de la contamination : il s’agit du test dit Green Run, effectué la nuit du 2 décembre 1949. À Hanford, en fonctionnement normal, avant de retraiter le combustible issu des réacteurs à l’usine, on le laissait refroidir en piscine pendant trois mois, de manière à ce qu’il perde la plupart de ses éléments radioactifs à vie courte, comme l’iode 131. Au cours du test Green Run, le combustible n’a été refroidi que trois semaines : il était donc des centaines de fois plus radioactif que d’habitude, encore « vert ». Selon les responsables de la radioprotection à Hanford, ce test a été fait à la demande de l’armée. Les militaires pensaient que les Soviétiques, qui venaient de faire leur premier essai nucléaire, devaient à ce moment-là produire du plutonium à plein régime pour se constituer un arsenal. Il était donc probable qu’ils réduisaient eux-mêmes le temps de refroidissement en piscine pour accélérer la production, et qu’ainsi leurs usines de retraitement émettaient beaucoup d’iode radioactif. C’est seulement pour pouvoir étalonner leurs appareils de détection avant un futur survol de l’URSS que l’US Air Force a demandé aux ingénieurs de Hanford d’utiliser du combustible « vert » et d’enlever les filtres. Les météorologues, qui sont des gens prévoyants, avaient prédit que l’iode 131 se disperserait au-dessus du Pacifique. Mais voilà, une tempête surprit tout le monde, et dissipa les effluents gazeux sur les villages ou fermes des environs, contaminant l’État de Washington et l’Oregon, sans que les habitants en soient informés.

Qui va nettoyer tout ça maintenant ?
Ce n’est qu’en 1986 que les activités de Hanford et les contaminations qu’elles ont entraînées sont connues du public. Des écologistes et des journalistes se saisissent alors du Freedom of Information Act, une loi de 1967 qui permet à chaque citoyen de demander à n’importe quelle agence gouvernementale la publication de ses archives. Ainsi, le Department of Energy (DOE), administrateur du site, se voit forcer de rendre public 19 000 rapports internes sur Hanford qui racontent sans fard les très importantes contaminations des années 1945-1965.
En 1990, le DOE stoppe la production de plutonium et signe un accord tripartite avec l’Agence américaine de protection de l’environnement et le secrétariat à l’Écologie de l’État de Washington. Cet accord prévoit le nettoyage du site de Hanford et l’amélioration du stockage des déchets. Le calendrier fixé est très optimiste : il imagine la fin des travaux vers 2010. Mais avec les années, les incidents et accidents se sont multipliés : fuites récentes de cuves à simple et double enveloppes, ou effondrement du toit d’un tunnel renfermant des déchets ce 9 mai 2017…
Le DOE a promis de régler le problème des cuves et s’était engagé à les vider, à en « vitrifier » le contenu avant de le déplacer dans un site de stockage permanent de l’État du Nevada. Aujourd’hui, l’usine de vitrification n’est toujours pas fonctionnelle, quant au projet de site d’enfouissement à Yucca Moutain (Nevada), il a été totalement abandonné en 2009.
Entre le démantèlement des réacteurs, la gestion des sols et des nappes phréatiques contaminés et la vidange des cuves, la fin du chantier de remédiation à Hanford à été repoussée aux calendes grecques. Les plus chagrins parlent des années 2080 et d’un coût de 110 milliards de dollars !

Ainsi, pour construire leur arsenal nucléaire, les États-Unis ont-ils sacrifié une large portion de leur territoire, et les bombes destinées à l’URSS auront au final empoisonné des citoyens américains. Les Russes, de leur côté, ne sont pas en reste. Construit en 1948 par des esclaves du goulag, le complexe nucléaire de Mayak, dans l’Oural, équivalent parfait de Hanford, est encore plus létal : au-delà des contaminations de fonctionnement, trois accidents nucléaires majeurs s’y sont produits [7. À Mayak, de 1948 à 1951, les autorités relâchaient les déchets liquides dans la rivière Techa, contaminant les riverains qui n’ont jamais été prévenus ni empêchés d’accéder à l’eau. En 1957, une cuve à déchets de haute activité a explosé, répendant 18 millions de curies de sous-produits de fission sur le site et 2 millions sur la région environnante. Enfin, en 1967, des déchets injectés dans un lac ont fait monter la température de l’eau et baisser son niveau. Des sédiments radioactifs ont été mis à jour et dispersé par une tempête.] ! Pire, les autorités russes, actant la destruction écologique engagée à Mayak, ont décidé de faire du lieu une poubelle nucléaire accueillant des déchets radioactifs du monde entier…

Notes
| ↩1 | Nom de code du projet américain de construction d’une bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le projet Manhattan employa plus de 120 000 personnes sur une trentaine de sites. |






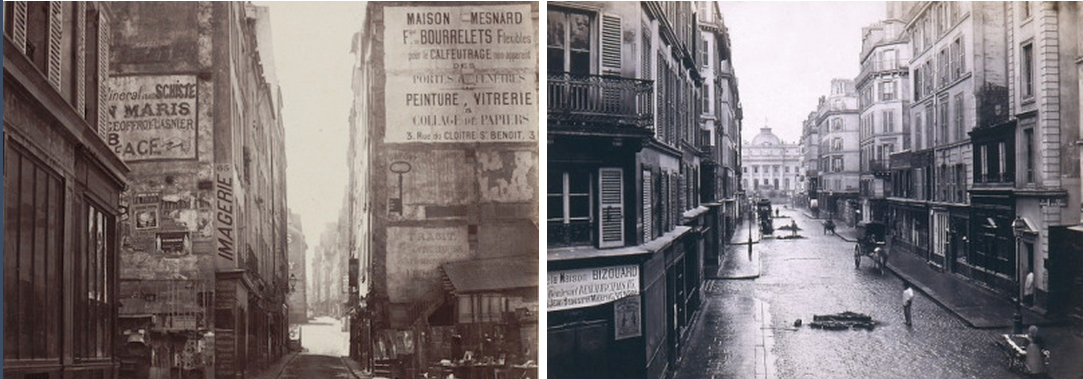











Recent Comments