by Julia Burtin Zortea | 22 mai 2017 | Marabout
Le sanctuaire de Lourdes est célèbre pour ses miracles qui, depuis les visions de Bernadette Soubirous en 1858, continuent de se produire. Depuis plus de 150 ans, les médecins du sanctuaire ont enregistré un peu plus de 7 000 déclarations de guérisons, dont 2 000 ont été jugées « inexplicables » en l’état des connaissances médicales. Comment se fait-il alors que seules 69 guérisons aient à ce jour bénéficié d’une inscription au registre officiel des miraculés ? Dans son analyse sociologique de l’expertise médicale des guérisons déclarées « miraculeuses » à Lourdes, Lætitia Ogorzelec-Guinchard détaille la minutieuse entreprise de certification des prodiges thérapeutiques.
Cet article est issu du premier numéro de Jef Klak, « Marabout », encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF.
Pourquoi avoir choisi les miracles de Lourdes ?
Je voulais relever deux défis. Le miracle est très généralement représenté comme un objet simple : soit on l’affirme, soit on le rejette, mais on ne se pose jamais la question de sa production. Le concept de « boîte noire », introduit par Bruno Latour[2. La science en action, éd. de La Découverte, 2005 (première édition 1989). Dans cet ouvrage, l’auteur s’intéresse aux processus politiques et sociaux de construction des résultats scientifiques et techniques, et prône l’« ouverture » de ce champ à l’opinion critique et publique.] m’a beaucoup inspirée : la « science faite », avec ses postulats indiscutables, trouve son origine dans un contexte de production incertain, généralement occulté. Concernant Lourdes et les guérisons miraculeuses, mes questions de départ étaient simples, presque naïves : pourquoi existe-t-il pour l’Église de vrais miracles, inscrits au registre des miracles officiels, et des guérisons jugées « non miraculeuses » ? En somme, comment fait-on pour reconnaître un miracle ? Pour l’authentifier ?
Par ailleurs, je voulais montrer qu’il était possible d’inscrire l’analyse d’un objet de croyance dans une enquête empirique, rigoureusement menée.
Pourquoi le premier article que vous avez publié sur votre recherche[3. Laetitia Ogorzelec, « De la foule à la procession. La mise en place d’une stratégie de contrôle social à Lourdes. », <ethnographiques.org>, Numéro 21, novembre 2010.] porte-t-il sur le contrôle de la foule à Lourdes, et non sur les miracles ?
À partir du moment où un pèlerin note une amélioration de son état de santé suite à son passage au sanctuaire, il peut garder la nouvelle pour lui, ou entreprendre une démarche auprès du Bureau médical de Lourdes pour tenter de faire reconnaître le caractère miraculeux de sa guérison. Au départ, je m’étais focalisée sur cette procédure, longue et incertaine. Mais je me suis vite rendu compte qu’il me fallait avant tout répondre à une autre question : pourquoi existe-t-il, depuis 1883 à Lourdes, un Bureau médical chargé de l’expertise des guérisons déclarées « miraculeuses », et pas dans d’autres sanctuaires ? À La Salette[4. Le sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Salette a été établi en 1851 à l’endroit où deux enfants bergers déclaraient, cinq ans plus tôt, avoir vu une Vierge en pleurs. ] par exemple, près de Grenoble, ou à Međugorje, en Bosnie, les guérisons ne sont pas inscrites dans une telle procédure de contrôle.
En 1858, quand la jeune Bernadette Soubirous raconte avoir vu « une forme blanche ayant la forme d’une petite fille », son histoire semble plutôt banale, puisqu’il existe une grande tradition d’apparition mariale à de jeunes bergères dans les Pyrénées. Dans les semaines qui suivent, pourtant, des gens commencent à venir, de plus en plus nombreux, sur le lieu des visions. À Lourdes, la foule grandit, et cela inquiète les autorités politiques. À cette époque, les épisodes révolutionnaires de 1789, de 1830 et de 1848 sont encore bien présents dans les esprits. Les consignes ne tardent pas à venir de Paris : il faut tout simplement interdire cette dévotion sauvage qui s’improvise aux abords de la grotte. Les autorités y placent des barrières ; les cierges et les offrandes sont détruits.
Comment les pèlerins ont-ils réagi ?
Face à ces mesures répressives, les gens manifestent leur colère. Ils estiment qu’ils ne font rien de mal, et les barrières sont jetées dans le gave[5. Un gave (du gascon « gabe ») est le nom générique donné aux cours d’eau (grands ou petits), situés au Béarn, en Bigorre, sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées
et en Chalosse.]. C’est alors que se produit un phénomène peu connu : à Lourdes même, d’autres visionnaires – des enfants – se font entendre ; ils sont rapidement une vingtaine à dire qu’ils ont aussi vu la Vierge ! Alors que l’administration pensait régler le problème rapidement, elle s’avère totalement débordée par l’événement.
À votre avis, pourquoi la Vierge a-t-elle « réussi » à Lourdes (selon l’expression d’Élisabeth Claverie[6. Voir « Quand on jette une vierge dans un pays communiste… », entretien avec É. Claverie.]) alors que d’autres apparitions n’ont pas entraîné de mobilisation et se sont éteintes au bout de quelques semaines ?
Je pense que la configuration politique explique beaucoup de choses concernant les événements de Lourdes. Depuis le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851, la Seconde République est remplacée par le Second Empire. Encore marqué par les différents épisodes révolutionnaires, le pouvoir en place redoute les soulèvements. Aussi, les institutions du régime sont-elles sur le qui-vive. Lorsque des foules commencent à se former autour de la jeune voyante, considérant ces rassemblements soudains comme dangereux, les autorités administratives régionales se mobilisent immédiatement. Dans cette perspective, l’affaire locale de « la Grotte » ne tarde pas à se transformer en véritable problème politique. Le nombre alors considérable de rapports qui circulent – notamment entre le préfet de Tarbes, le commissaire et le procureur de Lourdes – témoigne bien du souci des autorités de suivre le moindre trouble d’un œil attentif et de contenir par avance toute opposition.
Mais c’est aussi (et peut-être surtout) grâce à la presse que les événements de Lourdes font leur apparition sur la scène nationale. Lorsque Louis Veuillot, rédacteur en chef de l’Univers[7. Journal des « Catholiques intransigeants ». Apparus au XIXe siècle, les Catholiques intransigeants s’opposent au catholicisme libéral qui accorde la foi avec les idées provenant du modernisme et de la sécularisation, issues des Lumières et de la Révolution française. Ils revendiquent la vérité rationnelle des enseignements et des prescriptions de l’Église catholique.] et écrivain catholique parmi les plus influents en 1858, défie les autorités en franchissant les barrières qui interdisaient l’accès à la grotte pour aller y prier, son geste est rapidement interprété comme une alliance possible entre une partie de l’élite parisienne et les Lourdais luttant contre la fermeture de la Grotte. Il en est de même de la visite de la gouvernante du prince impérial, au cours de l’été 1858, qui ne manque pas de donner aux habitants de Lourdes l’impression d’une validation de la véracité des apparitions par la Cour et du soutien manifeste de l’impératrice Eugénie.
Dès lors, l’histoire de Lourdes n’est plus uniquement constituée par des initiatives locales ou même régionales ; elle s’inscrit dans un mouvement national, devient une cause pour les catholiques dans la bataille qui les oppose aux anticléricaux et aux rationalistes. L’ampleur de la polémique est telle qu’à l’automne 1858, quelques mois seulement après les premières visions, rares seront ceux qui n’ont pas entendu parler de Lourdes.
Quel était alors le positionnement de l’Église ?
Pour une fois, on ne se demande pas « Que fait la police ? », mais plutôt « Que fait l’évêque ? », car ce dernier, depuis Tarbes, ne se prononce pas sur les événements. Il interdit au curé de Lourdes de fréquenter la grotte afin de ne pas engager la responsabilité de l’Église. Cette réserve perturbe l’administration impériale, qui souhaite qu’un sens soit donné aux événements afin de mieux les encadrer. Inquiets, le garde des Sceaux et le ministre des Cultes déclarent que ces manifestations sont de nature à « jeter le discrédit sur le gouvernement de l’Empereur », à « compromettre la dignité de la religion »[8. Lettre du garde des Sceaux au procureur général de Pau, dans Laurentin R., Lourdes. Documents Authentiques : tome 2, Paris, P. Lethielleux éditeur, 1957, p. 234-235.] ainsi que « les véritables intérêts du catholicisme[9. Deuxième lettre du ministre des Cultes Rouland au préfet Massy, dans Laurentin R., Ibid., p. 311-312.] ».
En réalité, l’évêque se trouve dans une position inconfortable, car les critiques des journaux voltairiens[10. Qui critiquent les valeurs établies, surtout morales et religieuses.] vont bon train. Par exemple, on se demande pourquoi la Vierge se montre « à Lourdes plutôt qu’à Paris », et « à Bernadette et non à l’Académie des Sciences »[11. Quatrième article de La Presse, 30 août 1858. ]. Dans un contexte de lutte entre rationalistes et catholiques, l’évêque souhaite rester prudent concernant les événements de Lourdes.
Mais l’administration impériale estime qu’il est urgent « de remettre aux mains de l’évêque, seul capable de la contrôler et de la guider harmonieusement, une affaire si pleine d’épines et de déboires entre les mains de l’administration[12. Selon Laurentin R., Documents authentiques : tome 3, Paris, P. Lethielleux éditeur, 1958, p. 69.]. » Après cinq mois de silence, les pressions de l’autorité politique sont telles que le prélat est obligé de prendre position[13. Dans ses travaux, Laetitia Ogorzelec-Guinchard montre combien cette stratégie de contention des foules à Lourdes s’inscrit dans une histoire de l’encadrement politico-religieux, où le « gouvernement des âmes » participe de la consolidation d’un ordre politique établi. Elle se réfère particulièrement aux exemples de la crise des farines (quand Louis XVI s’adresse aux évêques pour que ces derniers diffusent des injonctions au maintien de l’ordre), à l’instauration d’une religion civile – les fêtes révolutionnaires – sous le pouvoir jacobin afin de contrôler l’« allégresse publique », et à la mise en œuvre du mouvement des missions religieuses pendant la Restauration afin de réhabiliter le catholicisme, alors déclinant. ]. Or là où l’administration impériale attendait un jugement immédiat, l’évêque met en place une commission d’enquête pour éviter les critiques, et il invite des représentants de la science (médecins, biologistes, chimistes…) à se prononcer, notamment sur les guérisons qui ont déjà eu lieu.
Cette commission d’enquête était-elle chargée de se prononcer sur la pertinence des guérisons ou sur la véracité des apparitions mariales ?
Dès 1858, les médecins de la commission – présentés comme d’éminents spécialistes – retiennent sept guérisons inexplicables en l’état des connaissances médicales de l’époque, parmi le grand nombre qui leur est présenté. Cet avis des médecins constitue une base suffisamment sûre et solide pour que l’évêque établisse le caractère « véritable » et « miraculeux » de ces rétablissements. Indirectement, en reconnaissant l’existence des miracles thérapeutiques, il certifie les apparitions qu’il officialise en 1862. Or ce qui est troublant, c’est que Bernadette n’a jamais dit explicitement avoir vu la Vierge.
Qu’aurait-elle vu ?
Au début, elle a dit avoir vu, dans une grotte, « une forme blanche ayant la forme d’une petite fille » – on est loin de l’image de la Vierge. J’ai pris connaissance du premier interrogatoire de Bernadette par le commissaire de Lourdes, son brouillon, et sa version définitive envoyée au préfet. À chaque fois que la jeune visionnaire utilise le terme « aqueró[14. « Cela », en patois bigourdan. ] » pour définir l’apparition dans le brouillon, le commissaire le transforme par les termes « la Sainte Vierge » dans le procès-verbal définitif. Comme le faisaient d’ailleurs les foules qui se rendaient à Lourdes, les journalistes – tout le monde…
Ce n’est qu’au bout de quelques semaines que Bernadette a fini par dire au curé de Lourdes que la « dame blanche » lui avait donné son nom, et que cette dernière lui aurait dit : « Je suis l’Immaculée Conception. » Le fait que Bernadette ait été jeune et analphabète a renforcé la véracité de son affirmation, car pour beaucoup, elle ne pouvait connaître et comprendre ce concept théologique.
Il avait fallu, dès les prémices, donner corps et sens à cette apparition…
Cela devait être rassurant. Et quand, quatre ans plus tard, l’évêque décide enfin de rendre son jugement concernant l’affaire de la grotte, c’est l’apaisement général. Les foules, gratifiées et guidées par la reconnaissance ecclésiale, se transforment alors en cortèges silencieux et lents de pèlerins en prière, dont les énergies ont été neutralisées.
La foule étant maîtrisée, encore fallait-il que les autorités religieuses vérifient la teneur des guérisons qui, dès lors, se multiplient, pour en prouver le caractère miraculeux. Est-ce là le rôle attendu du Bureau médical, installé dès 1883 sur le site du sanctuaire ?
La procédure de reconnaissance des miracles à Lourdes s’appuie sur un ensemble de critères définis à Rome au XVIIIe siècle : il est notamment précisé que le rétablissement doit être instantané, permanent, inexplicable en l’état des connaissances scientifiques, et aucun traitement médical ne doit en être la cause[15. Il s’agit des critères définis par le cardinal Lambertini, en 1738. ]. Or, il est tout à fait admis pour l’Église catholique que seuls des médecins peuvent renseigner ces informations. Aussi le travail du Bureau médical s’inscrit-il dans la continuité du contrôle de la foule : par sa présence, il permet d’encadrer le discours sur les guérisons.
Mais la création du Bureau médical est aussi une manière de répondre aux critiques formulées par les théoriciens de l’hystérie, qui, dans leurs travaux, mettent en doute le caractère miraculeux des guérisons de Lourdes. Par exemple, dans son article « La foi qui guérit » (1882), Jean-Martin Charcot[16. Fondateur avec Guillaume Duchenne de la neurologie moderne, il est l’un des plus fameux cliniciens français, précurseur de la psychopathologie, connu comme chef de file de l’École de la Salpêtrière pour ses travaux sur l’hypnose et l’hystérie, dont Freud s’est inspirée pour fonder la psychanalyse.] explique que les guérisons de Lourdes ont bel et bien lieu, mais que « le miracle thérapeutique a son déterminisme et ses lois » : les maladies qui peuvent guérir à Lourdes seraient uniquement celles que l’esprit produit sur le corps ; elles seraient donc toujours fonctionnelles[17. Le terme de « trouble fonctionnel » regroupe l’ensemble des symptômes ne reposant pas sur une lésion organique, et dont la cause est souvent psychologique ou psychiatrique. Dans « La foi qui guérit », Charcot attribue les guérisons de paralysies – dites miraculeuses – à la résorption d’un trouble fonctionnel. ] et jamais organiques (a-t-on jamais vu un membre amputé repousser ?). La guérison opérerait suite à un effet d’autosuggestion[18. L’autosuggestion désigne l’effet des croyances ou des convictions sur le ressenti d’une personne et l’évolution d’une affection. ]. En somme, les maladies guéries à Lourdes relèveraient essentiellement des manifestations de l’hystérie. De ce point de vue, à l’hôpital de la Salpêtrière aussi, les médecins seraient capables de produire des « miracles ».
Pour réagir à ces attaques, les médecins du sanctuaire vont s’attacher à mettre de côté les guérisons qui pourraient être taxées d’hystérie pour ne garder que celles qui portent sur des faits organiques (une plaie qui se referme instantanément, un os qui se ressoude). Les médecins de Lourdes sont ainsi chargés de faire le tri : ils rejettent les guérisons qui pourraient nuire à la réputation du sanctuaire et ne s’intéressent qu’à celles qui leur paraissent vraiment inexplicables par les connaissances médicales. À la fin du XIXe siècle, le Bureau médical se présentait d’ailleurs comme une clinique ouverte, et encourageait les sceptiques à venir prendre part aux discussions qui l’animaient.
Qui sont les médecins du Bureau médical ?
Depuis 1883, jusqu’à la période actuelle, le responsable est désigné par l’évêque de Lourdes. Il s’agit de l’unique médecin permanent. Autrement, le Bureau médical est composé des médecins qui sont présents au sein du sanctuaire lorsqu’ils accompagnent des pèlerinages par exemple. Si un cas de guérison se présente, les médecins présents sur le site peuvent être sollicités par le responsable du Bureau médical et participer aux réunions et discussions. Sa composition est donc très variable.
En quoi le miracle est-il le résultat d’un processus d’enquête ?
La procédure de reconnaissance des miracles s’articule actuellement en trois phases. Elle n’a que peu évolué depuis 1883. Dans un premier temps, les médecins du Bureau médical doivent établir : 1. la certitude rétrospective de la maladie, 2. la réalité de la guérison déclarée, 3. le caractère inexplicable, ou non, de cette dernière. Ces médecins sont également chargés de déterminer si, sur le plan médical, les trois caractéristiques traditionnelles exigées par l’Église sont présentes : l’instantanéité de la guérison, l’absence de convalescence et la persistance de la guérison. Pour ce faire, le médecin permanent travaille, en quelque sorte, comme un juge d’instruction. Il ouvre une enquête et cherche à rassembler toutes les pièces qui lui permettront de se prononcer avec certitude sur ce cas de guérison. Par exemple, il contacte le médecin traitant de la personne guérie, il demande à cette dernière de réaliser des examens complémentaires auprès de spécialistes, il recueille les témoignages de ses proches, etc. Si la guérison répond à l’ensemble de ces critères et qu’elle est considérée comme inexplicable par le Bureau médical, le dossier est ensuite envoyé à une seconde instance, créée en 1947 : le Comité médical national de Lourdes, devenu en 1954 le Comité médical international de Lourdes (Cmil), siégeant une fois par an à Paris, et composé de médecins spécialistes désignés par l’évêque de Lourdes[19. Suite aux évolutions du monde médical de la première moitié du XXe siècle, où le rôle grandissant des médecins spécialistes discrédite et vide, en partie, de sa substance celui des généralistes, l’évêque de Tarbes décide d’adjoindre au Bureau médical une deuxième instance, le Comité médical national de Lourdes. Ainsi, à partir de 1947, les guérisons « certaines et inexplicables » recensées par le Bureau médical doivent être confirmées par une seconde instance de contrôle médical, composée d’une vingtaine de membres, spécialistes de différentes branches de la médecine. En 1954, par souci de conformer cette instance médicale à la diversité toujours plus grande des pèlerins et des malades qui affluent de tous pays, le Comité médical devient international.]. Ces derniers examinent le cas une nouvelle fois, afin de s’assurer que la guérison ne trouve aucune explication susceptible d’être retenue par la science.
Enfin, le dossier arrive au troisième niveau, strictement religieux : il est soumis au jugement de l’évêque du diocèse de la personne guérie, qui enquête sur la vie du requérant et sur le contexte de la guérison. Cet évêque décide, seul, de proclamer (ou pas) le miracle.
Je pensais que la proclamation du miracle reviendrait à l’évêque de Lourdes et non à l’évêque du diocèse de la personne guérie… Le miracle unirait ainsi toute la communauté chrétienne…
Pas forcément ! Beaucoup d’évêques restent embarrassés par la question des miracles. Il n’y a qu’à voir les chiffres : entre 1858 et aujourd’hui, les autorités médicales de Lourdes ont enregistré un peu plus de 7000 déclarations de guérison, dont 2000 d’entre elles ont été jugées inexplicables en l’état des connaissances médicales. Sur ces 2000 cas, seules 69 guérisons ont été reconnues miraculeuses par des évêques.
Pourquoi les évêques bloquent-ils la procédure ?
Certains préfèrent sans doute se passer de ce type de publicité pour leur diocèse. Mais la raison principale de leur refus réside dans le fait que les médecins de Lourdes ont de plus en plus de mal à se prononcer sur le caractère certain et définitif de la guérison. Les maladies qu’ils examinent aujourd’hui sont différentes de celles du début du XXe siècle : concernant les maladies dégénératives comme le cancer ou la sclérose en plaques, il est difficile d’affirmer, quand on constate une amélioration, qu’il s’agit d’une guérison définitive. La médecine actuelle est beaucoup plus relativiste que celle de la fin du XIXe siècle qui revendiquait le statut de science exacte. Cette évolution a compliqué la reconnaissance des miracles à Lourdes : les jugements des médecins semblent plus fragiles, et, face à cela, les évêques se réservent sans doute le droit de ne pas se prononcer.
Il fut un temps où l’Église a cherché l’appui d’une médecine positiviste pour rendre solide son jugement sur les guérisons déclarées « miraculeuses », et ainsi répondre aux critiques des rationalistes. Or l’évolution de la médecine a perturbé ce schéma…
Un grand nombre de guérisons restent donc à l’état de « presque-miracles », coincées à mi-chemin de la procédure. Ce cas de figure doit être décevant pour
les médecins du Bureau médical…
Oui. Au moment où j’ai fait mon terrain, en 2006 et 2007, le responsable du Bureau médical estimait que « les évêques [devaient] prendre leur responsabilité ». Cette position est assez compréhensible : si les médecins du sanctuaire réalisent ce travail d’enquête, mais que les évêques ne se prononcent pas sur le résultat de leur travail, leur activité de contrôle perd de son sens. Le silence de certains évêques explique l’existence, à certaines périodes, de campagnes de relance des médecins auprès des évêques concernés par certaines guérisons (à la veille des anniversaires par exemple : au cinquantenaire puis au centenaire des apparitions, plusieurs miracles ont ainsi été proclamés).
Le travail d’accumulation des preuves du Bureau médical s’est-il modifié en 150 ans d’existence ?
Le travail d’expertise et ses contraintes ont suivi les évolutions de la médecine. Il est donc évident que les examens complémentaires que les requérants au titre de « miraculé » doivent réaliser actuellement n’avaient pas lieu d’être à la fin du XIXe siècle. Les dossiers se chargent donc de preuves de natures différentes.
Combien de temps faut-il aux médecins pour traiter un dossier et rendre une conclusion ?
Il est difficile de dire a priori le temps nécessaire au traitement d’un dossier. Il s’agit toujours de cas singuliers. L’accord entre les médecins sur un cas de guérison n’est pas toujours simple (ils viennent souvent de spécialités médicales différentes).
Si parler d’action du temps n’a pas de sens en soi, les médecins peuvent néanmoins en faire une « res-
source agissante » dans un système de preuves. Prenant alors la forme d’une épreuve, le temps peut servir à « qualifier un changement d’état » : il peut transformer l’« amélioration énorme » constatée par les médecins en « rechute et évolution de la maladie » ou, au contraire, éloignant le risque de la récidive, en « guérison complète ».
La reconnaissance officielle, par l’Église, du statut de miraculé, confère-t-elle une autorité religieuse à la personne ?
Non, mais l’inscription à la liste officielle des miraculés de Lourdes confère à elle seule une certaine autorité. Cette question des miracles est très médiatisée actuellement, et faire reconnaître le caractère miraculeux de sa guérison, c’est participer dans le même temps à l’affirmation de l’efficacité thérapeutique du sanctuaire. On peut imaginer qu’un certain nombre de personnes « guéries » ne souhaitent pas officialiser leur guérison et celles-ci échappent alors au sanctuaire.
Au regard de l’évolution de la médecine, n’a-t-il jamais été question d’assouplir les critères de reconnaissance des miracles ?
Les critères de contrôle utilisés à Lourdes, élaborés à Rome au XVIIIe siècle, n’ont pas changé. Or, on l’a vu, il est désormais difficile d’établir le caractère définitif d’une guérison, comme il est aujourd’hui rare de rencontrer des malades qui n’auraient pas reçu de médication. Aussi, une autre procédure a-t-elle été mise en œuvre à partir de 2005. Cet autre outil ne vise pas à « reconnaître » des miracles, mais à faire connaître des « guérisons remarquables ». Jusqu’à présent, le Cmil a reconnu cinq cas de « guérisons remarquables », mais seule celle de Serge François (guéri d’une algie sciatique) a été promulguée par un évêque et a fait l’objet d’une inscription au registre officiel des miraculés, en 2011.
Quels sont les critères de reconnaissance des « guérisons remarquables » ? En quoi diffèrent-ils de ceux mobilisés pour apprécier les miracles ?
Pour les médecins du sanctuaire, il ne s’agit pas de faire une deuxième catégorie au rabais où l’enquête diagnostique serait moins sérieuse, mais de faire une catégorie différente qui permet de regrouper des guérisons qui n’ont pas la prétention d’être inexpliquées, mais seulement hautement improbables.
Pour qu’elles soient qualifiées d’« exceptionnelles », les modalités de la guérison doivent suivre une procédure précise : le malade a présenté des symptômes invalidants qui ont persisté pendant une durée minimum de 5 ans, ces symptômes ont gravement entravé sa vie quotidienne, ils ont résisté à tous les traitements prescrits, la guérison fut subite dans des circonstances qui sont en relation avec le sanctuaire de Lourdes, elle a persisté plus de 10 ans, cette guérison était hautement improbable.
Les médecins reconnaissent que le point faible de cette nouvelle démarche de contrôle se situe du côté du diagnostic : l’enquête diagnostique existera, mais elle ne pourra jamais être aussi affirmative que pour les cas retenus par le Cmil dans le cadre de la procédure de reconnaissance des miracles. Cette nouvelle catégorie des guérisons exceptionnelles accueillera donc des cas refusés par le Cmil (souvent des dossiers incomplets ne permettant pas de conclusions définitives). Dans cette catégorie, le diagnostic sera vraisemblable, mais non certain.
Face à votre enquête, les médecins de Lourdes n’ont-ils pas éprouvé la crainte de voir leur secret de fabrication profané ?
Pas du tout ! Dans les premiers temps, j’ai éprouvé quelques difficultés à accéder aux archives du Bureau médical, mais les médecins ont finalement estimé qu’il s’agissait d’un travail qui devait être accompli. Car si les miracles de Lourdes sont célèbres, on sait très peu de choses en revanche du travail d’enquête complexe que ces médecins réalisent.
Continuez-vous vos recherches sur Lourdes ?
Je souhaite approfondir davantage certains points peu développés dans mon travail de thèse. Par exemple, l’idée de volonté de vérité qui semble traverser toute l’histoire des événements de Lourdes, celle de la construction du sanctuaire, du contrôle des guérisons…
J’ai également ouvert des chantiers de recherches qui prolongent l’approche de mon travail de thèse. Par exemple, je travaille actuellement avec des juristes sur la construction juridique de la discrimination. De la même manière que j’étudiais les procédures probatoires des médecins du sanctuaire de Lourdes pour parvenir à la conclusion d’une guérison « inexplicable », je travaille sur la façon dont des juges parviennent à juger une situation comme « discriminatoire » ou non. De ce point de vue, ce qui m’intéresse, c’est la construction de jugements professionnels dans des situations marquées par l’incertitude.
by Julia Burtin Zortea | 21 décembre 2016 | Bout d’ficelle
Assimilée au capitalisme, à la futilité et à l’extravagance du style vestimentaire bourgeois, la mode est fortement dépréciée dans l’URSS naissante, au lendemain de la révolution d’Octobre. Prônant le rejet de la consommation ostentatoire, l’homme et la femme bolcheviques doivent faire preuve d’austérité et s’habiller simplement. Très rapidement pourtant, dès les années 1930, le concept de mode réapparaît, des politiques vestimentaires sont élaborées, une organisation bureaucratique statue sur la pertinence « soviétique » des modèles créés… Entretien avec Larissa Zakharova, historienne et auteure de S’habiller à la soviétique. La mode et le Dégel en URSS (éd. CNRS, 2012).
Ce texte est issu du numéro 2 de Jef Klak, « Bout d’ficelle », paru en mai 2015 et encore disponible en librairie.
Téléchargez l’article en PDF.
Comment en êtes-vous venue à l’étude de la mode soviétique ?
À Saint-Pétersbourg, j’ai commencé par travailler sur la redistribution du logement pendant la guerre civile (1917 à 1921). Le sujet n’avait rien à voir avec la mode, mais m’a poussée à définir le cadre théorique de ce que serait une histoire du quotidien en Union soviétique. Dans l’historiographie russophone des années 1990, l’histoire du quotidien était assez mal vue. On la considérait comme anecdotique, dissociée de la grande histoire événementielle qui elle, avait toute sa légitimité. Il se disait qu’aborder le quotidien revenait à faire une description statique et non problématisée des manières de vivre et de faire, laquelle n’avait pas un grand sens explicatif par rapport à l’expérience soviétique.
De cette historiographie russophone, je suis passée à l’historiographie francophone, et j’ai découvert les travaux de Michel de Certeau sur les arts de faire, les ruses anonymes et le bricolage qui composent le quotidien… Il m’a semblé que ce cadre conceptuel et théorique convenait très bien à cette société de pénurie : en Union soviétique, les individus étaient contraints de s’adapter au manque et à la pénurie au quotidien, et devaient déployer toute une palette de manières de faire pour construire leur mode de vie et leur environnement matériel.
Puis j’ai découvert les travaux de Alf Lüdtke[2. Alf Lüdtke (dir.), Histoire du quotidien, Paris, Éditions de la MSH, 1994 (1989).] et de l’Alltagsgeschichte (histoire de la vie quotidienne) allemande. Ce courant insiste, de la même manière que de Certeau, sur la créativité des agents ordinaires, mais en lien étroit avec la sphère d’action politique et économique d’État. Quand je me suis intéressée à la mode en URSS, pour ma thèse de doctorat, j’ai défini le quotidien comme lieu d’intersection entre politiques d’État et réponses des individus. Ceux-ci peuvent à leur tour modifier le cours des événements et les cadres d’action des dirigeants, infléchir le cours des politiques.
Comment avez-vous procédé pour écrire votre histoire de la mode ?
L’essentiel de ma documentation provient des archives institutionnelles. De ce point de vue, l’historien de l’URSS est bien loti, parce que cet État bureaucratique a produit énormément de documentation, dans des domaines qui ne sont pas aussi bien documentés dans les sociétés démocratiques libérales. L’univers de la création vestimentaire était, parmi d’autres, une sphère très investie par l’État. Dans les sources institutionnelles, on trouve de nombreuses traces des interventions et négociations entre les dirigeants, les experts et les consommateurs.
J’ai avant tout travaillé avec les matériaux fournis par les instances de création vestimentaire : les « Maisons de modèles de vêtements ». Dans ces institutions étatiques, les créateurs étaient des fonctionnaires chargés de concevoir des modèles de vêtements pour les entreprises de confection, qui étaient souvent réutilisés par les ateliers de couture sur-mesure. Les modèles devaient correspondre au concept de mode socialiste qui avait été élaboré au préalable, et se distinguer de la mode « bourgeoise », incompatible avec la société soviétique. J’ai également consulté les fonds d’autres instances : le Conseil des ministres ; le Comité central du Parti, qui veillait à l’élaboration et à l’application des mesures prises durant l’époque khrouchtchévienne[3. Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste de l’URSS de 1953 à 1964 et président du Conseil des ministres de 1958 à 1964.]. J’ai aussi travaillé avec les documents de la Direction des statistiques, parce que les dirigeants voulaient savoir ce que les individus consommaient, de quelle manière, et dans quelle mesure ils étaient satisfaits de ce que l’État leur offrait comme biens de consommation. Enfin, j’ai utilisé les enquêtes sur les budgets des ménages, réalisées par les Directions des statistiques à travers le pays. À partir du terrain de Leningrad (Saint-Pétersbourg), j’ai sélectionné un échantillon de 465 enquêtes, dans lesquelles j’ai analysé ce que les individus achetaient, combien ils dépensaient dans les magasins d’État ou auprès de particuliers qui vendaient sur les marchés ; combien ils dépensaient dans les ateliers étatiques de couture sur mesure ; combien chez les couturiers privés.
Tous ces documents m’ont donné un tableau général des politiques menées dans le domaine de l’habillement, ainsi que des pratiques de consommation des individus ordinaires pendant la période de dégel des années 1950-1960. J’ai ensuite complété ces matériaux d’archive par une vingtaine d’entretiens avec des consommateurs de cette période, qui m’ont permis d’aborder la question des cultures de consommation : pourquoi les gens s’adressent plutôt aux couturières privées ou à un atelier de couture sur-mesure ; qui achète dans les magasins d’État, et qui refuse par principe d’y aller ?
Pouvez-vous détailler ce que vous entendez par « mode soviétique » ? Comment ce concept a-t-il émergé, et comment est-il devenu un objet politique de l’URSS ?
La formulation même de l’expression « mode soviétique » rencontre souvent des sourires sarcastiques parmi les chercheurs – il s’agirait de deux termes inconciliables. Or, pour les acteurs de l’époque soviétique, le terme avait du sens, même s’il n’avait rien d’une évidence. L’élaboration de ce concept a fait l’objet d’âpres débats au fil des changements politiques de l’État soviétique.
Dans un premier temps, au lendemain de la révolution d’Octobre, la situation est particulièrement incertaine : les entreprises de confection et de textile ferment, puis sont nationalisées, mais elles ne peuvent fonctionner, puisque le pays est en guerre civile jusqu’en 1921. L’État n’a pas encore défini de politiques dans le domaine de l’habillement. En revanche, un milieu artistique émerge, et des créateurs expérimentent différents styles. On voit apparaître, par exemple, les courants du constructivisme révolutionnaire et de l’art industriel – que l’on voulait faire descendre dans la rue et rendre accessibles à tous. Les porteurs de ces concepts et de ces expériences artistiques possèdent souvent une formation prérévolutionnaire et connaissent des créateurs occidentaux, français notamment.
Nadejda Lamanova est l’une des figures fondatrices de la mode socialiste. C’est une couturière, qui avait créé des toilettes pour la cour impériale avant la révolution. Paul Poiré, avec qui elle était en contact, pensait qu’elle resterait travailler en France après la Révolution. Mais Lamanova faisait partie de ceux qui étaient très attirés par l’idéologie bolchévique. Elle est donc restée en Russie pour élaborer le cursus de formation des créateurs, appliqué au premier Institut textile fondé à Moscou en 1919. Elle élabore le principe du costume socialiste, qui devait être « rationnel » et fonctionnel, où la forme devait être adaptée aux circonstances, à la morphologie, au type de personnalité… Il s’agissait presque d’une théorie de la mode, mais qui ne s’opposait pas encore à la mode bourgeoise occidentale. Très vite pourtant, cette élaboration théorique a été utilisée dans les débats sur l’incompatibilité de la mode, phénomène d’origine bourgeoise, avec l’économie socialiste et la société soviétique, censée être égalitaire, où les distinctions sociales étaient prohibées. Ce concept de mode soviétique a donc été élaboré à l’époque de la Nouvelle politique économique (NEP – entre 1921 et 1928), qui introduit une relative libéralisation économique et le retour d’une certaine liberté dans le quotidien, pour dynamiser le pays suite à la guerre.
À la fin des années 1920, Staline s’impose à la tête du pouvoir et met fin à la NEP. Il nationalise et centralise l’ensemble de la production, et introduit une politique d’industrialisation à marche forcée, ainsi que des cartes de rationnement dans le quotidien. Toute réflexion sur la mode devient alors complètement inappropriée, puisque les usages politiques promeuvent l’ascétisme. Le terme même de « mode » est en quelque sorte banni du vocabulaire quotidien. Les magazines apparus dans les années 1920 changent de titre : ils ne portent plus ouvertement sur la mode, mais sur « l’art de s’habiller », qui défend les idées de rationalité, de fonctionnalité, de simplicité. On ne parle plus de mode.
À la fin de la NEP, les créateurs se réfèrent-ils à l’idée de formation d’un homme nouveau pour justifier les choix esthétiques des vêtements ? Les choix formels sont-ils articulés à une idéologie ?
Le concept de mode socialiste élaboré par Nadejda Lamanova s’inscrivait déjà dans un discours général sur l’homme nouveau. Elle n’était pas la seule à promouvoir ces idées, et dialoguait constamment avec d’autres personnalités, comme le commissaire à l’Éducation (Anatoli Lounatcharski), ou le commissaire à la Santé (Nikolaï Semachko), qui promouvaient l’idée d’hygiène sociale. Le débat sur l’hygiène peut paraître un peu éloigné de celui sur la mode, mais ils ont une vraie cohérence. Dans le projet de l’homme nouveau vivant dans une société égalitaire, les propositions de Lamanova allaient dans le même sens que celles d’autres penseurs de l’époque.
Après la période d’industrialisation, un nouveau revirement survient dans la deuxième moitié des années 1930. Suite au 17e congrès du Parti en 1934, Staline déclare que les fondements du socialisme ont été posés en Union soviétique, et que l’époque de l’ascétisme est terminée. « La vie est devenue meilleure et plus joyeuse », son fameux slogan, est affiché partout. C’est dans ce cadre qu’est lancée la campagne de lutte pour la koultournost’ (voir encadré), cette acculturation de l’homme nouveau. On estime que l’idée d’hygiène sociale n’a pas suffisamment été appliquée, et l’on entreprend donc d’expliquer aux Soviétiques ce qu’est être koultourny, un « homme civilisé ». Cette lutte pour la koultournost’ entraîne le retour en force de l’idée de mode : l’homme ou la femme soviétique est « civilisé » quand il sait s’habiller avec goût et selon la mode. Par cette idée d’éducation du goût, les créateurs trouvent leur fonction dans la société soviétique : ils sont chargés d’élaborer les tendances de mode, et peuvent ainsi éduquer les consommateurs au sens du « beau ». Dans la mesure où la mode socialiste vise à donner à tous un sens de l’esthétique, on estime alors que celle-ci n’est plus problématique, puisqu’elle ne produit pas de distinction sociale.
Mode et économie planifiée font-elles bon ménage ?
Difficilement. La mode, avec le concept d’évolution des tendances, implique en effet de changer périodiquement les vêtements avant leur usure matérielle. Or, d’après les économistes soviétiques, on ne peut pas jeter les produits issus du travail humain avant leur usure physique complète : ce serait irrationnel et contre-productif. Jusqu’à la fin de l’époque soviétique, les créateurs ont buté sur l’argument selon lequel la mode ne convenait pas à une économie planifiée. Ils ont donc tenté d’élaborer un rythme spécifique à la mode socialiste, moins rapide que la mode occidentale. Ils « ralentissent » la mode en proposant plusieurs lignes simultanées : parallèlement au « fond de collection[4. Ensemble des modèles qui restent inchangés d’une collection à l’autre, malgré les changements de tendances.] » permanent, les créateurs alimentent le marché avec des tendances déjà produites lors des précédentes saisons, en même temps qu’ils produisent de nouvelles silhouettes. Ils offrent ainsi plusieurs rythmes de changements de silhouettes, et parviennent à justifier la présence de la mode dans le cadre de l’économie planifiée socialiste.
Sur quoi se fonde ce « sens du beau », censé être partagé par tous ?
Il se fonde sur la notion de « bon goût », qui implique que le « sens du beau » est le même pour tout le monde. Les créateurs élaborent des règles de bon goût complètement figées, qui n’évoluent pas dans le temps. C’est pourquoi l’idée de bon goût se substitue souvent à l’idée même de mode, jusqu’à la dénaturer, puisque la mode est censée évoluer et altérer les conventions du goût. Or les créateurs soviétiques définissent leurs fonctions sociales par un travail d’éducation des consommateurs au bon goût, et oublient que la mode peut jurer avec ses règles.
Concrètement, le bon goût de rigueur consiste à accorder les accessoires de la même couleur : le chapeau, les gants, les souliers, le sac, l’écharpe ou le foulard. Une autre règle préconise de changer de souliers en arrivant au théâtre : on laisse les bottes dans le vestiaire et on chausse des souliers élégants pour assister à un ballet, à l’opéra ou à une pièce de théâtre. Ou encore, on choisit ses vêtements en fonction des circonstances, comme cela se fait dans la mode occidentale : en France, la mode distingue les robes de cocktail, celles de l’après-midi ou du soir… Cette distinction est reprise par les créateurs soviétiques, qui y ajoutent des valeurs propres à la société socialiste. Ils introduisent par exemple la catégorie des vêtements de travail.
Le discours des créateurs est aussi beaucoup plus normatif que celui des journalistes de mode, français notamment. Les créateurs soviétiques, qui jouent également le rôle de journalistes, peuvent écrire dans la presse qu’« il est impossible de porter chez soi des robes démodées ». On cherche également à créer des vêtements d’intérieur, qui doivent eux aussi être à la mode : une des règles du bon goût dictait en effet de changer de vêtements en rentrant chez soi. On ne pouvait pas être habillé de la même manière du matin au soir, il fallait changer de tenue à plusieurs moments de la journée.
Dans vos travaux, vous parlez du rôle du Grand conseil artistique, qui sélectionnait les modèles avant leur production. Il semble que la question du bon goût faisait polémique parmi ses membres…
Le Grand conseil artistique réunissait des représentants de différents corps professionnels. Il sélectionnait les modèles élaborés par les créateurs, et pouvait imposer un véto à certains d’entre eux. On n’y discutait pas tant du goût, mais plutôt des besoins des consommateurs. Les membres de ce conseil avaient des interprétations très divergentes des ordonnances du gouvernement. Ce dernier demandait d’améliorer le quotidien des Soviétiques en fournissant aux consommateurs davantage de vêtements, beaux, pratiques, confortables, etc. Mais les termes des ordonnances étaient très vagues et c’était aux professionnels de les interpréter, de les décliner en fonction de leur définition de ce qu’étaient les « beaux » vêtements, convenables à l’homme soviétique.
Les différences entre cultures professionnelles créaient des blocages dans la communication entre les acteurs censés travailler de concert. Les « travailleurs de commerce » – les employés des magasins d’État – avaient par exemple leur propre procédé de suivi de la demande, qui se fondait sur ce qui avait été demandé pendant la période précédente. Cette définition de la demande jurait avec la notion de mode, parce qu’elle ne pouvait prendre en compte aucune nouveauté. Les travailleurs de commerce rejetaient d’emblée toute nouveauté radicale, parce qu’ils ne pouvaient être sûrs de son succès, et apparaissaient donc comme conservateurs au sein des instances de sélection.
Ces employés de magasins d’État choisissaient-ils eux-mêmes ce qu’ils faisaient entrer dans leur stock de marchandises à commercialiser ?
Les vendeurs et leurs chefs, qu’on appelait « experts en marchandises », devaient effectivement suivre la demande par le biais de feuilles de contrôle, en notant chaque transaction. La méthode de suivi n’était pas parfaite, car sans moyen de systématiser, on notait de manière un peu lacunaire, aléatoire. Il existait donc certains mécanismes de transmission de la demande. « Une femme est venue demander une robe noire pour des funérailles et n’en a pas trouvé » : c’était noté, et transmis aux entreprises de confection. Mais que faisaient celles-ci ? Elles produisaient 10 000 robes noires de funérailles, selon le plan quinquennal. Cela provoquait forcément un problème d’ajustement, entre une demande ponctuelle et ce type d’arrivages.
Il se pouvait aussi que la demande bute sur un problème de fourniture des matières premières. Si des consommateurs demandaient des robes en laine de telle silhouette, il était possible d’en obtenir le patron, mais que l’entreprise ne dispose pas de tissu en laine pour les produire en quantité suffisante. L’économie centralisée n’arrivait tout simplement pas à activer jusqu’au bout ce mécanisme de communication, qui était pourtant formellement instauré entre les différentes instances de production vestimentaire.
Pour revenir à l’idée des cultures professionnelles divergentes, c’est avant tout la nouveauté des lignes qui posaient problème aux travailleurs de commerce, qui se fondaient sur les observations des pratiques d’achat passées. Ces propositions de nouveautés étaient également problématiques pour les travailleurs des entreprises de confection. Ils avaient les chiffres du plan en tête et lorsqu’ils voyaient une ordonnance expliquant qu’il fallait produire plus de « beaux vêtements pratiques pour le consommateur soviétique », cela signifiait, pour eux, produire la même robe en 25 000 exemplaires. C’était simple : on activait les chaînes de production, et hop hop hop, c’était produit. Pour les créateurs, la mode, c’était au contraire la diversité, et produire plus de beaux vêtements voulait dire proposer une plus grande variété de silhouettes. Les entreprises étaient particulièrement résistantes à cette diversification, qui impliquait d’adapter le processus de production à chaque patron, chaque matière, et d’apprendre aux ouvrières à couper les nouveaux tissus. Dans les magasins d’État, on trouvait donc surtout des vêtements démodés, qui étaient produits selon le plan et non pas selon les propositions des créateurs.
Il y avait donc une immense différence entre ce que les créateurs proposaient et les vêtements qui parvenaient à la population…
Oui mais, néanmoins, les gens pouvaient très facilement se tenir informés des dernières créations. Les patrons des modèles validés par le Grand conseil artistique – non produits en masse – étaient présentés dans les magazines de mode. À chaque fois que l’on se rendait au cinéma, les actualités, projetées sous forme de courts-métrages avant le film, contenaient des défilés de mode ; et les émissions de radio donnaient des descriptions verbales des nouvelles silhouettes à la mode. Par ailleurs, les nouvelles collections de la Maison des modèles faisaient l’objet de présentations publiques. Les consommateurs pouvaient ensuite suivre ces suggestions, mais ils devaient se montrer ingénieux : trouver du tissu, une couturière, faire la queue dans un atelier de couture sur-mesure, ou coudre eux-mêmes. En revanche, il serait faux de dire qu’à l’inverse, les personnes qui se rendaient dans des magasins d’État choisissaient la facilité, car il s’agissait d’espaces de pénurie.
Des modèles non validés par le Grand conseil artistique pouvaient-ils circuler sur le marché ? Quelle était l’influence de ce Conseil ?
Entre 1950 et 1960, on peut aisément parler du règne des experts. Les hiérarques du Parti faisaient confiance à ces personnes issues du milieu de la mode : ils les estimaient capables de juger ce qui serait beau et approprié, puisqu’elles appuyaient leur savoir sur une conception presque scientifique de la mode socialiste. L’étendue du pouvoir de ces experts s’illustre particulièrement avec l’affaire des stiliagui. Il s’agissait de jeunes, des zazous[5. Courant de mode de la France des années 1940. Il s’agissait de jeunes gens reconnaissables à leurs vêtements anglais ou américains, et affichant leur amour du jazz.] soviétiques, qui ont commencé à porter des vêtements de production étrangère à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rapidement considérés comme des personnes inclinées devant l’Occident bourgeois et non dévouées à la cause communiste, les stiliagui étaient assimilés à des « parasites sociaux ». Cet épisode s’inscrit dans un contexte politique bien particulier, marqué par la lutte contre le cosmopolitisme de la seconde moitié des années 1940.
Les créateurs sont intervenus dans ce débat en récupérant les tendances des zazous et en les intégrant, petit à petit, à leurs créations. Le style des stiliagui s’illustrait notamment par des pantalons très étroits – on disait qu’ils devaient s’armer de savon pour les enfiler, et ces jeunes étaient comparés, dans la presse, à des perroquets. En réponse, les créateurs ont donc rétréci la largeur des pantalons, jusqu’à les faire apparaître sous cette forme dans les magasins d’État, à la fin des années 1950. Ils étaient d’ailleurs tellement étriqués que des consommateurs ont alors fait le signalement suivant : « Vos pantalons sont si serrés que les hommes soviétiques qui se respectent doivent se faire coudre des pantalons plus larges par leurs propres moyens. » En jouant un rôle de médiateur, les créateurs ont ainsi réussi à faire passer la mode antisoviétique pour soviétique : à partir du moment où la mode des stiliagui a été intégrée aux créations officielles, la stigmatisation a cessé. Cela a amené certains chercheurs à dire que le mouvement des stiliagui avait disparu à la fin des années 1950. En réalité, ils sont devenus moins visibles dans le paysage urbain, car plus de jeunes gens se sont mis à porter des pantalons étroits. Mais l’étiquette même des stiliagui qui avait une forte connotation péjorative était désormais davantage appliquée aux marginaux et aux déviants sociaux (« hooligans », « parasites », etc.) qu’aux jeunes habillés à la mode. Le fait même de porter un pantalon serré a perdu le sens politique négatif qui lui avait été assigné jusqu’alors.
Un vêtement d’inspiration occidentale n’était donc pas considéré comme une menace s’il était produit sur le sol soviétique ?
Tout en définissant la mode soviétique en opposition à la mode bourgeoise, les créateurs soviétiques se sont toujours tenus au courant de ce qui se faisait en Occident. À l’époque du Dégel (1953-1964), ils se rendaient très régulièrement en France avec l’autorisation des instances du Parti : ils avaient pour consigne d’utiliser l’expérience occidentale afin d’améliorer le système de production vestimentaire de l’URSS. Cependant, les ordonnances du gouvernement étaient très vagues ; elles ne spécifiaient pas ce qu’était l’« expérience occidentale », et laissaient la possibilité aux créateurs de rencontrer qui ils voulaient. Inspirés par leur culture professionnelle, par Nadejda Lamanova et ses contacts au sein de la haute couture, ils ont vite repéré Paris et Christian Dior – qui passaient pour l’incarnation du « meilleur ». Tandis que les discours publics relayaient, dans la presse, l’opposition entre mode bourgeoise et mode soviétique, les créateurs écrivaient, noir sur blanc dans leurs rapports de mission, à propos de la mode française, que « tout [était] parfait et [pouvait] être imité ».
Ils reprenaient ainsi les modèles parisiens dans leurs créations, et les faisaient passer pour de la mode socialiste. Il s’agissait d’un double langage, en quelque sorte, et forcément, cela ne passait pas inaperçu. Par exemple, quand les créateurs des pays socialistes se réunissaient à des congrès internationaux de mode, ils s’adressaient des reproches réciproques du type « Vos robes trapèzes ressemblent étrangement à une proposition récente d’Yves Saint Laurent », ce à quoi les créateurs interpellés répondaient « Non, c’est faux, nous nous sommes inspirés des robes traditionnelles russes à bretelles, les sarafanes ». Justifiés ainsi, ils devenaient irréprochables, puisqu’ils avaient évidemment le droit de reprendre les lignes des costumes folkloriques. Ce qui comptait, c’était les justifications qui paraîtraient dans la presse et qui permettraient de dire : « Ça, c’est de la mode socialiste ! » Au final, un citoyen soviétique qui aurait eu accès au patron d’une robe occidentale par voie de contrebande, et qui l’aurait fait reproduire chez une couturière, n’aurait pas été montré du doigt dans la rue, parce que le gouvernement faisait, tout simplement, la même chose que lui.
Contrairement à l’idée reçue d’une grande standardisation
des produits sur le marché soviétique, les vêtements présentaient donc une grande diversité…
C’est ce que l’on peut voir sur les photos prises par des particuliers – et non sur des photos officielles, car les photographes de presse devaient représenter la foule soviétique comme homogène. Entre 1950 et 1960, les silhouettes partagent de grandes similarités entre la France et l’Union soviétique, même si les conditions de production altéraient la qualité des matériaux et modifiaient les lignes des vêtements. Et puis, les citoyens soviétiques avaient aussi accès à des films étrangers dans le cadre de programmes de coopération culturelle, comme le festival de films néoréalistes italiens de 1957. Suite à la projection du film français Babette s’en va-t-en-guerre (1959) avec Brigitte Bardot, les femmes soviétiques se sont massivement coiffées « à la Babette ».
Existe-t-il une distinction sociale par la mode ? La haute couture existe-t-elle encore ?
Même si c’était une prétention du régime, la société soviétique n’a jamais été égalitaire. Très vite, les privilèges se sont institutionnalisés, et les élites ont bénéficié d’un accès facilité à des produits plus diversifiés et de meilleure qualité. Ces inégalités se justifiaient de différentes manières. À partir des années 1930, suite aux exploits d’Alexei Stakhanov, le stakhanovisme[6. Afin d’améliorer la productivité industrielle de l’URSS, le second plan quinquennal (1933-1937) est caractérisé par la création d’écoles techniques pour former et perfectionner les travailleurs, et élève au rang de « héros du travail » les ouvriers qui se démarquent par leur forte efficacité. Le plus célèbre d’entre eux est le mineur Alexeï Stakhanov qui, dans la nuit du 30 au 31 aout 1935, aurait abattu 14 fois plus de charbon que la norme établie. Cette propagande en faveur du sacrifice au travail s’accompagne de l’augmentation de contraintes et de sanctions encadrant sévèrement les ouvriers (suppression des salaires pour les travailleurs considérés inefficaces, rétablissement du livret ouvrier, allongement de la journée de travail, etc.).] fait son apparition, avec le privilège, pour les « travailleurs de choc » d’accéder à un niveau de vie supérieur à celui des autres. Par ailleurs, il se disait aussi que les travailleurs dirigeants qui avaient de lourdes responsabilités, comme celle de représenter l’Union soviétique à l’étranger, devaient avoir une apparence convenable, respectable. C’est ainsi que les « distributeurs spéciaux » ont été créés : grâce à des systèmes de distribution spécialisés et fermés, les travailleurs des différents corps ministériels et du Parti avaient droit à des biens de meilleure qualité. Les élites artistiques bénéficiaient à peu près des mêmes avantages, et je me suis rendu compte, en menant des entretiens, que certains s’évertuaient, de plus, à établir des liens informels avec les Maisons des modèles, pour y acheter les pièces uniques qui avaient servi lors de défilés de mode, selon le principe de la haute couture. Les entreprises de confection avaient tendance à simplifier les patrons envoyés par les créateurs : par souci d’efficacité, l’idée créatrice était altérée. La pièce unique créée pour le défilé n’était donc jamais reproduite à l’identique, et était forcément de meilleure qualité, légèrement différente que les vêtements produits en masse. Donc oui, bien sûr, il existait une distinction sociale par le biais de la mode.
Vous pouvez peut-être en dire un peu plus sur les pratiques
quotidiennes des consommateurs ?
J’ai distingué, très schématiquement, trois cultures de consommation par rapport à la mode : ceux qui suivent la mode, ceux qui préfèrent le classicisme des magasins d’État, et les personnes qui empruntent aux deux. Ceux qui suivent la mode ne se rendaient jamais dans des magasins d’État : ils s’adressaient à une couturière privée, à un atelier de confection, ou cousaient eux-mêmes. Ces trois manières de fabriquer correspondent à des budgets différents – le plus cher étant d’avoir recours à des couturières privées, et le moins onéreux étant de coudre soi-même.
À partir des enquêtes de budget et des entretiens que j’ai réalisés, je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de lien de corrélation entre les revenus des gens et leur culture de consommation. On pouvait avoir de très faibles ressources et suivre une mode, à partir du moment où l’on avait une machine à coudre à la maison. Ma grand-mère, par exemple, cousait pour toute la famille. Elle suivait des patrons de couture, et y ajoutait sa marque de fabrique, son style… On reconnaissait chacun de ses vêtements.
C’était une pratique courante ?
Oui, et c’était aussi encouragé par l’État car, malgré la volonté du pouvoir de satisfaire les besoins des consommateurs, il existait des problèmes d’approvisionnement et de communication entre les différents maillons de la chaîne du système de production. Aussi, en parallèle de la production d’État, on trouvait un discours sur la nécessité, pour les jeunes filles, d’apprendre la couture – « C’est toujours pratique ». Je suis née en 1977, et j’ai appris à coudre à l’école, alors qu’en France, à la même époque, les cours de couture avaient été supprimés depuis longtemps dans l’enseignement général. Il existait même des cours du soir, pour celles qui voulaient se perfectionner. Les moyens mis à disposition par l’État étaient tels que l’on pouvait ensuite transformer cette activité en profession, et donc en activité illégale, puisqu’en théorie, on avait pas le droit de faire du profit chez soi. Malgré ce paradoxe, il existait un milieu très dense de couturières expérimentées, lesquelles avaient leur clientèle.
Elles ne couraient aucun risque ?
En cas de litige, un client aurait toujours pu dénoncer sa couturière – et dans ce cas, la milice constatait la production illégale, et condamnait la personne à un ou deux ans de travaux forcés – mais en réalité, le système fonctionnait bien, parce qu’il y avait une complicité et des intérêts communs entre clientèle et couturières. Cela complétait l’offre de l’État.
Finalement, cette diversité des pratiques, cette variété des silhouettes et l’image du bien-être qui se reflètent dans les archives privées découlaient de la participation de tous ces acteurs légaux, semi-légaux et illégaux. Ce qui comptait pour les dirigeants soviétiques, c’était le résultat final : la satisfaction du consommateur. Si la foule avait l’air contente, pourquoi chercher à embêter les couturières alors qu’elles apportaient leur pierre à l’édifice du bien-être général ?
On retrouve cette attitude ambivalente pour la revente des biens occidentaux, entrés en Union soviétique par voie de contrebande ou lors des divers moments d’ouverture à l’Ouest. Par exemple, le Festival international de la jeunesse et des étudiants de 1957 a été le théâtre de ventes massives de biens étrangers. Or, vendre des vêtements dans la rue était interdit puisque considéré comme une forme de spéculation. Aussi, des « dépôts-ventes » ont été mis à disposition des étudiants étrangers pour servir de points de revente, où ils pouvaient ensuite être légalement achetés par des consommateurs soviétiques ordinaires. Les objectifs économiques n’étaient pas toujours alignés sur le discours et la logique de pureté politique.
Où se fournissaient les stiliagui ? Dans ces magasins d’occasion ?
Suite à la Seconde Guerre mondiale, les biens étrangers entrent d’abord en Union soviétique sous forme de butin de guerre, de trophées saisis par les soldats et les officiers de l’Armée rouge. Ensuite, ils entrent avec les touristes. Des fartsovchtchiki – des spéculateurs, selon le langage officiel, qui vendaient des biens de production étrangère – allaient voir les touristes étrangers et leur demandaient d’acheter leurs chemises, leurs chaussettes, tout ce qu’ils pouvaient. Puis le trafic s’est développé, et des « touristes » bien informés amenaient intentionnellement des biens à revendre parallèlement au développement des magasins d’occasion.
Même si, au début, le stiliaguisme s’est fondé sur l’usage des biens de production étrangère, la plupart de ces jeunes fabriquaient des vêtements à partir de matériaux et de vêtements soviétiques. Avant que leur style ne soit repris par les créateurs, ils rétrécissaient leurs pantalons, ils amenaient leurs chaussures chez le cordonnier pour y faire mettre des semelles compensées. Ils bricolaient ce qu’ils imaginaient être de la mode occidentale. D’ailleurs, plusieurs mémoires écrits par des stiliagui racontent leur stupeur lorsqu’ils rencontrèrent la vraie jeunesse occidentale, lors du Festival de la jeunesse de 1957 : ce qu’ils avaient imaginé n’avait rien à voir avec les pratiques quotidiennes des jeunes occidentaux, habillés de manière très simple, beaucoup moins sophistiquée qu’eux.
Des règles officielles d’attribution de vêtements existaient-elles (quotas, contrôle de l’usure) ?
Non, hormis pendant les périodes où les cartes de rationnement étaient instaurées, et où il y avait des normes d’attribution des produits de consommation ordinaires. C’est-à-dire, lors de la guerre civile (de 1917 à 1921), puis avec les grandes politiques de planification et d’industrialisation (de 1928 à 1935), pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu’en 1948, puis sous l’époque gorbatchévienne, mais cela ne concerne alors que les biens alimentaires.
En deux mots, comment la mode socialiste a-t-elle évolué jusqu’à la fin du régime ?
Après la période du Dégel, dans les années 1960 et 1970, le système soviétique parvient à améliorer les conditions de production, les salaires augmentent, le pouvoir d’achat aussi (c’est ce que l’on appelle le contrat social brejnévien), le phénomène de reproduction des élites s’installe durablement, les canaux d’arrivage des produits occidentaux se multiplient, les jeans apparaissent sur le marché soviétique, l’industrie soviétique essaie de les reproduire…
Je n’ai pas fait d’enquête pour la période postérieure, mais je sais que la femme de Gorbatchev, Raïssa Gorbatcheva, a fait en sorte qu’un magazine de mode ouest-allemand, Burda moden, soit traduit en russe. Avec la Perestroïka, la distinction discursive entre une mode soviétique et une mode bourgeoise perd définitivement sa raison d’être.
La koultournost’
Dans une brochure moscovite publiée en 1938, la koultournost’ est définie comme « un ensemble d’attitudes dans la vie quotidienne : “l’homme cultivé’’ ne jure pas, ne crache pas… Il sait se tenir à table, se montrer galant avec les dames, il connaît les bonnes manières. Il apprécie la musique, le ballet, mais ce qu’il aime par-dessus tout, ce sont les livres. » Apparue dans les années 1930, la lutte pour la koultournost’ correspond à la volonté de « civiliser » les Soviétiques. La koultournost’ s’éloigne de la notion de capital culturel, car elle ne se réduit pas à une accumulation de connaissances dans les domaines de la culture dite légitime (art, littérature, musique, formation scolaire, etc.). Elle s’apparente davantage à la notion de « civilisation des mœurs » avancée par le sociologue Norbert Elias. Modèle de l’« homme cultivé », au même titre que la soznatel’nost’ (conscience sociale), la koultournost’ comprend une forte dimension hygiénique (aspect propre, apparence soignée), la diffusion des bonnes manières (gestes, expressions verbales), des normes du bon goût et du sens esthétique, le partage d’un niveau d’éducation jugé acceptable ainsi que des bases de connaissances sur l’idéologie soviétique. Cette stratégie d’intégration au moyen de valeurs et de pratiques communes était notamment dirigée vers les paysans qui arrivaient en ville pour gonfler les rangs des ouvriers.
by Julia Burtin Zortea | 24 janvier 2016 | Marabout
Dans le nord des Alpes, en Haute-Savoie et en Suisse romande, il n’est pas rare de faire appel aux talents d’un « leveur de mal » pour supprimer une douleur ou guérir une pathologie, jusque dans les services des urgences des hôpitaux. Efficace et discrète, cette pratique n’existe « que lorsqu’elle est mise en œuvre » ; modeste, mais tenace, elle questionne ce qu’elle ne cherche pas à expliquer.
Ce texte est extrait du numéro 1 de la version papier de Jef Klak, « Marabout », paru en septembre 2014 et encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF
En fouillant dans mes souvenirs d’enfance, il y a cette histoire d’école, celle de la fille qui, tout d’un coup, « perdit » ses encombrantes verrues au visage. Ses joues devenues lisses en un week-end, elle gagna le statut de star de la récré suivante, quand elle se fit un devoir de calmer la fascination angoissée des enfants réunis autour d’elle.
Au vrai, elle ne dit pas grand-chose. Elle se contenta de confirmer qu’elle ne s’était pas fait traiter à l’azote chez un dermatologue – ce que nous voulions bien croire, car son visage ne portait nulle trace de l’opération. Puis ajouta que ses parents l’avaient amenée chez « une dame, un peu sorcière », et cela fit l’affaire.
En réfléchissant bien, il se trouve qu’un monsieur fit aussi l’affaire de la dentiste du village alors qu’elle ne parvenait pas à arrêter une hémorragie incontrôlable, qu’un autre intervint pour soigner les brûlures de deux amis, respectivement causées par un retour de flammes de barbecue au visage et une casserole d’eau bouillante renversée sur les cuisses, et qu’enfin, une dame d’un village voisin fit la mienne, d’affaire, sur le pied, alors que rien d’autre n’y faisait.
Ces dames et ces messieurs, on dit qu’ils coupent, lèvent, barrent, pansent, soufflent les maux. Le terme varie en fonction des régions. En Haute-Savoie, on utilise surtout « couper », alors qu’en Suisse romande, de l’autre côté de la frontière, ces dames et ces messieurs pratiquent « le secret ». Ils ne touchent jamais la blessure ni la personne souffrante ; ils ne sont pas magnétiseurs, ni rebouteux. On dit qu’ils ont le don, et que voilà.
« Je pouvais le faire »
Au téléphone, la femme a d’abord cru à une demande de soin, puis son mari, le charpentier, a accepté la rencontre tout en prévenant qu’il n’avait rien à dire. Ce couple habite au fin fond de la vallée du Haut-Giffre, dans un cul-de-sac formé par un cirque glaciaire, là où la route s’achève. Ce premier février, alors que je sonne à leur porte, il neige abondamment sur les chalets du village.
« Alors, quoi ? Que voulez-vous savoir ? » Installé en bleu de travail près de la cheminée, dans sa maison de bois, Jean explique qu’il y a vingt ans, un ami de son beau-père lui a transmis le don. « Pourquoi moi ? Je ne sais pas. Il a dit qu’il avait senti que je pouvais le faire. » Le charpentier « coupe » la douleur des brûlures, mais ne fait pas disparaître les blessures. « Je ne fais pas de miracles. » Pourtant, précise son épouse, « on dit que le processus de cicatrisation est plus rapide après l’intervention d’un coupeur ». Au fil du temps et de la pratique, Jean a découvert qu’il était capable de soulager, outre les blessures par le feu, « tout ce qui se rapporte à la sensation de brûlure ». Zona, herpès, coups de soleil, douleur consécutive à une radiothérapie… Plusieurs fois par jour, les demandes affluent. « Heureusement, je peux intervenir par téléphone, à distance. Il me suffit de connaître le nom de la personne, le lieu et la nature de sa douleur. » Et après ? Jean montre sa tête : « Après, j’y pense. »
Depuis le début de la conversation, l’épouse du charpentier tourne autour de la table, hésitante. D’une seule traite, enfin, elle livre son inquiétude : « Ce don, on ne sait pas d’où il vient, et le feu, une fois coupé, on ne sait pas où il va. Je suis certaine que lui, ça l’épuise. » Jean admet que la procédure le « fatigue », car elle requiert « une certaine concentration ». En revanche – et son épouse acquiesce –, il lui est impossible de refuser une demande. « Une fois qu’on a reçu le don, on se doit de le rendre. »

« Ni soigneur ni guérisseur »
« Dans cette vallée, nous sommes très nombreux à couper. C’est pareil dans la vallée de l’Arve… et dans le Chablais, je ne vous raconte pas ! Pourtant, nous n’en parlons jamais entre nous. Cette pratique n’existe que lorsqu’elle est mise en œuvre. » Catherine, institutrice à la retraite, a reçu le don de son oncle dans les années 1970, lequel « a peut-être su déceler chez moi une aptitude à l’empathie ». Depuis lors, elle coupe le feu, les hémorragies et l’eczéma, en précisant que « les formules sont différentes en fonction de ce que l’on soigne ». Comme Jean, du village voisin, elle n’a jamais volontairement ébruité son « histoire de don ». C’est en coupant que l’on devient coupeur, puis le bruit se répand. Catherine insiste : elle ne tient pas un commerce, et n’a pas besoin de publicité. « Je ne veux pas que l’on m’appelle guérisseuse. Ce que je fais est beaucoup plus modeste. C’est un service, toujours donné dans l’urgence, et gratuitement. On ne fait pas payer ce qui nous a été donné. »
D’un coupeur à l’autre, les lois et les histoires se répètent, presque invariables. Ils ont été choisis pour accueillir le don, et le transmettront à une, deux ou trois personnes – rarement davantage –, plus jeunes qu’eux, afin de perpétuer la pratique sans la disperser. L’intervention se réalise souvent par téléphone. Les demandes émanent principalement d’inconnus, et peuvent venir de loin (Bretagne, Auvergne, Paris…). Aucun n’utilise son don sur lui-même. « Nous avons, nous aussi, besoin des autres ! », explique Catherine. Ils ne demandent jamais de contrepartie financière à leur activité – mais acceptent éventuellement un cadeau – et ne peuvent refuser de soigner : « Je suis sans limites », dit l’institutrice. « C’est une ligne de conduite », ajoute Aurèle, ancien taxidermiste devenu électricien, qui confie « sursauter » à chaque appel nocturne. Depuis la campagne annécienne, à la demande d’éleveurs, ce dernier exerce également son don sur les vaches « quand elles ont des grappes de verrues sur les mamelles ». Comme l’institutrice, il précise qu’il n’est « ni soigneur ni guérisseur », puisque « ce qu’on fait, c’est lever le mal. Ça ne marche pas pour les cancers ou les leucémies. On ne guérit pas tout ».
« Se soutenir des autres »
Par chez moi, en Haute-Savoie, savoir couper, c’est plutôt banal. Ce n’est guère plus qu’une petite qualité, discrète et rapidement mise en œuvre. Les numéros de téléphone se transmettent de main en main, entre amis ou membres d’une même famille, à l’église, ou griffonnés sur un bout de papier à la boulangerie. On finit toujours par connaître quelqu’un qui connaît quelqu’un. En vrai, on ne va pas voir de coupeur de feu ; on va voir le charpentier, Aurèle, ou la mère de ton beau-frère qui coupent le feu, les verrues ou l’eczéma, et puis, au pire, ça ne fait pas de mal.
Catherine estime que son action fonctionne dans 90% des cas. Jean oublie souvent de demander le résultat, « mais les gens continuent de m’appeler, ça veut donc dire que ça marche ». Lors d’une recherche anthropologique effectuée en 1994 dans le canton suisse du Jura, Nathalie Fleury souligne la dimension collective du « secret », lequel « se soutient des autres ». Son existence repose sur une « circulation du crédit » : un résultat positif constitue une preuve renouvelée de la compétence, et la demande signifie la reconnaissance des soignés. En 2007, Nicolas Perret, auteur d’une thèse de médecine sur les coupeurs de Haute-Savoie, observe à son tour que « ce sont les patients (…) qui transforment la potentialité du don en capacité thérapeutique ». À l’inverse d’un médecin, engagé pour soigner selon « une obligation de moyens », le coupeur est lié par une « obligation de résultats ». En bref, un « coupeur de feu qui n’est pas connu, ou reconnu, ou qui ne pratique pas, n’existe pas, même s’il possède le don[2. Perret Nicolas, « Place des coupeurs de feu dans la prise en charge ambulatoire et hospitalière des brûlures en Haute-Savoie en 2007 », thèse de doctorat, faculté de médecine de Grenoble, 2007.] ». En questionnant famille et amis, il apparaît d’ailleurs que certaines personnes n’activent jamais leur don, et que d’autres préfèrent nettement le refuser.
Cette petite qualité, il faut pouvoir en supporter la charge, donner de soi dans une fusion brève, intense et répétée, accepter de réciter silencieusement ce qu’il faut dire pour aspirer le « mal » de centaines d’inconnus, conserver la mèche pour qu’elle ne s’éteigne pas.
« Le secret ne soigne pas, il essaie »
Pour le feu, « plus on attend avant de couper, et moins l’on est efficace », tandis que la blessure, avant l’intervention, doit être vierge de toute action médicale – « une pommade ferait écran ». Par ailleurs, Catherine, Jean et Aurèle considèrent que le patient ne doit pas nécessairement croire en l’efficacité de la pratique pour que celle-ci opère, puisqu’ils interviennent également auprès de bébés, d’enfants et d’animaux.
« C’est une réalité qui me dépasse, confie Catherine, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne » ; « Je n’ai pas d’explication, relance Aurèle, ce qui compte, c’est le résultat. » Dans le Jura suisse, Nathalie Fleury, constate que les faiseurs de secret n’éprouvent nullement le besoin d’expliquer ou de prouver un savoir qui se manifeste uniquement comme savoir-faire. « Le secret ne soigne pas, il essaie », écrit-elle. Il n’est pas « démontrable », et les faiseurs ont d’ailleurs « du mal à le qualifier ». Certains parlent de don reçu, appris, trouvé, ou à développer ; d’autres évoquent une sorte de transfert – d’énergie, d’empathie – avec la personne souffrante[3. Fleury, op. cit.].
Il peut arriver que le mal soit « fort » ou « tenace » – pour les maladies de peau, surtout. Le don marche, ou ne marche pas, et s’il ne marche pas, on recommence l’opération à l’identique. L’acte est dans la parole – récitée silencieusement – et « c’est tout ce que l’on peut faire », considère Catherine, avant de compléter : « C’est aussi pour cela que l’on en parle peu autour de nous, car je remarque que les gens peuvent être inquisiteurs et inquiets quand ils ne comprennent pas. »
Faiseurs de secret et coupeurs de maux nient pratiquer ce qu’ils nomment « la médecine ». Ils se sentent plutôt complémentaires du corps médical qui, aux dires d’Aurèle, « n’arrive pas non plus à lever tous les maux ». À titre d’exemple, ce dernier poursuit : « Tenez, l’autre jour, le médecin du village m’a envoyé quelqu’un pour que je coupe son zona. »

« L’orateur évoque, et non invoque »
Au début des années 1980, André Julliard, ethnologue alors rattaché à l’université de Lyon, étudie les pratiques de vingt-cinq leveurs de maux du Jura français et de la Bresse, agissant principalement sur le feu, les zonas, les entorses, les verrues et les dartres. Fasciné par les travaux de Jeanne Favret-Saada sur la sorcellerie en Mayenne[4. Voir Jef Klak no 1, « Marabout », p. 59, « Être fort assez, la sorcellerie dans le Bocage ».], le chercheur se hasarde à rapprocher l’action de leveurs de celle des désorceleurs dans le cadre de conflits familiaux ou villageois, avant d’en revenir à une lecture plus personnelle de ses observations de terrain, radicalement différente. Comparant les leveurs de maux à des praticiens de proximité, plus accessibles géographiquement et financièrement que les professions médicales dans les campagnes, Julliard estime alors que la possession et la transmission du don ne « sauraient perturber les structures traditionnelles du village », et ne « relègue[nt] pas le guérisseur aux marges de la sociabilité villageoise », puisque ce dernier ne « devient pas sujet de crainte ou de méfiance[5. Cf. Julliard André, « Le don du guérisseur. Une position religieuse obligée », Archives de sciences sociales des religions, 54/1, 1982.] ». À l’exception de ces brèves remarques sur la position sociale du leveur, le chercheur se concentre plus particulièrement sur l’aspect religieux du don.
Avoir le don équivaut à posséder, par transmission, une, deux, trois ou plusieurs dizaines de formules apprises par cœur, chacune guérissant une seule affection organique (verrues, dartres, brûlures…)[6. La récitation des prières peut éventuellement s’accompagner d’une gestuelle (signe de croix, souffle, etc.).], lesquelles s’apparentent souvent à de courtes prières mettant en scène Jésus-Christ, ses apôtres, ou un saint guérisseur local, dans un combat avec une force opposée[7. On en trouve des exemples dans les almanachs paysans, dans les livres de médecine populaire, chez les folkloristes régionaux ou sur Internet – de toute évidence, jamais les coupeurs ne livrent leurs secrets.]. Associé à une « thérapie par lavage », au même titre que nombre de tisanes et de décoctions, le « don prière » cherche à refouler « une force extérieure » détenant une « vie énergétique autonome » agressant le corps humain. Au-delà des références chrétiennes de ces prières, le chercheur constate que la charge de lever le mal n’engendre « aucune altération manifeste de la croyance religieuse du guérisseur » : elle n’accroît pas la dévotion ni ne vivifie la foi, souvent moribonde, du leveur ; elle n’est pas synonyme d’initiation spirituelle ; elle n’est pas non plus comprise comme la réalisation terrestre d’une mission ou d’un pouvoir surnaturels. « Il est difficile de caractériser l’adresse à Dieu, à Jésus-Christ, ou à la Vierge Marie », remarque Julliard, puisqu’elle n’exprime aucune demande d’aide ou d’intervention. Tout au plus, « l’orateur évoque, plutôt qu’il n’invoque » le divin[8. Julliard André, « Dons et attitudes religieuses chez les leveurs de maux en France (1970-1990) », Marges contemporaines de la religion, Religiologiques, nº 18, 1998.].
Côté savoyard, Catherine, l’institutrice, explique qu’elle n’est « ni croyante ni pratiquante », tandis que Jean, le charpentier, se rend de temps en temps à la messe, tout en estimant que « couper le feu n’a pas de rapport avec Dieu ». Sans contredire les propos de Jean, l’écrivaine et historienne locale Colette Gérôme précise, depuis son chalet de la vallée du Giffre, qu’il existe aussi des curés qui coupent le feu, et que certains ont acquis une belle renommée en la matière.
Dans le Jura suisse, Nathalie Fleury constate que nombre de faiseurs de secret justifient leur pouvoir en invoquant leur appartenance chrétienne, tandis que les ecclésiastiques helvétiques, catholiques ou protestants, n’observent pas de position officielle face au secret, la majorité d’entre eux tolérant et acceptant cette pratique : « Ils reconnaissent la sincérité et la foi des faiseurs de secret, mais ne peuvent ou ne savent pas admettre la prétention théologique du secret[9. Fleury, op. cit.]. » De même, l’abbé Giovanni, aumônier catholique rattaché aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), reconnaît des traits chrétiens au « don prière », sans pour autant doter la pratique d’une quelconque valeur religieuse. Il a récemment fait appel à un coupeur de feu, alors que la mère supérieure d’un séminaire s’était gravement brûlée avec l’huile du caquelon de l’appareil à fondue. « La peau partait avec les habits… C’était affreux. Puis, tout d’un coup, plus rien. Moi, à chaque fois qu’on ne peut pas expliquer quelque chose, je me dis “tant mieux”, car cela provoque l’intelligence. Si l’on est critique avec l’Église, autant l’être aussi avec la science ! », estime l’abbé, avant d’exhiber un numéro de la revue Science et vie intitulé « Guérir par la pensée ». « Des études ont été faites, montrant que la spiritualité – et non la religion – développait une partie du cerveau », renchérit-il.
« La mémoire orale a retravaillé le secret »
Avant, c’était mal vu.
Certains ont dû souffrir à cause du don.
Si l’on peut faire le bien, on devrait pouvoir faire
le mal, ce genre de sous-entendu, vous voyez ?
Avant, il y avait des accusations de sorcellerie,
maintenant c’est fini, tout ça.
Le don, c’est une chaîne qui vient de loin.
Je suis certaine que ça existait
bien avant le Moyen Âge.
La montagne est associée au Mal.
C’est une porte d’entrée.
Les divinités païennes ont été christianisées.
Certaines sont devenues des Vierges noires.
D’autres, des saints guérisseurs.
Ils sont installés près des sources,
des fontaines, des anciens temples.
C’est pas les Romains, c’est d’abord les Celtes.
C’est païen.
C’est païen, puis chrétien.
C’était il y a vraiment longtemps.
C’est depuis toujours.
(Extraits de mémoires d’étudiants, d’entretiens
avec des coupeurs de feu et avec une historienne locale)
Par le truchement de fortes assertions, par petites allusions ou hypothèses, la pratique du secret cherche son histoire. Pour sa part, Nathalie Fleury considère qu’il n’est pas pertinent de partir en quête des origines, forcément « floues », tout en citant de probables « influences animistes » : certaines formules mettent en scène une nature vivifiée (la lune, les arbres, la terre) côtoyant le monde chrétien. « Les faiseurs de secrets ont perdu la référence première pour ne garder que le fondement chrétien. La mémoire orale a retravaillé le secret pour ne conserver que ce qui allait dans le sens présent de l’époque. » Au regard de la puissance inquisitrice de l’Église du XVIe siècle, en lutte contre « les hérésies » dans une zone géographique alors troublée par la Réforme, « se rattacher à Dieu [était] certainement un moyen de ne pas faire disparaître les pratiques locales » et d’éviter les accusations de sorcellerie[10. Ibid. ].
En ce sens, une lettre écrite au tout début du XVe siècle par le prédicateur dominicain Vincent Ferrier, de passage en Savoie[11. Au XVe siècle, le duché de Savoie s’étendait de l’actuelle Suisse romande jusqu’à Nice.], fait état « du paganisme » et « autres superstitions criminelles qu’il faut combattre », surtout chez les « peuples de la campagne » des diocèses de Lausanne et de Genève[12. Lettre écrite de Genève le 17 décembre 1403, citée par Hélène Viallet dans « Sorcellerie et déviances en Pays de Savoie du XVe et XVIIe siècle », La revue savoisienne, vol. 139, 1999.]. Ces observations coïncident avec les premières traces d’affaires de sorcellerie dans les archives savoyardes : entre 1411 et 1414, un homme d’Église est chargé par le diocèse de Genève de préparer une liste de personnes suspectes, de leur adresser des remontrances et, éventuellement, de les excommunier – procès et bûchers n’apparaîtront que plus tardivement. À la lecture des documents laissés par ces visites pastorales, l’historienne Hélène Viallet souligne « l’ambivalence du sorcier : jeteur de sort et guérisseur ». Ainsi, à La Balme de Sillingy, proche d’Annecy, Agathe, femme de Girard Rivilliod, et Jeannette Reine, sont accusées de sorcellerie car elles « ont coutume de guérir certaines infirmités par des paroles magiques ». De même, à Chapeiry, en Haute-Savoie, une autre Jeannette, femme de Pierre Majorier, est suspectée de pratiquer, outre la divination, la médecine « par les mots[13. Viallet, op. cit.] ».
Quelques décennies plus tard, Eynarde Fournier, une vieille dame vivant dans le Grésivaudan (entre Grenoble et Chambéry), accepte de réciter, lors de son procès, la prière qu’elle utilise pour « souffler » le feu des mauvaises fièvres. Évoquant les actions purificatrices de la pierre et de l’eau avant de s’en remettre à la Sainte Trinité, la prière est tout de même considérée diabolique par le notaire[14. Cf. Pierrette Paravy, « Prière d’une sorcière du Grésivaudan pour conjurer la tempête », Le monde alpin et rhodanien, 1982.].
« La liste est dans l’armoire de l’hôpital »
Maintenant assise face à la cheminée, l’épouse de Jean, le charpentier, parle tranquillement. Elle estime que l’attitude des médecins vis-à-vis des coupeurs a beaucoup changé en l’espace de quarante ans : « Ils ne pensent plus forcément qu’il s’agit d’une connerie, et sont devenus plus tolérants. Récemment, un médecin a demandé s’il pouvait nous envoyer des patients. On a décliné la proposition, car avec le bouche à oreille, ça faisait déjà beaucoup ! » Catherine, quant à elle, a souvent collaboré avec le médecin de son village, jusqu’à ce que ce dernier prenne sa retraite il y a peu. Prudente, elle n’ose se présenter au nouveau praticien, car elle ne sait pas trop « ce qu’il en pense ». Les techniques de soin dites populaires continuent d’entraîner des « réponses défensives » et une « profonde agressivité », comme l’écrit Benoite Denis dans sa thèse de médecine, soutenue à Angers en 2010 ; la jeune femme se réfère notamment à la réaction d’un collègue, lequel « déclare que s’il apprenait qu’un de ses patients, traité pour un zona, consultait parallèlement un coupeur de feu, il le sommerait fermement de lui rendre son Zelitrex[15. Traitement antiviral.Benoite Denis, « La médecine populaire des poussées dentaires : approches biomédicale, anthropologique et psychanalytique », thèse de doctorat, faculté de médecine d’Angers, 2010.] ! ».
En dépit de réactions parfois négatives, les coupeurs de maux suscitent, depuis une vingtaine d’années, l’intérêt des étudiants en médecine et en formation de soins infirmiers. En 2005, par exemple, la docteure Marina Gaimon réalise, dans le cadre de sa thèse, une enquête sur les motivations et satisfactions de patients ayant consulté un guérisseur dans le Berry, en particulier pour traiter les brûlures et les pathologies dermatologiques[16. Marina Gaimon, « Étude des motivations et des satisfactions des patients d’un secteur rural ayant consulté un guérisseur », thèse de doctorat, faculté de médecine de Tours, 2005. Cette dernière rapporte des taux de satisfaction extrêmement élevés.]. Et, si l’on s’en tient à la Haute-Savoie et à la Suisse romande, une dizaine de travaux portent exclusivement sur les collaborations entre institutions de soins et coupeurs de maux, après que deux apprenties infirmières ont ouvert le bal dans le Jura suisse en 1993. Entre-temps, une réforme des études médicales à Genève en 2000, puis à Lausanne en 2009, a introduit un stage obligatoire « d’immersion en communauté », lequel encourage les élèves à travailler sur « la multitude d’aspects [d’un processus de soin] qui sortent du cadre strict de la relation médecin-malade et du processus de diagnostic et de traitement[17. Cf. Présentation du stage obligatoire d’« immersion en communauté », faculté de médecine de Genève, www.medecine.unige.ch.] ».
Face à la présence de listes de coupeurs de feu, actualisées par les soignants, dans les services des urgences de plusieurs hôpitaux des cantons suisses de Genève, de Vaux ou du Valais, les étudiants s’interrogent donc. « Comment se fait-il que l’hôpital, où règne en maître l’Evidence-based medecine[18. Médecine fondée sur des preuves, ou médecine factuelle : paradigme scientifique cherchant à prouver, au moyen d’essais cliniques, le degré d’efficacité d’un traitement thérapeutique.], ait laissé une place, quelle qu’elle soit, à des praticiens dont le mode d’action peut faire penser à un rituel magique, ancestral, et certainement difficile à admettre pour tout esprit cartésien ? », écrivent Sophie Martinelli, Victoria Pozo et Juliet Zingg en introduction de leur mémoire de licence. Ces trois infirmières ont réalisé des entretiens avec le personnel des urgences de l’hôpital universitaire de Genève en 2011, où une liste est accrochée « à l’intérieur d’une armoire », et où l’on est bien incapable d’expliquer « comment la liste est arrivée là ». Comme ailleurs, en Haute-Savoie ou en Suisse, cette feuille de papier ne mentionne que des coupeurs de feu appelés pour réduire les douleurs des brûlures. À l’issue de leur enquête, les trois jeunes femmes estiment que l’existence de ces pratiques soulève bien plus de questions sur le « sens de la biomédecine et le rôle des soignants » que sur leur « simple efficacité thérapeutique ».
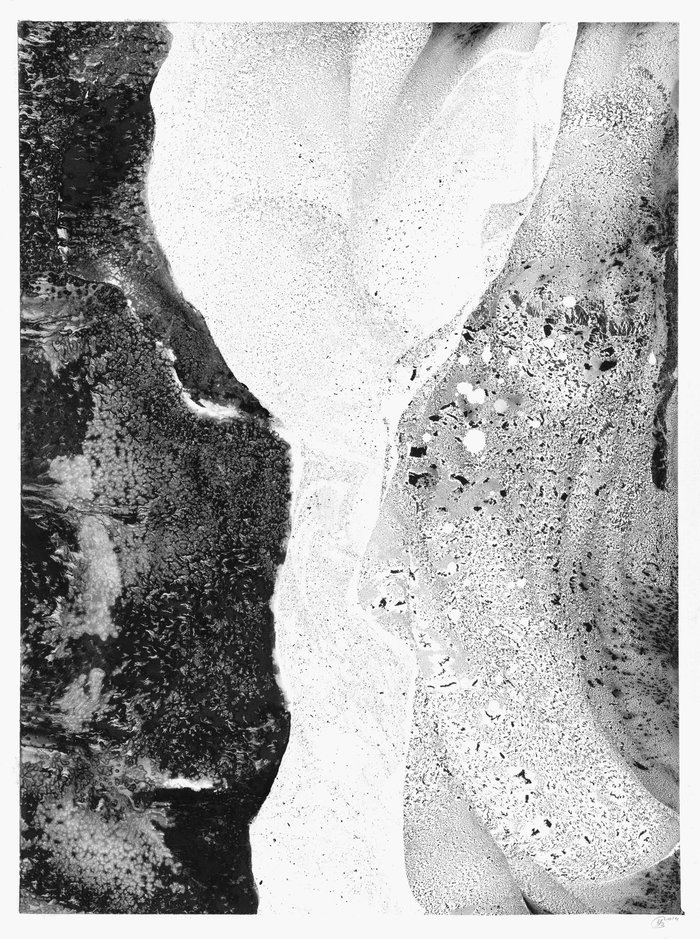
« Le standard a failli exploser »
À Thonon-les-Bains, aux abords du lac, la secrétaire d’un service de gériatrie des hôpitaux du Léman indique, avec un sourire, que « la chef de service sera disponible pour répondre de sa seconde spécialité une fois qu’elle aura achevé ses visites médicales ». Ancienne responsable du service des urgences, la docteure Danièle Tavernier est une interlocutrice de choix en matière d’intervention de coupeurs de feu dans l’hôpital. Originaire de la vallée du Rhône, elle a étudié à Lyon, avant d’effectuer son internat à l’hôpital de Sallanches, en Haute-Savoie, puis de prendre la direction du service des urgences de Thonon, il y a une vingtaine d’années. Installée dans son bureau, elle explique combien elle fut stupéfaite, au début de sa carrière, de constater que le personnel infirmier appelait des barreurs de feu en cas de brûlures. « J’étais complètement en opposition avec l’équipe. Je passais mon temps à leur expliquer que nous avions appris des techniques pour soigner les brûlures, et que nous n’avions pas besoin de ça. » Jusqu’au jour où elle reçoit deux très grands brûlés, lesquels expliquent ne plus ressentir de douleurs suite à l’action de coupeurs de feu. Au Centre de traitement des brûlés de Lyon, les soignants constatent, dans les deux cas, une cicatrisation anormalement rapide, ne laissant aucune trace.
Perplexe, Danièle Tavernier admet la technique dans son service, « uniquement dans les cas de brûlures, quand les gens disent qu’ils ont mal », jusqu’à accepter de témoigner de l’efficacité de cette pratique lors de deux émissions télévisées, accompagnée du coupeur de feu attitré de l’hôpital. « Alors même que la première émission était en cours de diffusion, le standard de l’hôpital a failli exploser – j’avais fait l’erreur de dire où je travaillais. Cela a duré six mois ! », poursuit la médecin. Des coupeurs de feu appellent pour proposer leur service depuis la France entière, d’autres personnes téléphonent pour exprimer leur désaccord. « J’ai même reçu un appel d’insulte de l’Ordre des pharmaciens ! Ils devaient craindre pour les ventes de pansements gras », s’indigne encore l’ex-cheffe de service, alors que cette dernière a toujours insisté sur le fait qu’elle n’altérait pas sa propre pratique de soin.
« Une leçon populaire ? »
À Sion, en Suisse, une liste existe depuis dix-sept ans. Dissimulée derrière un panneau, « elle ne porte pas l’en-tête de l’hôpital », précise le médecin-chef des urgences. En Haute-Savoie, à l’hôpital d’Annecy, le protocole de prise en charge des brûlures mentionne, en nota bene, la possibilité de faire appel à un coupeur de feu, avec l’accord du patient, tout en précisant que cela « ne doit en aucun cas retarder les soins traditionnels », et fournit une série de coordonnées.
De chaque côté de la frontière, la pratique reste soumise à son acceptation, souvent tacite, par le chef de service. Jamais véritablement officielle, et pas tout à fait officieuse, l’intervention des coupeurs de feu constitue la seule technique de soins dite parallèle tolérée au sein des hôpitaux du territoire alpin, sur proposition du personnel soignant ou à la demande du patient. « Serait-ce parce qu’il s’agit d’une technique rapide, gratuite, souvent opérée à distance [par téléphone] ? (…) Une technique où l’on n’aurait rien à perdre d’essayer ? », questionnent les trois infirmières dans leur mémoire. Quelle que soit la réponse, cette collaboration renforce, pour ces dernières, la qualité des soins, notamment parce la « croyance », la « culture » et l’« accord du patient [prennent] une place plus importante en comparaison avec les soins usuels dans l’hôpital ». Elles soulignent, enfin, un intérêt, une curiosité et une ouverture pour cette pratique plus forts de la part du personnel infirmier que de celle des médecins.
À l’occasion de sa thèse de médecine, Nicolas Perret a poussé l’enquête un peu plus loin, à partir des services des urgences des hôpitaux d’Annecy, d’Annemasse et de Thonon-les-Bains. Après avoir interrogé 134 soignants et 173 patients brûlés, ce dernier a obtenu des taux de satisfaction très élevés : 70% des soignants constatent que l’efficacité des coupeurs sur la douleur est forte ou totale, 81% d’entre eux estiment la collaboration entre services de soins et coupeurs de feu souhaitable ou indispensable, et 80% des patients ont vu leur douleur réduite d’au moins 30%. « On peut au moins dire que l’effet placebo assure des résultats. Mais, que dire à propos de l’intervention sur une personne qui n’y croit pas, ou bien qui n’est pas au courant, ou encore sur des animaux ? Là, je n’ai plus aucune réponse », confie ce jeune médecin, qui se demande si l’action des coupeurs de feu ne constituerait pas « une leçon populaire pour notre technocratie » ? D’un haussement d’épaules, Aurèle, l’ancien taxidermiste, pense que « parler d’effet placebo, c’est une manière de se rassurer ».
Illustrations : Tellurismes (Encres de chine sur papier, avril 2014, 56 x 76 cm) de Yann Bagot.
by Julia Burtin Zortea | 25 avril 2015 | Marabout
Dire que l’on entend des voix, c’est souvent mettre un pied dans l’hôpital psychiatrique – or cela concernerait une personne sur dix. Enseignante à l’université Paris 8-Saint-Denis et à la Cornell University aux États-unis, Magali Molinié, psychologue de formation, a décidé de prendre au sérieux les entendeurs de voix. Plutôt que d’imposer un savoir universitaire et des catégories psychiatriques pour établir des diagnostics médicaux, elle participe à la création de groupes de personnes partageant une même expérience de perceptions inhabituelles et y faisant face ensemble. Ces groupes renouent avec des pratiques alternatives à la médicalisation psychiatrique, jusqu’à parfois faire de leurs voix des alliées précieuses.
Ce texte est extrait du numéro 1 de la version papier de Jef Klak, « Marabout », toujours disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF
Comment vous êtes-vous intéressée à l’entente de voix ?
Au cours de mes études de psychologie, j’ai rencontré les travaux de Tobie Nathan sur l’ethnopsychiatrie. Alors que je faisais une thèse sous sa direction, j’ai intégré sa consultation au Centre d’ethnopsychiatrie clinique Georges-Devereux et rencontré les familles migrantes qui y étaient accueillies. C’est dans ces conditions que j’ai découvert la richesse du dispositif de Nathan : accueillir les gens et discuter avec eux à partir de leurs théories à eux, celles qui existent dans le monde d’où ils viennent, et non à partir de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Les considérer comme des « experts », s’appuyer sur les richesses dont ils sont porteurs plutôt que se focaliser sur leurs carences.
À partir des questions qui étaient débattues au Centre à l’époque, sur des êtres tels que les djinns, les vents, les génies de l’eau qui s’invitaient dans les consultations, je me suis demandé si nous avions des êtres comparables dans notre monde. C’était le moment où, après un « stage » au Centre Devereux, l’anthropologue et sociologue des sciences Bruno Latour posait la question : Quels sont nos invisibles ?
Pour ma part, je me suis demandé s’il était possible de considérer les morts comme des êtres qui pouvaient eux aussi être convoqués dans un dispositif de recherche ou de soin. Un mort, certains d’entre nous peuvent l’entendre, le voir, lui parler, vouloir faire des choses pour lui. Il a un mode d’existence qu’il s’agit de comprendre dans ses singularités et qui se manifeste dans la relation nouée avec lui par l’endeuillé, le « deuilleur », comme j’ai préféré l’appeler.
C’est dans ce contexte, toujours au Centre Devereux, que j’ai entendu parler pour la première fois des entendeurs de voix, au début des années 2000. Nous avions reçu le petit livre de Paul Baker : La voix intérieure, Guide à l’usage (et au sujet) des personnes qui entendent des voix traduit à l’époque par des membres du Réseau suisse sur l’entente de voix (Reev). Mais, jusqu’à ma rencontre en 2010 avec le psychologue Yann Derobert, ces contacts avec l’entente de voix n’étaient que des prémisses qui auraient pu rester sans suite. Il avait noué des relations avec les animateurs du réseau international d’entendeurs de voix, Intervoice, et il nourrissait le projet de créer quelque chose de similaire en France.
Quelles sont les origines du mouvement Intervoice ?
On doit la création du mouvement à Marius Romme, un psychiatre néerlandais, en 1987. L’une de ses patientes, Patsy Hague, avait des voix très envahissantes qui l’empêchaient de faire ce qu’elle désirait, ainsi que des idées suicidaires. Il s’est rendu compte que ses outils traditionnels ne marchaient pas avec elle, et a décidé de changer d’approche. Pour rompre son isolement, Romme lui a proposé de discuter avec des personnes vivant une situation similaire. Il assistait aux discussions, et c’est comme ça qu’un embryon de groupe s’est mis en place, avec des échanges sans tabou au sujet de leurs perceptions inhabituelles.
En collaboration avec Sandra Escher, ils sont allés participer à une émission de télévision à grande audience, au cours de laquelle Patsy a exposé son problème en vue d’un appel à témoin. Plus de 700 personnes ont appelé, dont 450 avaient une expérience d’entente de voix. À partir de là, Romme et Escher ont mené des entretiens approfondis avec des gens qui arrivaient à faire face à leurs voix, et ils ont ainsi développé leurs connaissances sur le sujet. D’autres recherches l’ont confirmé depuis : le fait d’entendre des voix n’est pas en soi un signe de maladie mentale, environ une personne sur dix connaît cette expérience. Certes, il y a généralement une phase de choc, de surprise, la première fois que ça arrive ; les gens peuvent être déstabilisés. Mais beaucoup parviennent à trouver une explication satisfaisante à ces phénomènes et à s’en accommoder. C’est parfois plus problématique que ça, mais les différences ne se situent pas dans la manière dont on entend les voix ni dans ce que ces voix disent. Tout se joue plutôt dans la forme de relation entretenue avec elles : être effrayé ou non, se laisser envahir ou poser des limites, tenter d’ignorer les voix, ou les accueillir et interagir avec elles. Ce qui peut poser problème, en somme, c’est être démuni pour faire face aux voix.
Cette expérience et ces rencontres se passent à la fin des années 1980. Est-ce qu’avant cela l’entente de voix a toujours été psychiatrisée ?
L’histoire a retenu le daimôn de Socrate, les voix de Jeanne d’Arc… Un collègue philosophe me rappelait récemment que Descartes entendait une voix. Plus près de nous, Amélie Nothomb, Bill Viola, Zinédine Zidane ont fait état d’expériences de cet ordre.
Pendant longtemps, les voix étaient comprises à l’intérieur de cadres religieux et culturels, du côté des extases, des phénomènes de possession ou de voyance. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le spiritisme a fait éclore des médiums qui étaient en relation avec des défunts ou avec des entités de mondes extra-terrestres. La manière de catégoriser ces expériences comme relevant d’une pathologie médicale est historiquement liée à la naissance de la psychiatrie, à la même époque. Mystiques, possédées ou hystériques ? C’est la grande question que se posent les fondateurs de la psychiatrie et de la psychologie, comme Charcot ou Janet.
Cette transition historique tient à la construction de la psychiatrie comme profession, c’est-à-dire aussi comme pouvoir, et de son ambition d’enlever à l’Église le monopole qu’elle détenait jusqu’alors sur la charge des âmes. Dès les débuts de la psychiatrie, avec Pinel, et plus tard avec le paradigme de la maladie mentale, quelque chose s’est construit, encore très actif aujourd’hui : l’idée qu’il revient à une branche de la médecine, qui s’appelle psychiatrie, de catégoriser certains vécus et comportements comme relevant d’une maladie mentale dont la cause se situerait dans le cerveau. C’est dans un tel cadre que le fait d’entendre des voix est conçu comme l’un des symptômes-clés pour envisager un diagnostic de psychose, de schizophrénie.
Du coup, le mouvement des entendeurs de voix a pour objectif d’aider ces personnes sans passer par la case psychiatrie ?
L’intention première est d’offrir les moyens à des personnes qui entendent des voix de redevenir acteurs et auteurs de leur existence, de trouver les soutiens et les ressources, en elles et autour d’elles, pour construire la vie qu’elles estiment digne d’être vécue – à partir de leurs propres critères, et non de ceux imposés par des modèles de normativité extérieurs, qu’ils soient médicaux ou sociaux. Les personnes qui font ces expériences ont besoin de leur trouver un sens et de pouvoir en discuter librement, sans être immédiatement renvoyées à un diagnostic psychiatrique. Pouvoir en parler dans un climat de sécurité et de confiance – que ce soit avec des pairs, des proches, des soignants : tout cela permet aux personnes de se réapproprier cette expérience, les évènements de vie et les émotions qui y sont liés, et de trouver des stratégies pour y faire face.
Vous dites « faire face », est-ce que ça veut dire qu’il y a toujours un aspect agonistique ou tyrannique dans l’entente de voix ?
Ça dépend… Les gens peuvent avoir des voix sympa, qui peuvent être soutenantes, rassurantes, ou qui peuvent basculer dans quelque chose d’effrayant, harcelant, injurieux ou autoritaire. Ce ne sont pas toujours des voix personnifiées. Ça peut être des bruits, des murmures, une voix féminine ou masculine, une voix d’enfant. Pour d’autres, ce n’est pas simplement une voix, mais une personne, située dans la tête ou bien en dehors. Ou encore d’autres perceptions, comme le fait d’être touché, frappé, de sentir des odeurs…
Si on s’attache à leurs vécus, les personnes entendent vraiment les voix. Patsy Hague a réussi à convaincre Marius Romme sur ce point : les voix sont réelles, les gens les entendent réellement. Partant de là, tout ce qui est habituellement mis en œuvre par les soignants ou les médecins pour dire « Vous savez bien que c’est votre maladie, tout ceci n’existe que dans votre tête, vous l’imaginez, mais ça n’est pas réel », équivaut à un déni de la perception des personnes. C’est le début d’une longue série de malentendus qui ne favorisent pas l’établissement d’une relation authentique.
Au lieu de nier, on pourrait tout aussi bien dire : « D’accord, vous entendez une voix ; de quoi s’agit-il ? De qui s’agit-il ? Que dit-elle, comment le dit-elle ? À quel moment est-elle apparue ? » C’est souvent une expérience fondamentale pour les personnes, centrale dans leur vie. Elles ont plus que tout besoin que leur expérience soit reconnue, entendue, validée. Prendre en considération les voix et leurs contenus permet de les remettre en contexte dans l’histoire de vie de la personne qui les entend. À l’origine des voix, il y a certes souvent des expériences traumatiques, mais alors ce n’est plus la personne qui est « malade », c’est plutôt qu’elle a été blessée par des personnes ou par des évènements. C’est différent.
Les différents mouvements d’entendeurs de voix semblent s’organiser autour d’un dispositif en trois étapes : comprendre les voix, les accepter et s’y adapter. On retrouve là deux types de thérapie : un semblant de comportementalisme, dans le sens où l’on s’adapte aux voix, et une approche plus psychanalytique, dans l’exploration de la personne, de son histoire, qui vise à comprendre les voix…
Paul Baker et Marius Romme insistent tous deux pour dire que le mouvement sur l’entente des voix n’est pas une nouvelle proposition thérapeutique – c’est une proposition d’émancipation. Romme a dit un jour à Baker : « Nous n’allons pas changer la psychiatrie, nous n’allons pas changer les parents, mais offrir aux personnes qui entendent des voix une organisation à partir de laquelle ils peuvent s’émanciper eux-mêmes. Organise des groupes, et les psychiatres suivront. » Ils aiment tous deux rappeler qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle proposition thérapeutique, mais d’un nouveau paradigme. Surgit alors un nouveau régime d’obligations, pour reprendre un terme d’Isabelle Stengers. Parmi celles-ci : ne rien faire sans les entendeurs de voix – qui deviennent ainsi les contributeurs incontournables de la définition du changement qu’ils souhaitent pour eux –, faciliter leur mise en relation et auto-organisation, instaurer leurs savoirs expérientiels comme une expertise à part entière dont chacun peut bénéficier (y compris les experts « par formation »), valider l’existence des phénomènes qu’ils vivent, les « dépathologiser » (en les resituant dans un continuum avec des expériences de vie ordinaires)…

Qu’y a-t-il de nouveau ici par rapport à l’antipsychiatrie des années 1960-70, et sa démarche anti-médicament, anti-asilaire et anti-autoritaire ?
C’est que la proposition d’émancipation émane des entendeurs de voix eux-mêmes. C’est un mouvement qui vise à s’organiser « par le bas ». Beaucoup de ses animateurs sont des femmes et des hommes qui ont eu des diagnostics de schizophrénie, un long parcours en psychiatrie avant de s’engager dans leur parcours de rétablissement. Ils sont aujourd’hui des formateurs en santé mentale reconnus, certains sont devenus psychologues et chercheurs. Eleanor Longden, Jacqui Dillon, Ron Coleman, Peter Bullimore, et tant d’autres encore. Autant d’entendeurs de voix assumés qui témoignent de leur expérience de la folie et du rétablissement, et militent pour que les entendeurs de voix se donnent les moyens de leur auto-organisation. Un de ces moyens, outre les conférences publiques, les formations, les rassemblements et les congrès, c’est la mise en place de groupes sur l’entente de voix.
Il y a beaucoup de groupes d’entendeurs de voix en France ?
De plus en plus. Deux ou trois dans le Nord, deux à Paris, deux à Marseille, un à Nancy, d’autres en gestation – comme à Montpellier ou à Bordeaux. Donc entre six et neuf en France, pour l’instant…
Concrètement, comment ça s’organise ?
Avec notre secrétaire général, Vincent Demassiet, et avec Yann Derobert et d’autres, on tente de faciliter le fonctionnement du groupe et la poursuite des buts qu’il s’est fixés : prendre en considération les entendeurs de voix et leurs expériences, soutenir les initiatives locales qui vont dans le sens de leur mise en relation, diffuser les informations, mettre en place des formations. En fait, favoriser la mise en place de tous les dispositifs dont les entendeurs de voix pourraient avoir envie de se saisir, en particulier les groupes. Que ceux-ci dépendent ou pas d’une institution psychiatrique, l’idée est qu’à terme tous s’autonomisent, et qu’ils soient régulés (nous préférons dire : « facilités ») par des entendeurs eux-mêmes.
Mais ça commence toujours avec des personnes qui entendent des voix et d’autres qui les entourent (proches, etc.). À Paris, nous avons commencé comme ça, il y avait parmi nous Sonia et Christian qui entendaient des voix. On avait envie de créer un groupe, on se demandait comment faire, comment contacter les gens que ça pourrait intéresser… On tournait un peu en rond, on n’avait pas l’habitude.
Vous n’aviez pas envie d’aller à la télé comme Marius Romme et Patsy Hague ?
On n’y a pas pensé, non ! Je ne connaissais pas encore l’histoire à l’époque, et Sonia et Christian n’étaient pas en détresse par rapport à leurs voix. Christian n’avait pas d’histoire avec la psychiatrie ; Sonia, oui, et elle facilitait déjà un groupe. Finalement, nous avons organisé une journée de formation avec Ron Coleman à Paris. Ron est un survivant de la psychiatrie qui a rencontré dans son parcours de « schizophrène » un groupe d’entendeurs de voix à partir duquel il a pu commencer à se rétablir. Aujourd’hui, il est devenu formateur de premier plan dans le champ de l’entente de voix et du rétablissement. Nos formations incluent toujours les entendeurs de voix. À l’issue de la formation, on a pu commencer à mettre sur pied le premier groupe parisien avec des personnes qui étaient venues pour l’occasion.
Qu’est-ce qu’il se passe dans ces groupes ?
Ce sont des groupes d’entraide et non des groupes cliniques ou d’intervention thérapeutique. C’est le soutien entre pairs qui est actif, la considération respectueuse pour l’expérience vécue par autrui. Chaque groupe, du moment qu’il est formé, se dote de ses propres règles : comment parler en sécurité et en confiance, quelles sont les conditions à poser pour cela ? Ça débouche souvent sur des règles posant que ce qui se dit reste entre nous, que les convictions de chacun doivent être admises et respectées, qu’on parle à partir de soi, sans faire un discours sur l’autre, sans interprétation. On peut parler d’autre chose, mais ça reste principalement des groupes focalisés sur l’entente de voix, les stratégies pour composer avec elles, la compréhension qu’on en a, le sens qu’on leur donne.
Les groupes n’ont pas forcément pour objectif de se rétablir des voix ?
En effet. C’est important à préciser, parce que depuis tout à l’heure, j’emploie le terme « rétablissement » et il faut que je m’explique. Ces groupes n’ont pas pour objet de supprimer les voix. Eleanor Longden, par exemple, explique qu’on peut considérer les voix comme des messagères, porteuses de sens. Ce sens n’est pas forcément identifiable d’emblée – ça peut demander un long travail d’investigation –, mais les voix peuvent finir par se révéler des alliées précieuses.
Le terme « rétablissement » vient du mot recovery en anglais. Même si aucun des deux n’est totalement satisfaisant, on les utilise principalement pour marquer le contraste avec les termes médicaux de « guérison », « rémission » ou « stabilisation ». Le « rétablissement », pour nous, cela signifie qu’il appartient à chacun de définir ses propres critères de la vie, telle qu’elle lui parait digne d’être vécue.
Ce que vous dites porte une critique contre l’institution, et l’on pense alors à un projet d’autonomie, au refus d’une loi qui viendrait du pouvoir médical ou politique, et qui forcerait à s’adapter à un ensemble de règles décidées d’en haut ou d’on ne sait où. On a l’impression que dans le mouvement des entendeurs de voix, il y a un geste politique, sous-jacent, mais très présent…
C’est vrai qu’il y a de ça, mais j’ai appris à me méfier du mot « autonomie », parce que dans plein d’endroits, on fait des injonctions à l’autonomie sans donner aux gens les moyens d’y parvenir réellement, et ça finit par être très violent. Il y a sans doute un autre mot à trouver autour du pouvoir d’agir, de reprendre de la puissance… Pour l’instant, je préfère dire « auteur » ou « acteur » de sa propre vie, parce que cela met en relief la créativité nécessaire à ce qui se joue là. On est obligé d’inventer des choses pour devenir auteur de sa vie, ce n’est pas donné d’emblée, ça demande quelquefois un véritable effort, d’investigation, de réflexion, de pratiques… Mais aussi de sortir de la solitude et de pouvoir s’appuyer sur les autres. Les groupes sont utiles pour cela.
Il y a une forme de collectif qui se crée là…
C’est ça… Des alliés… La récupération d’un pouvoir d’agir, et en même temps des capacités de trouver des appuis, de s’offrir soi-même comme appui, des étayages, des solidarités – et tout cela produit des effets sur notre sociabilité. On n’est pas seuls, on est tous embarqués, à partir de nouvelles manières de fonctionner, d’être, de vivre.
Est-ce que vous percevez une continuité entre les groupes d’entendeurs de voix et vos premières recherches concernant les morts, les invisibles ?
Bien sûr, il y a des différences : j’ai appris sur les relations avec les morts en conduisant des entretiens individuels avec des personnes recrutées dans un cadre de recherche en psychologie, alors que le REV est un collectif dans lequel j’interviens plutôt en tant qu’activiste, et dans lequel ma formation de psychologue ne m’est pas très utile.
Mais il y a aussi des continuités. Certaines personnes vivent avec des êtres que les autres ne voient peut-être pas, mais qui sont pour eux très importants, avec qui se tissent des relations très investies. Si je veux pouvoir en parler avec eux, j’ai intérêt à respecter ce qu’ils me disent, à ne pas le mettre en doute, ne pas le critiquer ou le catégoriser comme un symptôme de maladie. Si je veux discuter avec quelqu’un sérieusement, honnêtement et authentiquement, je ne peux pas disqualifier ses convictions.
Ça veut dire qu’on donne une existence à l’objet de la croyance de l’autre…
Si ça existe pour la personne, alors je n’ai aucune raison de le remettre en cause. C’est un préalable à la possibilité d’un échange avec elle et pas seulement une question de respect pour ses croyances. Pourquoi parleriez-vous à quelqu’un de quelque chose qui vous importe plus que tout, si cette personne s’évertue à vous expliquer que vous vous trompez, que c’est un effet de votre imagination ou d’un déséquilibre chimique dans votre cerveau ?
Comment peut-on alors expliquer ce mépris généralisé pour des croyances qui, finalement, sont extrêmement partagées ? Ce sont des choses très diffuses et pourtant rabrouées, méprisées, invalidées. C’est étonnant comme paradoxe…
On hérite d’une histoire où toutes ces choses ont été comprises comme des signes, des messages à décrypter, comme ça peut encore l’être dans certains mondes : ces voix sont des messages envoyés par un être, et il s’agit d’identifier l’être, de décrypter le message qu’il envoie, etc. Le décryptage psychiatrique est tout autre, l’expérience inhabituelle n’y est plus un signe des relations qu’on peut entretenir avec des présences invisibles, mais un symptôme de maladie mentale.
Récemment, lors d’une formation, Peter Bullimore nous demandait de faire un petit exercice en exposant une croyance inhabituelle, qui serait la nôtre. On était en petits groupes, et je me suis rendu compte qu’il était très difficile de trouver une croyance inhabituelle… Par exemple, si je dis que je crois à la télépathie, est-ce si inhabituel que ça ? La transmission de pensées, tout le monde y croit un peu, non ? Certains en ont fait l’expérience… Une dame nous a dit qu’elle croyait au diable. Moi, comme ça, spontanément, je ne crois pas au diable ; mais si je réfléchis bien, je peux comprendre pourquoi on y croit, et ça me parait parfois très pertinent.
Je cherchais une croyance qui me serait propre et j’ai dit : « Je crois aux fantômes. » Finalement, on peut avoir mille manières de croire aux fantômes. Bref, je pense que Peter voulait attirer notre attention sur le fait que toutes les croyances qu’on peut catégoriser un peu vite comme délirantes sont aussi présentes dans le monde ordinaire. On m’a raconté récemment l’histoire d’un jeune qui a été déclaré délirant parce qu’il ne supportait pas la wifi : il éteignait celle de ses parents la nuit. Or, combien sommes-nous à penser qu’il est dangereux de s’exposer à ces fréquences ?
Comme vous dites, il y a mille manières de croire aux fantômes. Ce qui nous empêche d’assumer cette croyance, c’est souvent l’image médiatisée du fantôme, le drap blanc… Les espaces de la pensée sont très étroits…
Il est important d’arriver à transformer ces expériences, ces convictions en sources d’enseignement. Quelqu’un comme Eleanor Longden dont je parlais tout à l’heure, qui est passée par des moments très difficiles avec ses voix, affirme souvent qu’il n’est pas question pour elle aujourd’hui de s’en séparer. Elles sont devenues ses meilleures alliées pour la guider dans l’existence, pour comprendre des choses qui lui arrivent, et prendre les bonnes décisions. Elle explique par exemple que quand elle entend une certaine voix, elle sait qu’il est temps pour elle de faire un break, d’arrêter de travailler.
Illustration : Sup Umbra, par Yann Bagot
by Julia Burtin Zortea | 31 mars 2015 | Marabout
Le 24 juin 1981, la Vierge apparait à six enfants dans le village isolé de Međugorje en Bosnie-Herzégovine, l’un des États de la République fédérative socialiste de Yougoslavie d’alors. Depuis, tous les jours à la même heure, cette dernière continue de se montrer et de transmettre ses messages aux six voyants. À mesure qu’un pèlerinage s’y développe, drainant chaque année des milliers de pèlerins en quête de soutien, Međugorje se métamorphose. L’histoire officielle de cette localité, qui commence à se revendiquer « croate » et « catholique », se fissure ; les morts et les conflits refoulés resurgissent, les positionnements politiques se durcissent jusqu’à ce qu’une guerre survienne.
Pendant une dizaine d’années, momentanément interrompue par les années de guerre, Élisabeth Claverie, directrice de recherche au CNRS, a suivi les pèlerins et enquêté sur cette « Vierge événement ». Publié en 2003 chez Gallimard, Les guerres de la vierge, une anthropologie des apparitions, restitue l’intense travail ethnographique de l’anthropologue à propos de ce lieu où la Vierge est tour à tour « croate, mère du juge, mère du rédempteur, mère de Dieu, ennemie du communisme, supercherie, rêve, vessies et lanternes, soldat oustachi, doublet du Christ, diable lui-même, soucoupe volante, « elle », voisine et amie des morts, corédemptrice, femme de l’Apocalypse, mièvre statue, image répressive d’une féminité dominée, chef de guerre ».
Ce texte est extrait du numéro 1 de Jef Klak, « Marabout », dont le thème est Croire/Pouvoir. Sa publication en ligne est le premier d’une série limitée (1/6) de textes issue de la version papier de Jef Klak, toujours disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF
Comment avez-vous choisi de travailler sur ce pèlerinage à Međugorje ?
J’habitais et je travaillais en Lozère, sur les systèmes de parenté. Ma voisine utilisait le pèlerinage à Lourdes comme système de soins, et j’ai fini par m’y rendre avec les gens du canton. J’ai trouvé le voyage intéressant, mais c’est à peu près tout.
En 1967, une nouvelle Vierge est apparue en Italie à San Damiano (province de Piacenza). Cette voisine, alors âgée de 60 ans, qui ne conduisait pas et qui ne pouvait jamais s’absenter longtemps car elle travaillait dans une ferme d’élevage, a décidé d’affréter un car pour se rendre sur le lieu de cette nouvelle apparition. J’ai été très surprise de voir ce que cette Vierge était capable de faire faire à ces gens qui, d’ordinaire, ne se distinguaient pas par leur capacité d’initiative.
En arrivant à San Damiano, j’ai tout de suite compris que si je voulais travailler sur le sujet, il me fallait sortir d’une certaine forme de description automatique, revenant à dire « Ces gens croient à la Vierge car ils sont comme ci, ou comme ça… ». Il me fallait couper avec un environnement dans lequel j’agrégerais forcément des familiarités. J’ai finalement choisi de partir avec un groupe que je ne connaissais pas, à Međugorje en Bosnie, depuis Paris, via une agence d’organisation de pèlerinage.
Dans le bus, en arrivant en Yougoslavie, je me suis retrouvée à côté d’une fille qui avait 30 ans – mon âge à l’époque – et qui a commencé à me parler comme si nous partions en vacances au Club Med. La très grande majorité des gens du groupe ressemblait à ceux que je fréquentais tous les jours – ils n’étaient pas du genre à se rendre à la « Manif pour tous ».
Quand on cherche à complexifier la question du « croire », on peut se faire la remarque que la frontière entre le rationnel et l’irrationnel, entre un savoir légitime et une croyance illégitime, structure la pensée critique de part en part. Alors certes, on peut déplacer la frontière, la bousculer, mais elle revient souvent au galop…
Vous savez, il n’y a que les autres qui croient que ceux dont on dit qu’ils croient, croient. Quand je me suis rendue à Međugorje, où une Vierge apparaît depuis 1981, je m’étais habillée en bleu marine avec un chapelet autour du cou, et je m’attendais à trouver des gens un peu fous. Or, je me suis bien vite aperçue qu’en fait, personne ne croit. Croire n’est pas le bon mot. Les gens que je rencontrais au sein du pèlerinage font des choses avec des types d’êtres, surnaturels entre autres, à la manière d’un prestidigitateur. Ces types d’êtres sont pertinents de temps en temps, parce qu’ils peuvent, par exemple, réaliser ce qu’un vaccin ne sait pas faire. Ils ne sont pas fixes. Ils peuvent être pris au sérieux pendant un instant, puis tournés en dérision la seconde suivante ; on peut se mettre à pleurer devant eux, puis dire qu’ils n’existent pas.
Il y aurait plusieurs manières d’étudier un collectif de personnes parties en pèlerinage sur le lieu d’une apparition. Nous pourrions nous dire que ce sont des catholiques, et qu’en conséquence ils croient. Observer que ce sont de vieilles dames italiennes, avec des foulards noirs, plutôt paysannes, et en conclure que tout cela est cohérent, qu’il s’agit d’un ensemble de ringards : les crétins croient, les chasseurs chassent. Or, quand on s’approche un peu plus près, on se rend compte que la population du pèlerinage est bien plus variée. Et si l’on suspend pendant un instant toutes les déterminations que j’ai évoquées pour s’en tenir à la pratique, si on laisse à ces personnes des compétences critiques, sans leur enlever leur réflexivité, on se rend compte qu’elles ont le plus grand mal à faire intervenir un être surnaturel dans le monde moderne. Il n’y a rien d’évident à cela. Quand on jette une Vierge dans un pays communiste un matin, il se passe un tas de choses très complexes et très peu compatibles avec les agencements de la modernité… mais qui parviennent à se produire tout de même.
Comment le travail d’installation de cet être surnaturel dans le monde moderne est-il effectué par les personnes qui se rendent à Međugorje ? Quel a été votre parti pris méthodologique pour l’étudier ?
Ces objets surnaturels sont tellement déterminés par la cassure rationnel/irrationnel, et tellement lourdement équipés par le ridicule qu’on ne peut pas les aborder sans transformer leur accès. Pour contourner ces obstacles, il est important d’écouter comment les acteurs soutiennent ce qu’ils disent, comment ils effectuent le travail d’aller chercher ce type d’êtres qui n’a pas encore beaucoup de chair, comment ils s’installent dans un collectif qui jouera momentanément le jeu, selon ses règles propres.
Dès que les gens se retrouvent à l’aéroport pour accomplir le pèlerinage à Međugorje, ils disent très rapidement « Elle est là », « Elle va venir ». Personne ne demande « C’est qui, elle ? » ; personne ne les engage à douter de son existence. On pourrait se dire que l’on a affaire à un collectif trié, où des individus partagent tous la même fixette. Or non, ces gens ne se connaissent pas, et sont très différents. Aussi, leur objectif, juste avant que l’avion ne décolle, est-il de formuler une proposition qui alignera les membres du groupe. Cet alignement se réalise dans le dialogue, dans des rapports d’interlocution. Il leur faut installer des réquisits, c’est-à-dire une situation qui va entre-tester les personnes pour créer un espace dans lequel les épreuves de véridicité seront différentes. Par le langage, il leur faut poser les limites du groupe, de leur monde commun. Après cela, ils sauront que l’implicite est partagé.
Les gens qui participent au pèlerinage savent très bien vivre dans le monde moderne sans engager d’êtres surnaturels. Ils savent aller chez le boucher, partager un dîner entre amis, etc. Hormis dans de rares situations, ils ne parlent jamais de cet être. En revanche, à partir du moment où ils permettent à une Vierge d’exister, un ajustement mutuel doit s’accomplir car le groupe, dès le départ, doit pouvoir prendre en charge de nombreuses choses.
La souffrance, par exemple ?
Par exemple. On trouve beaucoup de gens au chômage depuis longtemps, qui viennent de perdre un conjoint, qui se trouvent en phase terminale de cancer, etc. Ce sont des gens qui sont arrivés au terme d’épreuves qui les dépassent et dont la résolution est loin d’être assurée. Ce qui m’a frappée, c’est que les évènements ne se disent plus que dans une économie de la résignation – « C’est la vie ». J’ai mis du temps à le comprendre, mais le fait d’aller chercher cette Vierge par l’usage d’un vocabulaire qui n’a rien à voir avec celui de la vie quotidienne, par l’intervention de mots et d’expressions qui reviennent tout le temps – « Elle est là », « J’ai eu une grâce » –, permet de desserrer, un peu, cette économie de la résignation. Tout à coup, une brèche s’ouvre dans la suite de malheurs. Il y a beaucoup de techniques pour transformer le malheur répété en trouble réversible, lesquelles ont fait l’objet de nombreuses études dans les années 1970, surtout chez les anthropologues africanistes et américanistes, mais aussi en France, avec Jeanne Favret-Saada. Je parle de malheurs qui ne sont pas attribuables à une même chaîne – la mort d’un enfant, l’avortement d’une vache – mais qui, en s’accumulant, sont interprétés comme une persécution.
Comment, sur ce lieu d’adoration de la Vierge, ce sentiment de persécution par le malheur est-il évacué ? L’est-il seulement ?
Pendant le voyage à Međugorje, je me suis retrouvée face à un schéma, très banal au final, qui consiste d’abord à expliquer sa situation compliquée à des gens que l’on ne connait pas, puis à passer à une série d’accusations. Non pas pour trouver quelqu’un à la racine du malheur, mais pour trouver des gens qui contribuent à déresponsabiliser la personne. L’accusée s’appelle d’abord la vie – cette somme irrévocable de malheurs. Puis, un mouvement s’opère, et la personne se figure que ce sont des malheurs qui lui arrivent particulièrement à elle. Enfin, de manière très progressive – et c’est très fréquent – les gens multiplient les mini imputations, ils trouvent des mini causes indirectes : « Faut dire que mon fils, s’il n’avait pas fait ça, il n’aurait pas de cancer », « Faut dire que mon mari, il n’est pas très marrant ». Le récit initial incorpore toute une série d’accusés – des membres de la famille, des amis, la personne en danger elle-même. Et, un peu comme dans le système sorcellaire décrit par Jeanne Favret-Saada, soi est innocent : vous êtes attaqué, victime, vous qui êtes si gentil et doué d’innocuité.
En arrivant à Međugorje, les gens sont déjà passés par cette série de séances/postures énonciatives, laquelle atteint souvent son point d’orgue quand ils se trouvent nez à nez avec une statue de la Vierge. Comme cet être est bénévolant (il veut le bien d’autrui), et qu’il a un cœur de mère, plein d’amour et de miséricorde, ils se mettent à tenir devant lui des propos quasiment haineux contre la vie, le destin, des gens en particulier. C’est très graduel, mais la conscience grandissante d’avoir à ses côtés un avocat (la Vierge) qui ne juge pas autorise une position contra-phobique, déjouant le mécanisme de la peur. Car au fond, les accusations portées sont souvent symétriques à celles que l’on a reçues, ou que l’on s’était faites. Avec l’aide de cet avocat, la position devient progressivement moins passive, moins victimaire. C’est ce que l’on retrouve dans l’usage très répandu, au bout de deux ou trois jours de pèlerinage, de l’expression « J’ai reçu une grâce ». Accepter d’être « pardonné » engage une responsabilité dans le récit : cela implique que la personne se risque à entrer dans une situation où elle a éventuellement quelque chose à voir avec la cause directe du malheur ou avec la manière de l’affronter.
Petit à petit, les gens se mettent à tenir le discours de la réversibilité. Ils ne disent pas « Mon mari va guérir » ou « Les gens qui m’en veulent vont arrêter de m’en vouloir », mais ils modifient leur propre position par rapport à la situation. Si l’on regarde ainsi de près la pratique des personnes, au fond, ce que l’on appelle croire, c’est une manière de se subjectiver avec un adjuvant (la Vierge Marie dans ce cas précis) ; c’est avoir le sentiment que quelqu’un suspend son jugement à mon égard, ce qui fait éclater le système persécutif, et la résignation.
Cela peut faire penser au fonctionnement d’un certain militantisme politique, quand le collectif joue le rôle d’adjuvant, et que le système de responsabilité, sur une problématique donnée, est recomposé, partagé, extériorisé.
En sortant, totalement ou en partie, de la notion d’irréversibilité, ou d’une sorte d’eschatologie individuelle, des gens retrouvent une finalité dans laquelle ils peuvent être actifs ; le futur se desserre. Il est intéressant de constater qu’il y a constamment des apparitions dans le monde, mais que seules certaines fonctionnent : à Lourdes, à Međugorje, à Kibeho au Rwanda… Dans le cas de Međugorje, je pense que cela a fonctionné car deux tendances se sont rencontrées : d’une part celle des pèlerins qui viennent « chez la Vierge », sur un site, qui se fichent un peu de la Bosnie, qui ne connaissent pas grand-chose au communisme (tout en l’assimilant à un contexte un peu dangereux) ; et d’autre part celle des locaux qui habitent ce lieu-frontière de la Bosnie-Herzégovine où, juste derrière une ligne de montagne, se dessine la Croatie. Les habitants de Međugorje sont des Croates d’Herzégovine. C’est justement l’imbrication de ces deux tendances qui a créé la question du politique.
Comment cela ? Quelle était la « tendance » des habitants de Međugorje ? Comment la Vierge a-t-elle été perçue, localement ?
La Vierge est apparue pour la première fois en juin 1981 à Međugorje, alors en Yougoslavie communiste, un an après la mort de Tito. Ce qui est très intéressant, c’est que le Parti a interdit cette apparition, mais que la Vierge n’a jamais obtempéré. Elle sautait d’un arbre à un autre, elle se cachait dans une cave, des chiens policiers ont été lâchés là où elle apparaissait… Mais rien n’y a fait, la police communiste n’est pas parvenue à l’attraper.
Vous voulez dire que les enfants continuaient de la voir dans des lieux différents ?
Oui. Elle sautait partout. Cette façon de déjouer et de desserrer la contrainte policière locale était un coup de génie. Certes, la police avait des moyens : elle a enfermé les jeunes voyants, par exemple, mais la Vierge apparaissait malgré cela. Pour les gens locaux, cette compétence à tromper la vigilance du Parti a créé quelque chose de l’ordre d’un mouvement politique, même si le terme est un peu trop fort.
Une mobilisation ?
En quelque sorte. Et la conscience d’être assisté d’un avocat extrêmement puissant. D’un vrai challenger au Parti. C’est là que l’histoire prend une tournure collective. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette zone frontière était un lieu de concentration d’Oustachis fascistes croates, lesquels ont perpétré en 1941 de grands massacres contre la population serbe de la région, et contre des communistes qui s’opposaient à la présence nazie. À la fin de la guerre, en représailles, les partisans communistes ont assassiné les moines du monastère-école franciscain de Široki-Brijeg (soupçonnés d’avoir encadré des Oustachis), ainsi que des centaines de Croates, dont certains membres des familles des actuels voyants. Tito ayant alors pris le pouvoir, ces familles ont été priées de taire toute revendication au sujet de leurs morts. Au moment des apparitions de la Vierge en 1981, Međugorje était donc également peuplée par ces disparus.
Ont-ils fini par réapparaître ?
D’une certaine manière. Après la mort de Tito, puis la chute du mur de Berlin en 1989, le Parti communiste avait perdu beaucoup d’influence. À partir de 1990, les nouveaux langages politiques de Slobodan Milošević en Serbie et de Franjo Tuđman en Croatie ont progressivement remis en scène les thèmes nationalistes, et Međugorje a tout de suite été embarquée dans ce schéma. Ce n’est que peu avant le commencement de la guerre de Yougoslavie en 1991 que je me suis rendue compte que les voyants avaient alimenté, à leur façon, le nationalisme croate d’Herzégovine. Ils avaient demandé à être rattachés à la Croatie, et encouragé le nettoyage ethnique dans la région. Puis, pendant la guerre, les nationalistes d’Herzégovine ont déclaré ce territoire « croate de Bosnie », et certains soldats de l’armée régulière ou des milices se faisaient adouber, en quelque sorte, par la Vierge de Međugorje, dont ils accrochaient la photo au revers de leur veste.
En conséquence, sur ce site où des gens venaient dans le cadre de leur eschatologie individuelle, une entreprise politique locale en arrivait à considérer que même le Parti était réversible, qu’une lutte était possible, et que le chef des armées était la Vierge elle-même. Cela a donné un autre sens à l’ensemble.
Quelle a été l’attitude des pèlerins vis-à-vis de ce contexte local ?
À partir de la fin des années 1980, les pèlerins qui se rendaient à Međugorje (lesquels étaient très peu inscrits à gauche, politiquement) ont commencé à faire circuler un type d’histoire très différent de ce qui avait été élaboré lors de la première décennie de l’apparition. En relayant les discours locaux, ils ont participé à transformer les familles oustachies de la Seconde Guerre mondiale et leurs descendants (cela ne concerne évidemment pas tout le monde) en victimes du communisme. Cette idée est aussi mensongère que celle de traiter tous les Croates de fascistes, mais cette nouvelle fiction n’avait pas pour fonction de retracer historiquement la série des faits politiques.
En lisant votre livre, il y a un moment où je me suis perdue entre les différentes opinions émises par les habitants et la presse quant au déroulement des massacres commis dans les années 1940… Les faits sont brouillés, on ne sait plus qui a fait quoi, qui se venge de qui… Ne restent que des versions de l’histoire, présentant toutes leur logique, leur cohérence…
Je crois qu’il est important d’être perdu, parce que les choses sont effectivement très compliquées. En juin 1981, peu après la première apparition, un journal communiste de Sarajevo a publié une caricature représentant un soldat oustachi sous les traits de la Vierge. Il ne faut pas oublier qu’il s’agissait alors, pour les communistes au pouvoir, d’un travail classique de propagande par des accusations de crimes, assimilant tous les Croates à des assassins et à des ennemis. Ces accusations ont ensuite largement été reprises par la presse yougoslave. Pour le Parti, cette Vierge ne pouvait être autre chose qu’un complot nationaliste et religieux mené contre lui, et contre la Yougoslavie titiste, symbole de paix civile. Les autorités politiques n’ont alors pas autorisé les Croates à exprimer autre chose que ce qu’elles voulaient qu’ils représentent.
Pourtant, les premières revendications des habitants de Međugorje n’ont pas été immédiatement religieuses ou nationalistes. Au contraire, elles se référaient à la sociologie de la région, et portaient sur les inégalités qui en découlaient. Les habitants croates de Međugorje étaient des paysans, qui vendaient raisins et poivrons aux commerçants urbains et musulmans de Mostar, 25 km plus loin. On retrouve ici l’opposition traditionnelle entre ceux qui travaillent et produisent au village, et ceux qui vendent, gagnent de l’argent, font partie de la nomenklatura, tiennent le Parti, et obtiennent les permissions pour partir travailler en Allemagne, etc. Les revendications portaient sur cette inégalité de traitement, non pas entre chrétiens et musulmans, mais entre paysans et communistes de la ville. Ce n’est que plus tard que les communistes sont devenus des musulmans, des « Turcs », des « sales Ottomans » ; or il faut bien garder à l’esprit que ces catégories politiques ne se sont pas tout de suite refermées sur ce qu’elles sont tristement devenues. Il y a eu un moment d’espoir. Au début – je dirais jusqu’en 1986 –, il s’agissait d’un mouvement de révolte locale contre un système d’oppression effectif, très puissant : contre le fait de ne pas pouvoir circuler librement, contre la milice omniprésente, contre les logiques claniques du Parti, etc. Cette lutte a changé d’orientation dans un second temps, quand des porte-parole nationalistes s’en sont emparés. La série des évènements politiques qui affectèrent la gouvernance des Partis communistes des pays du bloc de l’Est jusqu’à la chute du Mur de Berlin, l’exécution de Ceaușescu, la crainte d’une rupture du Pacte de Varsovie, entrainèrent, à la fin des années 1980, une série de contrecoups politiques en Yougoslavie et des remaniements idéologiques. Les positions ultranationalistes purent alors s’affirmer avec véhémence, comme ce fut le cas de Milošević en Serbie vis-à-vis du Kosovo et des provinces autonomes, et de Tuđman en Croatie, dans les années qui précédèrent la guerre (qui fit rage entre 1991 et décembre 1995).
Au fil de votre enquête, vous faites apparaître une Vierge aux multiples capacités…
Au départ, je ne connaissais pas du tout le sujet. Il m’a donc fallu comprendre la complexité structurelle de cette petite statue blanche et bleue un peu ringarde. Le fait qu’elle soit née sans semence masculine lui donne un statut très particulier : c’est la seule de cette espèce. D’un côté, elle a toujours été difficile à constituer en tant que mère du Christ par les Pères de l’Église ; son existence et ses particularités ont suscité des débats théologiques sans fin. D’un autre, ce personnage possède des compétences et des qualités très diverses : elle est à la fois une jeune fille à l’innocence pure, une mère tendre et miséricordieuse, et une guerrière terrifiante, un chef de guerre apocalyptique. Tout cela rassemblé dans une même femme !
Les pèlerins et les habitants de Međugorje ne connaissent pas la théologie mariale, et pourtant, ils savent très bien quelles sont les compétences de la Vierge. Mieux, ils savent les utiliser, jongler avec. Ils sentent très bien qu’elle peut mener un combat, au sens politique du terme – annoncer la fin du communisme, mener la Croatie à la victoire. Et qu’elle peut également vous guérir et vous enlacer. J’ai observé comment ces savoirs ont été déposés dans les gestes, dans les prêches…
D’après vous, est-ce la Vierge qui produit et révèle le contexte local, ou l’inverse ?
C’est tout le problème. Je continue de me poser cette question avec la Vierge rwandaise de Kibeho. Cette dernière est apparue six mois après celle de Međugorje et, dans les deux cas, les apparitions ont été suivies de génocides. Classiquement, elles sont interprétées comme des signes de crise. Elles interviennent toujours sur des zones frontière – géographiques, linguistiques, sociales. Mais je n’ai pas voulu redire cela, puisqu’on le trouvait dans les analyses déjà produites.
À l’inverse, j’ai voulu suspendre – méthodologiquement – l’histoire locale, et traiter l’apparition comme un événement. La conséquence descriptive est importante. Déclarer cette Vierge « événement » revient à ne pas surinterpréter ce qui l’a forgée, à ne pas énoncer « Voilà des gens opprimés par quarante ans de communisme qui veulent retrouver leur liberté, et qui font apparaître une Vierge ». J’ai préféré poser la question suivante : Quand une Vierge apparaît un matin en Bosnie communiste, que se passe t-il ?
Pour certains, cette apparition est vraie, alors qu’elle est fausse pour d’autres. Chacun va argumenter sur une ligne, et c’est la somme de ces lignes qui restitue un paysage historique et politique. Si vous jetez une apparition dans un groupe, cela va tout de suite faire apparaître les scissions du village. Déjà, pour voir une Vierge, il faut être au minimum deux personnes – cette découverte reste une grande surprise pour moi. À Međugorje, à La Salette, à Lourdes, le voyant s’est adressé à la personne qui l’accompagnait en disant « Tiens, regarde, la Vierge ! ». Et l’autre personne lui a toujours répondu « La Vierge t’apparaîtrait, à toi ? ». Ce « À toi ? » pose d’emblée la question de l’élection. La personne qui affirme avoir vu une apparition passe ensuite pour hystérique, mythomane, etc., mais il va y avoir des gens pour soutenir cette élection, et d’autres pour la contredire. Ces débats sur l’élection nous ramènent rapidement à la sociologie locale, aux fractures et aux conflits en jeu.
On est bien loin de croyances…
Si vous parlez de systèmes clos de croyances, légendaires par exemple, vous utilisez le mot « croyance » comme un nom qui désigne ce qui, aujourd’hui, n’est pas vrai, au sens de ce qui n’est pas vérifiable. Mais si, au lieu de travailler sur les croyances, vous travaillez sur les pratiques de personnes qui mettent en œuvre des êtres surnaturels, leur inconscient, ou n’importe quelle chose qui n’est pas empiriquement vérifiable, cela donne un résultat bien différent. Une proposition possède un régime de vérité au sein de sa propre économie. Si vous vous trompez d’économie pour juger de telle ou telle proposition, alors évidemment vous la trouverez fausse, ou stupide.
Nous nous trompons alors souvent d’économie ! Dans le langage, un objet non empiriquement vérifiable (un ovni, une sainte Vierge, un esprit, un inconscient) passe généralement pour faux…
Parce qu’il faut tout le système qui va avec pour pouvoir l’appréhender. Sinon, on passe à côté. La première étape est d’essayer de comprendre au sein de quels énoncés une proposition est active, au sein de quelles pratiques. Et ensuite de comprendre pourquoi un dispositif fonctionne, pourquoi on est touché. À Međugorje, je pleurais tout le temps. Si l’on enlève l’aspect folklorique du pèlerinage, il reste un espace où peuvent s’exprimer des choses qui n’auraient pas pu, ou pas su, trouver de forme ailleurs. Deux lieux me provoquent le même effet : les manifs, et les pèlerinages. C’est probablement dû au fait qu’un accord se crée entre plusieurs personnes, où le singulier et le collectif s’alignent…
Avec beaucoup d’implicite, de non verbal…
Oui, en dehors de la négociation. Pendant une fraction de seconde, on est certain qu’un accord a régné – un véritable accord, et pas un accord partiel ni un accord suivi de négociations sans fin, lesquels restreignent la violence sans l’abolir. Dans cette forme d’accord véritable, c’est de bien commun dont il est question. À Međugorje, en général, il y a la foule, vous, et cet être auquel on ne croit qu’à moitié. Et puis soudain, à un moment donné, un alignement se crée. On sait bien que c’est une fiction. Mais cette fiction est plus vraie que vraie.
Et les Balkans dans tout cela ? Vous attendiez-vous à trouver un lieu d’enquête aussi « chargé » ?
Pas du tout. Ce n’est qu’au bout de trois ou quatre pèlerinages que je me suis avisée que j’étais dans les Balkans, et pas uniquement « chez la Vierge ». J’ai alors commencé à habiter chez des gens, puis à Mostar, un peu plus longtemps. J’ai essayé d’apprendre la langue. Ensuite, la guerre est arrivée. Je ne l’avais pas vue venir. Pas si vite. J’ai dû rentrer en France, où je me suis engagée dans des mouvements militants. Ce fut un moment terrible.
Les accords de Dayton, marquant la fin de la guerre, ont été signés en décembre 1995. Je suis retournée à Mostar un mois plus tard. Tout était détruit. Međugorje avait été épargnée car il s’agissait d’un lieu de négociation internationale, mais les villages alentour étaient dévastés. Admettre que des Croates que je fréquentais aient pu être des tueurs, des bourreaux, m’a pris des mois. Quelque chose en moi résistait ; les mécanismes de dénégation sont puissants.
ÉPILOGUE
Dans la foulée de ses travaux sur Međugorje, Élisabeth Claverie a travaillé sur les premiers temps de la guerre en Bosnie, et sur l’engagement nationaliste dans les milices et le parti serbes de Bosnie. Après avoir réalisé des entretiens avec des chefs nationalistes et des fils de famille qu’elle connaissait, elle a analysé les matériaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie pour travailler sur le détail de l’épuration ethnique et recomposer une histoire de la guerre en Bosnie. À titre d’exemple, son article « Techniques de la menace » revient sur les techniques de « terrorisation » par privation de l’intimité des habitants musulmans d’une petite bourgade proche de Sarajevo, quelques jours avant l’arrivée des milices. Puis, petit à petit, ses recherches se sont orientées sur la vallée de la Drina et sur la municipalité de Višegrad, en Bosnie Herzégovine, dont elle a écrit la « chronique du nettoyage ethnique ». Avec une anthropologue bulgare (Galia Valtchinova, professeure à Toulouse II-Le Mirail), elle poursuit actuellement une enquête sur l’effacement complet des traces de ces massacres – et de la population musulmane de la région. Par ailleurs, Élisabeth Claverie vient tout juste d’achever un long travail d’ethnographie judiciaire sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale, dans le cadre de crimes perpétrés en République Démocratique du Congo.

Photographie : Patrick Imbert, “Venise”



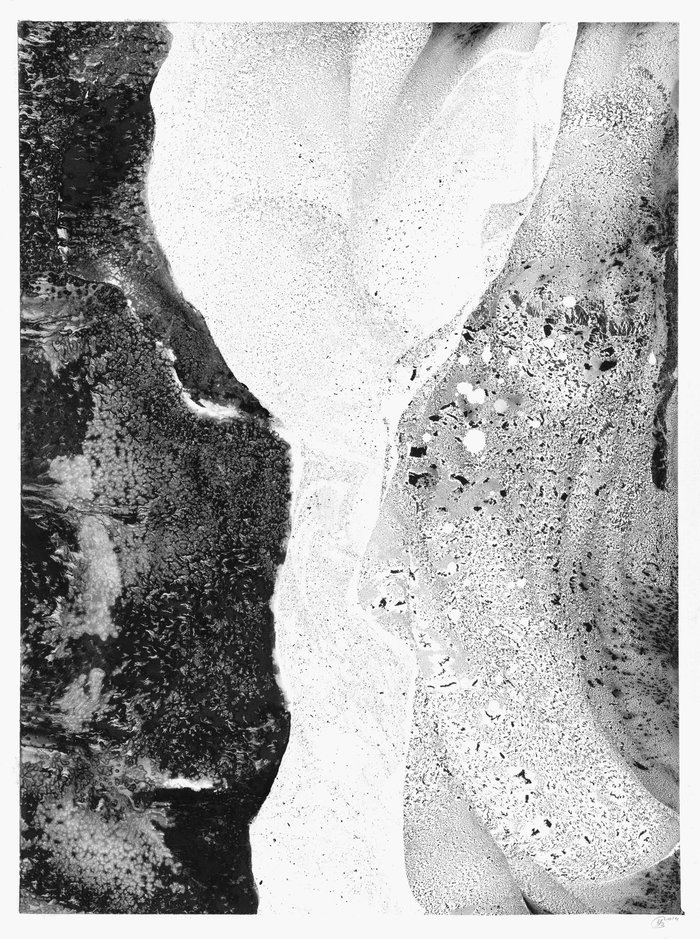


Recent Comments