by Mickaël Correia | 26 novembre 2018 | Culture de base
Entre marchandisation sportive, ferveur populaire et tensions politiques, le Mondial de football est un nœud d’ambivalences. Son histoire s’entremêle à celles des régimes autoritaires, se trouble dans des scandales financiers, s’enflamme au gré des injustices sociales qu’elle produit… En cet été 2018, Alexis Berg (un bon ami de Jef Klak) a dérivé aux marges de ce Spectacle des spectacles, en Russie et en France, pour photographier ce qui s’y vit, loin des images uniformes et univoques souvent servies par les médias. Mickaël Correia, membre de Jef et auteur d’Une histoire populaire du football nous propose ici un copinage éhonté, comme avant goût de ces photos : Contre Allez, à paraître le 27 novembre 2018, aux éditions Mons. (more…)
by Mickaël Correia | 27 février 2018 | Ch’val de course, Culture de base
Le football n’est pas sorti de la jambe d’un dieu grec. L’émergence du sport-roi montre comment une multitude de jeux populaires de ballon, au moins depuis le XIVe siècle, ont peu à peu été uniformisés et simplifiés jusqu’à la forme sportive que nous connaissons aujourd’hui. L’histoire du football à travers les âges nous raconte comment les communautés paysannes se sont fait déposséder de leur amusement par un capitalisme industriel naissant. D’abord interdit par les autorités royales qui en craignaient la sauvagerie et le potentiel subversif, le foot a ensuite été normalisé et standardisé par la bourgeoisie britannique, qui a su en faire l’un de ses plus formidables outils de contrôle social, avant d’être réapproprié par les classes populaires.
Cet article est extrait de Une histoire populaire du football, qui paraît le 8 mars aux éditions La Découverte.
Télécharger l’article en PDF.
« Faire d’un pied léger poudroyer les sablons,
Voir bondir par les prés l’enflure des ballons. »
Ronsard, Le Bocage Royal, 1584
« Alors que notre seigneur le Roi s’en va vers le pays d’Écosse dans sa guerre contre ses ennemis et nous a recommandé particulièrement de maintenir strictement la paix […] et alors qu’il y a une grande clameur dans la cité, à cause d’un certain tumulte provoqué par des jeux de football dans les terrains publics, qui peuvent provoquer de nombreux maux – ce dont Dieu nous préserve –, nous décidons et interdisons, au nom du Roi, sous peine de prison, que de tels jeux soient pratiqués désormais dans la cité », décrète, en avril 1314, Nicholas de Farndone, lord-maire de Londres. Promulguée au nom du roi Édouard II d’Angleterre, cette ordonnance se généralise à d’autres cités du Royaume sous le règne du fils héritier du trône, Édouard III, qui réitère par trois fois cet édit contre le ballon rond. Dans un pays prêt à tomber dans la guerre de Cent Ans et dévasté par la peste noire, les premières mentions historiques de la pratique du football sont intimement liées au rétablissement de l’ordre public, le belliqueux Édouard III encourageant ses sujets à s’adonner au tir à l’arc et autres exercices ayant un caractère militaire plutôt qu’aux turbulents « jeux de foeth ball ».
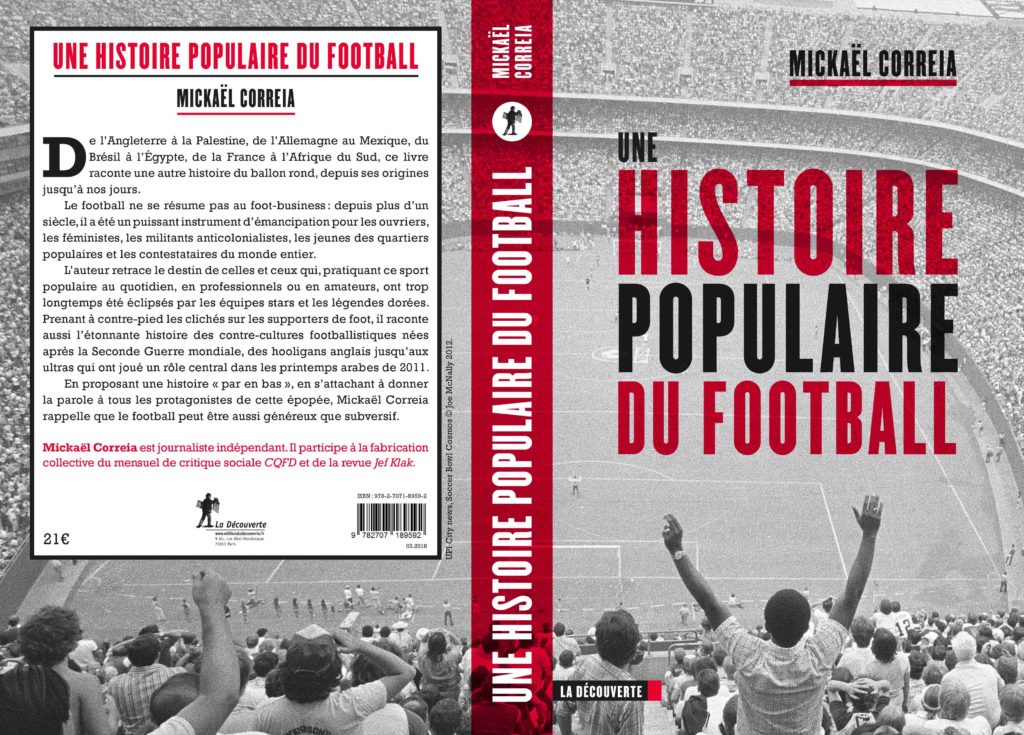
Un proto-football sauvage
Depuis le XIVe et jusqu’au XIXe siècle, on retrouve au fil des descriptions de jeux de ballon une même structure de pratiques que l’on dénomme en anglais folk football ou mob football et, en français, soule ou choule, qui s’étend de l’ensemble de la Grande-Bretagne au nord-ouest de la France. Des jeux collectifs de balle se pratiquant dès la Grèce antique (le sphairomachia et l’episkyros) puis sous l’Empire romain (l’harpastum des légionnaires [2. L’harpastum pourrait être à l’origine du calcio fiorentino, jeu de ballon pratiqué à Florence dès le Moyen Âge.]), les origines de ce proto-football si décrié par les autorités royales demeurent néanmoins sinueuses [3. Des jeux de ballons ont été également pratiqués en Amérique précolombienne (le tlatchi), dans le Japon féodal (le kemari) ou encore en Chine (le cuju) sous la dynastie Han.]. L’ethnographe Émile Souvestre qui décrivit dans le détail les dernières parties de soule en Basse-Bretagne au XIXe siècle assure que « cet exercice est le dernier vestige du culte que les Celtes rendaient au soleil. Ce ballon, par sa forme sphérique, représentait l’astre du jour ; on le jetait en l’air comme pour le faire toucher cet astre et, lorsqu’il retombait, on se le disputait ainsi qu’un objet sacré [4. Émile Souvestre, La Soule en Basse-Bretagne, Le Musée des Familles, 1836, tome III, p. 117.] ». Le terme soule viendrait du celtique heaul, le soleil, modifié par les Romains en seaul ou soul, mais pourrait tout aussi bien provenir du mot latin solea qui désigne plus humblement… la sandale romaine.
Si les premières traces du jeu de football se révèlent par le truchement de son interdiction, c’est à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, sous le règne d’Henri VI d’Angleterre, qu’on le décrit en tant qu’activité ludique, toujours entachée d’une réputation des plus détestables : « Certains nomment jeu de football le jeu qui les réunit pour se récréer ensemble. Dans le jeu rural, les jeunes gens poussent une balle énorme, non pas en la lançant en l’air, mais en la cognant violemment et en la faisant rouler sur le sol, et cela non pas à la main, mais au pied. C’est un jeu, dis-je, assez abominable, et, à mon avis au moins, plus vulgaire, plus indigne et plus méprisable que tout autre sorte de jeu, un jeu se terminant rarement sans quelque perte, accident ou préjudice pour les joueurs eux-mêmes [5. Ronald Knox et Shane Leslie, The Miracles of King Henry VI, Cambridge University Press, 1923.] » Souvent pratiqué le Mardi gras jusqu’à la fin du Moyen Âge, le calendrier du jeu semble essentiellement reposer sur celui des fêtes chrétiennes [6. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, Du guerrier à l’athlète : éléments d’histoire des pratiques corporelles, PUF, 2002.]. En 1698, l’écrivain français François Maximilien Misson, dans ses Mémoires et observations faites par un voyageur en Angleterre, évoque quant à lui le football en des termes plus avenants : « En hiver, le football est un exercice utile et charmant. C’est un ballon de cuir gros comme la tête et rempli de vent. Cela se ballotte avec le pied dans les rues par celui qui le peut attraper [7. Gondouin Charles et Jordan, Le Football : rugby, américain, association, Pierre Lafitte & Cie, 1914, p. 273.]; il n’y a point d’autre science. »

C’est qu’en effet, les règles de ce proto-football sont pour le moins minimalistes et varient en fonction de chaque territoire. On retrouve cependant un corpus de pratiques de jeu semblable d’une région à l’autre. Deux troupes rivales doivent par n’importe quel moyen amener le ballon dans le camp opposé [8. Néanmoins, certains récits tardifs font parfois référence à la règle du bann qui protégeait le porteur de la soule.]. La balle de jeu, de la taille d’une tête, peut être un ballon de cuir rempli de foin, de mousse ou de son, une boule de bois ou d’osier. L’endroit où déposer le ballon pour remporter la partie est marqué par un simple mur, la limite d’un champ, la porte d’une église, une trace arbitraire sur le sol ou encore une mare dans laquelle il faut plonger la balle. La taille du terrain peut se limiter à celle d’un champ ou d’un quartier, comme s’étendre à l’ensemble du territoire des paroisses qui se confrontent. Quant au nombre de participants dans chaque camp, il est illimité, pouvant atteindre plusieurs centaines de joueurs. Enfin, une partie de folk football ou de soule peut durer quelques heures, voire plusieurs jours. Les parties font généralement se confronter les jeunes hommes ou les hommes mariés aux célibataires, les femmes n’hésitant pas à se lancer dans le jeu pour aider leur camp à remporter la victoire [9. Nicolas Bancel, Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. Différents corps de métiers peuvent aussi s’affronter au cours de certaines parties urbaines annuelles. Émile Souvestre détaille ainsi : « Les gens les plus solides et les plus agiles de chaque paroisse, sans qu’on tint compte de l’égalité numérique des souleurs, formaient deux camps rivaux. […] C’étaient alors des joutes formidables, où les champions se comptaient par centaines, et qui se poursuivaient durant des journées entières avec un acharnement indescriptible. […] On avait arrêté à l’avance à quelles conditions précises la partie serait considérée comme gagnée. Parfois, pour être déclaré vainqueur, il suffisait de porter le ballon sur le territoire de sa paroisse, parfois il fallait l’amener dans tel ou tel village désigné [10. Louis Gougaud, « La soule en Bretagne et les jeux similaires du Cornwall et du pays de Galles », Annales de Bretagne, tome XXVII, 1911-1912.]. »
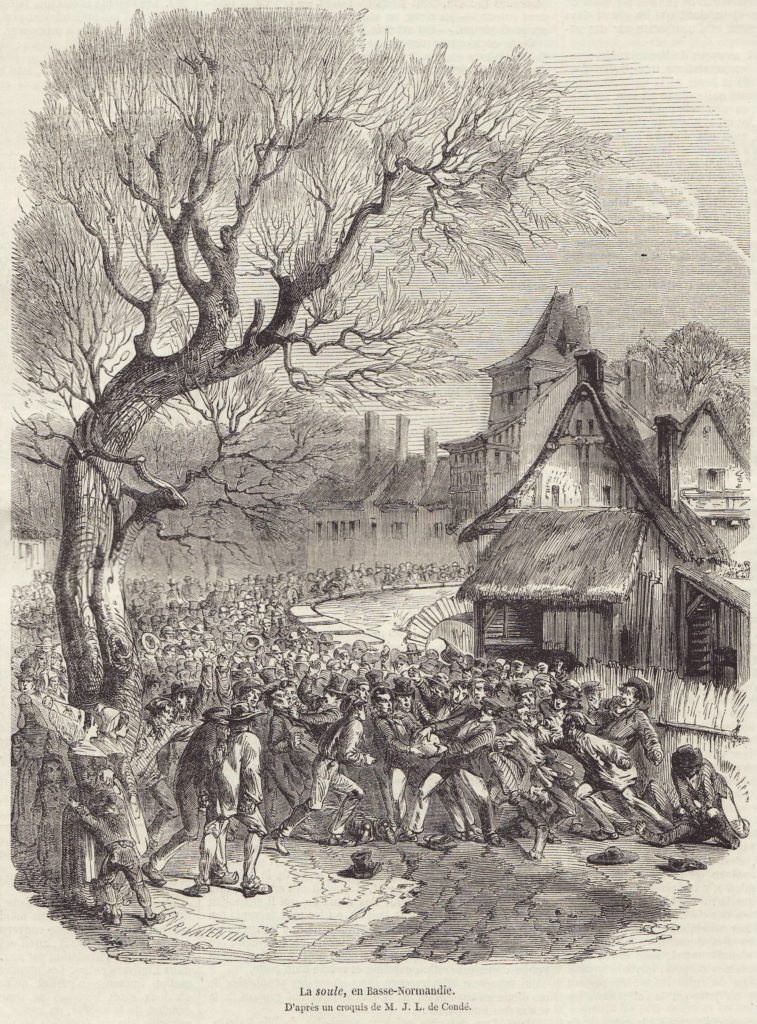
Une violence défouloir
Par-delà l’aspect prosaïque qu’offrent au premier abord ces jeux populaires, les parties de football recouvrent un espace ritualisé où la communauté – villageoise ou de corps de métier – affirmait son existence. Dans le cas des confrontations entre mariés et célibataires, le jeu pouvait être appréhendé comme un rite d’initiation à la virilité masculine [11. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.], mais possédait également une fonction intégratrice au sein de la communauté paysanne. Les parties de folk football ou de soule servaient à renforcer un mode de vie communautaire unissant les individus dans le jeu, comme dans le travail agricole [12. Idem.] : les moissons, les plans d’ensemencement et les mises en jachère étaient en effet essentiellement gérées par la communauté villageoise. Lors des parties, la soule se transformait en « véritable combat dans lequel les gens de dix paroisses divisées par camps, se disputent un ballon de cuir à travers les landes et les chemins, les coteaux et les vallons, les torrents et les rivières [13. Michel Pitre-Chevalier, La Bretagne ancienne, Didier, 1859, p. 552.] ». Délimité en début de rencontre, l’espace de jeu pouvait facilement s’étendre en cours de partie : la connaissance du terrain et de celui de son adversaire devenait alors primordiale pour remporter le jeu [14. Patrick Vassort, Football et Politique. Sociologie historique d’une domination, Les éditions de la Passion, 1999.]. Incarnation de la vitalité de la cohésion sociale de toute une communauté, les jeux de football offraient également la victoire à ceux qui exploitaient au mieux les potentialités de leur territoire, une symbolique puissante au sein de l’imaginaire paysan. Enfin, il est à noter que ces rudes parties de ballon offraient à l’occasion un espace de transgression des hiérarchies sociales propre au temps du carnaval et des jours gras, où prêtres, nobles, bourgeois et autre notables locaux s’adonnaient librement à ce jeu du peuple. Quitte à ce que l’amour du ballon contamine les gentilshommes : au XVIe siècle, le poète Pierre de Ronsard et le roi Henri II de France pratiquaient ainsi régulièrement la soule aux abords de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés à Paris.
Les jeux de proto-football étaient cependant invariablement vilipendés par les observateurs qui y voyaient l’expression d’une intolérable violence physique. En 1583, le pamphlétaire et voyageur anglais Philipp Stubbs dépeint le folk football dans The Anatomie of Abuses comme : « L’un de ces passe-temps diaboliques usités même le dimanche, jeu sanguinaire et meurtrier plutôt que sport amical. Ne cherche-t-on pas à écraser le nez de son adversaire sur une pierre ? Ce ne sont que jambes rompues et yeux arrachés. Nul ne s’en tire sans blessures et celui qui en a causé le plus est le roi du jeu. »

Cette dénonciation de la violence physique occulte cependant le fait que ces parties sauvages de ballon permettaient le défoulement de rivalités, voire de haines, entre individus ou entre cantons. Un coup de poing pour laver un affront ou une jalousie, une mêlée généralisée pour mettre fin à une querelle de famille ou de voisinage. Les jeux de football étaient ainsi un mode original de régulation des conflits individuels ou intervillageois [15. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.], un espace public donnant lieu à une justice à la fois autonome et populaire [16. Patrick Vassort, ouvr. cité.]. Parfois, la vengeance à laquelle on pouvait s’adonner dans l’effervescence du jeu s’étoffait d’une dimension plus politique. L’historien du sport Jean-Michel Mehl mentionne ainsi une partie de soule lors des trois jours gras de 1369 : « Dans les violences qu’il exerce sur un écuyer qui participe comme lui au jeu, Martin le Tanneur cherche à se venger de la noblesse. Un réflexe de “classe” dicte sa façon de jouer. Quand on sait que cette soule a lieu dans le comté de Clermont-en-Beauvaisis, la leçon de cet exemple est plus nette : ce sont les rancunes nées de la jacquerie et de sa répression qui s’étalent à l’occasion d’une manifestation ludique [17. Jean-Michel Mehl, Les Jeux au Royaume de France, du XIIIe au début du XVIe siècle, Fayard, 1990.]. »
Ballons émeutiers et justice populaire
Les foules rassemblées à l’occasion des parties de football pouvaient également être détournées à des fins insurrectionnelles, notamment dans l’Angleterre des XVIIe et XVIIIe siècles, en pleine période de privatisation du foncier agricole et de fin des droits d’usage des terres. En 1638 dans le comté d’Ely, situé dans l’Est-Anglie, une partie de football fut organisée dans le but de saccager délibérément des digues mises en place pour assécher et transformer en terres arables des marais communaux (les fens) – travaux de drainage qui furent objet de protestations populaires lors du XVIIe siècle [18. James Walvin, The People’s Game. The History of Football Revisited, Mainstream Publishing, 2000, p. 26.]. Dans le Northamptonshire, il est fait mention en 1740 d’une partie de football réunissant cinq cents hommes à Kettering, lesquels détruisirent un moulin privatisé pour le compte de Lady Betey Jesmaine [19. Idem.]. Idem en 1765, à West Haddon, où des paysans opposés à la mise en clôture de 2 000 acres de communaux organisèrent sur le terrain une rencontre de football qui ne fût qu’un prétexte pour arracher puis brûler collectivement les clôtures. Cinq joueurs furent emprisonnés, mais les organisateurs de ce match de football contestataire ne furent jamais retrouvés [20. Ibid., p. 27.]. À Holland Fen, dans le Lincolnshire, on dénombre pour le seul mois de juillet 1768 pas moins de trois émeutes footballistiques dans les fens, réunissant deux cents hommes et plusieurs « femmes insurgées [21. Idem.] ».
Dénigrées en tant que simple « amusement violent [22. Siméon Luce, La France pendant la guerre de Cent Ans, Paris, 1re série, 1890.] », ces pratiques de foot populaire mettent ainsi en jeu un corps qui devient outil de régulation autonome de tensions sociales et politiques [23. Patrick Vassort, ouvr. cité.]. Comme le rappelle le sociologue Patrick Vassort, « la soule répond à une dimension conflictuelle, conflit de générations, de classes, d’ordres, de villages, de cantons, de paroisses. La capacité de cette pratique à perdurer dans le temps démontre son efficience dans le rôle qui lui est dévolu : celui d’une justice populaire et immanente créatrice de pouvoirs [24. Idem.] ». Cependant, par les incontrôlables désordres qu’ils génèrent et leur fonction de « justice locale autogérée » échappant aux pouvoirs étatiques et de droit divin, ces jeux de football s’attirent rapidement les foudres des autorités.
Entre répression et « civilisation »
Après la première ordonnance contre le football de 1314 pour cause de troubles à l’ordre public, on relève près d’une trentaine d’interdictions du ballon rond dans différentes villes et comtés d’Angleterre jusqu’en 1615. En 1608 et 1609, deux ordonnances condamnent par exemple à Manchester le tort causé par « une compagnie de personnes viles et désordonnées s’adonnant à cet amusement illégal avec une ffotebale dans les rues », et mentionnent le grand nombre de fenêtres brisées au cours des parties qui se disputaient dans les rues [25. Norbert Elias et Eric Dunning, ouvr. cité.]. Mais rien n’y fait : « Bien que les autorités aient considéré cette activité comme étant un comportement asocial, s’amuser avec une balle – même si l’on se brisait des os et saignait du nez – demeura pendant des siècles le passe-temps favori du peuple dans la majeure partie du pays [26. Idem.]. »
En France, dès 1319, Philippe V dit le Long ordonna l’interdiction de tous les jeux s’apparentant à la soule (ludos soularum [27. Jean-Jules Jusserand, Les Sports et les jeux d’exercice dans l’ancienne France, 1901, rééd. Slatkine, 1986.]). Charles V dit le Sage, prit une mesure similaire en 1369 [28. Patrick Vassort, ouvr. cité.], arguant de la prétendue vacuité de la soule. En 1440, via un article des statuts synodaux de l’évêque de Tréguier, l’Église bannit les souleurs de son diocèse ; elle condamne le libre jeu des corps dans la soule et les parties endiablées qui saccagent les lieux de cultes ou les cimetières, voire s’achèvent en beuveries et festins collectifs [29. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. Quant aux autorités séculières, lassées de ces agitations intempestives et de l’effervescence populaire pour ce jeu, elles prohibent dans certaines villes et régions la soule, tel Poitiers en 1465 [30. Idem.] ou le Parlement de Bretagne en 1686 qui ordonne l’interdiction de ce « jeu maudit ».
Du XIVe au XVIIIe siècle, les nombreuses condamnations du ballon rond s’inscrivent dans un mouvement plus général de régulation de la violence des jeux, étroitement associé à la normalisation d’autres pratiques – alimentaires, sanitaires, sexuelles ou encore guerrières. Pour le sociologue Norbert Elias, cette répression des jeux populaires, et plus globalement la généralisation du « contrôle des affects » dans les différentes sphères sociales des individus, est intimement liée à l’apparition de structures étatiques centrales fortes lors de la Renaissance, cherchant à acquérir le monopole de la violence physique [31. Norbert Elias, La Civilisation des mœurs, Pocket, 2011 p. 514.]. Les jeux de football sont cependant si enracinés dans les cultures populaires que ces interdictions, émanant d’un pouvoir vertical, monarchique ou ecclésiastique, n’affectent que faiblement les pratiques de jeu.

Néanmoins, en Angleterre comme en France, seigneurs et notables locaux appréhendent progressivement le ballon rond comme un instrument de pouvoir de proximité supplémentaire servant à marquer de façon ostentatoire leur domination sur leurs sujets, tout en contenant les potentiels débordements inhérents à la pratique du folk football. Pour ces gentilshommes, une telle annexion des jeux du peuple participe également à faire émerger ou à consolider divers pouvoirs locaux difficilement contrôlables par des États qui cherchent alors en Europe à se centraliser [32. Patrick Vassort, ouvr. cité.]. En France, la soule bretonne se transforme ainsi du XVe siècle à 1789 en un droit féodal, une obligation que les paysans, le plus souvent le dernier marié de l’année, doivent rendre à leurs seigneurs. Dans le Morbihan, à Caden, le dernier marié devait au seigneur de Bléheden une « soule de cuir neuf avec un pot de vin et un couple de pain ». La soule était lancée le lendemain de la Saint-Michel, par le seigneur ou son représentant, et la femme du dernier homme marié était « tenue de dire une chanson à danser lorsque la dite soule est jetée pour commencer [33. Sports en Morbihan, des origines à 1940, Archives départementales de Vannes éd.] ».
Si le jeu de soule perdure bon an mal an dans le nord-ouest de la France au XIXe siècle voire au début du XXe, le Second Empire marque un tournant en termes de développement des moyens de répression locale, telle la gendarmerie à cheval, responsable de l’interruption de nombreuses parties de soule [34. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. Mais c’est surtout le processus d’individualisation de la propriété agraire et l’exode rural qui mettent fin à la pratique du jeu. Les sociabilités paysannes, liées à la production agricole communautaire, s’effritent, en même temps que les terres et pâtures collectives où pouvaient se pratiquer le jeu sont privatisées [35. Idem.] : la fin de la soule en France signe l’entrée des communautés paysannes dans la révolution industrielle.
Un football sous enclosures
Outre-Manche, la décapitation du roi Charles 1er Stuart en 1649 et l’instauration par Olivier Cromwell d’une expérience « républicaine » qui s’achèvera en 1660, mettent à mal l’hégémonie culturelle et spirituelle de l’Église. Comme l’analyse l’historien britannique Edward P. Thompson : « Les relations sociales, les relations de loisirs, même les rites de passage, ne sont plus sous le contrôle et la domination du clergé. […] Au XVIIIe siècle, il y a rupture avec l’Église : les jours fériés augmentent, atteignant jusqu’à deux ou trois jours par semaine. On se livre à des exercices sportifs brutaux, à des ébats sexuels, on boit beaucoup, tout ceci échappant complètement au contrôle du clergé ou des puritains, et étant laissé au seul contrôle des cabaretiers qui vendent de la bière [36. Edward P. Thompson, « Modes de domination et révolutions en Angleterre », Actes de la recherche en sciences sociales, nos 2-3, juin 1976, p. 140-141.]. » Si les campagnes britanniques sont traversées aux XVIIe et XVIIIe siècles par une déferlante de festivités populaires, une autre vague de fond vient bouleverser ces territoires ruraux : les enclosures.
La production agricole reposait essentiellement, à l’échelle villageoise, sur la collectivisation de terres céréalières et de biens fonciers publics, les commons – essentiellement des forêts, des landes, des pâturages et des marais – et sur une exploitation communautaire. Mais à la fin du Moyen Âge, dans le Surrey et le Kent, apparaissent les premières enclosures, c’est-à-dire la mise sous clôture de parcelles agricoles. Ce système permet de rationaliser le système agraire : de grands champs céréaliers collectifs sont transformés en surfaces individualisées ensuite converties en pâturages à moutons et cultures fourragères beaucoup plus rentables. Les enclosures prennent une ampleur soudaine à partir du XVIIe siècle, touchant dès lors le quart des terres cultivables du pays [37. Eric John Hobsbawm, Histoire économique et sociale de la Grande-Bretagne. Tome 2 : de la révolution industrielle aux années 1970, Seuil, 1977, p. 92. ]. Elles se muent en un instrument de concentration agricole au profit des propriétaires terriens. L’accaparement des terres communalisées au profit de la bourgeoisie rurale soutient la montée en puissance politique de cette dernière. En effet, la révolution puritaine britannique qui renversa les Stuarts a pour conséquence l’avènement en 1688 d’une monarchie constitutionnelle consolidant le rôle de la Chambre des communes. Le régime parlementaire s’efforce de satisfaire les intérêts des propriétaires terriens [38. Ibid., p. 93.], en affermissant le droit d’acquisition et la propriété privée : entre 1727 et 1815, les propriétaires terriens feront ainsi voter au Parlement plus de 5 000 Enclosure Acts, accélérant le processus de division parcellaire des terres en exploitations privées [39. Ibid., p .92.].

L’effondrement des pouvoirs féodaux et ecclésiastiques ainsi que l’accaparement légal des terres participent à faire émerger dans les campagnes une véritable bourgeoisie agraire : la landed gentry. Au XVIIe et XVIIIe siècles, ces propriétaires fonciers, négociants-meuniers et grands fermiers capitalistes ne se considèrent pas comme des collecteurs de rentes passifs à la vieille morale pétrie de devoir et d’abnégation, mais comme des entrepreneurs férus de progrès, favorisant l’innovation agricole, et affichant délibérément leur recherche assidue du profit. Cette bourgeoisie exerce son hégémonie sur la société rurale britannique grâce à un mode de domination bien distinct du pouvoir vertical de droit divin : il s’incarne par le biais d’un contrôle de proximité de la population, lequel se traduit notamment par une attention toute paternaliste aux réjouissances populaires.
La landed gentry encourage en effet l’effervescence festive en organisant des jeux, offrant des prix ou un bœuf à rôtir à chaque événement. Elle accorde son patronage aux parties de folk football, certains gentlemen s’amusant même à participer au jeu, simulacre d’une bourgeoisie qui se rapproche de son peuple et qui aime s’encanailler à ses côtés. Dans une société mieux régulée et pacifiée grâce au parlementarisme et à l’instauration de l’habeas corpus – mettant fin aux arrestations arbitraires dès 1679 –, la gentry ne veut plus des pratiques ludiques synonymes de débordements rebelles et de violences physiques.
Rationaliser pour mieux gouverner
Comme en France, la privatisation des terres va graduellement mettre fin aux jeux populaires de football dont les terrains de jeu, extensibles, détruisent le capital agricole et menacent directement les intérêts économiques de la landed gentry. Parallèlement, dans leur quête permanente de rendements et de bénéfices, la bourgeoisie agraire généralise les enclosures sur l’ensemble des friches, forêts et pâturages communaux du pays. Progressivement, les communautés paysannes se désintègrent et se voient dépossédées tout autant de leurs terres que de leur jeu de ballon, vidé de sa fonction sociale originelle. Comme on rationalise l’espace rural en parcelles agricoles à la productivité accrue, le football doit désormais avoir son espace alloué. La gentry autorise alors des jeux de football sous contrainte, pratiqués par des équipes plus restreintes (une trentaine de joueurs) avec des buts matérialisés, sur un terrain réduit et équitablement divisé.
La monopolisation de la violence par les institutions centrales, mais aussi le parlementarisme comme mode de gestion du pouvoir, préfigurent alors le football moderne. Au même titre qu’à la Chambre des communes, whigs (libéraux) et tories (conservateurs) s’affrontent de part et d’autre au sein d’une salle équitablement divisée en deux et sont soumis à la régulation d’un président de séance, le football se joue désormais sur un terrain clos, aux camps symétriques et sous contrôle d’une autorité supérieure [40. Norbert Elias et Eric Dunning, Sport et Civilisation. La violence maîtrisée, ouvr. cité.].

Au début du XIXe siècle, dans les villes d’Angleterre, l’émergence des premières forces de police – notamment les Watch Committees, polices locales créées en 1835 –, les restrictions spatiales liées à l’industrialisation galopante du pays et le peu de temps libre des premiers ouvriers des manufactures mettent un terme aux pratiques populaires urbaines de folk football. « Les pauvres ont été dépossédés de tous leurs jeux, tous leurs amusements, toutes leurs réjouissances », écrit alors en 1842 un envoyé spécial du Times à Liverpool. En parallèle, le Highway Act, voté en 1835, stipule que les jeux de football sont interdits dans les rues des villes et doivent, dans les champs, se pratiquer dans des espaces délimités. En 1844, un homme du clergé du Suffolk écrit alors à propos des paysans dépossédés de leurs terres comme de leur jeu : « Ils n’ont pas de prairies ou de communaux pour pratiquer les sports. On m’a dit qu’il y a trente ans, ils avaient droit à un terrain de jeu dans un terrain particulier, à certaines saisons de l’année, et qu’ils étaient alors célèbres pour leur football ; mais d’une façon ou d’une autre, ce droit s’est perdu et le champ est maintenant labouré [41. Eric John Hobsbawm, ouvr. cité, p. 93.]… »
« Participer à un match, c’est pas une blague, je peux te le dire.
C’est autre chose que les jeux de ton école privée.
On a vu des clavicules se briser en deux, une douzaine d’élèves ont été estropiés.
L’année dernière, un copain de classe a eu ses deux jambes cassées. »
Thomas Hugues, Tom Brown’s School Days, 1857
À la fin du XVIIIe siècle, les public schools [42. Système d’éducation privé et élitiste fondé à partir du XIVe siècle et initialement réservé à la noblesse britannique. Les public schools accueillent généralement les élèves âgés de 13 à 18 ans.] britanniques sont agitées par de fréquentes insurrections d’élèves. Ainsi, « la célèbre révolte d’Eton en 1768 fut suivie par cinq graves rébellions à Winchester, entre 1770 et 1818. En 1770, certains élèves étaient armés de pistolets et en 1793, ils dépavèrent une cour et portèrent les pierres au sommet d’une tour pour défendre leur bastion, lors d’un conflit à propos de la discipline imposée par un prefect et autres “petites misères” . » Ces rébellions scolaires se propagent à d’autres public schools : « À Harrow, en 1771, quand la candidature du Dr Parr au poste de directeur échoua, les élèves, qui l’avaient soutenu, attaquèrent le bâtiment où les administrateurs se réunissaient et détruisirent la voiture de l’un d’entre eux. L’ordre ne fut pas restauré avant trois semaines. Eton et Harrow connurent d’autre révoltes, tout comme Charterhouse, Merchant Taylors’ et Shrewsbury. Rugby eut ses révoltes dans les années 1780 [43. Lawson John et Silver Harold, A Social History of Education in England, Methuen Ed., 1973.]. » Au sein de ces institutions pédagogiques aristocratiques, les valeurs inculquées à la future élite du royaume étaient pour le moins féodales : le courage, la capacité à supporter la douleur et la loyauté étaient les principales obsessions moralisatrices des éducateurs [44. James Walvin, ouvr. cité, p. 32.]. Mais si les autorités scolaires s’adonnaient aux flagellations et autres sévices corporels sur leurs pensionnaires, elles avaient le plus grand mal à maintenir l’ordre dans leurs établissements.
En parallèle de leurs activités scolaires émeutières, les élèves consacraient une grande part de leur temps libre à diverses formes de folk football, directement inspirées des jeux de ballon populaires encouragés par leurs pairs, les landlords et la gentry rurale. Chaque public school pratiquait son propre style de football. Certains jeux consistaient à se faire passer la balle entre coéquipiers jusqu’aux buts comme à Rugby dès 1823. D’autres, qualifiés de dribbling game, consistaient pour l’essentiel à donner de grands coups de pied au ballon jusque dans le camp adverse.

Dépitées par la violence de ces parties de football, les autorités scolaires s’efforcèrent, souvent sans succès, d’interdire les jeux organisés par les élèves. Le wall game, un football rituel qui opposait externes et pensionnaires d’Eton, fut interdit de 1827 à 1836. Samuel Butler, directeur de la public school de Shrewsbury de 1798 à 1836, condamna dans son institution le football qui, selon lui, « convenait davantage aux garçons de ferme et aux travailleurs manuels qu’à de jeunes gentlemen [45. Holt Richard, Sport and the British, a Modern History, Oxford University Press, 1989.] ».
Godliness & good learning
L’avènement de la révolution industrielle oblige cependant les public schools à adopter un nouveau régime pédagogique, dans le but de former des gentlemen prompts à prendre en main l’essor du capitalisme industriel et colonial britannique. L’indiscipline qui régnait dans les établissements scolaires, le mode de vie quotidien empreint de violence des élèves et leurs révoltes récurrentes devenaient incompatibles avec les nécessités sociales et économiques qu’exigeait l’émergente société victorienne.
À partir de 1830, un profond mouvement de réforme morale est initié par le révérend Thomas Arnold, headmaster du collège de Rugby de 1828 à 1842. Ce dernier, ainsi que toute une génération de nouveaux directeurs et professeurs, est un fervent disciple des Muscular Christians, une association fondée par un chanoine anglican peu après la bataille de Waterloo en 1815 [46. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. Inspirés par la renommée de la gymnastique allemande suite aux succès militaires prussiens lors des guerres napoléoniennes, les Muscular Christians théorisent les bienfaits pédagogiques et moraux des exercices physiques. Appuyé par tout un réseau de réformateurs, tel Benjamin Hall Kennedy, headmaster de Shrewsbury de 1836 à 1865, Thomas Arnold ambitionne alors de purger les écoles de ses traditions les plus archaïques [47. James Walvin, ouvr. cité, p. 36.]. Il met en place un régime pédagogique rigoureux, plus porté vers la moralité chrétienne et le savoir, le godliness and good learning – « piété et bon apprentissage [48. Idem.] ». Arnold ouvre également les portes de son établissement aux enfants de la bourgeoisie marchande qui, avec les jeunes aristocrates, sont destinés à conduire la révolution industrielle en marche et deviennent les sujets d’une nouvelle éducation au code moral des plus stricts.

Les Muscular Christians conçoivent les activités physiques comme source de discipline et de tempérance [49. Holt Richard, ouvr. cité.]. Le courant pédagogique piloté par Thomas Arnold se penche en conséquence sur les jeux pratiqués à l’initiative des élèves. Préoccupés par la violence et la brutalité de ces divertissements ludiques, les réformateurs des public schools et les éducateurs formés par Arnold, plutôt que de s’évertuer en vain à interdire les jeux de football, décidèrent de les intégrer pleinement dans les enseignements. Ils laissent alors dans un premier temps les élèves seniors auto-organiser leurs jeux, légitimant par là même la pratique estudiantine culturelle des jeux de football. Cependant, les tenants de la pédagogie disciplinaire des Muscular Christians instrumentalisent rapidement la principale source de désordre et de violence dans les établissements scolaires pour en faire en outil de contrôle des élèves. Agissant par opportunisme pédagogique, les éducateurs réformateurs décèlent dans ces jeux de nouvelles pratiques corporelles que l’on peut codifier pour mieux discipliner les élèves sujets à l’insurrection et inscrire dans leurs corps le principe de la loi [50. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.]. « Je préfère que mes élèves jouent vigoureusement au football plutôt qu’ils emploient leurs moments de loisirs à boire, se saouler ou se battre dans les tavernes de la ville », affirme Thomas Arnold [51. Bernard Andrieu, « La fin du fair-play ? Du “self-goverment” à la justice sportive », Revue du MAUSS, 3 août 2011.].
« Le sang véritable des public schools »
Les premières règles de jeux de football, destinées à atténuer la brutalité endémique des pratiques physiques, sont formalisées aux alentours de 1840 [52. James Walvin, ouvr. cité, p. 38.]. Les surfaces sur lesquelles on s’adonne au ballon rond influent sur sa codification rigoureuse. À Rugby, où l’on joue sur un terrain souple, on normalise en 1846 un jeu qui autorise la prise du ballon à la main – le handling –, en 37 règles. Les sols durs d’Eton favorisent le développement du dribbling game et l’usage des mains pour porter le ballon ou pour arrêter l’adversaire y est proscrit en 1849. Quant à la Westminster School, elle met en place les premières feuilles de matchs dès 1854 [53. Idem.]. Les jeux de football prennent rapidement une place prépondérante au sein de la vie quotidienne des élèves des public schools : ils deviennent l’activité physique pratiquée en hiver, l’été étant dédié au cricket. Ainsi, dans son roman autobiographique publié en 1857, Tom Brown’s School Days, l’ancien school boy Thomas Hugues décrit déjà une vie scolaire passée sur les terrains de jeux de Rugby où il se consacre assidûment au football de son école afin de contrer le harcèlement d’un élève plus âgé et plus fort que lui [54. Paul Dietschy, Histoire du football, Perrin, 2010.].
Les footballs des public schools se voient progressivement parés de toutes les vertus pédagogiques. La pratique du ballon rond, sur un espace spécialement mis à disposition par l’école et dans le respect des règles validées par les autorités éducatives, pouvait occuper de nombreuses heures les élèves durant leur temps libre, alors moins portés sur les insurrections. Mais il forgeait également le caractère des hommes indispensables au développement de l’Empire britannique et de son industrie triomphante, en véhiculant sur les terrains de jeux autant l’esprit d’initiative que la discipline et le self-government. La pratique des jeux physiques codifiés devient quasi obligatoire sur l’ensemble des public schools – dès 1853, le Marlborough College les introduira dans son cursus scolaire [55. Nicolas Bancel et Jean-Marc Gayman, ouvr. cité.] – et des professeurs y sont spécialement dédiés. Dans certaines écoles, avoir été éducateur physique est désormais un préalable pour pouvoir prétendre à leur direction [56. Daniel Denis, « Aux chiottes l’arbitre », Politique Aujourd’hui, no 5, 1978, p. 12.]. Le Muscular Christian Hely Hutchinson Almond, directeur de la Loretto School de 1862 à 1903, affirme quant à lui déceler dans le football et le cricket un ensemble de pratiques pour former les futures classes dominantes à la compétition économique : « Les jeux dans lesquels le succès dépend de l’union des efforts de plusieurs, et qui cultivent le courage et l’endurance, sont le sang véritable du système des public schools [57. J. A. Mangan, Athletism in the Victorian and Edwardian Public School. The Emergence and Consolidation of an Educational Ideology, Cambridge University Press, 1981, p. 57.]. »
Un sport industriel
Dès la fin des années 1840, les jeux de football s’évadent des public schools grâce à la fondation des premiers clubs universitaires, à l’initiative des anciens élèves alors devenus étudiants. L’extension du réseau ferroviaire britannique entraîne la multiplication des parties de jeux entre équipes universitaires ou entre public schools et permet d’organiser les premières compétitions d’envergure régionale. Mais l’inextricable diversité des règles de jeu propre à chaque établissement vient freiner l’ambition de ces rencontres autour du ballon rond. En 1848, à l’université de Cambridge, quatorze anciens élèves de Harrow, Eton, Rugby, Winchester et Shrewsbury se réunissent le temps d’une après-midi, dans une simple chambre d’étudiant, et s’escriment à unifier les règles des jeux de football : « Il en résultait une terrible confusion, car chacun jouait selon les règles propres à sa public school, se rappelle un des protagonistes de cette rencontre. Je me souviens comment un [footballeur] d’Eton gueula sur un ancien élève de Rugby à propos de la possibilité de prendre le ballon à la main. […] Chacun apporta une copie de ses règles du jeu, ou bien les connaissait par cœur, et nos avancées dans l’unification de nouvelles règles furent fastidieuses.[…] Notre réunion ne prit fin qu’aux alentours de minuit [58. James Walvin, ouvr. cité. p. 46.]. »
Cette première standardisation du football, dénommée « Règles de Cambridge », oriente le jeu vers le dribbling game, occultant la pratique du handling chère aux élèves de Rugby, et démocratise considérablement le football à travers les campus universitaires du pays. Des clubs non scolaires et uniquement dédiés au ballon rond voient alors le jour. Mais le football moderne prend véritablement naissance le 26 octobre 1863 à la Freemasons’ Tavern de Londres. Les délégués de onze clubs de la capitale et de la banlieue entreprennent de structurer administrativement le football et d’en fixer des règles définitives en s’appuyant sur celles de Cambridge.

La Football Association est officiellement constituée le jour-même, mais d’âpres débats font alors rage au fil des séances à propos de l’usage des mains lors du jeu ou de la survivance de certaines pratiques jugées par certains trop violentes. Deux mois plus tard, quatorze articles définissent autant les dimensions maximales du terrain que les règles pour le coup d’envoi, le marquage d’un but ou encore la touche. Si l’interdiction du hacking (coup de pied dans le tibia) et du tripping (croc-en-jambe) réduit la brutalité physique sur les terrains, le jeu reste essentiellement un football de dribble, rude et individualiste, propre à la combativité promue par les gentlemen. Le hors-jeu est introduit dès 1866 afin d’encourager les passes entre coéquipiers et, en 1881, apparaît dans la codification du jeu la figure toute puissante de l’arbitre, l’homme en noir – la couleur des clergymen – chargé de faire respecter les règles de la Football Association sur le terrain. Le divorce avec les anciens élèves de Rugby, adeptes du handling, est quant à lui définitivement consommé, et ces derniers constitueront la Rugby Football Union en 1871, premier pas vers l’élaboration du rugby moderne. La codification rigoureuse des règles de jeu de ballon, l’apparition des premiers clubs, la création d’une fédération (la Football Association) ainsi que l’organisation des premières compétions transforment le dribbling game en véritable sport moderne [59. Norbert Elias et Eric Dunning, ouvr. cité.], le football-association, que l’on dénomme ainsi pour le distinguer de son proche cousin, le rugby-football.
La Football Association se drape dès lors des traits les plus manifestes de la révolution industrielle – au même titre que les autres sports modernes qui se normalisent en ce temps-là, tels le cricket, le rugby ou encore le tennis. Ses règles standardisées permettent au plus grand nombre de reproduire un même corpus de pratiques corporelles au sein d’un espace-temps rationalisé. La spécialisation des joueurs et des postes au sein de l’équipe met en scène la division du travail nécessaire à la société industrielle. L’organisation du jeu sous l’œil de l’arbitre, figure tutélaire qui impose sa loi, incarne la discipline et l’esprit d’initiative nécessaires à une même finalité de production : marquer des buts [60. Patrick Mignon, La Passion du football, Odile Jacob, 1998.]. Les premiers compte-rendus de match dans la presse empruntent quant à eux au vocabulaire industriel pour décrire les parties ; les équipes sont des « machines bien huilées », les joueurs ont des jambes tels des « pistons » ou se transmuent en « dynamos » qui tirent des « coups de masse [61. Holt Richard, ouvr. cité.] ».
Tacler l’hégémonie bourgeoise
La morale bourgeoise introduit également dans le football et plus généralement au sein des sports modernes l’éthique du fair play. Issu tout droit du code de l’honneur chevaleresque qui combinait art de la guerre et art de la courtoisie [62. Sébastien Nadot, Le Spectacle des joutes. Sport et courtoisie à la fin du Moyen Âge, Presses Universitaires de Rennes, 2012.], le fair play est intrinsèque aux sociétés aristocratiques pour lesquelles, comme le décrit l’historien Johan Huizinga dans son essai sur le jeu, « il ne peut être question de victoire que […] lorsque l’honneur du chef sort accru du combat » ou encore que « le vainqueur sait faire preuve de modération » [63. Johan Huizinga, Homo ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, Gallimard, 1972, p. 162.]. La beauté du geste, l’honneur individuel, le contrôle de soi et la retenue dans le jeu doivent primer sur la victoire. Le fair play, prônant le respect à la fois des règles, de l’adversaire et du résultat final du match [64. Bernard Andrieu, « La fin du fair-play ? Du “self-goverment” à la justice sportive », art. cité.], devient avec la naissance des sports modernes, un « entraînement au comportement moral sur le terrain de jeu transférable à l’ensemble du monde [65. McInstosh Peter, Fair-Play: Ethics in Sport and Education, Heineman, 1979, p. 27.] ». Les classes dominantes anglaises, en rationalisant le ballon rond en sport moderne, assujettissent ainsi le football en instrument pédagogique au service de l’Empire britannique, mais aussi en nouvelle forme de sociabilité pour gentlemen.

Dès 1867, grâce à l’unification des règles par la Football Association, apparaissent les premiers championnats inter-comtés qui opposent les clubs des anciens élèves des public schools. La fédération sportive organise à partir de 1872 la Football Association Cup – ou Coupe d’Angleterre de Football – qui réunit alors quinze clubs de gentlemen, et dont le règlement fixe la durée du match à 90 minutes et le nombre de joueurs par équipe à onze. Le maillage des clubs s’accroît rapidement : si on compte 50 clubs affiliés à la Football Association en 1871, on en dénombre 1 000 dès 1888 [66. Paul Dietschy, ouvr. cité.]. Une véritable régularité des compétitions avec l’établissement d’un calendrier des matchs ainsi que la comptabilité des résultats sous la forme de classements [67. Alfred Wahl, Les Archives du football. Sport et société en France (1880-1980), Gallimard-Julliard, 1989.] s’instaurent, permettant de valoriser les équipes les plus victorieuses et d’engendrer les premières vedettes du football.
Si, depuis sa création dix ans auparavant, la Cup est remportée par des clubs de gentlemen, la finale de 1883 opposant les Old Etonians, menés par l’exubérant aristocrate Lord Kinnaird, au Blackburn Olympic marque un tournant dans l’histoire du football. Pour la première fois, une équipe uniquement composée d’ouvriers gagne la Cup. Le but de la victoire marqué par les Blackburns signe alors tout autant la fin de l’hégémonie bourgeoise sur le ballon rond que les prémices de la popularisation du football.
En moins de trente ans, le football devient un trait fondamental de la culture de classe ouvrière britannique. Il s’exporte à travers la planète grâce à la domination géographique et économique de l’Empire britannique. Édouard Pontié, rédacteur en chef de l’hebdomadaire sportif français Armes et Sports écrit ainsi dès 1900 : « Tout le Vieux Continent a des équipes de football. […] L’Allemagne et l’Autriche, comme les pays bohèmes et hongrois, ont adopté le jeu, la Suisse a fait de même, l’Italie a de bonnes équipes à Turin, à Milan, à Rome et à Naples ; l’Espagne enfin s’intéresse au mouvement avec Madrid et Barcelone. Les soleils d’hiver n’éclaireront bientôt plus partout que des joueurs de football. »

by Mickaël Correia | 22 décembre 2017 | Contrôle continu, Terrains vagues
Photographies de ValK
« Zone en état de siège permanent », « caches d’armes à feu » voire « risque de morts ». Depuis la remise au gouvernement du rapport sur le projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes le 13 décembre dernier, la même rengaine d’une ZAD aux mains de « professionnels de la contestation » qui piétine l’ordre républicain revient sur le devant de la scène médiatique. À l’heure qu’il est, tout reste encore possible : abandon du projet par le gouvernement, expulsion des occupant·es, ultime report d’une décision presque impossible. Entretien long format avec des occupant·es de la ZAD sur les derniers mois du mouvement et les perspectives de lutte, aussi réjouissantes que périlleuses.
Télécharger l’article en PDF.
En juin dernier, le Premier ministre Édouard Philippe nommait deux médiateurs et une médiatrice pour émettre dans les six mois un rapport quant au projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Qu’est-ce qui a conduit le pouvoir à cette décision alors que le gouvernement précédent annonçait régulièrement le démarrage imminent des travaux sur la ZAD ?
2016 a été une longue séquence de menaces et d’offensives de la part du gouvernement Hollande pour se donner la possibilité d’intervenir sur la ZAD – c’est-à-dire expulser les occupant·es et démarrer les travaux.
En décembre 2015, durant la COP 21, nous avons organisé un convoi de trois cents personnes en vélos et tracteurs avec des paysan·nes, des militant·es associatif·ves, des habitant·es de la ZAD, des gens de la Coordination des opposants au projet d’aéroport et des comités locaux de soutien. Malgré les interdictions de circuler et l’état d’urgence qui venait d’être promulgué, l’objectif était de se rendre à Paris pour dénoncer l’opération de marketing écologique du gouvernement, qui poursuit ses projets éminemment climaticides. Comment pouvait-il s’engager en faveur de l’environnement alors que les travaux pour le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes étaient annoncés, promettant de détruire zones humides et terres agricoles ?
Suite à cette mobilisation, le 31 décembre, Vinci décide de mettre en procédure d’expulsion les habitant·es dits « historiques » de la ZAD. La multinationale touche alors un symbole fort, car on parle des paysan·nes qui sont resté·es sur la zone malgré ses propositions de reprendre leurs terres .
Depuis 2012 et l’échec de l’opération César [2. En octobre 2012, l’État lançait l’opération César, une mobilisation massive des forces de l’ordre afin d’évacuer les occupant·es de la ZAD. Après plusieurs semaines d’expulsions, de réoccupations et de résistances, l’opération policière se solde par un cuisant échec.], l’État n’arrive pas à expulser la ZAD, car il s’est formé un front commun et solidaire anti-aéroport qui va des occupant·es, qui ont des pratiques d’action directe voire illégales, jusqu’aux militant·es associatif·ves, qui mobilisent les recours juridiques pour tenter de contrer légalement le projet. La stratégie du pouvoir est alors de créer des brèches dans cette unité via un biais vicieux : l’argent. Comme le gouvernement sait que les « historiques » ne partiront pas d’elleux-mêmes, il demande à la justice d’ajouter des astreintes financières aux procédures d’expulsion. Tou·tes ces habitant·es expulsables qui ont là leurs vaches, leur maison, leurs emprunts, se sont ainsi retrouvé·es sommé·es de payer chaque jour des amendes phénoménales.

En à peine dix jours, une manifestation de soutien est organisée. Vingt mille personnes, des centaines de cyclistes et quatre cents tracteurs bloquent le périphérique de Nantes le 9 janvier 2016, jour des soldes. Les paysan·nes de Copain [3. Le Collectif des organisations professionnelles agricoles indignées par le projet d’aéroport. Le Copain est composé de la Confédération paysanne 44, du Civam, du Groupement des agriculteurs biologiques 44, de Terroirs 44, d’Accueil paysan et de Manger bio 44.] enchaînent même soixante tracteurs sur le pont de Cheviré (un axe majeur pour accéder à la ville) afin d’obtenir l’abandon des expulsions. Ils y resteront jusque tard dans la nuit avant de se faire expulser par la police.
Le 25 janvier, le juge valide les expulsions des habitant·es « historiques », mais ne prend pas en compte les astreintes financières. Et c’est à ce moment-là que Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, annonce ses craintes d’un conflit violent sur la ZAD, où l’on voit des reportages télévisés effarants sur les dangereux « zadistes », et où Bruno Retailleau, le président de la Région (un Républicain proche de François Fillon), achète avec l’argent public des pages dans la presse locale pour promouvoir une pétition demandant l’évacuation de la ZAD.
Les travaux étant censés démarrer en mars 2016, soixante mille personnes viennent le 27 février occuper les quatre-voies autour de la ZAD. Une tour de guet de dix mètres de haut est construite à l’endroit même où sont censés commencer les premiers travaux. C’est une des plus grosses mobilisations du mouvement, un geste qu’avait pressenti le gouvernement qui, une semaine avant, renonce finalement à démarrer les travaux.
C’est à cette période qu’on voit poindre une nouvelle stratégie de la part de l’État…
En effet, toujours au mois de février, François Hollande sort de son chapeau l’idée d’organiser un référendum local, afin de faire croire que les gens vont pouvoir décider eux-mêmes. Un véritable piège pour nous, car rien ne semble plus honnête, légitime et démocratique qu’un référendum… Cette annonce aurait pu créer des tensions politiques au sein du mouvement : pour une partie des anti-aéroports, déjà désabusé·es par les processus démocratiques, il était évident qu’il fallait boycotter cette initiative. Les associations, quant à elles, voyaient bien l’arnaque politique, le jeu de dés pipés – qui a les moyens de faire campagne ? qui organise le scrutin ? –, mais certaines d’entre elles voulaient en profiter pour sensibiliser l’opinion publique quant à l’absurdité du projet d’aéroport.
Le 26 juin 2016 au soir, alors que le « oui » au projet d’aéroport l’emporte à 55 % et que les journalistes s’attendent à voir une ambiance de défaite à la Vache-rit – lieu d’assemblée du mouvement sur la ZAD –, occupant·es, habitant·es, paysan·nes et retraité·es hurlent en boucle « Résistance ! ». Une façon d’exprimer la joie d’avoir réussi collectivement à échapper à ce piège et d’assumer qu’ensemble, malgré nos différentes cultures militantes, nous ne nous plierons plus à ces pratiques faussement démocratiques.
Le Premier ministre Manuel Valls avait promis qu’à la suite de cette consultation, les expulsions interviendraient dès le début de l’automne. Alors que chaque semaine, à l’Assemblée nationale, un·e député·e différent·e interroge le Premier ministre quant à l’avancée du projet d’aéroport, l’enjeu pour nous est de montrer qu’en cas d’expulsion, un nombre incroyable de personnes seraient prêtes à se mobiliser pour défendre physiquement la ZAD.
Le 8 octobre 2016, une grande manifestation contre l’expulsion de la ZAD est mise sur pied, avec l’idée que tous les anti-aéroports viennent avec un bâton à la main. Ce bâton, c’est celui des marcheur·ses, des berger·es, des militant·es du Larzac, mais aussi un clin d’œil à Michel Tarin, un paysan syndicaliste et figure historique de la lutte contre l’aéroport. Avant de décéder en 2015, il avait déclaré : « Si un jour les forces de l’ordre reviennent sur la ZAD, moi je serais là face à la police avec mon bâton. » L’objectif de la manifestation du 8 octobre est donc de venir planter un bâton sur la ZAD et de « prêter serment » qu’on reviendra le déterrer pour défendre la zone en cas d’expulsion. Un geste fort de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont affirmé une capacité à résister physiquement. Cette symbolique met à mal le discours du gouvernement qui communique sur l’image d’opposant·es respectables débordé·es par deux cents squatteur·euses violent·es.

Suite à cette journée des bâtons, le pouvoir a repoussé semaine après semaine l’éventuelle expulsion. C’est une période de stress et de vigilance intense pour le mouvement, avec ses discussions tactiques, les rumeurs les plus folles de CRS prêts à déferler sur la ZAD, l’organisation de la communication interne ou encore la mise sur pied de barricades pour contrôler les points d’entrée sur la zone. Manuel Valls avait promis qu’il expulserait avant la fin de l’automne, mais sa démission en décembre 2016 pour se présenter aux primaires de gauche a finalement mis à mal ses velléités d’expulsion. Avec la période électorale, le gouvernement socialiste ne peut plus prendre de risque avec ce dossier sensible.
Dès le mois de mai 2017, l’élection d’Emmanuel Macron sème le trouble dans le mouvement, dans le sens où ce projet d’aéroport a toujours été historiquement porté par les vieux caciques de gauche et de droite. Et Macron sent bien qu’il ne va pas pouvoir s’en sortir au vu des échecs de ses prédécesseurs : d’une certaine façon, lui aussi joue sa crédibilité politique avec ce délicat projet d’aéroport. Il décide ainsi de nommer une commission de médiation, et nomme Nicolas Hulot au gouvernement comme ministre de l’Environnement, plutôt anti-aéroport.
On débouche donc sur cette situation ubuesque : un an après une consultation locale considérée par le pouvoir comme légitime, le gouvernement annonce former une commission afin de réexaminer l’ensemble du dossier dès juin 2017. Cette décision consterne les pro-aéroports, car ils se retrouvent face à des médiateurs et médiatrice plutôt sceptiques face au projet de Notre-Dame-des-Landes [4. Les deux médiateurs et la médiatrice sont Anne Boquet, une ex-préfète de région, Michel Badré, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et Gérald Feldzer, un proche de Nicolas Hulot, ancien conseiller régional Europe Écologie-Les Verts en Île-de-France.]. Un comble, puisque depuis des années, les pro-aéroports sont aux commandes du projet à l’instar de Bernard Hagelsteen, le préfet qui a signé la Déclaration d’utilité publique (DUP) en 2008 ou de Nicolas Notebaert, conseiller du ministre des Transports sous le gouvernement Jospin de 2001 qui a relancé le projet – deux personnes qui ont été quelques temps plus tard embauchées comme cadres par Vinci !

Quel regard porte l’ensemble du mouvement anti-aéroport sur cette médiation ? Suite à la remise du rapport le 13 décembre dernier au gouvernement, existe-t-il un espoir que le projet soit définitivement abandonné ?
Notre-Dame-des-Landes n’est pas un conflit qui est lié à des questions d’expertises techniques et objectives, mais bien un conflit éminemment politique entre deux visions du monde : celle de la croissance et du développement économique à tout prix d’un côté, et de l’autre, celle qui considère qu’il faut arrêter cette machine de destruction du vivant pour vivre, habiter et produire autrement.
Aux yeux des occupant·es, l’objectif de cette médiation est de gommer la dimension politique du projet et de faire croire qu’une série d’expert·es neutres ont analysé l’impact sonore, environnemental et agricole de l’ancien et du nouvel aéroport, la possibilité de réaménager ou non les pistes à Nantes-Atlantique ou de ne faire qu’une piste à Notre-Dame-des-Landes. Comme si l’abandon ou la reprise du projet étaient liés à des considérations purement techniques. En même temps, si le gouvernement décide de ne pas réaliser l’aéroport, il se cachera derrière ce vernis de l’expertise pour dire que l’État ne s’est pas plié à quarante ans de résistance anti-aéroport.
Alors, évidemment il y a de l’espoir, car nous avons un ministre de l’Environnement qui est depuis longtemps opposé au projet et des médiateurs et médiatrices qui ont l’air de vouloir rouvrir sérieusement le dossier. Pour une partie du mouvement, cette expertise sert aussi à dévoiler l’arnaque de la DUP, une escroquerie technique qu’essayent de mettre à jour certains anti-aéroports depuis des années. La possibilité d’abandon du projet est donc quand même palpable, mais le point épineux dans ce dossier, c’est les occupant·es. Les médiateurs et la médiatrice préconisent en effet le « retour à l’état de droit » et l’évacuation de la ZAD « quelle que soit l’option retenue ». Position partagée par le gouvernement depuis le début de la médiation.
De notre côté, si chaque composante du mouvement a été interrogée indépendamment par la médiation sur des points précis du projet (les paysan·nes sur la destructions des terres agricoles par exemple), il a été décidé en assemblée que dès que l’on serait interrogé sur l’avenir de la ZAD, on dialoguerait de façon collective via une délégation représentant le mouvement, c’est-à-dire l’ensemble de ses composantes : l’Acipa, l’Adeca [5. Respectivement, l’Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, créée en 2000, et l’Association de défense des exploitants concernés par l’aéroport, fondée en 1973. ], Copain, les Naturalistes en lutte, les occupant·es.
Nous voulons en effet démontrer que la ZAD n’est pas un campement de squatteurs et squatteuses activistes, mais que 270 hectares de terres sont occupées et cultivées durablement, que ce soit en maraîchage, apiculture, céréales ou élevage, sans compter les projets de transformation annexes comme la meunerie, les deux boulangeries ou la conserverie. De même, les occupant·es ont mis en place un journal hebdomadaire, une bibliothèque, un studio hip-hop, une radio, des cours de danse ou d’escalade, un atelier-garage, etc. Une vie diverse avec des projets sociaux et une autonomie qui se construit au quotidien.
Par ailleurs, le mouvement prend en charge lui-même ses conflits internes, puisqu’on est dans une zone où la police ne rentre plus et où les institutions étatiques n’ont plus d’emprise. Bref, depuis cinq ans, les gens construisent en dur – on dénombre environ soixante-dix lieux de vie sur la ZAD –, et on peut aisément dire que certain·es occupant·es sont devenu·es aussi des habitant·es « historiques ».

En dépit de la diversité militante du mouvement, comment cette vision commune de l’avenir de la ZAD a été collectivement élaborée ? Comment se projeter dans le futur quand on est perpétuellement menacé·e d’expulsion ?
Les débats internes autour de l’avenir de la ZAD ont débuté dès 2014 pour éviter toute division après un éventuel abandon du projet, ou que chacun·e se retrouve à négocier ses droits seul·e dans son coin. Ce n’était pas facile, car nous partions d’angoisses en miroir. Pour les « historiques », les occupant·es ont pu apparaître comme des militant·es qui arrivaient avec de grandes ambitions révolutionnaires, qui sont opposé·es à l’élevage ou à la mécanisation, qui construisent un peu partout sur la zone. Ils se demandaient donc s’ils auraient encore leur place dans cette ZAD de demain. À l’inverse, pour nombre d’occupant·es, la victoire pouvait signifier qu’ils deviendraient de facto inutiles. Leur expulsion serait en quelque sorte synonyme d’une « normalisation » de la ZAD.
Les discussions sont parties de cette défiance mutuelle de se faire exclure par l’autre. Les échanges ont été extrêmement lents et ont abouti à une déclaration commune en six points [6. « Parce ce qu’il n’y aura pas d’aéroport – Texte dit “Les 6 points pour l’avenir de la ZAD” ». ] dont l’énoncé pourrait se résumer ainsi : au lendemain de l’abandon du projet, il faut que les « historiques » (habitant·es, locataires, propriétaires) puissent recouvrer leurs droits, mais aussi que toutes celles et ceux qui ont défendu ce territoire, qui sont venu·es occuper, puissent rester ici s’ils ou elles le désirent, et ne pas être expulsé·es.
La déclaration stipule ensuite que toutes les terres agricoles de la ZAD, notamment celles appartenant à Vinci, seront redistribuées et gérées par le mouvement de lutte. Ces terres ne doivent pas servir à l’agrandissement d’exploitations agricoles préexistantes, mais aller à de nouvelles installations de paysan·nes (conventionnelles ou hors-cadre). Cela va être un vrai combat politique, mais depuis des années, les paysan·nes de Copain ont annoncé que si le projet est abandonné, les agriculteurs et agricultrices qui ont accepté de négocier avec Vinci ne seront plus légitimes à retrouver leurs terres.
Une autre donnée importante des six points, c’est la préservation des formes d’activités, d’organisations collectives, et d’habitats qui se sont mises en place au fil des années sur la ZAD : toute cette vie qui fait la singularité de ce territoire. En effet, l’abandon du projet ne doit pas signifier la fin des expériences politiques et sociales sur la ZAD, car nombre d’opposant·es, y compris celles et ceux de l’Acipa, qui au début n’étaient centré·es que sur l’arrêt de l’aéroport, ont envie de prolonger cette aventure collective.
Nous avons vécu depuis cinq ans dans une temporalité de combat et d’urgence où l’on pouvait se faire expulser dans la semaine comme dans six mois. Mais l’an dernier, au moment où la probabilité d’expulsion était la plus forte, une « Abracadabois » – une sorte d’école du bois – s’est mise en place et s’est penchée très sérieusement sur l’entretien des forêts et des haies de la ZAD dans les cent ans à venir : « le temps des arbres ».
Nous nous sommes rendu compte qu’en tant qu’« enfants du XXIe siècle », et contrairement aux sociétés paysannes, nous ne nous posions quasiment jamais la question de l’au-delà de notre propre existence, tellement nous sommes dans l’immédiateté. Dans une zone soumise à la perpétuelle précarité et à la menace de se faire expulser sur-le-champ, nous avons alors paradoxalement redécouvert la possibilité de se projeter dans le futur, et même au-delà de nous-mêmes.

Comment cette future ZAD pourrait-elle se concrétiser ? Quels compromis implique-t-elle ?
Pour les plus ancien·nes du mouvement anti-aéroport, la perspective d’un bail emphytéotique [7. Bail de très longue durée, d’au moins dix-huit ans et d’au plus quatre-vingt dix-neuf ans.] géré par une structure collective autonome, un peu comme le modèle élaboré après la victoire de la lutte du Larzac dans les années 1980, est une idée stimulante. Mais nous allons nous retrouver à devoir asseoir la légitimité de l’avenir de la ZAD avec un gouvernement beaucoup plus hostile et réticent que celui de François Mitterrand en 1981. Quand les militant·es du Larzac ont négocié leur bail, ils avaient en face des politicien·nes dont beaucoup avait soutenu de près ou de loin le mouvement. Ce que représente aujourd’hui la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en termes d’affront symbolique pour l’État français est ici totalement différent.
Ce qui est certain, c’est que si d’ici les jours qui viennent, le gouvernement annonce l’abandon du projet, nous entrons dans une nouvelle phase de lutte. Et on espère ne pas l’entamer seulement en tant qu’occupant·es, mais avec toute la diversité des composantes du mouvement. Nous sommes donc à un moment charnière. Soit nous allons vers une défense de la ZAD contre le démarrage des travaux, avec un niveau de désabusement et de colère jamais inégalés, soit, si c’est l’abandon, nous nous apprêtons à vivre une expérience assez inédite : celle de penser l’autogestion d’un territoire à grande échelle. Avec l’enjeu de conserver la forme la plus protectrice pour toutes celles et ceux qui habitent la ZAD, entre certain·es qui ont besoin de stabilité voire de légitimité, et d’autres qui aspirent à plus de liberté et d’autonomie.
Ce qui a fait la beauté de l’expérience de la ZAD depuis des années, c’est que des individus arrivent à produire, à vivre, à s’organiser selon des manières qui n’auraient jamais été permises ailleurs. Aujourd’hui, si tu veux faire de la charpente, de l’agriculture, organiser un concert, il te faut passer par un tel nombre de contraintes et de normes, par tellement de critères aseptisants, marchands et sécuritaires, que cela finit par t’écœurer et te décourager. Mais sur la ZAD, un tas de personnes se sont réappropriées ces activités, car tout d’un coup, il y avait la possibilité de les faire librement, collectivement et selon d’autres principes.
Si la ZAD est libérée demain, ce n’est pas pour se retrouver sous les affres de cette normalisation. La zone restera en combat. Quelles rapports de force et formes de négociation seront possibles ? Est-ce que cela va se faire sous la forme d’un bail, d’une contractualisation ? Quel temps cela va-t-il prendre ? Qu’est-ce que nous allons gagner en termes d’autonomie ? Qu’allons-nous perdre ? Parviendrons-nous à nous maintenir ensemble ? Tout cela reste une inconnue, même si nous avons tracé collectivement une ligne de principes. Et ce ne sera qu’une succession de paris à la fois excitants et périlleux. Nous savons où nous voulons aller, mais le chemin à trouver pour y parvenir ensemble, pour que ça réussisse sans perdre le sens de la ZAD en route est loin d’être gagné.

Les deux médiateurs et la médiatrice ont plaidé pour une évacuation de la ZAD, abandon du projet ou non. Alors que la « loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est entrée en vigueur il y a deux mois, inscrivant dans le marbre l’état d’urgence [8. À ce propos, voir « Depuis l’état d’urgence, il est devenu normal d’aller en prison pour ce qu’on pourrait faire, et non pour ce qu’on a fait ».], n’existe-t-il pas pour les « zadistes » une menace de répression policière et judiciaire de grande ampleur ?
Nous avons la chance de vivre dans un territoire où la police ne rentre pas et nous sommes dans une lutte où il existe une entente dans le mouvement pour assumer publiquement des formes d’illégalismes (comme semer des terres ou construire des hangars, ce que la préfecture interdit formellement) au sein d’une enveloppe protectrice qui nous a relativement protégé·es des affres de la répression. De nouveaux modèles répressifs autour de la lutte contre l’aéroport ont tout de même été expérimentés. La manifestation du 22 février 2014 à Nantes a été un tournant, car c’était une des premières fois où, sur la simple base d’images vidéo, on arrêtait quelques semaines plus tard dans la rue ou dans leur domicile des militant·es pour « violence sur agent dépositaire de l’autorité publique » ou « participation à un attroupement armé ».
Nous ne sommes cependant pas au même niveau que le mouvement de lutte No TAV au Val de Suse [9. À propos de la lutte No TAV en Italie, lire « Les Libres Républiques » par le collectif Mauvaise Troupe sur le site de Jef Klak.], où les militant·es croulent sous une pluie de procès et de peines de prison. Mais le rapport de force institué par le mouvement anti-aéroport et le niveau d’insolence face au pouvoir peuvent laisser imaginer un certain ressentiment chez les forces de l’ordre et l’État, désirant se venger avec des arrestations ciblées… C’est en ce sens que, pour les occupant·es, la question de l’amnistie pour tout·es est centrale dans les discussions. Les procédures judiciaires en cours, les peines de prison, les interdictions de territoire, le fichage des militant·es anti-aéroport, tout cela doit être levé avec l’abandon du projet.
Au-delà de cette question répressive, et si l’on pousse la réflexion plus loin au sujet de cette lutte, nous avons remarqué que l’État sait gérer une mobilisation de masse ou des groupes de personnes quand ils se placent uniquement dans la confrontation physique. Mais ici, le pouvoir a été dépassé par la conjonction entre un mouvement populaire et des gens prêts à mettre leur corps en jeu dans la confrontation. Cela dit beaucoup sur les possibilités politiques encore ouvertes dans nos sociétés. L’État ne sait pas gérer des individus qui osent résister physiquement tout en étant reconnus comme légitimes dans leurs actions et soutenus massivement.

Comment faire pour que le mouvement ne s’épuise pas et reste combatif ? Comment éviter que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ne s’enferme sur elle-même suite à un éventuel abandon du projet ?
Un élément assez nouveau pour la lutte anti-aéroport est apparu au printemps 2016 lors du mouvement contre la loi Travail. Nous nous sommes retrouvé·es dans les rues de Nantes, mais aussi à la raffinerie de Donges, un bastion du syndicalisme local. Nous avons donc durant ce mouvement rencontré des lycéen·nes, des étudiant·es, mais aussi des syndicalistes avec qui nous avons énormément échangé lors des grèves et des blocages.
À l’époque, un texte public des syndicalistes CGT de Vinci avait annoncé sans ambages : « Nous ne sommes pas des mercenaires, nous ne participerons pas à ce projet d’aéroport. Nous ne voulons pas travailler à n’importe quel prix et pour n’importe quel projet. » Cette déclaration a eu une grande résonance dans les sphères syndicalistes, car il est à contre-courant d’un certain discours productiviste de la CGT. Durant les manifestations, nous avons par ailleurs découvert plein de complices parmi les syndicalistes de Nantes Métropole, malgré le discours officiel des autorités locales selon lequel les « zadistes » étaient les grands responsables des émeutes urbaines en marge des défilés contre la loi Travail.
Une nouvelle composante au sein de la lutte anti-aéroport s’est ainsi formée : un collectif inter-syndical composé de la CGT, de Solidaires ou encore de la CNT qui s’engagent aux côtés du mouvement. Pour ces salarié·es syndiqué·es, ce projet est absurde d’un point de vue social et en termes d’emplois. Mais ce qui les intéressent aussi, c’est qu’il y a des individus qui reprennent leur vie en main sur la ZAD, c’est-à-dire qui se posent la question de comment on pourrait produire, vivre, travailler, habiter autrement. Des questions qui selon elles et eux, doivent être réinsufflées au sein des entreprises. Depuis le printemps 2016, de nombreuses sections syndicales locales voient donc la ZAD d’un bon œil, car elle propose un nouvel imaginaire en termes d’expérimentations sociales et de rapport au travail, mais aussi parce que nous sommes une lutte qui a réussi à plusieurs reprises à établir un certain rapport de force victorieux face au pouvoir.
Suite à ces rencontres, des sections syndicales sont venues sur la ZAD, pour organiser un repas à la ferme de Bellevue, ou un banquet à l’auberge des Q de plombs. Untel qui fait de la cartographie dans son travail s’est retrouvé impliqué dans le groupe Carto du mouvement. Un autre qui est bibliothécaire syndiqué, a travaillé au recensement des ouvrages de la bibliothèque du Taslu sur la ZAD.

Afin de prolonger ces alliances, un réseau de ravitaillement des luttes du Pays Nantais et nommé « les Cagettes Déter » a été mis sur pied [10. Voir zad.nadir.org/IMG/pdf/cagette_deter.pdf.]. Le but est de reprendre un peu la tradition des paysans-travailleurs de 1968 [11. En mai 1968, des paysan·nes nantais·e sont venu·es soutenir les ouvrier·es en lutte de la région en apportant des vivres au sein des usines occupées. Sous la houlette de Bernard Lambert, un paysan syndicaliste qui sera plus tard à l’origine de la Confédération paysanne, ces agriculteurs et agricultrices militant·es se définissent alors comme des paysans-travailleurs pleinement ancré·es dans la lutte des classes. ] en soutenant avec de l’alimentation produite sur la ZAD et dans les fermes du coin les luttes de la région. Par exemple, dès cet automne, suite à une grève des postier·es de Saint Herblain, nous sommes arrivé·es avec des paniers de légumes et de viande, du pain, du cidre, etc. Un ravitaillement logistique qui a servi d’outil de rencontre, puisque par la suite, des paysan·nes sont venu·es en solidarité bloquer des bureaux de poste avec leur tracteur.
Alors, évidemment, le danger existe que la ZAD devienne une sorte de territoire écolo-alternatif avec quelques projets agricoles locaux, un ghetto pour militant·es chevronné·es… et que ça se referme un peu. Mais on peut aussi faire confiance à des actions comme les Cagettes Déter ou celles qui en ce moment voient nombre d’occupant.e.s de la ZAD participer à l’occupation de l’université de Nantes pour héberger des migrant·es. Nous restons vigilant·es pour que la ZAD demeure un grenier de luttes, une zone la plus circulante et ouverte possible, pour que les liens entre occupant·es, paysan·nes, habitant·es, militant·es associatif·ves et syndicalistes perdurent.
Depuis le mouvement CPE en 2006, il n’y a pas eu de victoire politique suite à une grande lutte populaire. Et nous avons aujourd’hui besoin d’une victoire, car elle peut en permettre d’autres. D’ailleurs, le 10 février prochain, date de la fin de validité de la Déclaration d’utilité publique du projet d’aéroport, nous donnons rendez-vous sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, soit pour fêter l’abandon du projet, soit pour réaffirmer que nous sommes toujours en lutte. Des paysan·nes d’ici ont déjà mentionné l’idée, si l’on gagnait, d’organiser directement un convoi pour la lutte anti-nucléaire de Bure.

by Mickaël Correia | 14 novembre 2017 | Bout d’ficelle, Le lundi au soleil, Terrains vagues
Dessins de Florent Grouazel
À Roubaix, la zone de l’Union est l’ancien « cœur battant » de l’industrie textile française du XXe siècle. Grèves dans les usines, syndicalisme ouvrier, main-d’œuvre immigrée mais aussi restructurations et délocalisations ont animé ce quartier industriel et populaire jusqu’à ce qu’il devienne au début des années 2000 une des plus grandes friches industrielles du pays. Depuis maintenant près de dix ans, les élus et acteurs économiques locaux ont lancé un vaste chantier de réhabilitation de l’Union pour que la zone devienne à terme un pôle de compétitivité et d’innovation industrielle au service de la métropole lilloise. Symbole de ce projet titanesque, le Centre européen des textiles innovants, qui réunit start-ups, entreprises familiales et laboratoires de recherche, se veut le fer de lance de la future révolution textile. Entre projet de rénovation urbaine, relégation des ancien·nes ouvrier·es du textile et économie de l’innovation, reportage en quatre actes, quatre espaces, sur la friche de l’Union.
Ce texte est issu du deuxième numéro de Jef Klak, « Bout d’ficelle », traitant du textile, de la mode et des identités de genre, et encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF.
À mon arrivée à la Maison de l’Union, Julie Lattès, communicante pour la Société d’économie mixte (SEM) Ville Renouvelée, propose que nous nous attablions au-dessus d’une vaste maquette de présentation toute en diodes lumineuses et cubes anonymes. Vague fantasme démiurgique, cette dernière permet d’arpenter les 80 hectares de la zone de l’Union, une immense friche industrielle, à cheval entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, au nord de Lille. La SEM Ville Renouvelée a jusqu’à 2022 pour mener à terme un des plus importants projets de renouvellement urbain français dans le cadre de partenariats publics-privés largement financés par Lille Métropole . « Dès 1993, l’Union est appréhendée par les élus locaux comme un futur pôle d’excellence métropolitain, commente Julie Lattès. L’Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais a alors commencé à racheter les terrains et les bâtiments désertés. En 2004, le projet urbanistique est défini par le cabinet Reichen et Robert & associés [2. Agence d’architectes et d’urbanistes spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine industriel. La Grande Halle de la Villette et le Pavillon de l’Arsenal à Paris ou encore les docks Vauban du Havre font partie de leurs réalisations. Le cabinet a remporté en 2005 le Grand Prix de l’urbanisme.]. La zone sera réaménagée en différents secteurs qui accueilleront deux filières d’excellence : les textiles innovants ainsi que l’image. Mais il est prévu également un éco-quartier, un espace vert, du logement social. »
Pour écouter ce discours policé, il a fallu d’abord slalomer entre d’énormes gaines électriques orange, qui tentent vainement d’égayer des trottoirs encore mal dégrossis. Puis marcher longuement, accolés à ces panneaux aux sourires peroxydés vantant des projets immobiliers. Tout autour, des grues structurent en horizontales un ciel minéral. Et le vacarme étouffé des chantiers marteaux-piquants. « Pendant près d’un siècle, la filature de coton Vanoutryve et le Peignage de La Tossée étaient les deux grandes usines textiles phares de cette zone. Mais les crises pétrolières et la mondialisation ont progressivement transformé l’Union en vaste friche à partir des années 1990. Le chantier en cours veut conjuguer la recherche de l’innovation, la préservation de l’héritage industriel et les principes d’un développement plus durable », résume brièvement Julie Lattès.

ACTE I
La Maison de l’Union
« Faire du blé sur les friches »
Filature, peignage… Ces mots résonnent intensément dans la région. Dès le début du XXe siècle, l’agglomération de Roubaix-Tourcoing est devenue une capitale mondiale du textile, avec plus de 110 000 salarié·es embauché·es dans le secteur. La zone de l’Union est alors le poumon de la Manchester française : inaugurés au XIXe siècle, le canal de Roubaix et le chemin de fer qui la traversent accélèrent l’industrialisation de ce territoire encore rural. En 1870 s’ouvre le premier atelier de traitement de la laine à La Tossée, et trois ans plus tard, la filature de coton Vanoutryve voit le jour.
Les grandes familles industrielles règnent sur la région : Motte, Dewavrin, Six, Prouvost ou encore les célèbres Mulliez [3. La famille Mulliez, originaire de Roubaix, première fortune de France, pèse 3 milliards d’euros. Organisée en groupement d’intérêt économique dénommé « Association familiale Mulliez », elle regroupe plus de 500 membres de la famille et possède les groupes Auchan, Oxylane-Décathlon, Midas, Norauto, Flunch, Kiabi, Kiloutou, Cultura, etc.]. Le patronat paternaliste et catholique du Nord esquive les crises successives de la filière textile en se diversifiant dans la distribution lors de l’entre-deux-guerres (avec la création de groupes comme La Redoute, Les Trois Suisses ou La Blanche Porte), en faisant appel à une main d’œuvre immigrée (belge, maghrébine, portugaise, polonaise) et grâce au renouvellement des parcs de machines nécessitant de moins en moins d’ouvriers. Dès le début des années 1970, la désindustrialisation lamine la zone de l’Union et, de restructurations en liquidations, la filature de coton Vanoutryve et le Peignage de La Tossée, le deuxième de France, ferment leurs portes en 2004.
Retour autour de la maquette du projet de l’Union. La chargée de communication de la SEM Ville Renouvelée rappelle que nous sommes justement dans l’ancien magasin de stockage de laine de La Tossée. Dénommé aujourd’hui l’hôtel d’entreprises « Le Champ Libre », il accueille la Maison de l’Union ainsi que l’antenne régionale de l’Institut du monde arabe ou encore les rédactions locales de La Voix du Nord et de Nord Éclair. Une grande partie du site industriel de La Tossée a été rasée pour faire place à une société de manutention, un parking de 400 places, des logements, mais surtout une ruche d’entreprises. Ce bâtiment « à l’architecture avant-gardiste » accueillera d’ici peu une trentaine de start-ups essentiellement centrées sur les textiles innovants.
L’ancienne filature de coton Vanoutryve est quant à elle le chantier le plus avancé de l’Union. Désormais appelé « Plaine Images », le site est devenu depuis 2007 « le pôle d’excellence de l’image et des industries créatives » et rassemble entre autres le créateur de jeux vidéo Ankama, la chaîne télévision Télé Melody, une plate-forme de recherche et développement… La filature réhabilitée se définit comme un « cluster pour la création digitale et l’innovation » et se veut un espace hybride à la pointe du progrès, réunissant entreprises, chercheur·es et artistes.

Julie Lattès insiste sur les emplois créés et à venir – 1 400 actuellement sur le site de l’Union et 6 000 à terme. D’ici quelques mois va s’ouvrir en lieu et place des anciennes brasseries de l’Union le siège de Kipsta, une filiale du groupe Oxylane-Décathlon (détenu par les Mulliez : la grande famille patronale du Nord rôde toujours). L’Union accueillera ainsi Kipstadium, « le siège mondial des sports collectifs » et un immense complexe sportif de plus de quatre hectares. Plus loin, les bureaux régionaux de Vinci Construction, dont les simili-briques tentent maladroitement de rappeler l’héritage industriel de Roubaix, ouvriront bientôt.
Comme le vantent les plaquettes de présentation du projet, « si l’Union est le berceau de l’industrie textile, elle est aussi le symbole de son avenir ». Ce symbole, construit de toutes pièces sur la friche, est le Centre européen des textiles innovants (Ceti), plate-forme technologique de recherche et développement « unique au monde ». « Creuset d’innovation, vecteur de créativité, tête de réseau, le Ceti est un lieu où l’on conçoit, expérimente et développe une nouvelle offre produits adaptée à l’économie et aux besoins du monde de demain », se vante le site du Centre européen de recherche et de prototypage dédié aux nouveaux textiles. Il est porté par le pôle national de compétitivité Up-Tex [4. Up-Tex est un des 71 pôles de compétitivité créés en 2004 pour relancer la politique industrielle en France. Ces pôles rassemblent sur un même territoire et autour d’un même secteur industriel, entreprises, laboratoires de recherche, universités et écoles d’ingénieur·es.], consacré à « la compétitivité par l’innovation, dans le domaine des tissus techniques spéciaux et innovants ». Lors de son inauguration en octobre 2012, Martine Aubry, présidente de la communauté urbaine de Lille, annonçait que c’est « le cœur de la révolution textile qui va battre ici [5. La Voix du Nord, 11 octobre 2012. ] ».
Le projet de l’Union est ainsi inscrit dans la politique industrielle de la communauté urbaine lilloise. Il est l’un des cinq pôles d’excellence de Lille Métropole, avec Eurasanté, dédié à la filière biomédicale, ou encore EuraTechnologies, consacré aux technologies de l’information et de la communication, construit dans une ancienne filature de coton et de lin. Une logique à la fois de requalification urbaine et de city reimaging, c’est-à-dire une politique d’image visant à « vendre » la ville industrielle, anime également le projet de rénovation urbaine de l’Union. La SEM Ville Renouvelée met en avant « un quartier attractif, mixant finement activités économiques, équipements, logements et espaces naturels » qui se construit sur « le principe de la ville mixte, intense et évolutive ».
« Les politiques d’image se formalisent et évoluent vers la construction de véritables “marques urbaines” capitalisant sur les atouts supposés des villes, alors que les cibles du redéveloppement apparaissent de plus en plus clairement identifiées : d’une part, les entreprises tertiaires considérées comme les plus innovantes, les plus en phase avec l’économie de la connaissance ; d’autre part, des groupes sociaux à haut pouvoir d’achat [6. Max Rousseau, « Villes post-industrielles : pour une nouvelle approche » Métropolitiques, 18 septembre 2013.] », écrit Max Rousseau, docteur en sciences politiques qui a réalisé sa thèse sur le city reimaging de Roubaix et de Sheffield en Angleterre [7. Max Rousseau, 2011, Vendre la ville (post) industrielle. Capitalisme, pouvoir et politiques d’image à Roubaix et à Sheffield (1945-2010), Thèse de doctorat en sciences politiques, université Jean Monnet, Saint-Étienne.]. Pour le sociologue et urbaniste Jean-Pierre Garnier, la reconversion de l’Union n’est rien de moins qu’« un processus de recyclage des anciens quartiers populaires en nouveaux quartiers hype. Entre les oligarchies politiques locales d’un côté et les puissances économiques et financières de l’autre – aujourd’hui cela s’appelle “partenariat public-privé”, autrefois on appelait ça “collaboration de classes” –, l’objectif est le suivant : faire du blé sur les friches, soit en les transformant en quartiers pour classes aisées, soit en y faisant venir des activités dites de pointe [8. Débat du 29 septembre 2012 à Roubaix sur la zone de l’Union organisé par le journal indépendant lillois La Brique.] ».
En partant, Julie Lattès propose une visite des chantiers. Le vent est glacial, la pluie terrible, et après avoir vanté les mérites architecturaux des alvéoles de la future ruche d’entreprises de La Tossée, le parcours passe devant un café, vestige d’une rue aujourd’hui entièrement démolie dans le cadre du projet de réhabilitation. La maison toute en vieilles briques se dresse fièrement, seule au milieu des friches délavées, effleurée par une route au bitume noir fraîchement coulé. Sur l’un des murs, une banderole « Toujours ouvert ! » claque au vent. « C’est Chez Salah, un café tenu par un vieux Kabyle qui a refusé de vendre sa maison à la SEM Ville Renouvelée, précise Julie Lattès. Il a résisté pendant plus de six ans à l’expulsion. Sa détermination a été très médiatisée. On s’est dit finalement que c’était un lieu de centralité important, en connexion avec le futur espace vert de l’Union. »
Au loin se dessine le Centre européen des textiles innovants, long et pâle vaisseau échoué sur un lit d’herbes sales. Mais en ce matin de décembre, les demandes de rendez-vous pour pouvoir y entrer et interroger un des dirigeants du Centre sont encore en attente. Fin de visite. Aux abords de l’ancien portail d’entrée de La Tossée, où les pavés ont été vermoulus par les chaussures et les mobylettes pétaradantes des ouvriers, Julie Lattès avoue ne pas savoir ce qu’il adviendra de l’ancienne conciergerie de l’usine. Bouzid Belgacem et Maurice Vidrequin, eux, savent.

ACTE II
La Tossée
« Nous ne voulons pas subir la double peine : le licenciement et l’oubli. »
Au quartier du Pont-Rompu à Tourcoing, à quelques encablures de l’Union, se trouve le siège perdu de l’Association des ancien·nes salarié·es du Peignage de La Tossée. Les odeurs chaudes de bois et de laine emplissent le local envahi d’anciennes pièces mécaniques, de sacs de laine ou de navettes à filer sauvés in extremis à la fermeture du Peignage. Des « tiots bouts d’rin » représentant des fragments de leur vie de travail et des amitiés d’usines. Autour d’un café, Bouzid Belgacem raconte avoir travaillé plus de trente ans à La Tossée comme aide mécanicien puis agent de maîtrise. Maurice Vidrequin a commencé comme graisseur de machine et a bossé trente-cinq ans dans le peignage. Tous deux sont d’anciens délégués syndicaux de l’usine, mais aussi et avant tout des « gens du textile », ces ouvriers de la laine et du coton dont beaucoup sont reconnaissables à leurs mains aux phalanges amputées par les machines. « À La Tossée, les ouvrier·es étaient issus de dix-sept nationalités différentes, et il existait une belle entente, une grande solidarité entre nous tous, raconte Bouzid Belgacem. On aidait les copains et copines à côté quand on était en avance sur ses machines à peigner. Il y avait peu de femmes, car le peignage de la laine, c’est ce qu’il y a de plus difficile dans la filière textile. Les conditions de travail à La Tossée étaient vraiment très dures, il y avait énormément de poussière, pas de matériel d’aération adapté et, franchement, le comité d’entreprise n’en avait rien à foutre. Quant aux salaires, il y avait une disparité, entretenue par la direction, entre hommes et femmes, entre équipes, entre créneaux horaires. Malgré notre unité syndicale, on n’a jamais récolté qu’une fin de non recevoir… »
Alors que l’usine, qui emploie 1 200 salarié·es au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est depuis sa fondation détenue par la famille Binet, cette dernière revend le Peignage à un consortium d’actionnaires au début des années 1970, sentant venir les bouleversements dans l’industrie textile. S’enclenche alors le cycle des restructurations. La famille patronale Dewavrin rachète l’usine au début des années 1980. Puis la Standard Wool Corporation, société américaine spécialisée dans le tabac, se diversifie en achetant des sociétés textiles, dont La Tossée, en 1986. « Ils ont essayé ensuite de nous revendre jusqu’en 1995 à Chargeurs, un géant du textile, raconte Maurice Vidrequin. Ce groupe avait déjà liquidé un peignage voisin, et on savait qu’on allait mourir. On a été en lutte, on a manifesté devant le siège de Chargeurs à Paris, ç’a été très chaud ! On n’était plus que 200 ouvrier·es, mais on arrivait à sortir 10 millions de kilos de laine chaque année, ça représentait 20 000 moutons par jour. On produisait aussi de la lanoline, de la graisse de laine utilisée dans les cosmétiques, ça rapportait pas mal d’argent. »
Bouzid Belgacem poursuit : « Les restructurations, j’en ai connu quatre. Quand les nouvelles machines rentrent, les humains sortent : à la fin, un seul ouvrier gérait 16 peigneuses… On l’a vue, la déconfiture de la laine : la consommation a chuté, et puis la Pologne, la Tchéquie et le Maghreb sont arrivés dans le marché mondial avec une main-d’œuvre à bas prix. On voyait les bilans comptables, et tous les mois, l’usine perdait du pognon, on ne survivait que grâce au cours élevé du tabac qui compensait les pertes du secteur textile. » Le groupe Chargeurs refuse finalement de racheter l’usine, et un plan social est annoncé en 2003. Les salarié·es de La Tossée, qui ont peur que la direction vendent les machines et le stock de laine peignée durant le week-end, organisent alors des rondes de surveillance autour du site de production. Les syndicats décident ensuite de bloquer la production et de se barricader dans l’usine. « On était là jour et nuit, il y a eu trois semaines de grèves très dures, et Salah nous accueillait dans son café. Il nous offrait les coups à boire, et pour les repas, il nous arrangeait pour pouvoir payer le mois d’après. » Le PDG de La Tossée offrant une prime ridicule de départ au prorata de l’ancienneté des salarié·es, il a fallu de rudes négociations pour trouver un statu quo : tous sont licenciés en 2004, mais avec des primes décentes, des départs à la retraite ou des congés de reconversion. Le blocage de l’usine est alors levé. Fin de La Tossée.
En février 2005 est créée l’Association des anciens salariés du Peignage de La Tossée avec pour principal objectif de rester en contact et de briser l’isolement. « Les gens étaient en pleurs : ce n’était pas possible de se quitter comme ça, avec toute cette fraternité et cette solidarité entre nous, explique Bouzid Belgacem. Nous ne voulions pas subir la double peine : le licenciement et l’oubli. » Détresse sociale, divorces et suicides émaillent la fermeture des usines de Roubaix et de Tourcoing dès 2000. « Ç’a été le tremblement de terre. Des fois, le père, la mère, les fils et les oncles, des familles entières étaient embauchées dans le textile. Ils n’ont fait que du textile toute leur vie et ne savaient faire que ça… »
Pour ne pas subir cette « double peine », l’association veut qu’une Cité régionale de l’histoire des gens du textile soit créée sur place. « C’est un lieu chargé d’histoire des luttes sociales, et puis nous avons récupéré énormément d’objets de l’usine à la benne », précisent les anciens syndicalistes. Des expositions, du théâtre ou encore des projections de documentaires sur le témoignage d’ancien·nes ouvrier·es ont été depuis organisés. Mais loin d’être un simple musée, cette Cité se voudrait avant tout un lieu de mémoire vivant et un espace de production. Les ancien·nes salarié·es sont en ce sens devenus proches d’Ardelaine [9. Sur l’aventure coopérative d’Ardelaine, lire Moutons rebelles. Éditions Repas, 2014. Écouter également sur le CD de « Bout de ficelle », piste 8, le documentaire « Des brebis, des fileuses » sur La Fibre Textile, collectif à la dynamique similaire à celle d’Ardelaine.], une coopérative ouvrière ardéchoise qui collecte de la laine locale pour la transformer artisanalement. L’association veut ainsi créer Nordelaine, une unité de production en coopérative pour travailler de la laine lavée en Belgique et montrer les étapes de production jusqu’au produit fini, avec une petite boutique de vente de vêtements « Made in Roubaix ». « C’est difficile, on n’est pas vraiment écouté·es, voire parfois récupéré·es par les élus locaux, déplore Bouzid Belgacem. On a même réoccupé La Tossée en 2009 pendant les élections régionales. On aimerait s’installer dans les anciennes chaufferies et la conciergerie, mais on attend encore la décision des politiques… »

Le Peignage de La Tossée ne reflète qu’un pan de l’histoire des autres usines roubaisiennes. La mythique Lainière de Roubaix, fondée par la famille Prouvost, ferme en 2000 et licencie 212 salarié·es (elle employait près de 8 000 ouvrier·es dans les années 1950). En 1987, le groupe Chargeurs lance une OPA sur l’empire Prouvost et dépèce petit à petit pour ses actionnaires les différentes sociétés textiles de l’entreprise familiale. Quant à la réhabilitation des anciens bâtiments, la filature Cavrois-Mahieu, qui a employé jusqu’à 1 200 ouvrier·es avant de fermer en 2000, est devenue le Non-Lieu, un centre d’art. La Condition publique, ancien entrepôt de conditionnement de laine, a été transformé en un centre artistique et culturel.
Depuis le début du déclin de l’industrie textile dans les années 1970, on passe en trente ans de 50 000 à 8000 salarié·es du textile pour Roubaix et Tourcoing. Roubaix est devenue depuis peu la ville la plus pauvre de France : 45% de sa population y vit désormais avec moins de 977 euros par mois [10. Étude publiée en janvier 2014 par le bureau d’étude Compas et reprise par l’Observatoire des inégalités.]. Pour le collectif de l’Union, qui réunit les anciens salariés de la zone de l’Union et des associations roubaisiennes, « [l’industrie textile] a produit d’importantes richesses au prix d’une misère sociale et économique constante pour beaucoup ouvrier·es que l’on a fait venir de plus en plus loin avant de déplacer les usines vers d’autres régions du monde. Localement, les industriels se sont reconvertis dans la grande distribution et la finance, ou se sont spécialisés sur les “textiles innovants” [11. « Pour le droit à changer d’ère – Plateforme de constitution du Collectif de l’Union », novembre 2005.] ».
ACTE III
Le Ceti
« Être le site d’excellence international de la valeur ajoutée textile »
Depuis son inauguration fin 2012, le Centre européen des textiles innovants a du mal à convaincre de son succès. Il faut dire qu’avec des bâtiments flambant neufs de 15 000 m2, et après un investissement de 42 millions d’euros, le centre emploie à peine une quarantaine de personnes. Un peu léger pour inverser la courbe du chômage creusé ici depuis la fermeture des usines. L’ancien directeur a même été récemment remercié faute d’avoir réussi à développer suffisamment le site. Le projet a été porté dès 2001 par André Beirnaert, fondateur du pôle de compétitivité Up-Tex, à l’époque président du syndicat patronal du textile dans le Nord. Le patron des patrons du textile est surtout connu pour avoir dirigé à partir de 1985 les activités tissage de la famille Prouvost puis la Lainière de Roubaix… pour finir dirigeant chargé du peignage pour le groupe Chargeurs, siphonneur des usines textiles locales contre lequel les ouvriers de La Tossée ont tant lutté.
Le Ceti a également été impulsé par Clubtex. Créé il y a 25 ans, ce club d’entreprises des textiles techniques rassemble de nombreuses petites et moyennes entreprises familiales qui ont anticipé le déclin du textile dans la région pour se réorienter vers les tissus de pointe. Cousin Frères, dans le secteur depuis 1848, se sont par exemple spécialisés dans le cordage de haute technologie et les textiles biotechnologiques. DMR Rubans, une ex-société de la famille Prouvost créée en 1905, s’est reconvertie dans la rubanerie high-tech. Ferlam Technologies, entreprise de cardage créée en 1936, produit aujourd’hui du tissu d’isolation thermique. Pennel & Flipo, créée en 1921, conçoit désormais des tissus de haute technologie pour l’industrie, la marine et la sécurité. À côté de cet historique patronat local et népotique, de nouveaux candidats au progrès ont débarqué : Damart [12. Dont le directeur de développement industriel n’est autre que Gilles Damaz, président d’Up-Tex.], Etam, ou encore la filiale Nord de Bouygues construction, tous persuadés que l’avenir économique se jouera dans les textiles innovants.
« Dans le Ceti, il y a des machines très performantes et hors de prix pour fabriquer du fil technique, mais ce n’est pas un site de production : il n’y a qu’une poignée d’ingénieur·es là-dedans, en concurrence avec l’Allemagne et les États-Unis, lance, dubitatif, Bouzid Belgacem. Ils nous ont dit que les techniques actuelles et innovantes de tissage créeront l’emploi de demain, mais tout ce que je vois, ce sont des bâtiments vides. »

Une rencontre avec un cadre dirigeant du Ceti est enfin organisée pour que je puisse entrer au sein même du futur « cœur de la révolution textile ». L’insipide dalle de béton ruisselante ponctuée de panneaux « sol glissant » témoigne des défauts inhérents à ce type d’architectures construites à la hâte. Alors que le hall d’accueil du Centre laisse entrevoir des coursives désolées, Jean-Marc Vienot, secrétaire général de Clubtex et directeur général d’Up-Tex déboule derrière une austère porte-battante : « Le Ceti est un écosystème qui permet de répondre à toutes les sollicitations sur les textiles innovants. Le site d’excellence comporte tout d’abord une plateforme technologique : c’est un contributeur d’innovation à travers le design thinking, un service de prototypage pour la recherche et développement. C’est aussi le pôle de compétitivité Up-Tex qui est un incitateur d’innovation, en faisant collaborer entreprises et laboratoires de recherche. Il y a ensuite Clubtex, un facilitateur de business, et enfin Innotex, un incubateur d’entreprises, qui est en quelque sorte un accélérateur d’innovation. » Le chantier de l’Union se construit aussi grâce aux mots. « Notre ambition : être le site d’excellence international de la valeur ajoutée textile », conclut humblement Jean-Marc Vienot.
Le Ceti produit donc de la recherche appliquée, suite à des demandes venant d’entreprises, et valorise ses machines-outils high-tech (dont des engins relativement rares dans le monde, capables par exemple de tisser trois fibres de natures différentes ou de fabriquer des textiles technologiques dits non-tissés). Ses ingénieur·es peuvent ainsi créer « des tissus fonctionnels, connectés, monitorés ou interactifs », avec ou sans nanotechnologies, à destination du secteur médical, du bâtiment, de la protection ou encore du transport.
L’incubateur Innotex accompagne des start-ups du textile innovant, ensuite développées en sociétés commerciales dans la ruche d’entreprises de La Tossée. L’incubateur a ainsi vu naître Wearismyboat, qui conçoit des vêtements anti-mal-de-mer ou encore Dooderm, qui produit des textiles améliorant les traitements contre les maladies de peau. Mais d’autres start-ups moins reluisantes ont vu le jour, comme une entreprise de décoration de volets roulants, une autre qui commercialise une désopilante application de web-shopping ou encore Evoletik, qui propose des tissus pour customiser les prothèses médicales et qui sont fabriqués… en Italie. Le Centre peut mobiliser diverses entreprises via Clubtex, et Jean-Marc Vienot se targue même d’avoir organisé des journées de travail avec Areva : « Ce sont des savoir-faire et non des produits finis que proposent désormais les entreprises de cette filière. Elle peuvent ainsi travailler pour le secteur automobile et ensuite pour le bâtiment, précise-t-il. On a des savoir-faire spécifiques, car certaines entreprises traditionnelles ont pris le virage de la mutation technologique du textile pour préserver leur business ; un virage qui date d’au moins une trentaine d’année. »
« Reportage sur le textile chez DMC Lille & Loos », 12 juillet 1978, JT FR3 Nord Pas de Calais.
Retour trente ans en arrière, donc. En juillet 1978, un reportage de FR3 se demande si l’industrie textile du Nord a amorcé son déclin ou sa pleine mutation technologique. Chez DMC Lille & Loos, une usine textile du coin, le syndicaliste ouvrier Bernard Robbe s’emporte : « La mort du textile est voulue et a été programmée par le gouvernement et le patronat dès le Septième Plan [14. Instrument de planification de l’économie par l’État français qui a eu cours jusqu’en 2006. Le Septième Plan concerne la période 1976-1980. ], c’est écrit en toute lettres ! » Stoïque, Gérard Thiriez, le président de DMC, répond : « Les industriels du textile ont à relever le défi des pays à bas salaires. On peut arriver à modifier les fabrications textiles et à produire des marchandises plus évoluées. L’expérience a montré que, ces dernières années, des petites et moyennes entreprises se défendaient très bien et arrivaient à adopter le créneau de production qui est demandé sur le marché. Le textile emploie dans la région 100 000 personnes, il est probable que ce chiffre diminue dans les années à venir. Ce qui est souhaitable, c’est que la diminution soit très progressive, il y a une nécessité de reconversion. » Ce contre quoi le syndicaliste s’insurge en conclusion : « Ce problème de reconversion et de restructuration n’est qu’un maquillage d’une volonté politique déterminée et programmée ! »
« L’industrie textile dans le Nord », 8 octobre 1980, Soir 3
En octobre 1980, un autre reportage sur le textile dans le Nord rappelle que 7 chemises sur 10 achetées en France sont désormais produites à l’étranger et proclame pourtant : « Le salut n’est point dans le protectionnisme mais une meilleure compétitivité. » Pascal Watine, dirigeant des filatures du Sartel, à Roubaix, déclare, mal à l’aise, que pour rester compétitif il devra se purger de 20% de ses ouvrier·es d’ici cinq ans. Pour Julien Delaby, syndicaliste du textile, « les investissements des entrepreneurs du textile ont commencé à migrer vers d’autres branches plus lucratives, vers d’autres pays, et se concentrent en France vers la réduction du nombre d’emploi dans les usines. […] Le patronat a délibérément abandonné la formation dont auraient besoin les ouvrier·es pour se reconvertir ». La voix off conclut, fébrile : « Roubaix se refait aujourd’hui une beauté urbaine. Les ruines industrielles sont rasées […]. Comme si la région changeait de vêtement pour en endosser de plus solides. »
Purger délibérément les gens du textile des usines, sans ménagement et sans aucune reconversion possible, afin que les indéboulonnables tenants du secteur puissent se reconvertir dans les textiles innovants pour « préserver leur business »… Tel est le scénario de cette mort annoncée, avec pour visée l’édification du Ceti : « Tout cela a été voulu par le patronat local et sciemment prémédité : quelques années auparavant, les patron·nes faisaient pression sur les élu·es pour que d’autres secteurs industriels ne s’installent pas ici, pour garder une main-d’œuvre docile. Les grandes familles patronales comme les Mulliez, Dewavrin, Prouvost ou Désurmont faisaient la pluie et le beau temps : tout était organisé pour que nous restions les parents pauvres du secteur industriel français, les salaires étaient équivalents dans toute la région, et les ouvrier·es n’avaient pas le choix. Tout cela a fait que l’après-textile a signé notre arrêt de mort. », précisent les ancien·nes salarié·es du Peignage de La Tossée.
Le virage du textile technologique s’est effectué avec les mêmes entreprises familiales, piloté par le même patronat séculaire. Mais les ouvrier·es étaient à la place du mort. Pour elles et eux, il n’y a eu ni mutation, ni reconversion. « La reconversion industrielle constitue un droit pour les populations qui ont fourni la main-d’œuvre de ces industries, clame le collectif de l’Union [16. « Pour le droit à changer d’ère – Plateforme de constitution du collectif de l’Union », novembre 2005.]. Nous savons que, trop souvent, les sites en reconversion sont considérés comme des terrains disponibles qu’il faut remplir d’activités venues d’ailleurs et qui ne bénéficient qu’à la marge à la population des quartiers. » La nouvelle révolution textile est avant tout fondée sur une économie d’innovation créatrice de valeur ajoutée, et non de production. Une économie pour ingénieur·es et jeunes entrepreneur·es pour lesquel·les on modèle désormais la ville : l’Union doit devenir un « éco-paradis » pour cadres supérieurs. Avec un but des plus affligeants : apporter compétitivité à la métropole lilloise et changer l’image de Roubaix.

ACTE IV
Rue de Tourcoing
« On ne nous a pas donné la possibilité de peser sur les décisions »
Au sortir du Ceti, la nuit enveloppe déjà la zone de l’Union. Comme une île au milieu d’un désert industriel, la lumière chaude émanant du café Chez Salah scintille fébrilement au début de la rue de Tourcoing. Salah Oujdane, fringant septuagénaire, ouvre quand bon lui chante et prend ce soir son temps pour me servir des bières. « J’ai racheté le fond de commerce en 1965, mais je continue à travailler, quand j’en ai envie. La retraite, c’est pour les fainéants ! s’amuse-t-il. Un jour, deux personnes de la SEM Ville Renouvelée sont venues. Elles ont commandé à boire et à peine servies, elles m’ont de suite menacé : “De toute façon si vous ne vendez pas, vous serez expulsé”. Je leur ai dit : “Dégagez et ne remettez plus jamais les pieds ici ! ” L’argent, je m’en fous, j’en ai pas besoin et je me défends tout seul, j’ai envie de ne rien devoir à qui que ce soit. »
La bonhommie de Salah Oujdane, devenu symbole de résistance au projet de l’Union, et le charme surranné de son café en ont fait une icône médiatique. Le Monde, M6, TF1, France 3, Public Sénat… tous veulent leur histoire du Gaulois irréductible, tous s’extasient devant son vieux juke-box resté intact et les chaises en formica [17. Bien loin de ces clichés, voir le documentaire réalisé en 2012 par Nadia Bouferkas et Mehmet Arikan, Chez Salah, ouvert même pendant les travaux.]. Salah préfère ce soir se remémorer les habitants du coin et les ouvriers de La Tossée ou des grandes brasseries qui passaient à la sortie du travail boire un verre. L’Union, grouillant des ouvriers des usines voisines, abritait une vingtaine de bistrots, un cinéma… « Le quartier a bien changé… » soupire-t-il.
Nombre de maisons ont été rasées et des habitant·es expulsé·es dans le cadre du projet de réhabilitation de l’Union. L’Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais n’y est pas allé avec le dos de la cuillère, murant les maisons ou démolissant des rues entières. Dans le prolongement de la rue de Tourcoing, autour de l’îlot d’habitations Stephenson, un collectif d’une soixantaine de familles, « Rase pas mon quartier », a été créé en l’an 2000 pour protester face à la destruction des maisons dans lesquelles les ouvrier·es avaient mis toutes leurs économies. Deux ans plus tard, guidés par la peur d’être expulsé·es sans ménagement, la moitié des habitant·es avait déjà quitté les lieux.
Mais pour la SEM Ville Renouvelée, concernant l’îlot Stephenson, « le fil rouge du projet a été d’associer les futurs habitants des maisons rénovées aux choix d’aménagement et d’éco-réhabilitation opérés.[…] En 2013, le quartier reprend vie autour d’habitants historiques, riverains depuis plusieurs décennies, et de nouveaux arrivants. Elles correspondent parfaitement aux besoins actuels : hautes performances énergétiques, alliance du charme de l’ancien et de matériaux modernes, agencement fonctionnel. » À Stephenson, seuls cinq habitant·es originel·les seraient resté·es et une trentaine de maisons ouvrières non démolies ont été réhabilitées. Avec parfois un coût au m2 de 2 700 euros, et malgré qu’un tiers soient qualifiés de « social », les 1~450 logements réhabilités ou neufs prévus sur l’Union seront dans l’ensemble difficilement accessibles aux Roubaisien·nes lambda. « Sur la trame de décennies d’histoire, un nouveau tissu urbain se confectionne aujourd’hui », se vante pourtant la SEM Ville Renouvelée.
Sous les fards de la participation et de la mixité sociale, la concertation avec les habitant·es n’a pas été évidente, la démolition de nombreuses maisons ayant eu lieu avant les réunions [18. À propos des processus de participation et plus généralement de la réhabilitation de l’Union, le journal indépendant lillois La Brique a réalisé un précieux travail d’enquête en novembre 2009 (La Brique, no 18).]… Le collectif de l’Union essaie depuis sa création de jouer le jeu de la participation proposée par la SEM Ville Renouvelée à travers le Club des partenaires, qui rassemble autant les ancien·nes salarié·es de la zone et les comités de quartier que les entreprises présentes, comme Vinci, ou les partenaires économiques de la métropole. « La cicatrice était encore fraîche. On était vraiment méfiant·es au début du projet de l’Union, et toujours dans une période de deuil. Mais on s’est dit qu’ayant contribué à l’effort économique de toute la région, qu’on avait aussi notre mot à dire », explique Bouzid Belgacem, qui participe au collectif de l’Union. Amer, il avouait encore récemment dans la presse locale : « La SEM aurait dû vraiment faire participer les associations, comme les ancien·nes de La Tossée. On avait un projet favorisant l’insertion professionnelle, mais on n’a pas été retenu·es. Il ne s’agissait pas seulement de prendre notre avis, mais on ne nous a pas donné la possibilité de peser sur les décisions [19. La Voix du Nord, 28 août 2014]. » Prix de consolation : les noms des terrains du complexe Kipstadium pourront finalement être choisis par les élèves des écoles primaires roubaisiennes…
Laissés pour compte dans le virage de la révolution des textiles innovants, les gens du textile, les ancien·nes ouvrier·es aux phalanges dévorées par les machines, ceux et celles qui veulent combattre contre l’oubli de leurs luttes et de leurs solidarités tissées sous les cadences infernales des usines, sont ainsi condamné·es à être également les spectateurs et spectatrices des mutations de leur ville. En plein cœur de la friche, en quittant la rue de Tourcoing, un gigantesque « ÊTES-VOUS ICI ? » a été peint sur le pan d’un bâtiment de briques de La Tossée, à deux pas de la Maison de l’Union. L’inscription semble interpeller cyniquement les ancien·nes habitant·es et les ouvrier·es relégué·es du quartier, autant que les tenants de la nouvelle révolution textile, déconnectée de ce que fut le « berceau de l’industrie textile ». Qu’on se rassure, la fresque a été commandée par la SEM Ville Renouvelée.
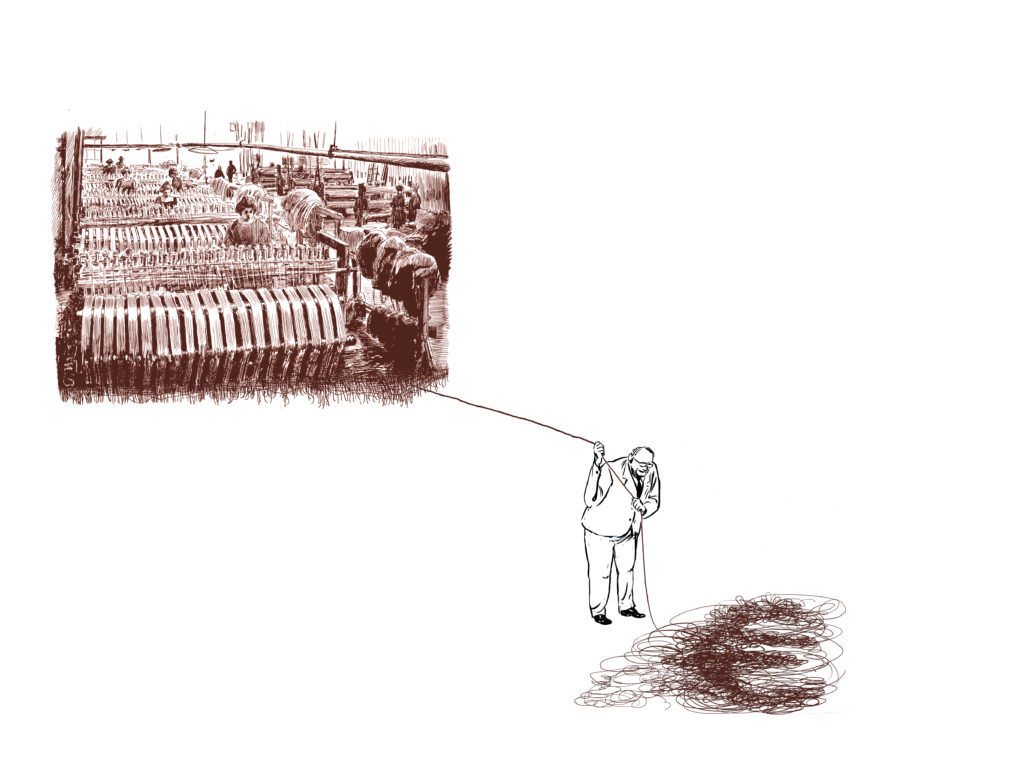
by Mickaël Correia | 10 avril 2017 | Selle de ch’val
Quel point commun entre un cochon élevé à la chaîne par l’industrie agroalimentaire, une professeure de musique en collège, une brebis paissant dans les alpages et un directeur des services vétérinaires pendant la crise de la vache folle ? Tous travaillent. Partant de là, se pose la question de leurs conditions de travail et de leur rapport à cette activité.
Jocelyne Porcher, éleveuse de brebis devenue sociologue, étudie les relations de travail entre humains et animaux d’élevage. Lise Gaignard est psychanalyste et chercheuse en psychodynamique du travail[2. Chroniques du travail aliéné, 2015, éditions D’une.]. Elle s’intéresse non pas à la « souffrance » ou au « bien être », mais plutôt à « la construction psychique liée à l’activité de travail ». Elles confrontent ici leurs manières de penser cette activité particulière qui lie humains et animaux plus souvent qu’on le croit.
Cet article est le deuxième d’une série de six publications issues du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », et publiées en ligne à l’occasion de la sortie du nouveau numéro, « Ch’val de course ».
Télécharchez l’entretien en PDF.
Sur quoi travaillez-vous et comment vous êtes-vous rencontrées ?
Jocelyne Porcher : J’ai été éleveuse de brebis puis j’ai dû arrêter. À 33 ans, j’ai repris un cursus de formation et j’ai obtenu un brevet de technicien agricole et un BTS Productions animales. Lors d’un stage, je me suis retrouvée dans une porcherie industrielle. La rencontre avec la violence productiviste a été un choc. Plus tard, quand je suis arrivée à l’Inra (Institut national de la recherche agronomique) pour un stage d’ingénieur agricole, j’ai découvert les recherches sur le « bien-être animal » : mettre des vaches dans des labyrinthes, infliger des chocs électriques à des moutons pour prouver leur capacité à anticiper… J’ai pu constater que les chercheurs sur le « bien-être animal » ne connaissaient ni les animaux, ni les éleveurs – qu’ils méprisaient ouvertement –, ni même l’élevage. Seules semblent compter leurs petites manip’, leurs publications scientifiques et leur place dans le monde académique. C’est en travaillant avec eux que j’ai décidé de devenir moi-même chercheuse, pour servir d’autres intérêts que ceux de l’agro-industrie. J’ai d’abord travaillé sur l’attachement entre éleveurs et animaux, ce lien formidable observé lors de mon expérience d’éleveuse, mais c’est surtout la souffrance des éleveurs qui ressortait de mes études et donc, j’ai cherché à la comprendre.
Lise Gaignard : Je suis pour ma part psychanalyste et j’ai travaillé dans des cliniques pratiquant la psychothérapie institutionnelle[3. La psychothérapie institutionnelle est une théorie et une pratique thérapeutique en institution psychiatrique qui met l’accent sur la désaliénation, la dynamique de groupe et la relation entre soignants et soignés. Selon celui qu’on considère comme son fondateur, François Tosquelles, la psychothérapie institutionnelle « marche sur deux jambes : Karl Marx et Sigmund Freud », qui permettent de penser ensemble les deux aliénations, l’une psychopathologique, l’autre sociale.]. Pendant la crise de la vache folle, au début des années 2000, j’ai été sollicitée sur la « souffrance au travail » – comme ils disent – des directeurs des services vétérinaires (DSV). Ils n’arrivaient pas à organiser les abattages de troupeaux ; cela leur faisait des cauchemars. Ils s’étaient dit qu’une psychanalyste, c’était bien, pour leur enlever les cauchemars.
J. P. : C’est à cette époque que nous nous sommes rencontrées, au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Suite à mon recrutement à l’Inra, j’avais été détachée au Laboratoire psychodynamique du travail et de l’action de Christophe Dejours : je faisais des enquêtes sur le travail dans les porcheries industrielles, et c’est en mobilisant la psychodynamique[4. La psychodynamique du travail est une discipline créée par Christophe Dejours au début des années 1970 afin d’analyser les processus psychiques mis en place par une personne face à la réalité du travail. Elle étudie les problèmes de relations entre les différents partenaires de travail et les processus subjectifs et psycho-affectifs mobilisés par les contraintes du travail.] que j’ai pu faire ces recherches en étant moi-même moins en souffrance. J’allais chez les gens, ils étalaient leurs histoires, ils pleuraient et je les laissais en larmes sur leur table de cuisine. Je me suis dit que quelque chose n’allait pas, qu’il fallait prendre les choses autrement, avoir une réponse collective à la souffrance exprimée par les éleveurs.
L. G. : L’élevage industriel est quelque chose de construit collectivement dont, au fond, tout le monde est plus ou moins responsable. Les enquêtes de Jocelyne sur la souffrance dans les porcheries ont politisé la question, laquelle est complexe, puisque les victimes sont aussi les coupables. La psychodynamique du travail montre que les victimes, ce sont aussi bien les cochons que les éleveurs ou les vacanciers qui vont sur les plages pleines d’algues vertes. Son travail permet de sortir des fausses alternatives que portent les experts du bien-être animal et les abolitionnistes de toute forme « d’exploitation animale[5. C’est-à-dire y compris l’élevage (qu’il soit industriel ou paysan) ainsi que toute forme de domestication.] ».
J. P. : Surtout que les cochons ne sont pas seulement des victimes ; ils collaborent au travail. Ils sont comme nous : ils sont trop bons, ils supportent tout par excès de gentillesse. C’est en cela que la question du travail est intéressante : les cochons perçoivent nos désirs et cherchent à bien se comporter pour nous faire plaisir.
Sur quelle définition du travail vous appuyez-vous pour questionner l’une, les animaux au travail, l’autre les salariés qui vous consultent ?
J. P. : Pour penser les animaux au travail, je me suis d’abord appuyée sur Le Manuscrit de 1844 de Karl Marx : le travail y est avant tout décrit comme un rapport émancipateur à la nature, une action sur le monde pour le transformer. Cela m’a permis de comprendre comment et pourquoi on vivait avec les animaux. Je suis partie de cette hypothèse : c’est le travail qui nous réunit et qui nous permet de vivre ensemble. Les éleveurs ne vivent pas avec les animaux pour gagner de l’argent. Ils n’en gagnent pas. Ils travaillent avec les animaux parce qu’ils veulent vivre avec eux.
Car travailler, c’est d’abord vivre ensemble, c’est chercher à s’émanciper des contraintes et de la tragédie de la vie. En élevage, le travail permet, aux animaux comme à nous-mêmes, de comprendre et d’appréhender les choses, de les maîtriser un peu pour que le moment de vie en commun entre éleveurs et animaux devienne autre chose qu’une tragédie – même si ça finit tragiquement pour les animaux et pour nous-mêmes.
L. G. : Il faut bien distinguer travail et emploi. J’utilise deux définitions. D’abord celle de Claude Veil dans Psychiatrie et milieu de travail[6. Dans Psychiatrie française, vol. XXVII/96.] : le travail, c’est toute production de services ou de biens entraînant des liens entre les personnes. Quand on emmène son gamin à l’école, on travaille. Ça permet de déstabiliser la question, de la complexifier. On sort de la définition sociologique du travail, qui est souvent recouverte par la question de l’emploi, ce qui fait qu’on ne sait souvent plus de quoi on parle dans les débats publics. Le travail pose la question de la production commune d’une société.
L’autre définition, c’est celle de la psychodynamique du travail, de Christophe Dejours : le travail est l’effort ajouté à la prescription pour qu’elle devienne réalisable. On a toujours une prescription qu’on ne pourra pas mettre en œuvre parce qu’elle est trop loin du réel, parce qu’il y a des prescriptions contradictoires – faire vite et faire bien et en toute sécurité. On doit donc arbitrer en permanence entre ce qu’on fait et ce qu’on dit. Le travail, c’est alors l’effort que je produis pour faire au mieux, c’est-à-dire au moins mal, en fonction de ce qu’on m’a demandé et de ce qui est possible. Cela dépend aussi de si je suis fatiguée ou en pleine forme, de retour de vacances ou déjà à bout le lundi. Il s’agit de réfléchir sur cet investissement, qui est totalement invisible, car les arbitrages ne durent qu’un quart de millième de seconde : on est pris dedans. Or, c’est là que réside la marge de manœuvre qui permet de ne pas laisser les gens en train de pleurer sur la table de la cuisine.
J. P. : J’ai pu aussi le vérifier dans mes recherches : le travail des vaches ne réside pas tant dans le suivi de procédures que dans leur effort pour bien faire, sans lequel ça ne marche pas. Nous l’avons montré avec Tiphaine Schmitt en étudiant le rapport des vaches au robot de traite dans une exploitation laitière[7. Jocelyne Porcher et Tiphaine Schmitt, « Les vaches collaborent-elles au travail ? Une question de sociologie », Revue du MAUSS, 2010/1 (no 35), p. 235-261.], pour lequel il n’y a pas de procédure : les vaches se débrouillent entre elles pour accéder à la machine. Nous avons montré que cet ajustement n’est pas de l’ordre du conditionnement ni de la hiérarchie, mais consiste en un ensemble d’arrangements entre les vaches elles-mêmes, assez drôle à observer. Certaines peuvent même enrayer la machine : il y en a une par exemple qui s’était arrêtée une demi-heure à l’entrée du robot, avec les autres qui piétinaient derrière. Elle a bloqué le système, volontairement.
L’enjeu est de montrer aux éleveurs qui ne le perçoivent pas que les vaches conservent une marge d’autonomie, même si elles ont l’air d’agir soit par conditionnement soit parce qu’elles sont contraintes. Les concepteurs des machines à traire s’efforcent d’ailleurs de réduire cette marge, pour que les vaches ne soient que des pions, forcées de suivre le chemin prévu. Ils s’efforcent en fait de les empêcher de travailler.
L. G. : Ici, le travail de la vache, c’est l’effort pour rendre le robot de traite à peu près utile.
J. P. : Le travail est un investissement dans la production, mais la vache ne produit pas du lait. Elle se moque de la courbe de production. En revanche, elle a conscience de toute l’organisation autour d’elle, et agit pour que tout se passe bien. C’est plus facile de parler de travail concernant les chiens de berger, les chiens policiers ou d’aveugle, parce qu’ils ont une vision de la finalité de leur travail : c’est une production de services. Mais même ceux qui forment les chiens le perçoivent souvent comme du conditionnement. Pourtant, les chiens de berger sont encore plus au fait du travail que le berger lui-même, car ils connaissent mieux les brebis. Il y a donc ceux qui prennent des initiatives et ceux auxquels le berger dit sans cesse : « À droite, à gauche, devant, derrière », qui sont finalement comme des automates. Mais on retrouve plus souvent les chiens automates dans les concours que dans les alpages.
L. G. : Au fond, la plupart des salariés ne savent pas plus ce qu’ils produisent que la vache qui produit du lait ou de la viande. Ils font, ils aménagent, souvent ils désobéissent, mais ils ne savent pas ce qu’ils produisent. Par exemple, un maître d’école n’a pas forcément conscience de participer à la production d’une société inégalitaire. On ne produit pas forcément ce qu’on croit.
J. P. : En tous cas, si on dit que les animaux travaillent, cela nous oblige à questionner l’organisation de ce travail, par exemple la question du temps de travail. Avec une vache laitière, on peut penser une organisation qui tienne compte de son statut de travailleur, y compris les pauses. En revanche, un porc charcutier est à l’usine 24 h/24. Et la seule porte de sortie, c’est l’abattoir.
Le travail est-il le seul mode de relation possible avec les animaux domestiques ?
J. P. : Le travail est partout, même dans les relations avec les animaux de compagnie. J’ai une chienne, et si son travail, c’est de me tenir compagnie, où est le champ du hors-travail ? Si je lui dis : « Aujourd’hui je travaille », et que je m’installe devant mon ordinateur, elle se met dans un coin et ne bouge plus. C’est un travail sur soi : elle est en forme, elle voudrait courir, aboyer, mais tant que je suis plantée devant mon ordinateur, elle attend. En revanche, si j’emmène ma chienne à la plage, elle fait ce qu’elle veut, et c’est moi qui suis à son service, qui surveille : c’est moi qui travaille.
À un moment, il y a du travail, de la production, de l’engagement, et à un autre du dégagement. C’est un changement de monde : les animaux sont dans le travail, dans notre monde à nous, ou plutôt le monde commun humains/animaux, et à un moment donné, ils sont dans leurs propres affaires.
Les animaux sauvages travaillent-ils aussi ?
J. P. : Pas tous. Les fourmis et moi, nous n’interférons pas. Peut-être sont-elles travailleuses, mais leur concept de travail ne regarde qu’elles. En revanche, certains animaux dits sauvages travaillent, comme les cétacés qu’on équipe d’un GPS pour surveiller le climat. On les capture, on les surveille, et les animaux le savent. Sans doute en pensent-ils quelque chose, et il se peut que cela fausse les résultats, comme dans les expérimentations animales[8. Voir Jef Klak nº 3 « Selle de ch’val »: « Les moutons ont des amis et des conversations. Comment les animaux désarçonnent la science. Entretien avec Vinciane Despret. ».]. Peut-être que ces baleines continuent leur vie comme avant de « travailler » pour nous, mais peut-être pas, ou pas autant qu’on ne le croit. À partir du moment où les animaux se demandent ce qu’on bidouille avec eux, ce qu’on leur veut, et qu’ils répondent, on peut considérer qu’ils travaillent.
Les animaux ont-ils un statut différent en « production animale » – c’est-à-dire industrielle – et dans les élevages paysans ?
J. P. : Lors de la crise porcine de 2015, un gros producteur de porc se plaignait dans la presse : « Je vais être obligé de licencier mes ouvrières. » Là, les truies renvoient à l’ouvrier aliéné, jetable, exploité au maximum. En revanche, dans l’élevage « véritable », les animaux ont un statut de travailleur, de partenaire, de collègue de travail. Un idéal de la relation de travail peut alors s’inventer, équitable dans une certaine mesure, où la coopération serait privilégiée – sans nier que nos relations aux animaux sont de toute façon asymétriques.
L. G. : Cette notion de « collègue de travail » est tout de même compliquée : normalement, on ne tue pas les collègues et on ne les mange pas à la fin de leur contrat.
Comment circule la souffrance entre salariés et animaux dans les porcheries industrielles ?
J. P. : On force la truie à produire de dix-huit à vingt-six porcelets par portée – une truie n’a que seize tétines. Par conséquent, la mise à bas est trop longue et les derniers porcelets risquent de mourir. Donc un salarié doit « fouiller » la truie, c’est-à-dire aller chercher les porcelets dans l’utérus. Ça lui fait mal. Le salarié se met à sa place. Si c’est une femme ayant des enfants, elle se dit : « Je suis mère moi aussi. » Il y a un côté charnel, une empathie de corps : on est si près des animaux qu’on ressent leur souffrance dans son propre corps.
J’appelle cela la « contagion de la souffrance ». Plus qu’une interaction, c’est une espèce de balance mutique de la souffrance, comme une contagion de quelque chose de sourd qui passe des animaux aux humains. C’est plus explicite chez les femmes que chez les hommes, qui ont des défenses viriles plus fortes[9. Ce concept de défense virile a été développé notamment par Christophe Dejours dans Souffrances en France. La banalisation de l’injustice sociale, Seuil, 1998.]. Même si les salariées essaient de maintenir un écart avec l’animal, comme un filtre, les animaux le dissolvent en se rapprochant d’elles. Cela produit une espèce de magma où la souffrance passe facilement. « On fait souffrir les animaux, et moi, je participe à ça. Les truies ne m’aiment pas, je sais pourquoi, mais j’aimerais bien qu’elles m’aiment. Je les fais souffrir, mais je fais de mon mieux. Mon chef me dit de tuer les porcelets chétifs, mais je ne le fais pas, je leur donne le biberon, j’y passe des heures. » Il y a aussi une souffrance éthique, morale, liée à la conscience de sa collaboration à un système qui génère de la souffrance.
Et les producteurs, est-ce qu’ils souffrent aussi ?
J. P. : Les producteurs sont coincés, ils ne peuvent pas quitter ce système de production. Ils ont fait le mauvais choix au mauvais moment et se sont laissé bourrer le mou, par intérêt voire par cupidité. En plus, ils ont souvent un taux d’endettement de 180% et les banquiers sur le dos. Dès lors, ils ne pensent qu’à extirper la matière animale des bestioles pour la transformer en fric et rembourser la banque. C’est pour ça qu’ils sont obligés d’aller pleurer à la télévision pour réclamer moins de normes : « Arrêtez de nous saouler avec l’environnement, avec le bien-être animal. » Le bien-être animal est bien utile à la filière dont il permet de redorer le blason, mais c’est une autre histoire pour le pauvre gars qui se retrouve bloqué par ces nouvelles contraintes, et ne peut plus inséminer ou faire ses piqûres comme il veut…
Quels sont les soubassements théoriques du bien-être animal ? En quoi consistent les études sur le bien-être animal dans les productions industrielles ?
J. P. : Le bien-être animal est directement issu de la zootechnie[10. La zootechnie est l’ensemble des sciences et techniques mises en œuvre dans l’élevage des animaux pour l’obtention de produits ou de services à destination de l’homme (viande, lait, œufs, laine, traction, loisirs, etc.).], qui cherche à rendre la machine animale productive dans un certain environnement. Il faut aussi chercher du côté des théories du conditionnement, de l’éthologie comportementale et surtout de l’éthologie appliquée, qui est devenue la véritable zootechnie du XXIe siècle : l’étude du comportement animal à visée économique – comment faire pour que la caille, le porc ou le chat produisent le plus possible dans les systèmes industriels et intensifiés, et pour que cela soit accepté socialement.
Cela fait quarante ans que l’Union européenne finance les études sur le bien-être animal en industrie. Quand j’ai commencé à travailler dans les porcheries industrielles, les truies avaient une sangle qui s’incrustait parfois dans leur chair. La souffrance était visible. Ils ont enlevé la sangle et ont mis les truies en cage. Désormais, bien-être animal oblige, ils ont aussi enlevé la cage, en partie – la truie gestante, théoriquement, n’y reste qu’un mois. Mais ils mettent huit truies ensemble dans un minuscule espace en béton, sur caillebotis, et elles finissent par se battre entre elles – par ennui. Cela nous est présenté comme une amélioration du bien-être animal.
Dans les faits, mes collègues qui étudient la question ne mettent jamais les pieds dans une porcherie ; ils collaborent jour après jour, depuis quarante ans, faisant tourner un système qu’ils prétendent améliorer mais qu’ils ne connaissent pas. Bref, le bien-être animal se résume à assurer la durabilité de cette abjection qu’est le système industriel.
Et le « bien-être au travail », quel est son origine, ainsi que son rôle ?
L. G. : Les sciences du travail et les psychologues du travail existent depuis l’avènement du taylorisme à la fin du XIXe siècle. Les premières études se sont focalisées sur la fatigue, l’engagement, les recrutements, les tests d’aptitudes. Auparavant, personne ne se préoccupait de savoir si un cordonnier aimait le cuir ou pas, comment faire pour qu’il soit tout le temps en forme psychiquement et ne se suicide pas le lundi matin. Il a fallu attendre l’ingénieur américain Frederik Taylor – puis Henry Ford et leurs successeurs – pour que soit théorisée la productivité humaine. Ils ont d’ailleurs très bien réussi : le travail humain n’a jamais autant rapporté qu’actuellement. Aujourd’hui, les psychologues du travail sont toujours au même endroit, sauf qu’ils ont deux casquettes : coachs et spécialistes de la « souffrance au travail », avec les mêmes formations, employeurs et conditions de travail. Le coaching marche moins bien ces derniers temps, mais avec la récente loi sur les risques psychosociaux[11. Le Code du travail français est longtemps resté sans inclure l’aspect mental pour définir les mesures de protection de la santé au travail. Cette idée a été introduite en 2002 par la loi de modernisation sociale, qui remplaça le mot « santé » par les mots : « santé physique et mentale » dans le Code du travail. L’employeur doit désormais prendre en compte tous les risques psychosociaux (RPS) c’est-à-dire les risques concernant non seulement l’intégrité physique des salariés, mais aussi leur santé mentale : le stress, l’épuisement, la souffrance, ou encore le harcèlement moral.], nombre de psychologues se retrouvent à travailler dans les entreprises, se spécialisant dans la filière du bien-être au travail. Ils travaillent pour EDF ou pour la Poste, et reçoivent les salariés pour leur dire : « Ayez des pensées positives ! » C’est un marché juteux.
Le changement le plus frappant dans le monde du travail aujourd’hui est justement cette idée d’envoyer les salariés « chez le psy » pour évacuer la perception de la souffrance : il faut qu’ils soient de nouveau en mesure d’exercer des techniques de travail toujours plus désocialisantes. C’est une dépolitisation totale.
Le pire, c’est que cette mascarade est parfois défendue par les syndicats eux-mêmes : au lieu de lutter sur les conditions de travail, ils voudraient que l’on dénonce les chefs harceleurs. Or, ces cadres sont eux-mêmes constamment sous pression : comme leurs évaluations, et donc leurs salaires, dépendent désormais directement de la production des autres, ils harcèlent leurs subalternes pour que ça aille plus vite, pour les pousser à enlever les sécurités, etc.
Il m’arrive de recevoir dans mon cabinet des salariés que m’envoient des médecins du travail ou des syndicalistes, mais je ne veux pas figurer sur le listing des psys spécialisés dans la « souffrance au travail ». Ceux-là se contentent de conseiller aux personnes harcelées par des chefs pervers-narcissiques de se mettre en arrêt-maladie. Mais le problème n’est pas médical. Après l’arrêt-maladie, si le salarié ne peut pas retourner travailler, la Sécu va l’envoyer à la Maison départementale des personnes handicapées avec une allocation adulte handicapé, et ses revenus vont baisser rapidement. C’est la manière la plus pratique et la plus courante de se débarrasser des travailleurs aujourd’hui. Je ne me bats donc pas tant contre le « bien-être au travail » que contre ceux qui sont obnubilés par la question de la souffrance au travail, et qui emmènent tout le monde dans ce qui est clairement une catastrophe nationale.
Comment se passe la consultation ?
L. G : Des salariés qu’on n’a pas réussi à calmer arrivent dans mon cabinet : ceux qui embarrassent tout le monde, qui parlent de se suicider au travail et risquent de faire exploser les statistiques. Pour éviter ça, certains services de médecine du travail acceptent de payer 110 euros pour qu’ils viennent passer une ou deux séances de deux heures dans mon bureau.
Ce sont en général des cadres, des professions intermédiaires, très peu d’ouvriers. Jamais des précaires. Ils commencent toujours l’entretien en racontant comment on les a rendus malades. Ils démarrent toujours de la même manière : « J’ai un chef pervers narcissique. » Ils en ont toujours un. Je leur demande ensuite ce qu’ils font comme travail. Ils répondent par exemple : « Je suis professeur de musique. » Et ils décrivent donc leur activité : « On a cinq classes de sixième la première année, on ne sait jamais le nom des élèves, on les a une heure par semaine, on n’y comprend rien. » Ils parlent ensuite des rapports de domination, de la hiérarchisation symbolique des matières : au collège, le haut, c’est les maths, après c’est la physique-chimie, puis les lettres, les langues et en dernier, il y a les arts plastiques et la musique.
Puis vient l’anecdote : elle s’est fait caillasser par des élèves avec de grosses boules de neige, jusqu’à l’intérieur de sa voiture, où elle se retrouve toute trempée le dernier jour de l’école avant Noël. Le directeur du collège passe à côté, elle lui demande de l’aide, et lui rigole. Elle a fait une dépression et n’est jamais retournée travailler.
Bref elle était désagréable avec les élèves, ces derniers étaient d’une cruauté effroyable envers elle, et le directeur également. C’était un rapport terrifiant.
Elle est donc entrée dans mon bureau avec des élèves délinquants et un principal de collège pervers-narcissique – et elle en avait des preuves. Mais elle est ressortie avec une autre vision : « Professeur de musique, ce n’est pas une vie, et les collèges, c’est l’enfer pour tout le monde. » Et c’est vrai. Elle était moins « rendue folle », mais plus embarrassée. Elle a arrêté de croire qu’on lui voulait du mal et s’est retrouvée dans une espèce d’incertitude, alors qu’avant, elle avait une solution : dresser les gosses et faire virer le principal. C’était pas compliqué – à part à mettre en œuvre –, mais le prix de tout cela, c’est qu’elle ne dormait pas, que plus personne ne lui téléphonait. Elle était seule car elle était trop pénible.
Le prix d’une vie plus lucide, c’est d’être davantage contrarié et, éventuellement, de passer à l’action. Qu’est-ce que l’action pour un prof de musique ? Se remettre au piano ? Je n’en sais rien. Ce sont les gens qui savent ce qu’il faut qu’ils fassent. Mais à un moment, on rentre dans l’embarras de la question de la société, du vivre ensemble au sens noble. Comment faire pour ne pas s’entretuer ? Comment faire un collège ? Il y a des établissements où ça se passe extrêmement bien. Même avec les profs de musique !
Au début des années 2000, tu as enquêté sur la « souffrance au travail » des directeurs de services vétérinaires pendant la crise de la vache folle. Peux-tu nous raconter cette expérience ?
L. G. : Les directeurs de services vétérinaires (DSV) ressentaient de la « souffrance au travail » parce qu’ils devaient abattre des troupeaux entiers à la moindre alerte, alors que, ne sachant pas comment la maladie se propageait, ils étaient scientifiquement contre les abattages. Mais ils étaient obligés.
Ces directeurs sont des hauts fonctionnaires qui travaillent avec le préfet pour faire appliquer les réglementations étatiques à propos du commerce de la viande : en temps normal, ils ne s’occupent pas d’animaux mais uniquement de produits animaux.
Peu de temps avant, on leur avait demandé d’organiser la mise à mort de tous les veaux d’un jour[12. Les éleveurs pouvaient à l’époque bénéficier de « la prime Hérode », une compensation financière européenne accordée pour l’abattage des jeunes veaux.], ce qui ne leur avait pas posé trop de problèmes ; il suffisait de signer un bout de papier pour les envoyer à l’abattoir. Mais cette fois, on leur demandait d’organiser l’abattage eux-mêmes, dans des équarrissages[13. L’équarrissage est le lieu où on traite les cadavres d’animaux morts hors des abattoirs.] qui n’étaient pas assez grands. Il fallait inventer. Ils ont dû faire appel à des gens qui savent tuer les bêtes – ceux qui avaient travaillé toute la semaine à l’abattoir rempilaient donc le dimanche – et ils abattaient aussi dans les champs. Et puis les bêtes ne sont pas si bêtes que ça : par exemple, des veaux d’un jour dont on venait de tuer la mère passaient à travers les clôtures. Bref, ç’a été un merdier total.
Pour les DSV, voir arriver sur leur écran : « Il y a un sérodiagnostic positif dans l’élevage de M. Machin, trois cents vaches », c’était l’angoisse. Comment faire alors pour ne pas souffrir ? D’autant qu’on leur demandait de faire couper toutes les têtes pour prélever un bout de cerveau et l’envoyer à Paris : il pouvait y avoir de grandes tables avec trois cents têtes de vaches. Les DSV n’ont jamais eu les résultats des examens.
Après ça, ils devaient répondre aux médias et raconter qu’ils donnaient des biftecks hachés à leurs propres enfants. On allait manger au restaurant La Boucherie le midi avec eux et ils commandaient du tartare… Une vétérinaire avait même dit : « Je suis prête à me faire filmer en train de mettre du sang de vache dans le biberon de mon bébé. » C’est un réflexe défensif : comment faire quand on réprouve son travail ? Il faut aller jusqu’au bout, sinon c’est trop dur. Les éleveurs, quant à eux, souffraient énormément. Or la consigne du préfet était « Aucun suicide d’éleveur ». Et ils ne se sont pas suicidés !
J. P. : Pas tout de suite !
L. G. : Les autorités ont proposé de leur offrir deux fois le prix du troupeau en compensation. Mais les éleveurs disaient : « Ce n’est pas une histoire de fric ! Comment vais-je refaire un troupeau ? Celui-là, ça fait trente ans que je le fabrique ! »
Est-ce pour des raisons similaires que certains éleveurs de brebis refusent une compensation financière quand quelques bêtes sont tuées par des loups – ce qu’on appelle la « part du loup » ?
J. P. : Pas exactement. Les brebis ont été domestiquées il y a 8 000 ans, c’est l’animal d’élevage par excellence. La brebis fait confiance à l’éleveur pour pâturer tranquillement, pour échapper à son destin de proie. Le premier engagement de l’éleveur est de protéger ses bêtes de la tempête, des ravins, de la maladie, du loup. Si une brebis se fait manger, c’est le troupeau entier qui est stressé, les liens entre les brebis et l’éleveur sont pulvérisés. Les éleveurs s’en fichent du chèque de compensation ; au contraire, c’est le prix de leur trahison. Je me suis appuyée sur la théorie du don de Marcel Mauss[14. Marcel Mauss, « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », L’Année sociologique, 1923-1924.] pour penser l’élevage : nous mangeons les animaux domestiques, en échange de quoi nous sommes tenus de leur offrir une belle vie. Et la mort des animaux n’est pas le but du travail mais le bout. Aujourd’hui, les éleveurs ont l’impression de ne plus être à la hauteur de ce que donnent les animaux.
Je n’ai rien contre les loups, mais ils ont compris qu’ils étaient protégés : puisqu’on élève des brebis pour eux, pourquoi se fatigueraient-ils à chasser d’autres animaux ? Ils sont eux aussi domestiqués, mais contre les brebis.
Tu dis souvent que travailler avec des animaux, c’est aussi se coltiner la mort, et par extension le vivant, question qu’écartent selon toi les véganes et les abolitionnistes…
J. P. : Le problème, c’est que les abolitionnistes croient avoir la solution : c’est mal de faire souffrir et de tuer les animaux, donc il faut arrêter de les manger, de les élever, de se les approprier. Il y aurait le bien d’un côté et le mal de l’autre. Il suffirait d’abolir l’élevage, y compris pour les animaux familiers. Comme le bien-être animal, qui consent à la violence du système industriel, la libération animale se donne comme vertueuse envers les animaux, mais consent de fait à leur disparition – avec pour logique implicite « Si tu ne nais pas, tu ne souffres pas ».
Selon moi, le véganisme rejoint les intérêts de ceux qui veulent prendre en main l’élevage, en l’occurrence les multinationales et les fonds d’investissement. La Fondation Bill Gates soutient par exemple des entreprises[15. Beyond meat et Hampton Creek Foods. Hampton Creek Foods est également soutenue par des fonds d’investissement comme Khosla Venture. La firme multinationale Cargill, de son côté, a breveté un substitut de fromage, le Lygomme ACH Optimum, essentiellement constitué d’amidons.] qui proposent des ersatz de poulet sans poulet, du bœuf sans bœuf, du fromage sans lait, de la mayonnaise sans œufs… Ça les arrange qu’on soit convaincus que c’est mal de manger des animaux : cela leur permet de nous vendre leurs nouveaux produits.
On arrive au bout du bout de notre rapport industriel aux animaux, que ce soit au niveau de l’éthique, de l’environnement, de la santé… Mais nous vivons dans un monde capitaliste où la solution est une nouvelle industrialisation. En plus de ces succédanés de viande, les multinationales et les fonds d’investissement cherchent à créer une industrie de la viande 2.0, à produire une viande sans animaux, car les animaux restent un frein à la production. En défendant le projet d’une production de viande in vitro (élaborée en cultivant des cellules souches en laboratoire), les abolitionnistes ne font pas le service après-vente, mais le service avant-vente. Les consommateurs de viande industrielle consentent tout de suite à un système industriel qui a cours, alors que les véganes militants consentent à un système qui arrive.
Bien sûr, les productions animales font souffrir horriblement les animaux et les salariés, elles contribuent à la destruction de la biodiversité et ont un impact réel sur le climat. Mais ce sont les systèmes industrialisés qui en sont responsables, pas l’élevage. Depuis 10 000 ans, l’élevage est, au contraire, en harmonie avec la planète. L’élevage, c’est vivre et travailler avec des animaux. Faire naître et élever. C’est un métier de la reproduction et de la relation. Une relation entre humains et animaux, et une relation commune à la nature. Les vaches font la prairie, comme les moutons dessinent les pentes de la montagne. Sans les animaux d’élevage, la forêt est à la merci des incendies : ils rendent notre environnement habitable, varié, beau.
La filière bio ne s’est que tardivement intéressée à l’élevage. Pourquoi ?
J. P. : La viande bio est commercialisée comme bonne pour la santé et l’environnement, pas pour la qualité du travail des éleveurs et des animaux. Quand je travaillais à Ecocert[16. Organisme de certification de l’agriculture biologique.], lors de sa naissance au début des années 1990, j’étais étonnée que beaucoup de maraîchers soient végétariens et considèrent les éleveurs comme des « viandards ». La filière bio est née des enjeux de la relation à la terre, à la plante, sans considérer tout de suite – sauf les biodynamistes – la relation homme-animal-plante. Aujourd’hui, ce secteur s’intéresse à l’élevage, notamment sous l’impulsion des consommateurs, depuis que les pratiques des systèmes industriels se sont ébruitées, et bien sûr à cause des scandales sanitaires.
Quand on vit en ville, sans contact avec des éleveurs, on n’a quasiment pas d’autre choix que de ne pas manger de viande si on ne veut pas alimenter l’industrie de production animale…
J. P. : Il est plus compliqué de vendre une viande saine et de qualité en circuit court que des légumes bio, notamment parce que la viande et le fromage doivent être réfrigérés pour le transport et la conservation. Mais pourquoi ne pas mettre en commun une camionnette frigorifiée et s’organiser avec des éleveurs ?
L. G. : La question de l’élevage concerne la vie quotidienne de tout le monde. Comment fait-on au jour le jour ? Que promouvoir de façon collective ? Les Amap fonctionnent bien pour les légumes, les petits maraîchers se sont bien débrouillés pour se rendre accessibles, pourquoi pas les éleveurs ? Des listes de psychanalystes féministes, non homophobes, élaborées par des usagers circulent sur Internet, et c’est une très bonne chose. On pourrait s’inspirer de ça pour les bouchers, les éleveurs. On ne s’organise pas assez sur la viande.
Ne devrait-on pas repenser aussi l’abattage ?
J. P. : C’est une question centrale, qui revient sans cesse chez les éleveurs que je connais : comment faire pour abattre à la ferme ? C’est pourquoi je participe à la création d’un groupe avec des éleveurs, des vétérinaires, des journalistes et la Confédération paysanne, pour faire changer la loi qui oblige à passer par les abattoirs[17. À ce sujet, lire J. Porcher, E. Lécrivain, S. Mouret, N. Savalois : Livre blanc pour une mort digne des animaux, Les Éditions du Palais, 2014. ]. Aujourd’hui encore, certains se risquent à abattre à la ferme, ni vu ni connu. Quand j’étais éleveuse, je ne suis jamais allée à l’abattoir, mais je n’aurais pas tué mon mouton moi-même : il faut un tueur pour cela, c’est un métier, et il y en a de moins en moins.
Pour ma part, je défends l’abattage à la ferme, mais mes collègues scientifiques défendent au mieux l’abattoir de proximité. L’Institut technique du porc (ITP) veut court-circuiter les résistances en créant des abattoirs de proximité dépendants de la filière industrielle. C’est ce qui m’étonne toujours avec l’industrie, et le capitalisme en général : pourquoi veulent-ils tout ? Pourquoi forcent-ils les petits bergers du Lubéron à passer par des abattoirs industriels ?
L. G. : Le capitalisme n’existe pas, ce ne sont que des gens qui le mettent en œuvre, comme dans l’exemple des Directeurs des services vétérinaires. Ce sont eux qui font appliquer les lois et les réglementations commerciales, et toute alternative leur donne des cauchemars, surtout si ça concerne la vie et la mort. Vu que ce ne sont pas les petits éleveurs qui nourrissent la France, ils peuvent les faire fermer. C’est ça le progrès, c’est ça la vie hygiénique.
J. P. : J’essaie de travailler la question du rituel avec les éleveurs. Une d’entre eux m’a dit récemment : « À l’abattoir, on n’a même plus la place de parler une dernière fois aux animaux. » Avant, au moment de laisser l’animal, son mari récitait une poésie indienne rituelle, à voix haute. Depuis que je travaille sur cette question, je me suis rendu compte que beaucoup d’éleveurs font ça. Moi, je le faisais aussi, dans ma tête. Et quand je mange de la viande, je visualise l’animal. J’en mange en conscience, en lien avec les animaux.
L. G. : Notre rapport au monde est fondé en premier sur notre rapport au vivant. Les animaux sont là, qu’on les mange, qu’on les tape ou qu’on les caresse, et nos relations avec eux sont fondatrices. Les psychanalystes nient trop souvent ce qui est de l’ordre de l’environnement et de l’expérience vécue, au bénéfice de relations strictement familiales de type père-mère-enfant. Alors que sur le divan, les gens nous parlent de leurs nourrices, de leurs maîtresses d’école, de leur chien, de leurs vaches. Cela a longtemps été considéré comme des résistances au triangle œdipien, mais la théorie psychanalytique est en train de changer. Il est courant que quelqu’un ait bien tenu le choc suite à la mort d’un proche, mais s’effondre deux ans plus tard suite à la mort de son chat, pour les deux. Et d’autres assument qu’ils ont eu plus de mal à faire le deuil de leur chien que celui de leur mère. Tout le monde le sait, mais on ne l’écrit jamais.
J. P. : Ce que je me demande, c’est comment ça se passe pour les animaux. Les animaux engagés dans le travail rêvent-ils du travail ? Est-ce que les vaches rêvent du travail ?
L. G. : De quoi d’autre veux-tu qu’elles rêvent ?

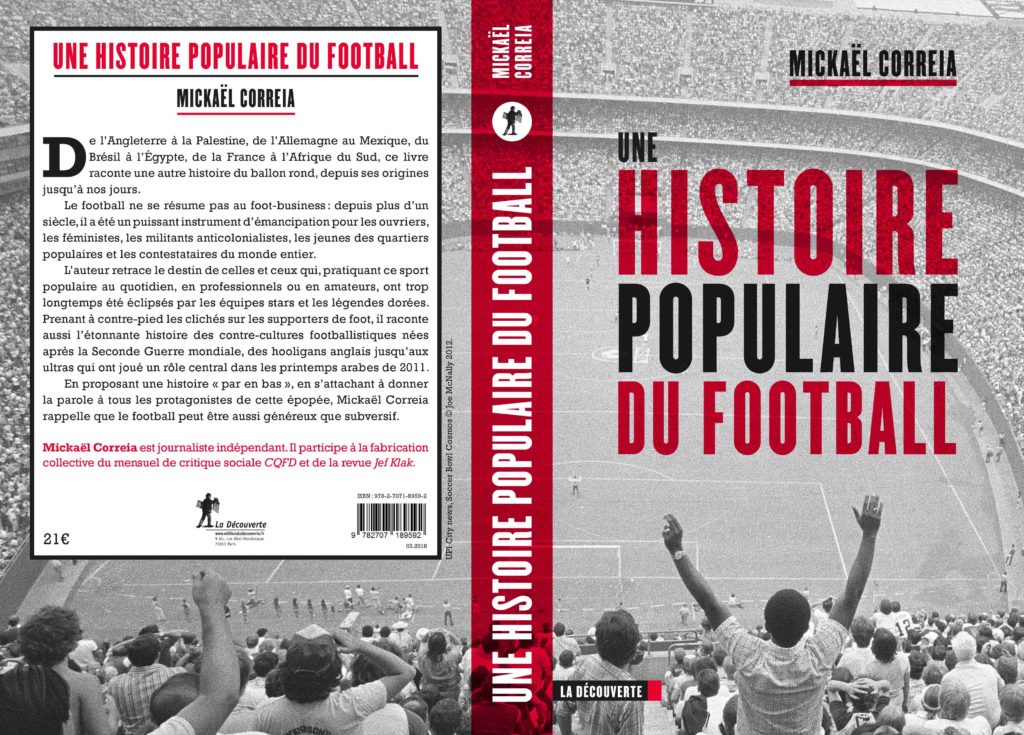

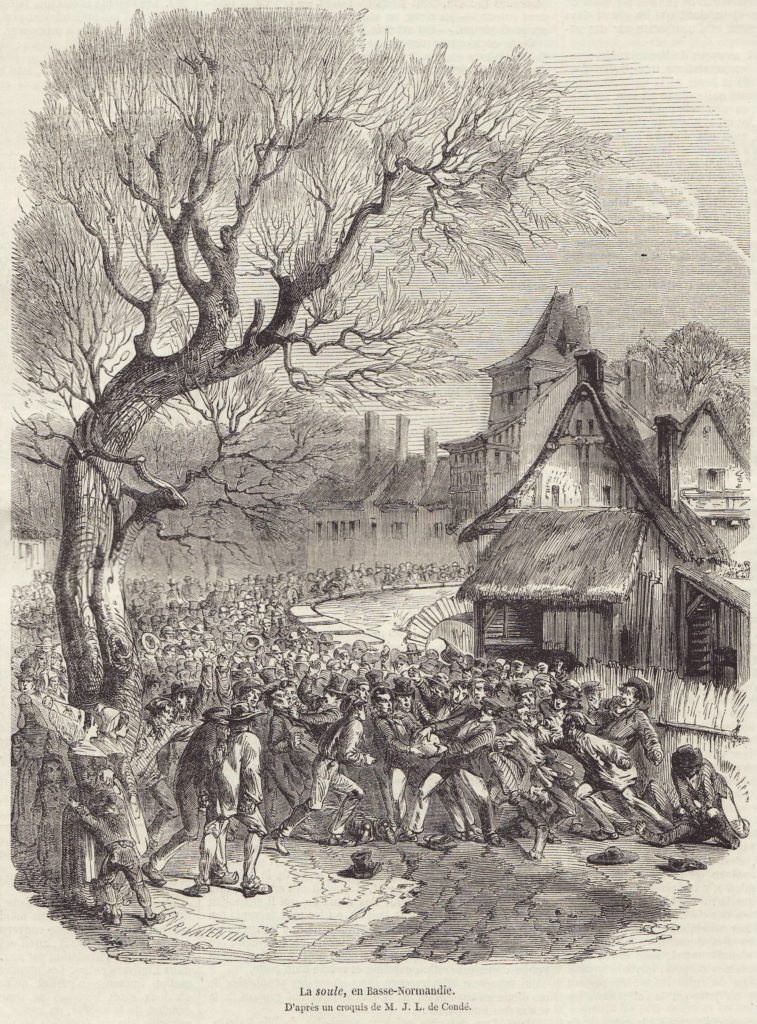
























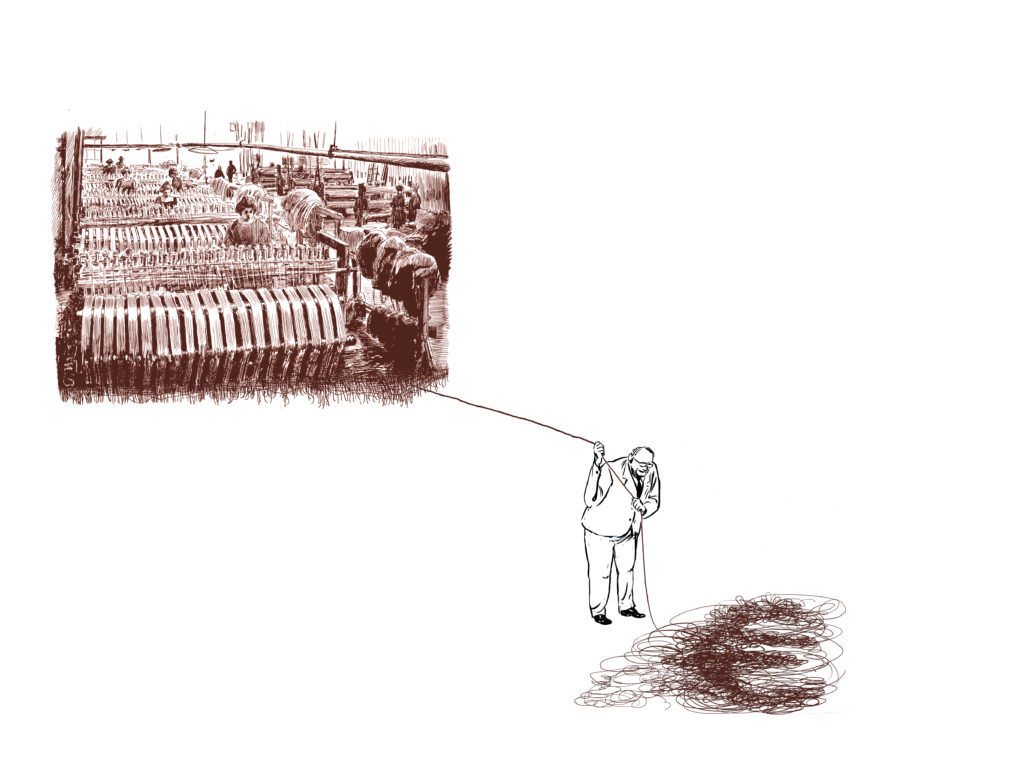
Recent Comments