Afin de prolonger la publication de la semaine dernière sur les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie de Covid-19, nous republions un article en forme de guide politico-touristique revenant sur l’histoire sociale de Milan et de ses luttes populaires. Où l’on suivra la route du précariat moderne, l’imposition du travail gratuit dans les métiers culturels, et des idées d’organisation : des syndicats du quotidien autrement appelés « biosyndicats ».
Bout d’ficelle
Milan, guide rouge
Quelques aventures des cagoules
La vérité sur un mouvement terroriste (un de plus !) qui fait trembler l’État, ou comment devenir anarcho-autonome en 4 leçons
Cette BD est née il y a une douzaine d’années dans un squat, quelque part en banlieue parisienne. L’idée était de jouer sur l’autodérision, de porter sur le mouvement social auquel nous appartenions ce regard grinçant que nous portions sur le monde. Bref, de pouvoir se moquer de certains travers d’un milieu « libertaire » en jouant sur ses contradictions, ses conflits, ses postures parfois… Mais il ne s’est jamais agi de régler des comptes. Au contraire. Il était bien question de mettre en déroute cette figure caricaturale que le discours de l’État et les médias tentaient de nous coller à la peau sous le nom d’« anarcho-autonome » ou d’« ultra-gauche », nouvel avatar d’un ennemi intérieur fantasmé.Peu de temps après, aux paroles suivirent les actes, puisque plusieurs affaires pour « organisation terroriste » se succédèrent, condamnant certain·es de nos proches à plus d’un an de prison pour quelques faits dérisoires. Le numéro 2 des Cagoules « Spécial répression » n’a jamais vu le jour, étant donné que la « répression », justement, nous étions en train de la vivre de plein fouet. Et quand les loups sont lâchés, il peut arriver de manquer d’humour (mais heureusement, cela n’est que passager). read more…
« Je m’en vais lire en refilmant »
Conversation avec Martine Rousset, cinéaste « cabane »
Martine Rousset fait des films depuis 1977, des films en pellicule, depuis toujours et tant que ce sera possible. Elle a grandi à Frontignan, à côté de Sète, où elle est retournée vivre, après avoir travaillé pendant 35 ans dans un musée parisien. Étudiante en philosophie à Montpellier dans les années post-1968, elle suit les cours d’Henri Agel, pionnier de l’enseignement du cinéma à l’université – une nouveauté directement issue de mai. Des années d’études scandées par « une majorité de grèves et d’occupation des locaux, jusqu’à l’avènement de la révolution socialiste », comme elle le dit elle-même. read more…
« Je lui dis des secrets et il les garde en lui »
Quatre enfants, dix mille doudous
Propos recueillis par Mathieu Rivat, Émilie Lebarbier, Noémi Aubry, Hélène Pujol, Bruno Thomé et Julia Burtin Zortea
Photos d’Éric Thomé, Bruno Thomé et Hélène Pujol
Objet transitionnel pour la psychanalyse ou nid à bactéries pour la médecine, peu importe. La parole est aux enfants. Hugo, Anna, Sara et Meïmouna nous racontent leurs doudous : tour à tour ami·e d’aventures imaginaires, confident·e des nuits parallèles et plus mieux encore…
Cet article est issu du deuxième numéro de Jef Klak, « Bout d’ficelle », encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF.
*
Gros nounours
Hugo, 5 ans
*
Comment s’appelle ton doudou ?
Gros nounours.
Il a des amis ?
Ah oui, j’ai une hotte entière de doudous. Il a plein d’amis. Dans le placard, il y en a un, c’est exactement le même au cas où je le perds ; ils viennent du même œuf. Il a des fils qui pendent, et des étoiles, tout dans le même ordre. Ils sont comme frères. Il s’appelle Copain.
Des fois, tu le prends à l’école ?
Des fois. Je le montre à mes copains et il faut qu’ils devinent comment il s’appelle. Ils n’ont encore jamais trouvé.
Tu lui racontes des secrets ?
Oui, je lui dis des secrets, comme ça [il se rapproche du doudou et lui murmure quelque chose dans le creux de son oreille]. Il n’y a que lui qui les entend, et ils ne sortent même pas par l’autre oreille. Il les garde en lui.
À quoi tu joues avec ton doudou ?
Il fait des puzzles, mais il ne joue jamais aux Lego. Surtout, je lui fais faire des cabrioles en l’air, hop là, et après, je le rattrape, hop là. Il tourne toujours en l’air, la tête en bas et les pieds en haut, mais jamais sur le côté.
Mais après une cabriole comme celle-là, tu crois qu’il se sent bien ?
Oui, il adore ça, il rebondit sur mes genoux, il fait comme le trampoline, il aime trop.
Quand est-ce que tu es avec ton doudou ?
Le soir, la nuit, des fois la journée dans la maison, quand je fais un temps calme. Je lui fais des câlins. J’aime bien dormir à côté de lui.
Quand tu pars en voyage, tu le prends aussi ? Tu vas où avec lui ?
Oui, toujours. Avec lui, j’ai été à Béziers, à Venelles, en Écosse, en Afrique, en Normandie.
Il aime bien ?
Oui, il aime bien, comme moi ; je lui apprends les voyages. Il a déjà pris l’avion, mais il n’a pas eu peur, parce qu’il est habitué, et moi aussi. Il aime bien le train, aussi.
Il est avec toi aussi quand tu fais des cauchemars ?
Oui, quand je le touche, ça me rassure ; quand je le touche, c’est sa peau que je sens, ça me dit que je suis dans le lit et pas dans le cauchemar, parce que des fois les cauchemars, c’est tellement vrai que je crois être dedans.
Il parle ton doudou ? Il te dit quoi ?
Beaucoup de choses, mais je ne sais pas exactement quoi.
Quand t’es pas là, il fait quoi ton doudou ?
Il joue, après il range et il va se coucher quand il est fatigué. Et aussi je lui donne à manger. Je lui amène les épluchures dans une assiette. Il y a des épluchures de pommes de terre, de carottes et les feuilles de poireaux ; les grandes feuilles vertes, il les mange.
Tu aurais envie de lui dire quoi à ton doudou maintenant ?
« Doudou, il faut que tu joues bien le soir, et que tu manges le midi », parce que le midi, je ne suis pas là, sauf quand je suis malade. Et quand on laisse la fenêtre ouverte, il peut aller manger les épluchures dans le compost, sinon c’est moi qui lui apporte le week-end. Quand il a très faim, je lui donne un sac entier.
Il a peur dans le noir ?
Non, il n’a pas peur. Comme moi.

*
Argobert
Anna, 9 ans
*
Quand est-ce que tu as rencontré Argobert ?
J’ai eu quatre doudous avant, mais je ne me rappelle plus.
Raconte-moi la première fois où tu as dormi avec lui…
C’était parce que j’avais perdu Paulo, mon doudou, et du coup j’ai pris Argobert pour la nuit. Et après, j’ai décidé de le garder.
Est-ce que tu l’as emmené à l’école ?
En maternelle, oui, parce qu’on pouvait. Après la cantine, on faisait la sieste, on avait le droit de dormir avec nos doudous. Quand je suis rentrée au CP, on n’avait plus le droit.
Comment tu as fait alors ?
Il y avait un petit bout de lui que je mettais dans ma poche et j’allais à l’école avec.
Tu fais quoi avec ton doudou ?
Quand on regarde un dessin animé, souvent, je le prends. Et aussi la nuit, quand je dors.
Comme Argobert est un peu cassé, le prochain doudou est déjà prévu. C’est une petite souris avec une capuche. Comment tu l’as choisie ?
Elle s’appelle Soussou. C’est Élisa qui me l’a donnée, et puis je sais pas, j’aime bien comment elle est.
Tu n’as jamais revu d’Argobert de la même espèce ?
Si. J’étais allée voir ma grand-mère à Toulouse. On est parties se promener et on est passées devant un magasin où il y avait plein de peluches qui ressemblaient beaucoup à Argobert.
Vous ne l’avez pas trouvé ?
On a trouvé une peluche qui ressemblait : c’était Argobert, mais en fille. Ensuite, on a montré Argobert au vendeur, et comme il était tout cassé, il n’a pas voulu qu’on reste dans la boutique. Il n’avait pas l’air très content de voir qu’une peluche qui ressemble beaucoup aux peluches qu’il a dans son magasin soit toute cassée.
Maintenant qu’Argobert cassé, pour toi, il est pareil que quand il était tout neuf ?
Non, parce qu’au début je l’aimais pas trop, ce n’était pas encore mon doudou préféré.
Là, il n’a plus du tout la même tête ?
Plus du tout. Et puis maintenant, il est en deux parties.
Tu le présentes à tes copains ?
Non. Quand c’est des amis qui sont dans la même école que moi, je n’ai pas trop envie, parce que j’ai peur qu’ils disent aux autres que j’ai encore un doudou.
Mais tu as des copines de ton âge qui ont encore des doudous ?
Quand c’est une fille qui est même un peu plus grande que moi et que je sais qu’elle a encore un doudou, je veux bien lui montrer.
Pour toi, Argobert, il te sert juste à t’endormir facilement ?
Non. Pas que ça. Je ne sais pas comment expliquer… En maternelle, je disais que c’était mon petit frère.
Tu n’as pas une histoire à nous raconter de toi et Argobert, quelque chose qui vous est arrivé à tous les deux ?
Quand je suis allée en Grèce, il n’était pas encore aussi abîmé que maintenant, je disais qu’il avait envie de se baigner, et du coup, je l’ai mis dans l’eau de la mer, et ensuite, il a mis trois jours à sécher.
Tu crois qu’il était en colère après ?
Oui, parce qu’il n’aimait pas être mouillé, mais je ne savais pas.
Tu le laves des fois ?
C’est mon papa qui veut tout le temps que je le lave. Pendant que je vais à l’école, je le cache dans la voiture, parce que j’aime pas quand il le lave. Et puis Argobert il n’aime pas tourner en rond dans la machine à laver.
Qui répare Argobert quand il est trop abîmé ?
C’est soit ma grand-mère du côté de mon papa, soit mon papa. J’aime bien quand on le répare, mais j’ai toujours peur que ce soit pas fini avant que j’aille me coucher.
Tu n’as pas une dernière histoire à raconter avec Argobert ?
Ah oui : une fois j’avais fait mes lacets et j’avais oublié de le reprendre. Au bout d’un moment, je me suis demandé où il était, et je me suis rappelé que je l’avais laissé là-bas : il était toujours là.
Tu l’as jamais reperdu ?
Une fois, j’avais demandé à Bruno de me le garder, j’étais rentré à la maison avec Maman, et j’avais oublié qu’il était dans le sac de Bruno, et du coup, j’ai dû m’endormir sans Argobert parce que Bruno, il était rentré après que je me sois couchée.
Et tu avais réussi à dormir ?
Mmh. Oui, mais c’était dur.

*
Soussou, Bibika, Bobinnet, Bleu, Pêche, Tofi…
Sara, 9 ans et Meïmouna, 10 ans
*
Qui a des souvenirs de doudou ?
Sara : Moi, j’ai deux doudous. Un, c’est un animal. Mais c’est Meïmouna qui me l’avait prêté, donc je l’avais volé, en fait. Il s’appelait…
Meïmouna : Soussou.
Sara : Parce que c’était une souris. Et puis l’autre, sa tête était comme une poupée, et son corps comme un doudou. Elle s’appelait Bibika.
Et maintenant, tu n’as plus ce doudou ?
Sara : Ben si. Mais je l’ai perdu. Enfin, je l’ai vu il y a cinq jours. Je ne le trouve plus.
Est-ce que tu as déjà vraiment perdu un doudou ?
Sara : Oui, j’étais triste au début, mais ensuite je me suis habituée. L’année dernière, je l’avais aussi perdu pendant longtemps. En fait, je le perds, et ensuite je le retrouve.
Et quand tu le retrouves, tu en fais quoi ?
Sara : Ben, je le prends. Pour dormir avec.
C’est que pour dormir ?
Sara : Oui. Quand j’ai peur. Mais maintenant, j’ai moins peur.
Tu avais peur de quoi ?
Sara : J’avais peur que la maison s’écroule. Et j’aime pas rester toute seule des fois. Et aussi, j’avais peur qu’il y ait le feu à la maison. Avec le doudou, j’avais moins peur. J’étais pas trop toute seule. [Baissant la voix] Parce que moi je pensais que le doudou, il était vivant. Et comme j’en avais deux, eh ben des fois, quand je faisais un câlin au premier, je croyais que l’autre il était jaloux.
Et toi Meïmouna ?
Meïmouna : Moi, à la base, j’avais 10 000 doudous. Mais je ne pouvais pas dormir avec mes trois doudous, parce qu’il n’y avait pas assez de place dans le lit, alors j’en choisissais un préféré. Et je me disais aussi, tiens, les autres, ils doivent être jaloux. Ils ont froid. Mais comment je fais ? Alors à un moment, j’en ai pris que deux.
Ils s’appelaient comment ?
Meïmouna : J’avais une marmotte qui s’appelait des fois Bleu parce qu’elle avait un bonnet bleu, ou Pêche parce qu’elle était douce. La marmotte, c’était mon grand-père qui me l’avait donnée. L’autre, le lapin, il s’appelait Bobinnet. Et le troisième, je m’en souviens plus, parce que je l’ai abandonné. Bobinnet, je l’avais depuis toute petite, et vu que la personne qui me l’a donné était morte, eh ben je l’ai gardé.
Sara : C’était qui ?
Meïmouna : Tatie. Il n’était pas pareil que l’autre doudou. Et puis ensuite, je ne l’ai plus eu avec moi. Et je me suis dit, si ça ne me fait plus autant de peine qu’avant, c’est que je n’ai plus besoin de doudou. C’était quand j’avais 9 ans 1/2. Maintenant, ils sont quelque part.
Sara : Ils sont entre de bonnes mains. Et maintenant, t’as quel âge ?
Meïmouna : Ben, tu le sais, 10 ans !
Sara : Ouais, mais les gens qui vont lire, ils vont pas le savoir. Imagine s’ils croient que tu as 40 ans !
Tu te rappelles quand tu as commencé à avoir un doudou ?
Meïmouna : Mes premiers souvenirs, c’est quand j’avais 3 ans. En fait, j’ai toujours eu un doudou. Il ne me servait pas qu’à dormir. On avait notre cousine qui venait, et on s’amusait à laver nos doudous, et à leur brosser les dents. Après, ils étaient tout rugueux.
Moi, j’avais un copain quand j’étais petite, et lui, son doudou, c’était un gros bout de coton. C’était pratique pour les parents : quand il le perdait ou qu’il était sale, ils remplaçaient le coton. Ils n’avaient qu’à aller au supermarché.
Sara : ah ouais, c’est pratique… Et aussi mon doudou, celui qui s’appelait Bibika, en fait c’était une fée.
Meïmouna : Un papillon.
Sara : Et quand j’étais petite, je lui avais coupé les ailes. Elles étaient grandes, elles me dérangeaient. Et là elle ne peut plus voler.
Meïmouna : Bon, les doudous, enfin, tu sais, je m’en passe maintenant, mais bon, les grosses peluches à la foire, eh bien j’adore, mais j’en ai jamais eu.
Ça aurait pu devenir un doudou, un truc aussi gros ?
Meïmouna : Ben oui. Pourquoi pas ? Tout à l’heure, j’ai dit que j’avais trois doudous, mais je n’ai pas parlé du troisième. C’était un chien, enfin un tigre, ou une panthère. Et c’était ma mère ou mon père qui me l’avait acheté, et Sara m’a copiée en prenant une autre couleur.
Sara : Oui, moi aussi, je l’avais.
Et donc, c’était une panthère, un chien, un tigre ?
Meïmouna : Une panthère.
Sara : Un chien.
Meïmouna : Un chien-panthère.
Sara : Quand j’ai eu le chien, enfin, la panthère, je l’ai présentée à mes deux doudous. J’ai dit : « Voici un nouveau doudou. » Comme ça, ils se connaissaient.
Et tu l’appelles comment ? Doudou ?
Meïmouna : Ben, on les appelle par leurs prénoms. Quand on parle d’eux à d’autres gens, on dit « mes doudous », mais on s’adresse à eux par leurs prénoms.

Le doudou d’Anna [leur petite sœur], il est comment ?
Meïmouna : Tu veux dire Tofi ? Elle l’a eu à Noël, quand elle avait 1 an. Et elle a des greluches accrochées à son doudou.
Des grelots ?
Meïmouna : Euh, oui.
Sara : Laisse-moi expliquer : elle a un doudou-vache qui a le ventre qui s’ouvre. Et dans son ventre, il y a d’autres petits animaux. Une poule, un mouton. Que des animaux de la ferme. Il y en a qui font « pouët » quand on appuie dessus. D’autres qui font du bruit quand on les secoue.
Meïmouna : Elle peut pas dormir sans, sinon elle fait une crise. Elle est habituée à avoir un truc avec elle.
Tu crois que c’est ça, un doudou, un truc qu’on est habitué à avoir avec soi ?
Meïmouna : Ça te rassure.
Sara : À mon avis, il y a un autre truc, mais quoi, je ne sais pas.
Meïmouna : C’est comme une petite maman. Comme si elle était là.
Sara [d’une voix théâtrale] :
Comme un ange qui te protège.
Vous voulez pas vous poser des questions que j’aurais oublié de poser ?
Meïmouna : Ok. Dans quel pays ton doudou a été fait ?
Sara : Made in China ! Mais c’est nul comme question. J’espère que c’est pas Made in China.
Meïmouna : Est-ce que tu as pensé à laver ton doudou avant de l’utiliser ?
Sara : Ben non. Est-ce que, à ton avis, ton doudou il est d’occasion, ça veut dire qu’il a appartenu à une autre personne avant ?
Meïmouna : Non. Est-ce que ton doudou, c’est du coton synthétique ?
Sara : Euh… J’ai pas pensé à regarder l’étiquette. Tu as vraiment des questions débiles, toi. Ton doudou, à quelle époque tu l’aimais bien ?
Meïmouna : De toute petite à 9 ans.
Sara : Et si tu l’avais perdu à cette époque, tu aurais été comment ?
Meïmouna : Hyper triste.
Sara : C’est-à-dire ? Tu pleurerais tout le temps, tu pourrais plus dormir ?
Meïmouna : Je serais devenue peureuse.
Le vêtement comme seconde peau
Brève biographie textile de Frida Kahlo
Illustrations par Maud Guély
Apparence et style vestimentaire riment-ils avec pure futilité ? L’œuvre et la vie de Frida Kahlo affirment l’inverse. Tout au long de sa carrière, l’artiste mexicaine a joué de sa propre image comme d’un véritable langage. C’est notamment en exposant ses propres meurtrissures corporelles et ses choix vestimentaires au moyen d’autoportraits qu’elle a sublimé/mis en scène ses écueils biographiques, et développé un discours politique questionnant la féminité ou la culture indigène de son pays.
Ce texte est issu du deuxième numéro de Jef Klak, « Bout d’ficelle », traitant du textile, de la mode et des identités de genre, et encore disponible en librairie. Version adaptée par les auteures, extraite de Un ruban autour d’une bombe. Une biographie textile de Frida Kahlo, Rachel Viné Krupa & Maud Guély, éd. Nada, 2013, qui sera republié en 2018.
Télécharger l’article en PDF.
« Un ruban autour d’une bombe 1 André Breton, « Frida Kahlo de Rivera », dans Le Surréalisme et la Peinture, Paris, Gallimard, 2002, p. 143.. » C’est avec ces mots qu’André Breton, fervent admirateur de Frida Kahlo, décrit son œuvre à la fois délicate et subversive. Les rubans, motifs textiles récurrents dans la peinture de l’artiste mexicaine, témoignent du soin qu’elle portait à son apparence et ouvrent la voie à une lecture vestimentaire de sa production. Si l’habit ne fait pas la personne, les vêtements dans lesquels Frida Kahlo se représente sont l’expression d’un choix délibéré et signifiant. Dans une production composée à 43% d’autoportraits, ils révèlent les aspects multiples d’une identité dynamique.
En 1925, elle a 18 ans et, suite à un accident d’autobus qui l’oblige à garder le lit plusieurs mois et dont elle conservera des séquelles à vie, Frida Kahlo commence à peindre. Lorsque le drame survient, elle est l’une des trente-cinq filles, sur deux mille élèves, à étudier à l’École nationale préparatoire de Mexico pour le concours d’entrée de la faculté de médecine. Dans cet environnement très masculin, elle cherche son style et choisit de se démarquer en revêtant des costumes d’homme comme l’attestent certaines photographies d’époque. Les pantalons qu’elle porte alors lui permettent également de masquer sa jambe droite atrophiée par une poliomyélite contractée à l’âge de 11 ans et qui lui vaut durant toute son enfance le sobriquet de « Frida jambe de bois ». L’accident dont elle est victime la contraint à arrêter ses études et la conduit à choisir la peinture comme activité de substitution.
Dès son premier autoportrait, Autoportrait à la robe de velours (1926), le vêtement trône au centre de sa création. La robe ultra-sensuelle dans laquelle elle apparaît marque une rupture vestimentaire radicale avec l’allure de garçon manqué qu’elle cultivait adolescente. Elle exacerbe ainsi sa féminité alors qu’elle vient d’apprendre qu’elle ne pourra jamais être mère : lors de la collision de l’autobus dans lequel elle voyageait, elle se fait empaler par une main courante qui lui transperce le bassin et le vagin. Elle dira ironiquement avoir perdu sa virginité ce jour-là, mais pas sa féminité.
La robe de velours grenat brodée de délicates arabesques terre de Sienne, son port de tête altier, ainsi que le geste délicat de sa main, confère au portrait de cette jeune Mexicaine de 19 ans une allure aristocratique et surannée, empreinte de maniérisme italien. La pâleur de sa peau et ses traits exagérément allongés révèlent l’influence de Modigliani. Par le choix de sa tenue et la figuration de ses traits, il semblerait qu’elle ait voulu privilégier son ascendance européenne, héritée de son père allemand, en gommant tout signe visible d’indianité. Le choix de l’orthographe germanique de son prénom « Frieda », qu’elle adopte alors pour signature, va dans le même sens. Bien qu’avec la révolution de 1910 les canons de beauté tendent à se mexicaniser, les critères esthétiques, tant physiques qu’artistiques, correspondent encore, pour cette peintre novice issue de la bourgeoisie citadine de Mexico, au modèle européen en vigueur depuis la colonisation espagnole.

Après deux ans de convalescence passés à peindre dans l’isolement de la maison familiale, Frida Kahlo renoue avec une vie sociale. En 1928, elle est introduite par un ancien camarade de classe dans l’entourage du révolutionnaire communiste cubain Julio Antonio Mella, exilé au Mexique, et de sa compagne, la photographe italo-américaine Tina Modotti. Quelques mois plus tard, elle adhère au Parti communiste mexicain. Lors d’une réunion politique, elle rencontre le peintre Diego Rivera. Son apparence vestimentaire témoigne alors de son engagement : elle porte l’uniforme sobre des jeunes militantes du Parti. C’est vêtue de pantalons et d’une chemise rouge brochée d’une étoile, distribuant des fusils et des baïonnettes à des ouvriers, que Rivera représente, dans la fresque Dans l’arsenal, celle qui, en 1929, devient sa nouvelle compagne.
Pour Frida Kahlo, cette relation marque le début d’une vie nouvelle. Immergée dans l’univers mexicaniste de son mari, elle élargit son panorama aux coutumes et aux arts populaires. Fervent défenseur de la culture indigène, Diego Rivera aime vêtir ses modèles des costumes traditionnels pour sublimer leur beauté. Frida Kahlo est consciente de ce penchant et, pour lui plaire, change intentionnellement de style : « Il fut un temps, confie-t-elle, où je m’habillais en homme. J’avais les cheveux coupés ras et portais des pantalons, des bottes et une pelisse de cuir mais, quand j’allais voir Diego, je mettais le costume de Tehuana [2. Bambi, « Frida Kahlo es una mitad », dans Excélsior, 13 juin 1954, Mexico, p. 1.]. » Ce vêtement se compose d’un huipil, tunique sans manches d’origine préhispanique confectionnée dans une pièce de coton rectangulaire, pliée en deux moitiés et cousue sur les côtés pour permettre le passage des bras. Porté sur une large jupe longue de mousseline de couleur vive garnie de falbalas blancs d’une hauteur minimale de vingt-huit centimètres, le tissage de la toile et la richesse des broderies font son originalité.
Dans le Mexique postrévolutionnaire des années 1920-30, endosser le costume des femmes indigènes de l’isthme de Tehuantepec n’a rien de folklorique mais relève d’une revendication identitaire d’ampleur nationale : « Dès le début du XXe siècle, explique l’historienne Aída Sierra, la culture urbaine naissante a eu besoin de symboles attestant de sa richesse. Avec la révolution mexicaine, ce besoin se fit plus pressant. La figure des Tehuanas faisait naître des désirs et des rêves chez ceux qui les contemplaient ; elle offrait des caractéristiques qui pouvaient effectivement représenter la grandeur du nouveau projet de nation [3. Aída Sierra, « La creación de un símbolo », dans Artes de México, nº 49, Mexico, 2000, p. 17.]. »
Si l’intérêt de Frida Kahlo pour ce vêtement coïncide avec sa rencontre avec Diego Rivera, c’est durant son premier séjour aux États-Unis qu’elle commence à le porter régulièrement. En effet, en 1930, suite à l’expulsion de Rivera du Parti communiste mexicain, accusé de collaborer avec le pouvoir en exécutant des commandes gouvernementales, le couple s’exile pendant trois ans aux États-Unis. Dans ses valises, Frida Kahlo emporte ses tenues exubérantes et chamarrées qui font sensation dans les salons de San Francisco, New York et Détroit. Elle souhaite ainsi affirmer son identité mexicaine et surtout ne pas être assimilée à la bourgeoisie locale pour laquelle elle n’a aucune estime. « Lorsqu’une communauté a peu, ou pas du tout, de contacts avec ses voisins, le fait de se vêtir de telle ou telle manière n’a probablement pas davantage valeur de signe que celui de parler telle ou telle langue […]. Il en va différemment lorsque les contacts sont fréquents ou permanents : dans ce cas, le vêtement a sans doute assez généralement une fonction de distinction, tout à fait consciente chez ceux qui le portent [4. Yves Delaporte, « Le vêtement dans les sociétés traditionnelles », dans Jean Poirier, Histoire des mœurs I, Paris, Gallimard, 1990, vol. 2, p. 975. ] », explique l’ethnologue Yves Delaporte, spécialisé dans l’anthropologie du vêtement.

Le costume des femmes de l’isthme de Tehuantepec apparaît pour la première fois dans une toile réalisée à New York en 1933 intitulée Ma robe est suspendue là-bas. Flottant dans les airs sur un cintre accroché à un ruban tendu tel une corde à linge, il constitue le personnage principal d’un autoportrait par substitut. Frida Kahlo est absente du tableau, mais son vêtement permet à lui seul de l’identifier. L’île de Manhattan, première place financière mondiale au temps de la Grande Dépression, constitue le décor au milieu duquel est suspendu son vêtement. Ce contexte économique spécifique donne naissance à une œuvre politique et sociale, dans laquelle Frida Kahlo émet une critique féroce de la société états-unienne et des effets néfastes du capitalisme, cependant que Diego Rivera peint un portrait éphémère de Lénine dans le hall du Rockefeller Center.
Contrairement à son mari, Frida Kahlo n’invoque ici aucune figure révolutionnaire pour servir son message, mais investit son vêtement des valeurs communautaires qu’elle revendique et d’une fierté toute nationale. Érigé au centre de l’œuvre, son costume de Tehuana constitue un foyer de résistance culturelle face à un mode de vie dominant, ainsi que le déclare Diego Rivera dans un article intitulé « Fashion Notes », dans le New York Times : « Le costume traditionnel mexicain a été créé par et pour le peuple. Les femmes mexicaines qui ne le portent pas n’appartiennent pas à celui-ci, au contraire, elles dépendent, mentalement et émotionnellement, d’une classe étrangère dont elles veulent faire partie, c’est-à-dire la grande bureaucratie nord-américaine et française [5. Diego Rivera, « Fashion Notes », dans The New York Times, 3 mai 1948, New York, p. 32. ]. »
Pour Frida Kahlo, introduire dans les soirées mondaines new-yorkaises les vêtements des Indiens du Mexique, opprimés depuis la conquête et laissés en marge des sphères du pouvoir, recouvre une dimension identitaire et politique forte. Le caractère patriotique de ses tenues est vanté par Diego Rivera : « Frida Kahlo est une femme extraordinairement belle, non pas d’une beauté triviale, mais d’une beauté aussi exceptionnelle et caractéristique que ce qu’elle produit. Frida exprime sa personnalité dans ses coiffures, dans ses vêtements, dans son goût prononcé pour les parures de bijoux, plus étranges et belles que luxueuses. Elle aime les jades millénaires, porte le huipil et le costume de Tehuana avec une jupe à volants amidonnée que portaient et portent toujours les femmes de Tehuantepec. […] Ses toilettes sont l’incarnation même de la splendeur nationale. Jamais elle n’en a trahi l’esprit, et elle a revendiqué son nationalisme à New York et à Paris, où d’éminentes personnalités admirèrent ses œuvres et où les stylistes lancèrent la mode “Madame Rivera” [6. Raquel Tibol, Frida Kahlo. Una vida abierta, Mexico, UNAM, 1998, p. 106. ]. »
Durant ses voyages, Frida Kahlo endosse avec un certain succès le rôle d’ambassadrice de la mode mexicaine. En 1938, à New York, où elle se rend pour assister à sa première exposition personnelle, la presse s’intéresse autant à ses tenues qu’à ses tableaux. Le magazine Vogue lui consacre sa une en reproduisant une photographie de ses mains couvertes de bijoux préhispaniques. Dans ce même numéro, un portrait photographique de Nickolas Muray la montre en pleine page vêtue d’un huipil rouge aux motifs or et d’une jupe noire brodée de fleurs blanches, les cheveux coiffés de fleurs et de rubans.
En 1939, André Breton, tombé sous le charme d’un autoportrait que Frida Kahlo avait dédié à Léon Trotski alors qu’ils entretenaient une liaison, l’invite à exposer à Paris. Dans le texte qu’il rédige pour le catalogue de cette exposition, il se réfère ainsi à ce tableau : « Au mur du cabinet de travail de Trotski, j’ai longuement admiré un portrait de Frida Kahlo de Rivera par elle-même. En robe d’ailes dorées de papillons, c’est bien réellement sous cet aspect qu’elle entrouvre le rideau mental. Il nous est donné d’assister, comme aux plus beaux jours du romantisme allemand, à l’entrée d’une jeune femme pourvue de tous les dons de séduction qui a coutume d’évoluer entre les hommes de génie [7. André Breton, ouvr. cité, p. 143. ]. »
Durant son séjour parisien, les tenues de Frida Kahlo sont immortalisées par la photographe Dora Maar et inspirent la couturière Elsa Schiaparelli qui crée en son honneur la robe « Madame Rivera ». Il est significatif que cette création porte le nom de Rivera et non pas celui de Kahlo car les vêtements indigènes, qu’elle porte pour lui plaire, sont soumis aux aléas de leur relation. Lorsqu’en 1935, Frida Kahlo découvre que son mari entretient une liaison avec sa sœur cadette, Cristina, elle quitte le domicile conjugal pour un appartement au centre de Mexico. Cette nouvelle vie se manifeste par un changement de style : elle abandonne ses robes traditionnelles pour des vêtements plus contemporains et mieux adaptés à son nouvel environnement urbain. C’est vêtue d’une veste en cuir sous laquelle elle porte un chemisier et une jupe droite blanche qu’elle se représente dans l’autoportrait Souvenir ou Le Cœur (1937) alors que sa robe de Tehuana est suspendue à ses côtés. Après avoir pardonné à Diego Rivera son aventure, elle la réintègre à sa garde-robe, jusqu’en 1939, année de leur divorce.

Cette nouvelle séparation affecte non seulement sa garde-robe mais aussi sa façon d’appréhender son rapport au genre, comme en témoigne Autoportrait aux cheveux coupés (1940), tableau révolutionnaire en ce qu’il fait de Frida Kahlo la première artiste à traiter picturalement le travestissement. Assise au centre d’une pièce vide, dont le sol est couvert de mèches de cheveux, elle apparaît vêtue d’un costume d’homme anthracite et d’une chemise carmin. Ces vêtements, trop larges pour elle, masquent totalement ses formes féminines et augmentent sa carrure. Ses cheveux, qu’elle vient de couper, sont coiffés en arrière ; ses sourcils fournis, ainsi que l’épais duvet qui dessine sa lèvre supérieure, renforcent davantage son apparente virilité. L’unique vestige de sa féminité réside dans les boucles d’oreilles qu’elle porte pour seuls bijoux.
Dans sa main droite, Frida Kahlo tient les ciseaux avec lesquels elle vient de sacrifier sa chevelure. Placés au niveau de son sexe, ils figurent l’arme d’une castration symbolique. Les paroles d’un corrido [8. Le corrido (en français ballade) est une composante de la tradition populaire au Mexique et dans d’autres pays d’Amérique centrale, dérivé de la romance espagnole du XVIIIe siècle.] populaire inscrites au sommet du tableau explicitent le renoncement à l’amour que lui portait Diego Rivera : « Tu vois, si je t’ai aimé, c’était pour tes cheveux. Maintenant que tu es chauve, je ne t’aime plus. » Elle n’apparaît pas ainsi comme la victime passive de ce désamour, mais comme l’auteure d’une transformation physique consciente et volontaire. Modifier son apparence en coupant ses cheveux équivaut à mettre en adéquation son image avec son nouveau statut de femme célibataire et indépendante. En ce sens, Autoportrait aux cheveux coupés est une œuvre pleinement féministe dont l’historienne et critique d’art Erika Billeter met en valeur le caractère avant-gardiste en rappelant que « la tentative d’émancipation figure ici pour la première fois en termes de peinture [9. Erika Billeter, L’Autoportrait à l’âge de la photographie. Peintres et photographes en dialogue avec leur propre image, Lausanne, Musée cantonal des beaux-arts, 1985, p. 58. ] ».
Dans l’Autoportrait aux cheveux coupés Frida Kahlo s’affranchit de sa condition et laisse exprimer sa part de masculinité – comme l’avait fait avant elle Marcel Duchamp, lorsque, sous l’objectif de Man Ray, il se travestit en Rrose Sélavy pour manifester l’existence de son moi féminin. Frida Kahlo revendique la pluralité de sa personnalité en montrant que l’on peut aussi bien devenir, et être, autre.

Les Deux Fridas (1939), tableau dans lequel l’artiste duplique sa propre image, est sans nul doute l’œuvre qui illustre le mieux ce sentiment de dualité. Deux portraits d’elle-même au visage et à la coiffure parfaitement identiques sont assis côte à côte. Seuls leurs vêtements permettent au spectateur de distinguer leur altérité. Alors qu’une Frida porte un costume indigène – huipil bleu et jaune et jupe verte à volants blancs –, une autre est parée d’une robe blanche en dentelle avec le bas de jupon brodé de roses rouges. Contrairement à la mode autochtone et populaire de son double, cette tenue correspond au style vestimentaire importé d’Europe par les colons espagnols et adopté par l’élite dominante après la conquête. Frida Kahlo revêt ainsi alternativement les emblèmes vestimentaires de ces deux civilisations, incarnant le métissage à l’origine de l’histoire mexicaine moderne. Pour matérialiser ce phénomène à la fois culturel et biologique, l’artiste recourt à la métaphore médicale de la transplantation : sous le corsage blanc déchiré de la Frida d’ascendance européenne apparaît son cœur, représenté en coupe, et dont la moitié transversale qui semble lui avoir été prélevée est greffée à même le huipil de son double indigène. Unis par un même système vasculaire, ces deux autoportraits siamois s’autoalimentent d’un même sang.
L’univers médical fait partie du quotidien de Frida Kahlo et imprègne son œuvre. Elle est ainsi la première dans l’histoire de l’art à montrer, dans ses autoportraits, ses appareillages orthopédiques comme des éléments à part entière de sa garde-robe [10. Dans sa collection printemps-été 1998, Jean-Paul Gaultier convertira ces prothèses en véritables accessoires de mode. ]. En 1944, dans l’autoportrait La Colonne brisée, elle présente pour la première fois, en guise de bustier, le corset en acier que ses médecins lui ont prescrit. Elle apparaît nue, le torse sanglé par des lanières en cuir. Les clous qui perforent son corps, tout comme le linge blanc enroulé autour de sa taille pour masquer son sexe, rappellent les images de la crucifixion. Au milieu de son torse écartelé, au cœur de sa chair à vif, une colonne ionique en ruine remplace sa propre colonne vertébrale, fracturée lors de l’accident qui ravagea son corps en 1925.
Deux ans plus tard, alors qu’elle vient de subir une greffe à la colonne vertébrale, elle reprend le motif du corset dans Arbre de l’espérance (1946), double autoportrait, où elle apparaît à deux stades de son hospitalisation : lors de son intervention et durant sa convalescence. On y voit une Frida en robe de Tehuana au chevet d’une autre Frida allongée sur un brancard, le corps nu et inerte au sortir du bloc opératoire. Par-dessus son huipil, elle porte un corset dont les brides métalliques compriment sa poitrine. Dans sa main gauche, elle brandit un autre corset identique, destiné à son double, comme pour le revêtir de ce bustier orthopédique indispensable à son maintien – c’est ce que laisse entendre l’inscription : « Arbre de l’espérance, tiens-toi droit. »

En août 1953, elle est amputée à hauteur du genou afin de stopper une gangrène qui ronge sa jambe droite. La perte de ce membre est un terrible traumatisme auquel elle survivra à peine un an. Coquette jusque dans la souffrance, elle refuse de porter une prothèse jusqu’à ce qu’on lui confectionne, pour la cacher, une paire de bottines de cuir rouge brodé de fil d’or et agrémentées d’une clochette. Quelques mois après l’intervention, elle réalise Le marxisme guérira les malades (1954) où elle est vêtue d’un corset en résine sur une jupe de Tehuana. Dans cet autoportrait, dominé par la figure de Karl Marx, Frida Kahlo place ses espoirs de guérison dans l’idéologie communiste, incarnée par deux énormes mains qui surgissent providentiellement du ciel pour soutenir son corps. L’imposant jupon vert à larges volants blancs, pareil à un socle sur lequel repose son buste corseté, participe également à assurer sa stabilité, comme l’analyse l’historienne du textile Annegret Hesterberg : « Les jupes amples, qui se confondent avec la figure féminine, donnent l’impression d’un volume corporel plus important et contribuent souvent à élever la dignité de celles qui les portent. Cette augmentation de la présence corporelle […] est non seulement ressentie par l’observateur mais aussi par la personne observée qui acquiert une conscience plus aiguë de sa propre existence. Debout, sa silhouette, qui ressemble à un grand cône, exprime la stabilité et la fermeté [11. Annegret Hesterberg, « Presencia reconstruida. Una segunda piel », dans Artes de México, art. cité, p. 42. ]. »
Selon ses proches, même lorsque son état de santé la forçait à rester alitée, elle ne dérogeait pas au rituel de l’habillement, peut-être pour dissimuler les stigmates d’un corps meurtri par une lourde histoire médicale et recouvrer une certaine intégrité physique ; une certaine façon de dompter la mort aussi. Ainsi, en 1954, dévastée physiquement et mentalement par son amputation et pressentant que sa fin était proche, elle donne à Diego Rivera des consignes strictes quant à la tenue dans laquelle elle souhaite être incinérée : un ample huipil blanc de Yalalag, ville zapotèque de l’État d’Oaxaca, sur une jupe noire sans volants, réservée traditionnellement aux enterrements.

Version adaptée par les auteures, extraite de Un ruban autour d’une bombe. Une biographie textile de Frida Kahlo, Rachel Viné Krupa & Maud Guély, éd. Nada, 2013, qui sera republié en 2018.
Notes
| ↩1 | André Breton, « Frida Kahlo de Rivera », dans Le Surréalisme et la Peinture, Paris, Gallimard, 2002, p. 143. |
Sur les ruines du futur
Contre-récit de la révolution des textiles innovants à Roubaix
Dessins de Florent Grouazel
À Roubaix, la zone de l’Union est l’ancien « cœur battant » de l’industrie textile française du XXe siècle. Grèves dans les usines, syndicalisme ouvrier, main-d’œuvre immigrée mais aussi restructurations et délocalisations ont animé ce quartier industriel et populaire jusqu’à ce qu’il devienne au début des années 2000 une des plus grandes friches industrielles du pays. Depuis maintenant près de dix ans, les élus et acteurs économiques locaux ont lancé un vaste chantier de réhabilitation de l’Union pour que la zone devienne à terme un pôle de compétitivité et d’innovation industrielle au service de la métropole lilloise. Symbole de ce projet titanesque, le Centre européen des textiles innovants, qui réunit start-ups, entreprises familiales et laboratoires de recherche, se veut le fer de lance de la future révolution textile. Entre projet de rénovation urbaine, relégation des ancien·nes ouvrier·es du textile et économie de l’innovation, reportage en quatre actes, quatre espaces, sur la friche de l’Union.
Ce texte est issu du deuxième numéro de Jef Klak, « Bout d’ficelle », traitant du textile, de la mode et des identités de genre, et encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF.
À mon arrivée à la Maison de l’Union, Julie Lattès, communicante pour la Société d’économie mixte (SEM) Ville Renouvelée, propose que nous nous attablions au-dessus d’une vaste maquette de présentation toute en diodes lumineuses et cubes anonymes. Vague fantasme démiurgique, cette dernière permet d’arpenter les 80 hectares de la zone de l’Union, une immense friche industrielle, à cheval entre Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, au nord de Lille. La SEM Ville Renouvelée a jusqu’à 2022 pour mener à terme un des plus importants projets de renouvellement urbain français dans le cadre de partenariats publics-privés largement financés par Lille Métropole 1 En 2011, pour environ 210 millions d’euros engagés sur la zone de l’Union, près des deux tiers provenaient uniquement de Lille Métropole.. « Dès 1993, l’Union est appréhendée par les élus locaux comme un futur pôle d’excellence métropolitain, commente Julie Lattès. L’Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais a alors commencé à racheter les terrains et les bâtiments désertés. En 2004, le projet urbanistique est défini par le cabinet Reichen et Robert & associés [2. Agence d’architectes et d’urbanistes spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine industriel. La Grande Halle de la Villette et le Pavillon de l’Arsenal à Paris ou encore les docks Vauban du Havre font partie de leurs réalisations. Le cabinet a remporté en 2005 le Grand Prix de l’urbanisme.]. La zone sera réaménagée en différents secteurs qui accueilleront deux filières d’excellence : les textiles innovants ainsi que l’image. Mais il est prévu également un éco-quartier, un espace vert, du logement social. »
Pour écouter ce discours policé, il a fallu d’abord slalomer entre d’énormes gaines électriques orange, qui tentent vainement d’égayer des trottoirs encore mal dégrossis. Puis marcher longuement, accolés à ces panneaux aux sourires peroxydés vantant des projets immobiliers. Tout autour, des grues structurent en horizontales un ciel minéral. Et le vacarme étouffé des chantiers marteaux-piquants. « Pendant près d’un siècle, la filature de coton Vanoutryve et le Peignage de La Tossée étaient les deux grandes usines textiles phares de cette zone. Mais les crises pétrolières et la mondialisation ont progressivement transformé l’Union en vaste friche à partir des années 1990. Le chantier en cours veut conjuguer la recherche de l’innovation, la préservation de l’héritage industriel et les principes d’un développement plus durable », résume brièvement Julie Lattès.

ACTE I
La Maison de l’Union
« Faire du blé sur les friches »
Filature, peignage… Ces mots résonnent intensément dans la région. Dès le début du XXe siècle, l’agglomération de Roubaix-Tourcoing est devenue une capitale mondiale du textile, avec plus de 110 000 salarié·es embauché·es dans le secteur. La zone de l’Union est alors le poumon de la Manchester française : inaugurés au XIXe siècle, le canal de Roubaix et le chemin de fer qui la traversent accélèrent l’industrialisation de ce territoire encore rural. En 1870 s’ouvre le premier atelier de traitement de la laine à La Tossée, et trois ans plus tard, la filature de coton Vanoutryve voit le jour.
Les grandes familles industrielles règnent sur la région : Motte, Dewavrin, Six, Prouvost ou encore les célèbres Mulliez [3. La famille Mulliez, originaire de Roubaix, première fortune de France, pèse 3 milliards d’euros. Organisée en groupement d’intérêt économique dénommé « Association familiale Mulliez », elle regroupe plus de 500 membres de la famille et possède les groupes Auchan, Oxylane-Décathlon, Midas, Norauto, Flunch, Kiabi, Kiloutou, Cultura, etc.]. Le patronat paternaliste et catholique du Nord esquive les crises successives de la filière textile en se diversifiant dans la distribution lors de l’entre-deux-guerres (avec la création de groupes comme La Redoute, Les Trois Suisses ou La Blanche Porte), en faisant appel à une main d’œuvre immigrée (belge, maghrébine, portugaise, polonaise) et grâce au renouvellement des parcs de machines nécessitant de moins en moins d’ouvriers. Dès le début des années 1970, la désindustrialisation lamine la zone de l’Union et, de restructurations en liquidations, la filature de coton Vanoutryve et le Peignage de La Tossée, le deuxième de France, ferment leurs portes en 2004.
Retour autour de la maquette du projet de l’Union. La chargée de communication de la SEM Ville Renouvelée rappelle que nous sommes justement dans l’ancien magasin de stockage de laine de La Tossée. Dénommé aujourd’hui l’hôtel d’entreprises « Le Champ Libre », il accueille la Maison de l’Union ainsi que l’antenne régionale de l’Institut du monde arabe ou encore les rédactions locales de La Voix du Nord et de Nord Éclair. Une grande partie du site industriel de La Tossée a été rasée pour faire place à une société de manutention, un parking de 400 places, des logements, mais surtout une ruche d’entreprises. Ce bâtiment « à l’architecture avant-gardiste » accueillera d’ici peu une trentaine de start-ups essentiellement centrées sur les textiles innovants.
L’ancienne filature de coton Vanoutryve est quant à elle le chantier le plus avancé de l’Union. Désormais appelé « Plaine Images », le site est devenu depuis 2007 « le pôle d’excellence de l’image et des industries créatives » et rassemble entre autres le créateur de jeux vidéo Ankama, la chaîne télévision Télé Melody, une plate-forme de recherche et développement… La filature réhabilitée se définit comme un « cluster pour la création digitale et l’innovation » et se veut un espace hybride à la pointe du progrès, réunissant entreprises, chercheur·es et artistes.

Julie Lattès insiste sur les emplois créés et à venir – 1 400 actuellement sur le site de l’Union et 6 000 à terme. D’ici quelques mois va s’ouvrir en lieu et place des anciennes brasseries de l’Union le siège de Kipsta, une filiale du groupe Oxylane-Décathlon (détenu par les Mulliez : la grande famille patronale du Nord rôde toujours). L’Union accueillera ainsi Kipstadium, « le siège mondial des sports collectifs » et un immense complexe sportif de plus de quatre hectares. Plus loin, les bureaux régionaux de Vinci Construction, dont les simili-briques tentent maladroitement de rappeler l’héritage industriel de Roubaix, ouvriront bientôt.
Comme le vantent les plaquettes de présentation du projet, « si l’Union est le berceau de l’industrie textile, elle est aussi le symbole de son avenir ». Ce symbole, construit de toutes pièces sur la friche, est le Centre européen des textiles innovants (Ceti), plate-forme technologique de recherche et développement « unique au monde ». « Creuset d’innovation, vecteur de créativité, tête de réseau, le Ceti est un lieu où l’on conçoit, expérimente et développe une nouvelle offre produits adaptée à l’économie et aux besoins du monde de demain », se vante le site du Centre européen de recherche et de prototypage dédié aux nouveaux textiles. Il est porté par le pôle national de compétitivité Up-Tex [4. Up-Tex est un des 71 pôles de compétitivité créés en 2004 pour relancer la politique industrielle en France. Ces pôles rassemblent sur un même territoire et autour d’un même secteur industriel, entreprises, laboratoires de recherche, universités et écoles d’ingénieur·es.], consacré à « la compétitivité par l’innovation, dans le domaine des tissus techniques spéciaux et innovants ». Lors de son inauguration en octobre 2012, Martine Aubry, présidente de la communauté urbaine de Lille, annonçait que c’est « le cœur de la révolution textile qui va battre ici [5. La Voix du Nord, 11 octobre 2012. ] ».
Le projet de l’Union est ainsi inscrit dans la politique industrielle de la communauté urbaine lilloise. Il est l’un des cinq pôles d’excellence de Lille Métropole, avec Eurasanté, dédié à la filière biomédicale, ou encore EuraTechnologies, consacré aux technologies de l’information et de la communication, construit dans une ancienne filature de coton et de lin. Une logique à la fois de requalification urbaine et de city reimaging, c’est-à-dire une politique d’image visant à « vendre » la ville industrielle, anime également le projet de rénovation urbaine de l’Union. La SEM Ville Renouvelée met en avant « un quartier attractif, mixant finement activités économiques, équipements, logements et espaces naturels » qui se construit sur « le principe de la ville mixte, intense et évolutive ».
« Les politiques d’image se formalisent et évoluent vers la construction de véritables “marques urbaines” capitalisant sur les atouts supposés des villes, alors que les cibles du redéveloppement apparaissent de plus en plus clairement identifiées : d’une part, les entreprises tertiaires considérées comme les plus innovantes, les plus en phase avec l’économie de la connaissance ; d’autre part, des groupes sociaux à haut pouvoir d’achat [6. Max Rousseau, « Villes post-industrielles : pour une nouvelle approche » Métropolitiques, 18 septembre 2013.] », écrit Max Rousseau, docteur en sciences politiques qui a réalisé sa thèse sur le city reimaging de Roubaix et de Sheffield en Angleterre [7. Max Rousseau, 2011, Vendre la ville (post) industrielle. Capitalisme, pouvoir et politiques d’image à Roubaix et à Sheffield (1945-2010), Thèse de doctorat en sciences politiques, université Jean Monnet, Saint-Étienne.]. Pour le sociologue et urbaniste Jean-Pierre Garnier, la reconversion de l’Union n’est rien de moins qu’« un processus de recyclage des anciens quartiers populaires en nouveaux quartiers hype. Entre les oligarchies politiques locales d’un côté et les puissances économiques et financières de l’autre – aujourd’hui cela s’appelle “partenariat public-privé”, autrefois on appelait ça “collaboration de classes” –, l’objectif est le suivant : faire du blé sur les friches, soit en les transformant en quartiers pour classes aisées, soit en y faisant venir des activités dites de pointe [8. Débat du 29 septembre 2012 à Roubaix sur la zone de l’Union organisé par le journal indépendant lillois La Brique.] ».
En partant, Julie Lattès propose une visite des chantiers. Le vent est glacial, la pluie terrible, et après avoir vanté les mérites architecturaux des alvéoles de la future ruche d’entreprises de La Tossée, le parcours passe devant un café, vestige d’une rue aujourd’hui entièrement démolie dans le cadre du projet de réhabilitation. La maison toute en vieilles briques se dresse fièrement, seule au milieu des friches délavées, effleurée par une route au bitume noir fraîchement coulé. Sur l’un des murs, une banderole « Toujours ouvert ! » claque au vent. « C’est Chez Salah, un café tenu par un vieux Kabyle qui a refusé de vendre sa maison à la SEM Ville Renouvelée, précise Julie Lattès. Il a résisté pendant plus de six ans à l’expulsion. Sa détermination a été très médiatisée. On s’est dit finalement que c’était un lieu de centralité important, en connexion avec le futur espace vert de l’Union. »
Au loin se dessine le Centre européen des textiles innovants, long et pâle vaisseau échoué sur un lit d’herbes sales. Mais en ce matin de décembre, les demandes de rendez-vous pour pouvoir y entrer et interroger un des dirigeants du Centre sont encore en attente. Fin de visite. Aux abords de l’ancien portail d’entrée de La Tossée, où les pavés ont été vermoulus par les chaussures et les mobylettes pétaradantes des ouvriers, Julie Lattès avoue ne pas savoir ce qu’il adviendra de l’ancienne conciergerie de l’usine. Bouzid Belgacem et Maurice Vidrequin, eux, savent.

ACTE II
La Tossée
« Nous ne voulons pas subir la double peine : le licenciement et l’oubli. »
Au quartier du Pont-Rompu à Tourcoing, à quelques encablures de l’Union, se trouve le siège perdu de l’Association des ancien·nes salarié·es du Peignage de La Tossée. Les odeurs chaudes de bois et de laine emplissent le local envahi d’anciennes pièces mécaniques, de sacs de laine ou de navettes à filer sauvés in extremis à la fermeture du Peignage. Des « tiots bouts d’rin » représentant des fragments de leur vie de travail et des amitiés d’usines. Autour d’un café, Bouzid Belgacem raconte avoir travaillé plus de trente ans à La Tossée comme aide mécanicien puis agent de maîtrise. Maurice Vidrequin a commencé comme graisseur de machine et a bossé trente-cinq ans dans le peignage. Tous deux sont d’anciens délégués syndicaux de l’usine, mais aussi et avant tout des « gens du textile », ces ouvriers de la laine et du coton dont beaucoup sont reconnaissables à leurs mains aux phalanges amputées par les machines. « À La Tossée, les ouvrier·es étaient issus de dix-sept nationalités différentes, et il existait une belle entente, une grande solidarité entre nous tous, raconte Bouzid Belgacem. On aidait les copains et copines à côté quand on était en avance sur ses machines à peigner. Il y avait peu de femmes, car le peignage de la laine, c’est ce qu’il y a de plus difficile dans la filière textile. Les conditions de travail à La Tossée étaient vraiment très dures, il y avait énormément de poussière, pas de matériel d’aération adapté et, franchement, le comité d’entreprise n’en avait rien à foutre. Quant aux salaires, il y avait une disparité, entretenue par la direction, entre hommes et femmes, entre équipes, entre créneaux horaires. Malgré notre unité syndicale, on n’a jamais récolté qu’une fin de non recevoir… »
Alors que l’usine, qui emploie 1 200 salarié·es au sortir de la Seconde Guerre mondiale, est depuis sa fondation détenue par la famille Binet, cette dernière revend le Peignage à un consortium d’actionnaires au début des années 1970, sentant venir les bouleversements dans l’industrie textile. S’enclenche alors le cycle des restructurations. La famille patronale Dewavrin rachète l’usine au début des années 1980. Puis la Standard Wool Corporation, société américaine spécialisée dans le tabac, se diversifie en achetant des sociétés textiles, dont La Tossée, en 1986. « Ils ont essayé ensuite de nous revendre jusqu’en 1995 à Chargeurs, un géant du textile, raconte Maurice Vidrequin. Ce groupe avait déjà liquidé un peignage voisin, et on savait qu’on allait mourir. On a été en lutte, on a manifesté devant le siège de Chargeurs à Paris, ç’a été très chaud ! On n’était plus que 200 ouvrier·es, mais on arrivait à sortir 10 millions de kilos de laine chaque année, ça représentait 20 000 moutons par jour. On produisait aussi de la lanoline, de la graisse de laine utilisée dans les cosmétiques, ça rapportait pas mal d’argent. »
Bouzid Belgacem poursuit : « Les restructurations, j’en ai connu quatre. Quand les nouvelles machines rentrent, les humains sortent : à la fin, un seul ouvrier gérait 16 peigneuses… On l’a vue, la déconfiture de la laine : la consommation a chuté, et puis la Pologne, la Tchéquie et le Maghreb sont arrivés dans le marché mondial avec une main-d’œuvre à bas prix. On voyait les bilans comptables, et tous les mois, l’usine perdait du pognon, on ne survivait que grâce au cours élevé du tabac qui compensait les pertes du secteur textile. » Le groupe Chargeurs refuse finalement de racheter l’usine, et un plan social est annoncé en 2003. Les salarié·es de La Tossée, qui ont peur que la direction vendent les machines et le stock de laine peignée durant le week-end, organisent alors des rondes de surveillance autour du site de production. Les syndicats décident ensuite de bloquer la production et de se barricader dans l’usine. « On était là jour et nuit, il y a eu trois semaines de grèves très dures, et Salah nous accueillait dans son café. Il nous offrait les coups à boire, et pour les repas, il nous arrangeait pour pouvoir payer le mois d’après. » Le PDG de La Tossée offrant une prime ridicule de départ au prorata de l’ancienneté des salarié·es, il a fallu de rudes négociations pour trouver un statu quo : tous sont licenciés en 2004, mais avec des primes décentes, des départs à la retraite ou des congés de reconversion. Le blocage de l’usine est alors levé. Fin de La Tossée.
En février 2005 est créée l’Association des anciens salariés du Peignage de La Tossée avec pour principal objectif de rester en contact et de briser l’isolement. « Les gens étaient en pleurs : ce n’était pas possible de se quitter comme ça, avec toute cette fraternité et cette solidarité entre nous, explique Bouzid Belgacem. Nous ne voulions pas subir la double peine : le licenciement et l’oubli. » Détresse sociale, divorces et suicides émaillent la fermeture des usines de Roubaix et de Tourcoing dès 2000. « Ç’a été le tremblement de terre. Des fois, le père, la mère, les fils et les oncles, des familles entières étaient embauchées dans le textile. Ils n’ont fait que du textile toute leur vie et ne savaient faire que ça… »
Pour ne pas subir cette « double peine », l’association veut qu’une Cité régionale de l’histoire des gens du textile soit créée sur place. « C’est un lieu chargé d’histoire des luttes sociales, et puis nous avons récupéré énormément d’objets de l’usine à la benne », précisent les anciens syndicalistes. Des expositions, du théâtre ou encore des projections de documentaires sur le témoignage d’ancien·nes ouvrier·es ont été depuis organisés. Mais loin d’être un simple musée, cette Cité se voudrait avant tout un lieu de mémoire vivant et un espace de production. Les ancien·nes salarié·es sont en ce sens devenus proches d’Ardelaine [9. Sur l’aventure coopérative d’Ardelaine, lire Moutons rebelles. Éditions Repas, 2014. Écouter également sur le CD de « Bout de ficelle », piste 8, le documentaire « Des brebis, des fileuses » sur La Fibre Textile, collectif à la dynamique similaire à celle d’Ardelaine.], une coopérative ouvrière ardéchoise qui collecte de la laine locale pour la transformer artisanalement. L’association veut ainsi créer Nordelaine, une unité de production en coopérative pour travailler de la laine lavée en Belgique et montrer les étapes de production jusqu’au produit fini, avec une petite boutique de vente de vêtements « Made in Roubaix ». « C’est difficile, on n’est pas vraiment écouté·es, voire parfois récupéré·es par les élus locaux, déplore Bouzid Belgacem. On a même réoccupé La Tossée en 2009 pendant les élections régionales. On aimerait s’installer dans les anciennes chaufferies et la conciergerie, mais on attend encore la décision des politiques… »

Le Peignage de La Tossée ne reflète qu’un pan de l’histoire des autres usines roubaisiennes. La mythique Lainière de Roubaix, fondée par la famille Prouvost, ferme en 2000 et licencie 212 salarié·es (elle employait près de 8 000 ouvrier·es dans les années 1950). En 1987, le groupe Chargeurs lance une OPA sur l’empire Prouvost et dépèce petit à petit pour ses actionnaires les différentes sociétés textiles de l’entreprise familiale. Quant à la réhabilitation des anciens bâtiments, la filature Cavrois-Mahieu, qui a employé jusqu’à 1 200 ouvrier·es avant de fermer en 2000, est devenue le Non-Lieu, un centre d’art. La Condition publique, ancien entrepôt de conditionnement de laine, a été transformé en un centre artistique et culturel.
Depuis le début du déclin de l’industrie textile dans les années 1970, on passe en trente ans de 50 000 à 8000 salarié·es du textile pour Roubaix et Tourcoing. Roubaix est devenue depuis peu la ville la plus pauvre de France : 45% de sa population y vit désormais avec moins de 977 euros par mois [10. Étude publiée en janvier 2014 par le bureau d’étude Compas et reprise par l’Observatoire des inégalités.]. Pour le collectif de l’Union, qui réunit les anciens salariés de la zone de l’Union et des associations roubaisiennes, « [l’industrie textile] a produit d’importantes richesses au prix d’une misère sociale et économique constante pour beaucoup ouvrier·es que l’on a fait venir de plus en plus loin avant de déplacer les usines vers d’autres régions du monde. Localement, les industriels se sont reconvertis dans la grande distribution et la finance, ou se sont spécialisés sur les “textiles innovants” [11. « Pour le droit à changer d’ère – Plateforme de constitution du Collectif de l’Union », novembre 2005.] ».
ACTE III
Le Ceti
« Être le site d’excellence international de la valeur ajoutée textile »
Depuis son inauguration fin 2012, le Centre européen des textiles innovants a du mal à convaincre de son succès. Il faut dire qu’avec des bâtiments flambant neufs de 15 000 m2, et après un investissement de 42 millions d’euros, le centre emploie à peine une quarantaine de personnes. Un peu léger pour inverser la courbe du chômage creusé ici depuis la fermeture des usines. L’ancien directeur a même été récemment remercié faute d’avoir réussi à développer suffisamment le site. Le projet a été porté dès 2001 par André Beirnaert, fondateur du pôle de compétitivité Up-Tex, à l’époque président du syndicat patronal du textile dans le Nord. Le patron des patrons du textile est surtout connu pour avoir dirigé à partir de 1985 les activités tissage de la famille Prouvost puis la Lainière de Roubaix… pour finir dirigeant chargé du peignage pour le groupe Chargeurs, siphonneur des usines textiles locales contre lequel les ouvriers de La Tossée ont tant lutté.
Le Ceti a également été impulsé par Clubtex. Créé il y a 25 ans, ce club d’entreprises des textiles techniques rassemble de nombreuses petites et moyennes entreprises familiales qui ont anticipé le déclin du textile dans la région pour se réorienter vers les tissus de pointe. Cousin Frères, dans le secteur depuis 1848, se sont par exemple spécialisés dans le cordage de haute technologie et les textiles biotechnologiques. DMR Rubans, une ex-société de la famille Prouvost créée en 1905, s’est reconvertie dans la rubanerie high-tech. Ferlam Technologies, entreprise de cardage créée en 1936, produit aujourd’hui du tissu d’isolation thermique. Pennel & Flipo, créée en 1921, conçoit désormais des tissus de haute technologie pour l’industrie, la marine et la sécurité. À côté de cet historique patronat local et népotique, de nouveaux candidats au progrès ont débarqué : Damart [12. Dont le directeur de développement industriel n’est autre que Gilles Damaz, président d’Up-Tex.], Etam, ou encore la filiale Nord de Bouygues construction, tous persuadés que l’avenir économique se jouera dans les textiles innovants.
« Dans le Ceti, il y a des machines très performantes et hors de prix pour fabriquer du fil technique, mais ce n’est pas un site de production : il n’y a qu’une poignée d’ingénieur·es là-dedans, en concurrence avec l’Allemagne et les États-Unis, lance, dubitatif, Bouzid Belgacem. Ils nous ont dit que les techniques actuelles et innovantes de tissage créeront l’emploi de demain, mais tout ce que je vois, ce sont des bâtiments vides. »
Une rencontre avec un cadre dirigeant du Ceti est enfin organisée pour que je puisse entrer au sein même du futur « cœur de la révolution textile ». L’insipide dalle de béton ruisselante ponctuée de panneaux « sol glissant » témoigne des défauts inhérents à ce type d’architectures construites à la hâte. Alors que le hall d’accueil du Centre laisse entrevoir des coursives désolées, Jean-Marc Vienot, secrétaire général de Clubtex et directeur général d’Up-Tex déboule derrière une austère porte-battante : « Le Ceti est un écosystème qui permet de répondre à toutes les sollicitations sur les textiles innovants. Le site d’excellence comporte tout d’abord une plateforme technologique : c’est un contributeur d’innovation à travers le design thinking, un service de prototypage pour la recherche et développement. C’est aussi le pôle de compétitivité Up-Tex qui est un incitateur d’innovation, en faisant collaborer entreprises et laboratoires de recherche. Il y a ensuite Clubtex, un facilitateur de business, et enfin Innotex, un incubateur d’entreprises, qui est en quelque sorte un accélérateur d’innovation. » Le chantier de l’Union se construit aussi grâce aux mots. « Notre ambition : être le site d’excellence international de la valeur ajoutée textile », conclut humblement Jean-Marc Vienot.
Le Ceti produit donc de la recherche appliquée, suite à des demandes venant d’entreprises, et valorise ses machines-outils high-tech (dont des engins relativement rares dans le monde, capables par exemple de tisser trois fibres de natures différentes ou de fabriquer des textiles technologiques dits non-tissés). Ses ingénieur·es peuvent ainsi créer « des tissus fonctionnels, connectés, monitorés ou interactifs », avec ou sans nanotechnologies, à destination du secteur médical, du bâtiment, de la protection ou encore du transport.
L’incubateur Innotex accompagne des start-ups du textile innovant, ensuite développées en sociétés commerciales dans la ruche d’entreprises de La Tossée. L’incubateur a ainsi vu naître Wearismyboat, qui conçoit des vêtements anti-mal-de-mer ou encore Dooderm, qui produit des textiles améliorant les traitements contre les maladies de peau. Mais d’autres start-ups moins reluisantes ont vu le jour, comme une entreprise de décoration de volets roulants, une autre qui commercialise une désopilante application de web-shopping ou encore Evoletik, qui propose des tissus pour customiser les prothèses médicales et qui sont fabriqués… en Italie. Le Centre peut mobiliser diverses entreprises via Clubtex, et Jean-Marc Vienot se targue même d’avoir organisé des journées de travail avec Areva : « Ce sont des savoir-faire et non des produits finis que proposent désormais les entreprises de cette filière. Elle peuvent ainsi travailler pour le secteur automobile et ensuite pour le bâtiment, précise-t-il. On a des savoir-faire spécifiques, car certaines entreprises traditionnelles ont pris le virage de la mutation technologique du textile pour préserver leur business ; un virage qui date d’au moins une trentaine d’année. »
« Reportage sur le textile chez DMC Lille & Loos », 12 juillet 1978, JT FR3 Nord Pas de Calais.
Retour trente ans en arrière, donc. En juillet 1978, un reportage de FR3 se demande si l’industrie textile du Nord a amorcé son déclin ou sa pleine mutation technologique. Chez DMC Lille & Loos, une usine textile du coin, le syndicaliste ouvrier Bernard Robbe s’emporte : « La mort du textile est voulue et a été programmée par le gouvernement et le patronat dès le Septième Plan [14. Instrument de planification de l’économie par l’État français qui a eu cours jusqu’en 2006. Le Septième Plan concerne la période 1976-1980. ], c’est écrit en toute lettres ! » Stoïque, Gérard Thiriez, le président de DMC, répond : « Les industriels du textile ont à relever le défi des pays à bas salaires. On peut arriver à modifier les fabrications textiles et à produire des marchandises plus évoluées. L’expérience a montré que, ces dernières années, des petites et moyennes entreprises se défendaient très bien et arrivaient à adopter le créneau de production qui est demandé sur le marché. Le textile emploie dans la région 100 000 personnes, il est probable que ce chiffre diminue dans les années à venir. Ce qui est souhaitable, c’est que la diminution soit très progressive, il y a une nécessité de reconversion. » Ce contre quoi le syndicaliste s’insurge en conclusion : « Ce problème de reconversion et de restructuration n’est qu’un maquillage d’une volonté politique déterminée et programmée ! »
« L’industrie textile dans le Nord », 8 octobre 1980, Soir 3
En octobre 1980, un autre reportage sur le textile dans le Nord rappelle que 7 chemises sur 10 achetées en France sont désormais produites à l’étranger et proclame pourtant : « Le salut n’est point dans le protectionnisme mais une meilleure compétitivité. » Pascal Watine, dirigeant des filatures du Sartel, à Roubaix, déclare, mal à l’aise, que pour rester compétitif il devra se purger de 20% de ses ouvrier·es d’ici cinq ans. Pour Julien Delaby, syndicaliste du textile, « les investissements des entrepreneurs du textile ont commencé à migrer vers d’autres branches plus lucratives, vers d’autres pays, et se concentrent en France vers la réduction du nombre d’emploi dans les usines. […] Le patronat a délibérément abandonné la formation dont auraient besoin les ouvrier·es pour se reconvertir ». La voix off conclut, fébrile : « Roubaix se refait aujourd’hui une beauté urbaine. Les ruines industrielles sont rasées […]. Comme si la région changeait de vêtement pour en endosser de plus solides. »
Purger délibérément les gens du textile des usines, sans ménagement et sans aucune reconversion possible, afin que les indéboulonnables tenants du secteur puissent se reconvertir dans les textiles innovants pour « préserver leur business »… Tel est le scénario de cette mort annoncée, avec pour visée l’édification du Ceti : « Tout cela a été voulu par le patronat local et sciemment prémédité : quelques années auparavant, les patron·nes faisaient pression sur les élu·es pour que d’autres secteurs industriels ne s’installent pas ici, pour garder une main-d’œuvre docile. Les grandes familles patronales comme les Mulliez, Dewavrin, Prouvost ou Désurmont faisaient la pluie et le beau temps : tout était organisé pour que nous restions les parents pauvres du secteur industriel français, les salaires étaient équivalents dans toute la région, et les ouvrier·es n’avaient pas le choix. Tout cela a fait que l’après-textile a signé notre arrêt de mort. », précisent les ancien·nes salarié·es du Peignage de La Tossée.
Le virage du textile technologique s’est effectué avec les mêmes entreprises familiales, piloté par le même patronat séculaire. Mais les ouvrier·es étaient à la place du mort. Pour elles et eux, il n’y a eu ni mutation, ni reconversion. « La reconversion industrielle constitue un droit pour les populations qui ont fourni la main-d’œuvre de ces industries, clame le collectif de l’Union [16. « Pour le droit à changer d’ère – Plateforme de constitution du collectif de l’Union », novembre 2005.]. Nous savons que, trop souvent, les sites en reconversion sont considérés comme des terrains disponibles qu’il faut remplir d’activités venues d’ailleurs et qui ne bénéficient qu’à la marge à la population des quartiers. » La nouvelle révolution textile est avant tout fondée sur une économie d’innovation créatrice de valeur ajoutée, et non de production. Une économie pour ingénieur·es et jeunes entrepreneur·es pour lesquel·les on modèle désormais la ville : l’Union doit devenir un « éco-paradis » pour cadres supérieurs. Avec un but des plus affligeants : apporter compétitivité à la métropole lilloise et changer l’image de Roubaix.
ACTE IV
Rue de Tourcoing
« On ne nous a pas donné la possibilité de peser sur les décisions »
Au sortir du Ceti, la nuit enveloppe déjà la zone de l’Union. Comme une île au milieu d’un désert industriel, la lumière chaude émanant du café Chez Salah scintille fébrilement au début de la rue de Tourcoing. Salah Oujdane, fringant septuagénaire, ouvre quand bon lui chante et prend ce soir son temps pour me servir des bières. « J’ai racheté le fond de commerce en 1965, mais je continue à travailler, quand j’en ai envie. La retraite, c’est pour les fainéants ! s’amuse-t-il. Un jour, deux personnes de la SEM Ville Renouvelée sont venues. Elles ont commandé à boire et à peine servies, elles m’ont de suite menacé : “De toute façon si vous ne vendez pas, vous serez expulsé”. Je leur ai dit : “Dégagez et ne remettez plus jamais les pieds ici ! ” L’argent, je m’en fous, j’en ai pas besoin et je me défends tout seul, j’ai envie de ne rien devoir à qui que ce soit. »
La bonhommie de Salah Oujdane, devenu symbole de résistance au projet de l’Union, et le charme surranné de son café en ont fait une icône médiatique. Le Monde, M6, TF1, France 3, Public Sénat… tous veulent leur histoire du Gaulois irréductible, tous s’extasient devant son vieux juke-box resté intact et les chaises en formica [17. Bien loin de ces clichés, voir le documentaire réalisé en 2012 par Nadia Bouferkas et Mehmet Arikan, Chez Salah, ouvert même pendant les travaux.]. Salah préfère ce soir se remémorer les habitants du coin et les ouvriers de La Tossée ou des grandes brasseries qui passaient à la sortie du travail boire un verre. L’Union, grouillant des ouvriers des usines voisines, abritait une vingtaine de bistrots, un cinéma… « Le quartier a bien changé… » soupire-t-il.
Nombre de maisons ont été rasées et des habitant·es expulsé·es dans le cadre du projet de réhabilitation de l’Union. L’Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais n’y est pas allé avec le dos de la cuillère, murant les maisons ou démolissant des rues entières. Dans le prolongement de la rue de Tourcoing, autour de l’îlot d’habitations Stephenson, un collectif d’une soixantaine de familles, « Rase pas mon quartier », a été créé en l’an 2000 pour protester face à la destruction des maisons dans lesquelles les ouvrier·es avaient mis toutes leurs économies. Deux ans plus tard, guidés par la peur d’être expulsé·es sans ménagement, la moitié des habitant·es avait déjà quitté les lieux.
Mais pour la SEM Ville Renouvelée, concernant l’îlot Stephenson, « le fil rouge du projet a été d’associer les futurs habitants des maisons rénovées aux choix d’aménagement et d’éco-réhabilitation opérés.[…] En 2013, le quartier reprend vie autour d’habitants historiques, riverains depuis plusieurs décennies, et de nouveaux arrivants. Elles correspondent parfaitement aux besoins actuels : hautes performances énergétiques, alliance du charme de l’ancien et de matériaux modernes, agencement fonctionnel. » À Stephenson, seuls cinq habitant·es originel·les seraient resté·es et une trentaine de maisons ouvrières non démolies ont été réhabilitées. Avec parfois un coût au m2 de 2 700 euros, et malgré qu’un tiers soient qualifiés de « social », les 1~450 logements réhabilités ou neufs prévus sur l’Union seront dans l’ensemble difficilement accessibles aux Roubaisien·nes lambda. « Sur la trame de décennies d’histoire, un nouveau tissu urbain se confectionne aujourd’hui », se vante pourtant la SEM Ville Renouvelée.
Sous les fards de la participation et de la mixité sociale, la concertation avec les habitant·es n’a pas été évidente, la démolition de nombreuses maisons ayant eu lieu avant les réunions [18. À propos des processus de participation et plus généralement de la réhabilitation de l’Union, le journal indépendant lillois La Brique a réalisé un précieux travail d’enquête en novembre 2009 (La Brique, no 18).]… Le collectif de l’Union essaie depuis sa création de jouer le jeu de la participation proposée par la SEM Ville Renouvelée à travers le Club des partenaires, qui rassemble autant les ancien·nes salarié·es de la zone et les comités de quartier que les entreprises présentes, comme Vinci, ou les partenaires économiques de la métropole. « La cicatrice était encore fraîche. On était vraiment méfiant·es au début du projet de l’Union, et toujours dans une période de deuil. Mais on s’est dit qu’ayant contribué à l’effort économique de toute la région, qu’on avait aussi notre mot à dire », explique Bouzid Belgacem, qui participe au collectif de l’Union. Amer, il avouait encore récemment dans la presse locale : « La SEM aurait dû vraiment faire participer les associations, comme les ancien·nes de La Tossée. On avait un projet favorisant l’insertion professionnelle, mais on n’a pas été retenu·es. Il ne s’agissait pas seulement de prendre notre avis, mais on ne nous a pas donné la possibilité de peser sur les décisions [19. La Voix du Nord, 28 août 2014]. » Prix de consolation : les noms des terrains du complexe Kipstadium pourront finalement être choisis par les élèves des écoles primaires roubaisiennes…
Laissés pour compte dans le virage de la révolution des textiles innovants, les gens du textile, les ancien·nes ouvrier·es aux phalanges dévorées par les machines, ceux et celles qui veulent combattre contre l’oubli de leurs luttes et de leurs solidarités tissées sous les cadences infernales des usines, sont ainsi condamné·es à être également les spectateurs et spectatrices des mutations de leur ville. En plein cœur de la friche, en quittant la rue de Tourcoing, un gigantesque « ÊTES-VOUS ICI ? » a été peint sur le pan d’un bâtiment de briques de La Tossée, à deux pas de la Maison de l’Union. L’inscription semble interpeller cyniquement les ancien·nes habitant·es et les ouvrier·es relégué·es du quartier, autant que les tenants de la nouvelle révolution textile, déconnectée de ce que fut le « berceau de l’industrie textile ». Qu’on se rassure, la fresque a été commandée par la SEM Ville Renouvelée.
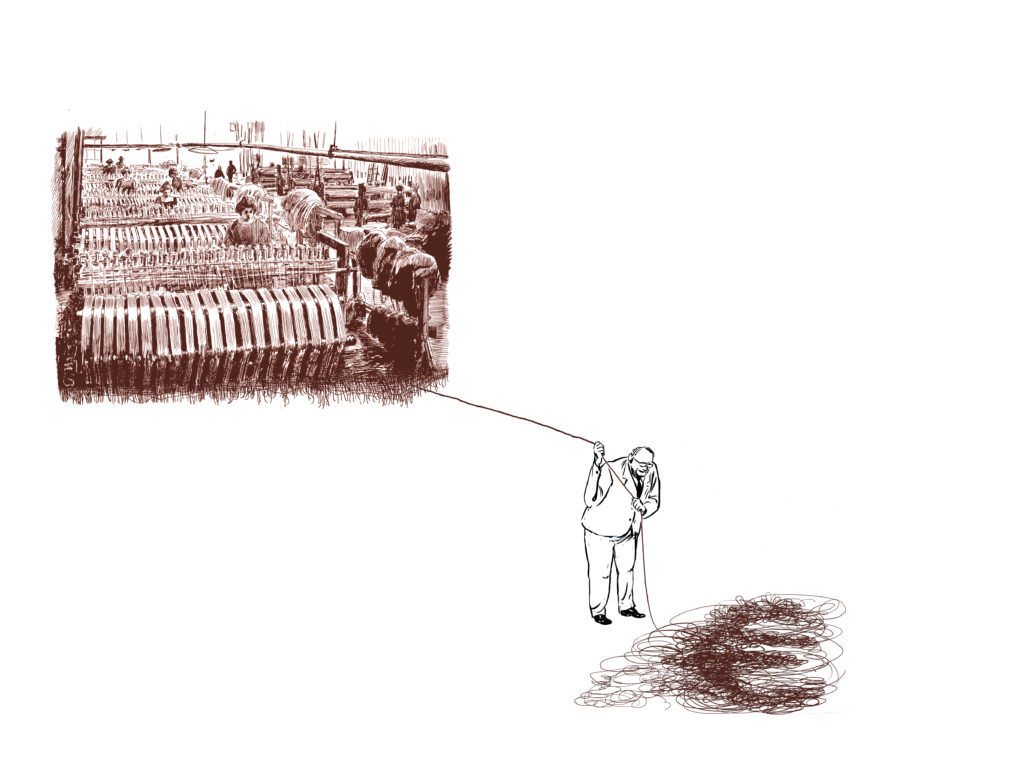
Notes
| ↩1 | En 2011, pour environ 210 millions d’euros engagés sur la zone de l’Union, près des deux tiers provenaient uniquement de Lille Métropole. |
La fabrique de l’aérobic
Chimie, lycra et VHS
Traduit du castillan par Julia Burtin Zortea. Article original « Forjar lo kitsch », Clift 1 Initialement paru sous le titre « Forjar lo kitsch », cet article provient du fanzine trimestriel barcelonais Clift, dont le 8e numéro (septembre 2013) porte intégralement sur l’aérobic. … Continue reading, 2013.
Que se passe-t-il quand un médecin militaire rencontre un chimiste, lequel croise un producteur de cassettes VHS, qui aperçoit à son tour une actrice célèbre dans la rue ? Un business fluo, tonique, intrusif, et singulièrement lucratif. Petite démonstration.
Cette traduction est issue du deuxième numéro de la revue Jef Klak, « Bout d’ficelle », encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF.
Hambourg, le 27 avril 2013. Dans la salle de concerts des Docks, la foule attend avec impatience l’entrée en scène de The Knife, groupe de musique électronique arty qui ne s’est pas produit sur scène depuis sept ans, et qui vient de sortir un disque évènement. D’où l’atmosphère vibrante de désir.
Le noir se fait et, par la porte de derrière, un homme apparaît, entièrement maquillé, portant moumoute, barbe et tenue de femme tout droit sortie d’une session d’aérobic des années 1980. Préfigurant plus ou moins la suite du show.
Il s’agit de Tarek Halaby, autoproclamé pour l’occasion master-teacher-guru-shaman-dictator-aerobic instructor-new age workshop leader et fidèle collaborateur de l’agitateur culturel états-unien Miguel Gutierrez. Ensemble, ils ont créé la performance DEEP Aerobics (Death Electro Emo Protest Aerobics), cours d’aérobic libre qui, selon la présentation de The Knife, « s’adresse à toute personne intéressée par l’idée de combiner la joie de vivre [2. En français dans le texte.] présente dans le vigoureux rebond de nos molécules anatomiques/spirituelles/énergétiques avec l’absurde existentiel d’une vie plongée dans un monde/pays/économie synonyme d’injustice, de bellicisme et de médiocrité culturelle ».
Dans la pratique, un mélange d’exercices de mains-en-l’air, de sauts-vers-la-droite, de danseeeez, accompagnés de phrases inspirées de pseudo-philosophie existentielle (I’m still alive and I don’t fear to die), dans le pur style « animateur-pour-le-troisième-âge-de-l’hôtel-Marina-D’Or ». Prélude parfait au nouveau show kitschissime et éclectique de The Knife, apéritif pour une soirée dingue de playbacks, de chorégraphies dignes des étés d’antan et de costumes en lycra aux couleurs exubérantes. The Knife ramasse le style festif et énergique de l’aérobic avant de l’éclater contre un mur, pour mieux montrer l’aspect aseptisé et vide de la réalité. Shaking The Habitual, allez.
Soyons clairs, The Knife (et par extension Tarek Halaby et Miguel Gutierrez) ne font rien d’autre que reprendre – avec plus ou moins de profondeur – un message et une esthétique dans l’air du temps. Pendant les années 1990, l’aérobic des Eighties a certes pu être associée à une certaine beaufitude, mais depuis vingt ans, l’esthétique naïve, coloriste et vitaliste de ce sport chorégraphié n’a pas cessé d’être revisitée : le podium de Betsey Johnson lors de la Fashion Week de New York (2013), les références disséminées dans le film La revanche d’une blonde (Robert Luketic, 2001), les actuels rendez-vous londoniens de cours d’aérobic style années 1980, ou encore les vidéos comme Mariko Takahashi’s Fitness Video for Being Appraised as an « Ex-fat Girl » (2004) de la vidéo-artiste Nagi Noda, etc.
La passion pour l’aérobic a ainsi gagné ses lettres de noblesse, en remettant au goût du jour d’autres formes d’exercices physiques comme le Pilates, ou en imposant des mots techniques tels que bodystiling ou bodypump. Une dynamique bien au-delà de simples irruptions de nostalgie culturelle.
Et la lumière fut
L’aérobic est une pratique sportive créée par le docteur en médecine Kenneth H. Cooper. En quête de la combinaison parfaite pour améliorer force physique et santé, il s’est enrôlé comme directeur médical du laboratoire aérospatial de San Antoni, et a passé deux années en tant que lieutenant-colonel dans les Forces aériennes des États-Unis. Sa carrière connut son apogée avec la publication de l’étude Aerobics (1968), un essai vendu à plus de trente millions d’exemplaires dans le monde entier. Ce succès s’explique par le fait que Cooper inventa une méthode qui, outre son application à la sphère militaire, offrait à tout un chacun des conseils pour améliorer le système cardiovasculaire. Rappelons qu’à cette même époque, la société américaine commençait à ressentir les effets du sédentarisme du Welfare State [3. Forgée en opposition au Warfare State (État de guerre), la notion de Welfare State (Estado del bienestar en espagnol et littéralement « État du Bien-Être » en français) n’est qu’un équivalent approximatif de la notion française d’État-Providence, NdT.] dans sa propre chair (ledit Cooper avait eu une attaque cardiaque à 29 ans qui l’avait amené à se consacrer au sport).

Misant sur l’assurance du succès, il voua sa carrière au développement de sa technique et, tant qu’à faire, à la création d’un rouleau compresseur marketing, en multipliant les suites d’Aerobics : The New Aerobics (spécial troisième âge), Aerobics for Women (réservé aux femmes) ou encore l’émission de radio La vie saine avec le Dr Cooper. Puis vint le summum : la construction du Cooper Aerobics Center, clinique de recherche orientée sur la relation entre longévité, exercice physique et santé, qui devint plus tard l’Aerobics Activity Center – la Mecque de l’aérobic –, comprenant un hôtel pour accueillir la clientèle du centre, un terrain d’entraînement et un dernier bâtiment, l’Institut Cooper, consacré à la recherche.
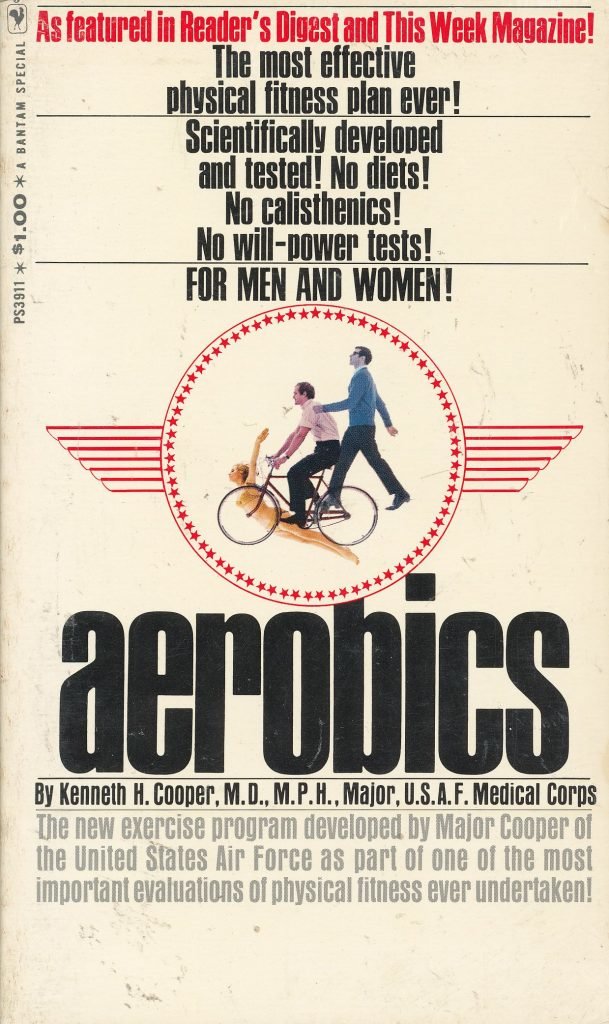
Cooper n’avait qu’une devise : « Il est plus facile de maintenir une bonne santé grâce à un exercice physique approprié, un régime alimentaire et un équilibre émotionnel, que de la récupérer une fois perdue », grâce à laquelle il fut l’un des premiers à introduire le sport dans le secteur marchand. Sa réputation est telle qu’au Brésil (où Cooper remporta un vif succès), on dit « coopering » ou « faire le Cooper » pour désigner la pratique du jogging.

Chimie, mode et sport
Diplômé en sciences, et docteur en chimie de la Duke University en 1940, Joseph Shivers commença sa carrière pendant la Seconde Guerre mondiale en synthétisant, pour le compte du gouvernement, un antidote contre la malaria destiné aux marines affectés au sud du Pacifique. Cependant, sa vie opéra un virage à 90° quand DuPont, géant de l’industrie chimique, jeta son dévolu sur le scientifique et lui proposa un emploi dans la section des polymères.
La firme DuPont est connue pour son esprit capitaliste et sa tendance à faire breveter tous ses produits pour en garder le monopole. Elle est également une des entreprises les plus importantes et réputées au monde, employant 59 000 travailleurs. C’est sans doute pour cette raison que Shivers, qui ne s’était jamais imaginé travailler dans cette branche de la chimie, ne pu écarter l’offre et commença en qualité d’assistant au sein d’un projet de blanchissage de la fibre acrylique, deuxième tissu synthétique inventé après le nylon [4. DuPont brevète le nylon en 1935 avec l’intention première de remplacer la soie dans les équipements militaires (parachutes, pneus, gilets anti-explosifs). La fibre acrylique est déposée six ans plus tard par la même entreprise, sous le nom d’Orlon, NdT.].

Sans toutefois jamais parvenir à blanchir cette fibre, Shivers apprit tout ce qu’il lui fallait savoir sur les polymères et appliqua ses connaissances à son nouveau projet : fabriquer une fibre élastique à partir du caoutchouc, pouvant être appliquée au secteur de la corsetterie. Et tada ! Après dix années de dur labeur, Shivers créa le spandex, plus connu sous le nom de lycra, lequel révolutionna entièrement le secteur textile.
La nouvelle fibre créée par DuPont promettait une plus grande durabilité et un poids moindre que le caoutchouc dont elle provenait, ainsi qu’un nouvel élément-clef : l’élasticité (le lycra peut s’étirer jusqu’à 600 % sans se déchirer). Selon les experts de DuPont, « What’s at work in elasticity, in part, is entropy », entropie comprise comme « a measure of the disorder of a close thermodynamic system in terms of a constant multiple of the natural logarithm of the probability of the occurrence of a particular molecular arrangement of the system that by suitable choice of a constant reduces to the measure of unavailable energy ». Wowww ! Nous rigolons de l’esthétique licencieuse de l’aérobic, mais qui pourrait me traduire ça ?

Dès sa première application commerciale, le lycra permit aux femmes de ne plus souffrir dans leurs vieux maillots de bain de laine : finies les longues heures de séchage après la baignade, la laine collée à la peau. À partir de là, le règne du lycra s’étendit aux vêtements sportifs et aux bodys ; il entra dans les discothèques, sculptant les corps sur la piste de danse, fut adopté par les stars de la pop et du rock, et connut une ascension continue. Aujourd’hui, DuPont estime que l’« on n’a toujours pas trouvé de limite à l’utilisation du lycra » : vernis à ongle, balles de golf et même préservatifs. « Si j’avais su ! », confie Shivers, maintenant âgé de 93 ans et retiré du monde de l’entreprise depuis une décennie.
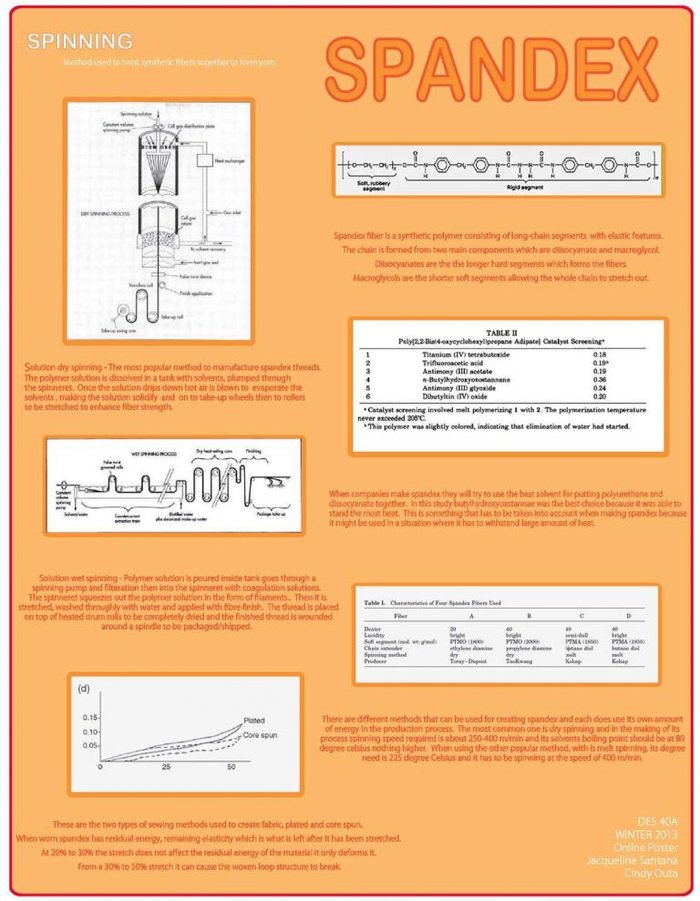
Des courbatures de couleur rose
Imaginez maintenant que nous nous trouvons au cœur des années 1950, en compagnie de la fille d’un acteur célèbre. Sur les traces de son père, elle se rend à Paris pour y suivre des cours d’interprétation et complète sa formation à New York à l’Actors Studio, d’où elle sort prête à triompher.
Nouveau saut dans le temps. Nous voici le 9 avril 1979, et la jeune fille aux rêves de celluloïd a revêtu les contours d’une femme en robe de soirée s’apprêtant à entrer dans le Dorothy Partner Pavilion, où se tient la 51e cérémonie de remise des Oscars. Nominée, elle est fébrile – davantage qu’elle aurait cru, ayant remporté un prix deux ans plus tôt.

Dernier bond temporel, plus ample encore : nous sommes avec Debbie et Stuart Karl, producteur et distributeur de cassettes VHS – support alors largement méconnu. Le couple se promène dans la rue en cette journée ordinaire, tandis que madame explique à son époux combien il serait génial de pouvoir faire du sport à la maison, plutôt que d’avoir à se rendre au gymnase. À ce moment précis, Stuart aperçoit dans la vitrine d’un magasin un poster géant de la célèbre star de cinéma que nous venons d’accompagner aux Oscars. Il s’agit de Jane Fonda, et Stuart a une révélation : la fameuse série d’aérobic Jane Fonda’s Workout naîtra de cette aventure conjugale aux accents de légende.
Jane Fonda, fille d’Henry, actrice reconnue et sex-symbol depuis le film culte de science-fiction Barbarella, refusa d’abord l’insistante proposition faite, entre 1980 et 1981, par Stuart Karl, pionnier de la VHS et créateur du genre How-to (sorte de YouTube de l’ère pré-Internet). « Jamais de la vie. Je suis une actrice, et ce serait fatal pour ma carrière », déclara à chaud Fonda dans une interview. Il faut par ailleurs se souvenir qu’à cette époque, les cassettes-vidéo circulaient encore peu, du fait de leur prix élevé. Jane douta donc un long moment, puis accepta enfin. Probablement – c’est ce que révèle une autre interview – parce qu’elle ne pouvait plus pratiquer sa grande passion, le ballet, après s’être cassée le pied.
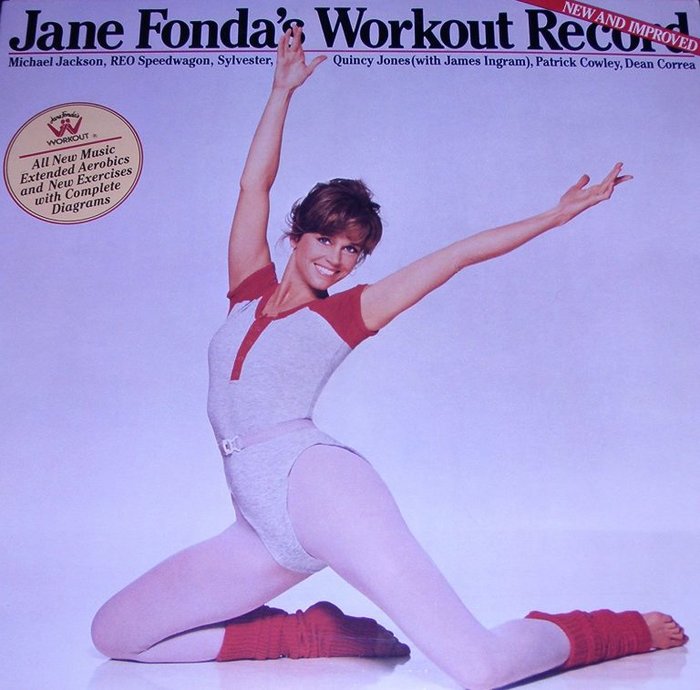
L’insistance de Karl porta donc ses fruits, et ils enregistrèrent leur première vidéo en 1982. Le scénario fut écrit par Jane Fonda, laquelle choisit aussi les costumes : du lycra pour se mouvoir comme si l’on ne portait rien, et des guêtres : « Je porte toujours des guêtres, parce que mon véritable amour est le ballet, et que les ballerines portent toujours des guêtres » – minute, papillon : la mode des guêtres dans les années 1980 viendraient-elles de là ? Tout ça à cause de Jane Fonda ?!
Jane Fonda’s Workout deviendra bientôt la première cassette VHS de non-fiction à atteindre plus de 100 000 ventes. Assurés de leur succès, le tandem Karl-Fonda réalisa quelques vidéos de plus, jusqu’à ce que Karl s’associe en 1984 à l’entreprise Lorimar, laquelle absorba peu à peu la Karl Video Corp. et ses productions. Les vidéos de Jane Fonda, avec la pratique et l’esthétique de l’aérobic qu’elles véhiculaient, exerceront une grande influence. En témoignent ces films orientés sur le phénomène : Pulsebeat ou Heavenly Bodies, tous deux tournés dans des gymnases et interprétés par des acteurs de second rôle, ultra-fibrés, portant lycra et guêtres, la tête ceinte de bandeaux.
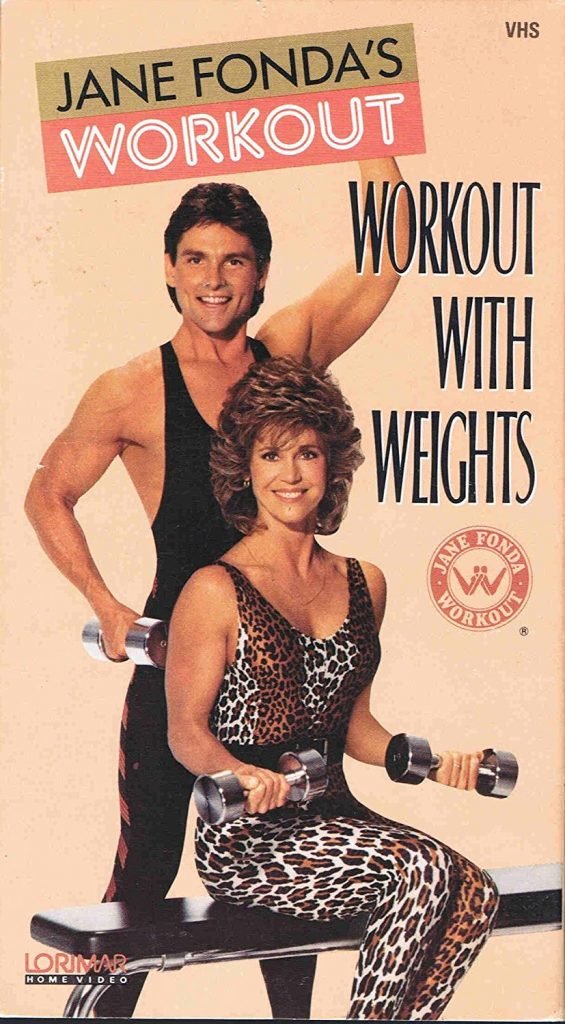
Jane Fonda fut par la suite la première personne n’occupant pas une fonction de technicien à être reconnue par le Video Hall of Fame. Son livre sur l’aérobic se maintint dans les meilleures ventes deux années consécutives – c’est d’ailleurs suite à cela que libraires et éditeurs décidèrent de créer la catégorie des ouvrages de non-fiction. Ou comment Jane Fonda fixa les critères de ce qui constitue aujourd’hui l’idéal-type de l’aérobic…
Notes
| ↩1 | Initialement paru sous le titre « Forjar lo kitsch », cet article provient du fanzine trimestriel barcelonais Clift, dont le 8e numéro (septembre 2013) porte intégralement sur l’aérobic. Né en 2012, Clift est réalisé et édité par la petite maison d’édition indépendante implantée à Barcelone DeHavilland : « Clift aborde toujours des thèmes inquiétants, dénaturés, et pervers » ; chaque numéro propose une couleur et un thème différents (le pelage, la bibliophagie, les excréments, la cryptozoologie, la boucle, les miracles…). |
Éloge du quatre pistes
King Tubby & Lee « Scratch » Perry : le gros son du ghetto
Peu de musiques ont incarné l’esprit d’un lieu comme l’a fait le « son du ghetto » – qu’on le nomme ska, rocksteady, reggae ou dub –, devenu en Jamaïque, dixit Lloyd Bradley 1 Lloyd Bradley, Bass culture – Quand le reggae était roi, Allia, 2006., « une obsession nationale ». « J’aimais jouer aux dominos, j’aimais danser. Je n’ai jamais aimé travailler, parce que je ne souhaite à personne d’être esclave », professe Lee « Scratch » Perry, ce petit gars originaire de l’arrière-pays, où l’extraction intensive de roches de bauxite chassait des milliers de paysans. « J’aime être travaillé dans mon esprit. J’ai bossé deux semaines dans une carrière et le bruit des pierres m’a inspiré. J’ai entendu des rythmes, j’ai entendu des mots, et ces mots m’ont poussé vers la ville. » Mais l’inspiration n’est pas que divine et ce faux paresseux de Perry va le prouver. « La véritable créativité est le sous-produit d’un type de maîtrise qui s’obtient au terme de longues années de pratique », écrit Matthew Crawford dans son Éloge du carburateur [2. Matthew B. Crawford, Éloge du carburateur – Essai sur le sens et la valeur du travail, La Découverte, 2010.], qui oppose le savoir-faire artisanal à l’appauvrissante aliénation du monde industriel. Et les studios d’enregistrement de Kingston avaient plus à voir avec un atelier mécanique de Bamako qu’avec une chaîne de montage Ford…
Ce texte est issu du deuxième numéro de Jef Klak, « Bout d’ficelle », traitant du textile, de la mode et des identités de genre, et encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF.
« Lee Scratch Perry est délirant – vraiment, vraiment timbré – et la plupart des gens d’ici le sont aussi, socialement parlant. »
Leroy Sibbles, chanteur des Heptones
Bidouillages copy-free
Les sound systems, qui ont fleuri aux coins des rues du ghetto dès les années 1950, véhiculent la soif de vivre de la jeunesse locale, ainsi qu’une vision acerbe de la question sociale non résolue par l’indépendance (1962). Plus posé que le ska, le tempo rocksteady permet, dès les mid-60’s, aux rude boys [3. Les rude boys sont les mauvais garçons du ghetto de Trenchtown. Le premier nom des Wailers était The Rude Boys. Le terme s’exporte ensuite en Angleterre, où les skinheads l’adoptent en même temps que le rythme rocksteady.] de danser sur la piste tout en restant frais en cas de baston. Après les producteurs se pillant les uns les autres, vient le temps d’une génération de pirates remixant et posant leur tchatche sur les tubes de l’été dernier.
Réparateur radio reconverti dès 1961 en ingénieur du son, King Tubby s’associe avec le DeeJay [4. Les DeeJays – à ne pas confondre avec les Dj’s, qu’en Jamaïque on appelle selectors (ou « selectas ») – sont des ambianceurs embauchés par les sound-systems pour chauffer la salle. Ils toastent au micro sur les morceaux que le selecta pose sur la platine.] U-Roy et booste les vibrations de la musique populaire avec ses bidouillages électroniques, posant les bases de ce qui deviendra le hip-hop, la drum’n’bass ou la techno [5. La cuisine des mixeurs, DeeJays et dub-masters jamaïcains des années 1970 est un avant-goût du hip-hop, qui sera clairement influencé par le bouillonnement sonore de Kingston – après que, dans un mouvement pendulaire, les specials jamaïcains se sont inspirés, eux, des Part-2 de James Brown.]… Graveur de dub-plates (disque souple servant de master) chez le producteur Duke Reid, il monte son propre studio avec un TEAC quatre-pistes, simple magnétophone à bandes. Substituant les boutons on/off par des curseurs, il fait entrer et sortir voix et instruments au gré de ses expérimentations, sublimant les riddims [6. Créolisation jamaïcaine du mot anglais « rythm », un riddim est une séquence musicale formant la base d’une chanson. Souvent joué par la basse ou le clavier, il a pour particularité d’être recyclé de multiples fois par divers groupes et sous des titres différents.] dont s’emparent depuis peu les DeeJays. Au passage, il invente le dub.
L’ingénieur devient artiste (Tubby est un fou de jazz) et hisse une musique des plus organiques au rang de classiques [7. Acmé de cette créativité débridée, les albums King Tubby meets Rockers uptown (1977) et Rockers meets King Tubby’s in a fire house (1980), en collaboration avec le musicien et producteur Augustus Pablo. https://www.youtube.com/watch?v=3_6aBcd9YyU] – au besoin en squeezant d’un coup de manette certains lyrics à l’eau de rose. Mis en exergue, les tambours de la pocomania (vaudou jamaïcain) convoquent les mannes de l’Afrique (que les maîtres d’esclaves craignaient tant qu’ils les avaient bannis de leurs plantations) et viennent tour à tour enlacer une montée triomphale de cuivres, une énorme ligne de basse, un riff fugitif du guitariste, un éclat de voix… Le démon du dub est dans les détails. Grains de folie sonores, fantaisies d’apprenti-sorcier abusant de la reverb’, mais ne sombrant jamais dans le saupoudrage superflu : l’ensemble se met en place en une savante mécanique, qui fait sens dans un grand tout
>
Système D
« La plupart de ces soirées dont nous parlons étaient en extérieur, où vous aviez toujours ces grosses enceintes, mais Tubby s’était dégoté des sirènes de navire métalliques pour les aigus et il les plaçait dans les arbres, comme ça, on avait l’impression que le son venait de partout. Quand la nuit était chaude, que la brise soufflait, c’était vraiment quelque chose à voir », explique le DeeJay Dennis Alcapone [8. Lloyd Bradley, op. cit.]. En 1970, devenu maître du gros son, Tubby s’acoquine avec Lee Perry, homme à tout faire chez Studio One rendu célèbre par son hymne anti-carcéral « Set them free » (1966). Il l’aide à monter son propre laboratoire : le studio Black Ark. Perry, roi du système D, va doper les chansons de Bob Marley, et, comme par jeu, rend souvent la version instrumentale supérieure à l’original par son humour et sa liberté de ton. « Il n’y avait que quatre pistes répertoriées sur la machine, mais j’en ai branché vingt autres direct sur la bande extra-terrestre. Je suis le berger dub [9. « Dub Shepherd », en référence aux prêtres de la pocomania.] ! » Cette prophétie auto-réalisatrice fait pâlir d’envie le White album des Beatles.
Potentiomètres manipulés avec dextérité, micro pendu dans un seau en guise de chambre d’écho, repas partagés entre deux prises, ganja + rhum, autant de recettes gagnantes pour des sessions enregistrées au feeling, mais avec toute la rigueur technique du monde. Les joues de Perry deviennent peau de tambour, des pleurs de bébé et des bruits de basse-cour émaillent ses arrangements. En perpétuant la gouaille du ska des origines, il évite d’avoir à officier dans la grand-messe rasta d’un Bob Marley devenu entre temps rock-star globale.
Formatage
Sourds aux sirènes de l’Exodus, et à l’instar du sceptique Chester Himes [10. Voir Retour en Afrique, de Chester Himes, Série Noire, Gallimard, 2003.], Perry et Tubby préfèrent investir leur énergie dans une nourriture terrestre pour ici et maintenant, à partir d’un imaginaire d’abord local. Cette tambouille relève bien plus de la Jamaïque profonde que du strict credo rasta [11. Le rastafarisme est un mouvement messianique né dans les années 1930 avec la pensée de Marcus Garvey, qui prône une rédemption biblique des Noirs du Nouveau monde par leur retour en Afrique.]. Rien à faire, c’est le son roots qui, comme son nom l’indique, exprime le mieux l’esprit de la terre, en lien avec l’esprit rebelle et volatile des sixties [12. Les pochettes des deux LPs des Wailers produits par Perry, Soul rebels et Soul revolution part II, témoignent de cet esprit : une fille seins nus brandit un fusil d’assaut et les membres du groupe prennent la pause avec des armes en plastique, vêtus comme des Black Panthers.] : une époque où, en une sensuelle dialectique, le mouvement social est parvenu à s’imbiber et, en retour, à irriguer le mouvement musical… Beaucoup de rastas oublieront par la suite que l’un de leurs prophètes, Marcus Garvey, fut leader de grèves sur le port de Kingston avant de devenir « le Moïse noir ». En exaltant le mysticisme et en se focalisant sur le thème du retour en Afrique, le son et la rue abandonnent peu à peu la bataille pour l’émancipation sociale de l’île. Le reflux de la subversion coïncide avec la commercialisation des idées et des musiques les plus présentables sur le marché mondial. Avec des têtes de gondole comme Jimmy Cliff, Bob Marley ou Steel Pulse, le label Island Records, fondé en 1959 par Chris Blackwell, Jamaïcain blanc expatrié dès 1962 à Londres, représente le versant opposé de cette cuisine-là. Blackwell polit le son et l’image du reggae, le rendant assimilable par le public rock mainstream. Un exode vers le formatage industriel difficilement compensé par le supplément d’âme du discours rastafarien.
En 1989, King Tubby se fait flinguer dans son studio – après Peter Tosh [13. Peter Tosh, abattu par un jeune voyou qu’il avait l’habitude d’aider, avait chanté un prémonitoire « Magga Dog », où il parlait des chiens errants qui mordent la main qui les nourrit.], Prince Far-I et bien d’autres. Les rude boys, d’abord manipulés dans les luttes entre partis, s’enrôlent dans la guerre des gangs de la drogue. Le règne du chacun-pour-soi s’exprime dans le slackness, ragga hyper sexualisé, et le bling-bling d’un dancehall sous influence gangsta rap. En 1983, mis sous pression par le succès et les racketteurs, « Scratch » Perry avait pété les plombs et foutu le feu à son studio avant de s’exiler en Angleterre.
Notes
| ↩1 | Lloyd Bradley, Bass culture – Quand le reggae était roi, Allia, 2006. |
Super pouvoir noir
Les comics à l’épreuve du Black Power
Traduit de l’américain par le collectif Angles morts
1966, le mouvement Black Power est en pleine ébullition, le Black Panther Party vient de se créer et le premier super-héros noir apparaît dans les strips de Marvel Comics. « T’Challa, la Panthère Noire » évolue dans le Wakanda, nation africaine indépendante au développement technologique avancé. Les Noirs représentés au sein de cette Black Nation fictionnelle sont médecins, hommes politiques ou simples soldats pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs désireux de bousculer les représentations. Malgré les diverses tentatives de Marvel Comics pour en affaiblir la dimension politique, la Panthère Noire et le Wakanda ont porté haut les couleurs de la communauté africaine-américaine, comme en attestent les courriers des lecteurs, témoins de cette lutte symbolique au sein de la culture populaire des années 1960-70.
Cet article est paru dans le numéro 2 de Jef Klak, « Bout d’ficelle », encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF.
En juillet 1966, trois mois seulement avant la création du Black Panther Party à Oakland, en Californie, Marvel Comics présente La Panthère Noire (The Black Panther), premier superhéros noir admis dans l’univers immortel des comic books américains. D’abord conçue par Stan Lee et Jack Kirby sous le nom de « Tigre de Charbon », la Panthère Noire est officiellement intronisée dans « l’Univers Marvel » dans le numéro 52 des Quatre Fantastiques, un titre immensément populaire à l’époque.
Héritière de la couronne du Wakanda, une nation africaine cachée, la Panthère Noire est dotée de la puissance, de la vitesse, des sens, des réflexes et de l’agilité d’une panthère, lui conférant ainsi des pouvoirs surnaturels. Elle n’est pas le premier personnage noir dans les comics américains, mais c’est le premier à être doté de super-pouvoirs, une avancée que Marvel qualifie fièrement d’« événement révolutionnaire ». Quelques semaines à peine avant le lancement de la Panthère Noire, la police de Greenwood, dans le Mississippi, jetait Stokely Carmichael1 NdT : Militant noir d’origine trinidadienne, Carmichael a été dirigeant du Student NonViolent Coordinating Committee (SNCC), organisation étudiante noire qui fait le choix de la non-mixité … Continue reading en prison, accusé d’avoir mené une foule de trois mille marcheurs pour les droits civiques, défilant sous un nouveau mot d’ordre : « Pouvoir Noir ! »
Pouvoir et Pulps
« Le thème des comics, c’est le pouvoir », déclara un jour Carmine Infantino, longtemps rédacteur en chef du label concurrent de Marvel : DC Comics. Sachant que les exploits hauts en couleur des superhéros et leurs super-pouvoirs servent de fonds de commerce à la plupart des comics, sa déclaration pourrait sembler singulièrement creuse. Elle est cependant loin d’être naïve pour analyser les relations entre représentations des super-pouvoirs dans les comics et perceptions du pouvoir politique et social dans l’imaginaire culturel américain.
Durant l’intense période politique des mouvements contre-culturels américains des années 1960 et 1970, les luttes sociales trouvent souvent un écho dans les pages de comics de superhéros populaires. Leur regain de popularité à cette époque est principalement dû à l’équipe innovante et audacieuse de Marvel Comics. Menée par un prolifique noyau dur constitué de Stan Lee, Steve Ditko et Jack Kirby, la maison d’édition réinvente le genre au début des années 1960, en rejetant le modèle de l’ère Superman, celui du superhéros classique conçu comme un noble sauveur surplombant l’humanité, au profit d’un nouveau type d’antihéros, embourbé dans des problématiques existentielles comme Monsieur tout le monde : un antihéros pour qui avoir des super-pouvoirs relève davantage d’un fardeau aliénant que d’un don libérateur.
En 1971, dans un article du New York Times Magazine, « Shazam ! Here comes Captain Relevant », Saul Braun a mis en lumière l’essor de cette réaction contre-culturelle, dirigée à la fois contre les clivages traditionnels liés à la guerre froide et contre les représentations des super-pouvoirs qu’elles impliquent :
« Il me paraît intéressant de remarquer que, à de rares exceptions près, la guerre du Viêtnam n’a pas suscité de résistance parmi une génération qui voyageait à travers le monde, avec une vision fantasmée du pouvoir. En revanche, elle a suscité, dans l’ensemble, l’opposition de la génération suivante qui, elle, a commencé à rejeter les comics des années 1950, avec leurs représentations du monde aseptisées, censurées et irréelles. Un monde dans lequel “nous” étions les bons et “eux” les méchants, dans lequel nous pouvions faire passer le non-respect des lois pour de l’héroïsme, un monde dans lequel les Noirs étaient invisibles. […] Un monde dans lequel aucun superhéros, en dépit des excès auxquels il pouvait se livrer, ne doutait jamais qu’il utilisait ses pouvoirs de façon sage et morale. »
A contrario, durant les années 1960-70, l’élite des mouvements de jeunesse américains est prise d’un soudain penchant pour les nouveaux superhéros de Marvel. En septembre 1965, Esquire magazine note que « Spiderman est aussi populaire que Che Guevara dans la frange radicale des universités américaines ». Un an plus tard, le même journal se penche à nouveau sur l’immense popularité des comics Marvel pour la jeunesse de l’époque, ainsi que sur la façon dont Stan Lee a accédé au rang d’icône :
« Le club de débat de l’université de Princeton a invité Stan Lee, auteur de dix comics de superhéros publiés par Marvel, pour s’exprimer dans le cadre d’une série de conférences aux côtés de Hubert Humphrey, William Scranton et Wayne Morse. [Stan Lee] a par ailleurs été invité à Bard (où il a attiré une audience plus grande que le président Eisenhower), à l’université de New York et à Columbia. […] Comme lui a confié un membre de l’Ivy League[2. NdT : Surnom donné à un ensemble de huit universités américaines, réputées les plus prestigieuses.] : “Les comics Marvel sont pour nous la mythologie du XXe siècle. À nos yeux, vous êtes le Homère de cette génération.” »
Le syndrome Superman
La défiance à l’égard du modèle classique des super-pouvoirs s’étend également au mouvement naissant du Black Power. Ce dernier emploie alors souvent le terme « Superman » pour symboliser les structures de pouvoir américaines dominées par les Blancs. Lors du procès des Sept de Chicago en 1969[3. NdT : Les Sept de Chicago étaient sept activistes, accusés notamment de conspiration contre le gouvernement, suite aux révoltes qui marquèrent la convention du Parti démocrate en 1968 à Chicago. Bobby Seale, qui devait initialement être jugé à leurs côtés, fit l’objet d’un procès à part. Ligoté et bâillonné pendant son procès, il fut condamné à quatre ans de prison pour outrage à magistrat.], dans l’une de ses interventions explosives devenues célèbres, Bobby Seale, président du Black Panther Party, dénonce « cette administration raciste, avec ses notions inspirées de Superman et sa politique digne des comics. Nous savons bien que Superman n’a jamais sauvé aucun Noir ». Pendant une audience, Seale provoque également le juge Julius Hoffman en déclarant : « Les Noirs ne sont-ils pas supposés être dépourvus d’esprit ? C’est ce que vous pensez. Nous avons pourtant un corps et un esprit. Je me pose la question suivante : n’avez-vous pas perdu le vôtre à cause du syndrome Superman et de toutes ces histoires de comics ? »
Dans son ouvrage intitulé Seize the time: the story of the Black Panther Party and Huey P. Newton, Seale utilise également le terme « Superman » pour désigner un agent du FBI auquel il a été confronté à Oakland le 16 août 1969 : « Il m’a regardé, arborant un large sourire. Il se prenait pour Superman. D’un simple regard, il était facile de voir à quel point il a été psychologiquement abruti par des concepts à la Superman. Il a subi un tel lavage de cerveau qu’il est persuadé de défendre le prétendu “monde libre”. » De même, le poète et musicien Gil Scott-Heron, auteur en 1970 de l’hymne désormais célèbre du Black Power « The Revolution will not be televised », composa un autre morceau intitulé « Ain’t no such thing as Superman ». Le rejet du concept de « Superman » et de la culture américaine des comics par Seale et Heron, montre que pour le Black Power, dans ses différentes composantes, la catégorie de « superhéros » incarne dès le départ un symbole mythique supplémentaire des super-pouvoirs exclusivement blancs – et méritait donc d’être déconstruite de façon critique.

La panthère surgit
C’est au sein de cette culture comics politiquement chargée que la Panthère Noire apparaît en 1966. Présentée dans le numéro 52 des Quatre Fantastiques, la Panthère Noire, également connue sous le nom de T’Challa, règne sur le royaume caché du Wakanda, situé dans les profondeurs de l’Afrique équatoriale. Le Wakanda abrite la seule source d’un métal précieux, le « vibranium », qui absorbe les vibrations et qui lui confère une valeur inestimable pour le développement technologique partout dans le monde. Le père de T’Challa fut tué par un chasseur d’ivoire, un Blanc du nom d’Ulysse Klaw qui tentait de prendre le contrôle des réserves de vibranium de Wakanda. T’Challa parvint à faire fuir Klaw et ses sbires du Wakanda, prétendit au rang de chef de la tribu en faisant valoir son statut d’héritier, et accepta les pouvoirs sacrés et mystérieux inhérents au titre de Panthère Noire. Peu après sa prise de pouvoir, le nouveau chef mit son propre génie scientifique au service de la transformation de son pays. Ce qui n’était que jungle devint une forteresse technologique moderne grâce à la vente « de petites quantités de vibranium à plusieurs fondations scientifiques, ce qui [lui] permit d’amasser une fortune, pareille à nulle autre sur la terre ! »
T’Challa fait preuve de ruse pour attirer les Quatre Fantastiques dans son pays afin d’éprouver ses grandes aptitudes de guerrier, en vue d’un combat final avec Klaw. La Panthère Noire parvient presque à battre les Quatre Fantastiques dans la jungle, en utilisant contre chacun d’eux une série d’ingénieux pièges techniques, finalement déjoués à cause de Wyatt Wingfoot, ami amérindien de l’équipe, qui n’est pas un superhéros et que la Panthère a négligé. Elle révèle par la suite que son objectif n’était pas de blesser les Quatre Fantastiques, mais de s’entraîner au combat en prévision de l’invasion imminente de Klaw. Prenant conscience des nobles intentions de la Panthère Noire, les quatre super-héros lui pardonnent, peu avant que l’on apprenne que Klaw est parvenu à franchir la frontière de Wakanda. En guise de symbole du respect pour le superhéros africain, les Quatre Fantastiques apportent leur aide pour vaincre Klaw et invitent T’Challa à se joindre à eux dans leur campagne mondiale contre le Mal.
Un enthousiasme mesuré
Les lecteurs s’empressent de répondre à la présentation par Marvel de son premier superhéros noir, et les réactions publiées sont dès le départ extrêmement positives. La première lettre, envoyée par un certain Henry Clay, de Détroit, paraît dans le numéro de novembre 1966 des Quatre Fantastiques :
« Je me réjouis de voir que vous avez rompu avec les traditions de votre profession et introduit un Noir en tant que héros sous les traits de Gabe Jones, le sergent Fury, un homme de la rue. Ce sujet, avant Marvel, semblait être un tabou implicite, mais désormais, un véritable superhéros noir existe ! Cela m’a presque fait danser des claquettes et déambuler, abasourdi, en répétant : ”Quelle bonne nouvelle… Quelle bonne nouvelle… !” Sa présentation, ses origines et son premier combat contre un véritable super-vilain en chair et en os, tout était superbe ! J’espère le voir bientôt dans son propre comic. »
Le numéro suivant des Quatre Fantastiques comporte bien plus de lettres de soutien. Linda Lee Johnson, de la Nouvelle-Orléans, félicite Lee et Kirby en déclarant : « Bravo à vous ! […] Vous êtes les premiers, les tout premiers à créer et présenter un superhéros noir. […]C’est vraiment merveilleux ! » Dans la même rubrique du courrier, Edward Koh de New Haven dans le Connecticut ajoute : « Je voudrais vous dire, Stan, combien j’ai été touché et fier de vous voir prendre position pour une cause qui le mérite. […] Vos grands idéaux dans le domaine de l’éducation et pour d’autres questions morales et sociales me rendent fier d’être un lecteur de Marvel. »
Si ces lettres louent l’audacieuse innovation de Marvel, la plus éloquente et astucieuse de ces premières réponses reste sans doute celle de Guy Haughton du Bronx, à New York, publiée dans le numéro de février 1967 des Quatre Fantastiques :
« Croyez-le ou non, mais vous êtes véritablement en train de faire diminuer la tension qui caractérise notre époque. Je pèse mes mots, vraiment. Il est si réconfortant pour un jeune Noir tel que moi – après avoir entendu parler toute la journée d’émeutes et d’explosions raciales – de s’asseoir, d’ouvrir un magazine Marvel et, disons, en page 2, dans la septième case, de voir un homme de couleur marcher dans la rue. Vous, mes amis, ne le comprendrez sans doute jamais, mais c’est quelque chose d’exaltant. C’est psychologiquement revigorant – oui, même dans quelque chose d’aussi modeste qu’un comic – de voir la race noire reconnue. […] Puis vous êtes arrivés avec la Panthère Noire. […] Je ne veux pas avoir l’air mélodramatique, mais je voudrais saluer votre courage, car il faut en effet du courage pour faire ce que vous avez fait. […] Mes amis, vous faites plus que divertir les masses, vous promouvez le respect humain et œuvrez pour un monde meilleur. »
La question de la terre natale de la Panthère Noire est pourtant soulevée dès les premières réactions de lecteurs. Le commentaire final de Haughton suggère que le choix de faire du superhéros un Africain plutôt qu’un Africain-Américain s’apparente à une esquive politique – une décision qui permet à Marvel d’être branché et pertinent tout en maintenant prudemment les super-pouvoirs noirs loin du tumulte du Black Power qui retentit dans les rues des États-Unis : « Un petit bémol tout de même. […] C’est bien, vous avez créé un superhéros noir, mais pourquoi doit-il être chef de tribu africain et ainsi de suite ? N’aurait-il pas pu être un simple Américain ? Si vous aviez créé un superhéros italien, serait-il le Ferrari Masqué ?? » Sur la question des super-pouvoirs noirs, Haughton semble davantage intéressé par qui est digne d’exercer de tels pouvoirs. L’aspect le plus important de la Panthère Noire n’est pas son pays ou même ses super-pouvoirs, mais plutôt sa condition de Noir (blackness) – et plus cette blackness est ordinaire, mieux c’est.
D’autres lecteurs ont relevé la banalité des pouvoirs du nouveau superhéros, un sentiment sans doute formulé de la manière la plus concise par Russell Bullock Jr. de Fembroke, dans le Massachusetts, pour qui « la “Sensationnelle Panthère Noire” est tout à fait déprimante ». En fait, les créateurs du superhéros, Lee et Kirby, se sont montrés indifférents à ses véritables super-pouvoirs. Plutôt que d’inventer une origine fascinante aux dons de la Panthère Noire, ses concepteurs ont réglé cette question par un mysticisme pseudo-ethnographique brumeux, en évoquant « un secret – transmis de chef de tribu en chef de tribu ! Nous ingérons certaines plantes et subissons de rigoureux rituels dont il m’est interdit de parler ! ».
Ce qui a stimulé l’imagination de Lee et Kirby réside dans le pays de la Panthère Noire lui-même, le Wakanda. Tandis qu’ils ne consacrent qu’une seule case, celle qui est évoquée précédemment, à la description des super-pouvoirs de la Panthère Noire, Kirby remplit pages après pages pour décrire les méandres de branches mécaniques mystérieuses de la pseudo-jungle du Wakanda. Lee, quant à lui, comble la narration par une succession d’exclamations émerveillées à la vue de ce paradis artificiel. Après tout, les Quatre Fantastiques ont presque plus été vaincus par la jungle du Wakanda que par les super-pouvoirs de la Panthère Noire. Pour Lee et Kirby, le paysage du Wakanda, avec sa richesse technologique, recèle la composante la plus « super » du personnage de la Panthère Noire. En fusionnant de manière inextricable la figure du superhéros avec deux des utopies américaines les plus marquées par la nostalgie – le passé paradisiaque de l’éden biblique et l’ère spatiale du Tomorrowland de Disney –, Lee et Kirby ont offert une vision surprenante du Super-pouvoir Noir qui tient plus du super-lieu que du super-pouvoir.
Au-delà du Wakanda
En dépit des innombrables merveilles de la terre natale de la Panthère Noire, le personnage lui-même n’est pas destiné à s’éterniser au Wakanda. Après avoir disparu pendant près d’un an des comics Marvel, il refait surface aux côtés de Captain America et d’Iron Man dans le numéro de janvier 1968 de Tales of Suspense, qui prépare le terrain de son voyage à New York en mai 1968 pour rejoindre la puissante équipe américaine de superhéros, The Avengers.
Une étrange transformation s’opère néanmoins au cours de son voyage vers Manhattan : quand il réapparaît en Amérique, le superhéros ne porte plus le nom de « La Panthère Noire », mais s’appelle désormais « La Panthère » ou « T’Challa ». Ce changement de nom inexpliqué ne passe pas inaperçu auprès des lecteurs de Marvel. En août 1968, les éditeurs publient la lettre de Lee Gray, de Détroit : « Le simple fait qu’il soit Noir n’est pas une raison pour supprimer “Noire” de son nom. » En réponse, les éditeurs défendent les auteurs comme suit : « [Ils] ne l’ont certainement pas fait parce qu’il est Noir ! Nous l’avons fait pour réduire le nombre de personnages affublés du qualificatif “Noir” qui se multiplient dans nos magazines : le Chevalier Noir, La Veuve noire et Black Marvel, pour ne citer qu’eux ! » Malgré cette explication, les éditeurs donnent immédiatement suite aux récriminations de Gray, annonçant que « l’assemblée Marvel a de nouveau voté – et vous avez probablement déjà remarqué que La Panthère est redevenue “La Panthère Noire” ! ».
Si ce changement de nom intempestif tente de tenir la Panthère Noire à l’écart du discours racial américain, l’intention tourne court. Dans le numéro de mars 1970 de The Avengers, intitulé « À la poursuite de la Panthère ! », Roy Thomas et John Buscema engagent pour la première fois la Panthère Noire dans un combat aux motifs raciaux, l’opposant à un groupe suprématiste blanc. Au début de l’histoire, le superhéros est capturé par ses adversaires qui entreprennent de salir sa réputation en envoyant un imposteur cambrioler des commerces locaux et attirer l’attention des médias. La situation empire quand deux dirigeants politiques radicaux – Hale, un Africain-Américain partisan du Black Power, et Dunn, un suprématiste blanc conservateur – se lancent dans un débat houleux à la télévision au sujet des récents agissements de la Panthère Noire : elle menacerait de déclencher des émeutes raciales dans le pays tout entier. À la fin de l’histoire, le lecteur découvre que Hale et Dunn sont les véritables coupables qui ont diaboliquement conspiré pour créer cette situation et favoriser leurs propres carrières politiques. La morale du scénario de Marvel ne brille pas par sa subtilité : les extrémistes politiques qui incitent à la haine (hate-mongers[4. NdT : Dans l’univers Marvel, les hate-mongers sont des clones dans lesquels des scientifiques ont transféré l’esprit d’Hitler après sa mort. Ils sont chargés de répandre le Mal. Ici, il faut aussi y voir une référence aux Hate Groups, catégorie utilisée dans le discours médiatique et politique américain pour condamner les groupes « extrémistes » dont la principale caractéristique serait d’inciter à la haine entre les groupes raciaux et sociaux. Cette notion a largement été utilisée pour disqualifier les mouvements nationalistes noirs.]), des deux côtés du débat racial, sont bien souvent davantage guidés par leur soif de pouvoir que par le bien-être de ceux qu’ils prétendent défendre.
Vaine tentative
Sept mois plus tard, Roy Thomas introduit à nouveau la Panthère Noire dans une intrigue construite autour de la question du radicalisme racial. Guest star dans le numéro 69 de Daredevil, « A life on the line », la Panthère Noire fait alors équipe avec le superhéros aveugle pour affronter un groupe de militants noirs, les Thunderbolts, une référence à peine masquée au Black Panther Party du monde réel. Cette histoire signe également la première occurrence de termes racialement connotés tels que « Pouvoir Noir », « Establishment » ou encore « Oncle Tom » en relation avec la Panthère Noire. Dans le déroulement de l’histoire, la Panthère Noire clame : « Cette vermine n’est pas intéressée par le Pouvoir Noir… mais uniquement par le pouvoir des Thunderbolts. » Le leader des Thunderbolts pour sa part, se moque de la Panthère Noire en lui lançant : « Tiens, tiens, voilà donc la Panthère ! L’homme noir originel[5. NdT : Il s’agit là d’une référence ironique à la notion d’homme originel (Original Man), répandue dans la culture populaire noire américaine, et qui fait de l’homme noir le premier homme. Il revient à l’islam noir américain, et notamment à la Nation of Islam, d’avoir développé une mythologie autour de cette question du premier homme noir. Cette notion s’est développée dans plusieurs directions, en s’inspirant des travaux panafricanistes sur les origines africaines de certaines civilisations et en trouvant des prolongements dans des mystiques musulmanes noires américaines comme celles des Five percenters.] de l’Establishment en personne. »
À bien des égards, le portrait de la Panthère Noire par Thomas dans « A life on the line » marque un tournant dans le développement du personnage, qui, à cette époque représente de plus en plus un idéal pour l’émancipation des Africains-Américains, une prise de position polarisant le lectorat comme jamais dans l’histoire des superhéros. L’auteur a ses partisans parmi les fans, dont Evan P. Katten de Bala-Cynwyd en Pennsylvanie, qui écrit : « J’ai été fortement impressionné par le numéro 69 de Daredevil […] L’équipe formée par Daredevil et la Panthère Noire s’annonce prometteuse ! […] Ce pourrait être l’équipe qui s’attaque aux problèmes sociaux – un Blanc aveugle et un Noir, qui représentent malheureusement deux des plus grands handicaps dans le monde d’aujourd’hui, bien qu’aucun ne soit à blâmer pour cela. » Or, bien qu’elle puisse sembler bien intentionnée, l’assimilation du fait d’être Noir à un handicap à laquelle procède Katten va à l’encontre de presque tout ce que le mouvement du Black Power prône à l’époque.
C’est pourquoi, à l’opposé, nombre de lecteurs Africains-Américains voient dans la manière dont la Panthère Noire évolue un affront au Black Power ainsi qu’une description non réaliste de la condition noire elle-même. À rebours des autres courriers publiés dans le même numéro, élogieux pour la plupart, William James de Youngstown, dans l’Ohio, écrit :
« Permettez-moi d’évoquer le numéro 69 de Daredevil et Roy Thomas, ainsi que l’effet que l’histoire a produit sur moi. Étant noir, comme toute autre personne noire, voir un écrivain blanc tenter d’écrire sur nous me fait toujours un peu grincer des dents. Peu importe dans quelle mesure il pourrait être un sympathisant de la cause noire, il ne sera jamais capable de penser comme un Noir. […] La façon dont Thomas dépeint les Noirs, reflétée par le type de dialogues qu’il impose à ses personnages noirs, s’apparente au portrait d’une bande de Blancs à peau noire. […] Ce que je vous conseille, Roy Thomas, c’est de sortir de chez vous et de vous trouver une piaule au cœur du ghetto de Harlem pour capter un peu de quoi on y cause. »
Les critiques de James semblent bien indulgentes comparées au seul courrier publié en réponse au « Pursue the Panther ! » de Roy Thomas dans le numéro 79 de Avengers. Adressée par Philip Mallory Jones d’Ithaca, dans l’État de New York, la lettre réprimande sur un ton cinglant Stan Lee et Roy Thomas pour leurs tentatives biaisées et simplistes de traiter les problèmes raciaux du pays. Jones débute son courrier en se présentant comme « un écrivain noir et lecteur de longue date de vos magazines très souvent sophistiqués ». La première critique de Jones porte sur une caractéristique du personnage : « T’Challa cache le fait qu’il est noir, car il veut être jugé comme un homme… et non comme un type racial ! » Jones avance en guise de réponse : « Voilà bien un raisonnement de Blanc. Cela implique que ce champion de la justice ne pourrait pas être considéré comme un homme si l’on en venait à savoir qu’il est noir, et ce ne serait qu’en étant blanc qu’il pourrait être jugé en tant qu’homme. » Jones accuse également l’histoire d’être uniquement destinée à prouver que la Panthère Noire n’est pas un « voyou » – ce besoin de justification « sous-entend qu’être noir, c’est être un criminel ».
Ces deux courriers de lecteurs charrient un fort ressentiment à l’égard de ce qu’ils perçoivent comme une tentative de Thomas d’enrôler la Panthère Noire pour en faire un agent de colonisation culturelle. De sorte que le T’Challa de Thomas se retrouve dans la position inattendue de colonisateur agressif, loin de l’immigrant bien intentionné. Cependant, pareille interprétation n’est pas très surprenante : privée du pouvoir de Wakanda, la Panthère Noire délocalisée n’a plus que ses mornes super-pouvoirs et sa blackness – une blackness dont l’origine culturelle diffère nettement de la rhétorique du Black Power de l’époque.

Retour au pays
Les transformations que la Panthère Noire connaît au début des années 1970 s’avèrent relativement mineures en comparaison de celles, nombreuses, expérimentées au cours du reste de la décennie. En 1973, un jeune auteur prometteur, Don McGregor, se voit confier, à la surprise générale, la déclinante publication bimestrielle Jungle Action avec pour instruction d’y donner un rôle de premier plan à la Panthère Noire. Avant l’arrivée de McGregor, Jungle Action avait pour personnage principal Tharn the Magnificent, un Tarzan blanc de seconde zone qui combattait des créatures de la jungle aux côtés de ses acolytes, deux splendides femmes blanches. Entre les mains de McGregor, Jungle Action devient le seul titre où la Panthère Noire apparaîtra pendant les quatre années à venir.
Après un passage dans The Avengers, le superhéros entame sa nouvelle trajectoire dans le numéro 6 de Jungle Action, quand McGregor prend les choses en main et introduit les lecteurs à une histoire épique intitulée « La rage de la Panthère » qui s’étale sur treize numéros. La Panthère Noire réalise qu’elle a perdu le contact avec son royaume natal, et un chef rival, Erik Killmonger, lui dispute le contrôle de Wakanda dont il a pris possession pendant qu’elle vivait ses aventures à l’étranger. La longue quête de la Panthère Noire, destinée à débusquer et vaincre Killmonger accompagné de ses lieutenants maléfiques, prend progressivement la forme d’une Odyssée, dans laquelle elle doit arpenter son propre royaume et rétablir le lien avec sa terre natale perdue.
Le premier courrier de la rubrique « Jungles Reactions » est publié dans le numéro de juillet 1974 de Jungle Action. Gary Frazier d’Eugene, dans l’Oregon, lance la discussion en qualifiant l’histoire de « révolutionnaire », en particulier l’attention subtile portée par McGregor aux différences de langage, suggérant ainsi de façon générale « que les Africains en Afrique sont différents des Afro-Américains ». Dans le numéro suivant, Bob Hughes de New Haven, dans le Connecticut, ajoute : « Après tous ces bons pères (et mères) blancs qui ont sillonné l’Afrique, un authentique, un véritable roi de la jungle noir africain était attendu avec impatience. » Dans le numéro 12 de novembre 1974, Meloney M.H. Crawford, de Saratoga Springs, dans l’État de New York, note que « les relations interpersonnelles et le développement des personnages atteignent un degré de sensibilité rare dans les comics aujourd’hui », et souligne l’importance de l’existence du Wakanda en tant que nation africaine indépendante dirigée par des Noirs : « Un dernier commentaire : Wakanda doit survivre ! Il est réconfortant de savoir qu’il a résisté aux assauts de chasseurs blancs, de filles de la jungle, de types à la Tarzan, et est resté une terre pour les NOIRS dans la jungle africaine. »
Dans la même veine, Ralph Macchio de Cresskil, dans le New Jersey, avance (de façon très développée) dans le numéro suivant : « Don, une nouvelle fois, le caractère et les traits de la Panthère ont été si clairement travaillés que j’ai vraiment eu le sentiment de déjà les connaître. Vous avez contribué en toute discrétion à l’avancement de la cause des Noirs, bien plus que les concurrents de Marvel avec leur “pertinence” mélodramatique qui avait du succès il y a quelques années. […] Au cours des derniers mois, nous avons observé les dessous d’une société entièrement noire, avec ses habitudes, ses conflits et, il est vrai, ses préjugés. […] Encore une chose : tenez les héros invités d’autres magazines à l’écart de cette série, car vous nous avez présenté Wakanda comme un monde qui se suffit à lui-même, et j’aime cela, énormément. »
En dépit des retours marquants de leurs fidèles lecteurs dont McGregor et l’équipe de Jungle Action bénéficient, la série connaît une fin prématurée. Elle est brusquement arrêtée en novembre 1976, six numéros seulement après la fin de « La rage de la Panthère ». Si de nombreuses raisons ont été avancées pour expliquer cet arrêt inattendu, la plupart d’entre elles se focalisent sur la logique économique et de maigres chiffres de ventes. Mais McGregor a donné une contre-explication à son licenciement, tout en admettant que les ventes de Jungle Action n’étaient pas à la hauteur des espérances de Marvel ou des siennes : « L’éditeur qui m’a renvoyé m’a dit, je cite, assez précisément car il y a certaines choses que je n’oublie pas : “Don, tu es trop proche de l’expérience noire.” C’est la raison qu’il m’a donnée à l’oral, je ne plaisante pas, pendant que je regardais le dos et la paume de mes mains blanches. “Vous voyez ce que je veux dire”, ajouta-t-il, et c’est ainsi que mon travail sur la Panthère s’acheva. »
Panthère cosmique
Ironiquement, il reviendra au co-créateur de la Panthère Noire, Jack Kirby, de révéler toute la mesure de l’investissement personnel des lecteurs à l’égard de la vision qu’avait McGregor de la Panthère Noire. Kirby, qui avait quitté Marvel en 1970 suite à des différends artistiques avec Stan Lee, réintègre l’entreprise en 1975 et, selon Shooter, se met en recherche de titres pour honorer son nouveau contrat, selon lequel il doit écrire et dessiner quatre numéros par mois. Après que McGregor a cessé de s’occuper de Jungle Action, Kirby se retrouve à nouveau aux commandes de la Panthère Noire. Pour la première fois, une série va être écrite, illustrée et éditée par Kirby lui-même. Dans le commentaire éditorial du premier numéro, il promet aux fans une « nouvelle Panthère Noire » : « Je peux seulement vous dire que vous verrez la Panthère qui vous est due, c’est-à-dire telle qu’elle a été pensée à l’origine. »
Si des lecteurs ont pu douter de la sincérité des prédictions théâtrales de Kirby, ceux-ci s’évanouissent à la lecture du premier numéro. Kirby y dévoile une nouvelle interprétation de la Panthère Noire, sans aucun rapport avec sa dernière incarnation dans Jungle Action. La première histoire, « La grenouille du Roi Salomon ! », inaugure la série en plongeant le superhéros dans une lutte intergalactique pour un artefact magique ancien – une intrigue qui inclut rien de moins qu’une grenouille cuivrée fonctionnant comme une antique machine à remonter le temps, un nain pour équipier, et un humanoïde à tête d’aubergine venu d’un futur lointain nommé « Hatch-22 ».
Sans surprise, les lecteurs réagissent immédiatement aux changements radicaux opérés par Kirby. La majorité des lettres traduisent un fort sentiment de trahison et de perte, les fans accusant Kirby d’avoir défiguré la Panthère Noire de McGregor. Ainsi du courrier de Jana Hollingsworth, de Bellingham, dans l’État de Washington : « Écoutez, je ne fais pas partie de la clique des supporters fanatiques de Don – je n’ai pas vraiment apprécié son LUKE CAGE –, mais ses histoires avec la PANTHÈRE étaient parmi les meilleures jamais produites. Elles étaient pertinentes, non pas dans un sens superficiel, mais véritablement pertinentes, à la fois sur les problèmes sociaux d’aujourd’hui et sur l’immuable condition humaine. Les intrigues de McGregor étaient aussi complexes que le monde réel, et ses personnages étaient d’authentiques êtres humains. Après “La rage de la Panthère” et “La Panthère contre le Klan”, il n’y a qu’un mot pour décrire “La grenouille du Roi Salomon” : obscène. […] Quand elle fut présentée dans les numéros 52 et 53 des Quatre Fantastiques, la Panthère n’était pas ce personnage cosmique insensé que vous avez dépeint. Il était le chef d’une nation africaine qui combinait son héritage traditionnel à la super-science occidentale. Dans “La rage de la Panthère”, McGregor explorait ce postulat d’une façon plus sophistiquée et réaliste. […] Je vous en prie, n’abandonnez pas ce monde réel pour foncer à travers l’univers. C’est le monde réel qui est véritablement fascinant. »
Malheureusement pour Kirby, la réaction d’Hollingsworth n’est que le premier nuage d’une pluie de lettres, suppliant Kirby et Marvel de ne pas « oublier ce que Don McGregor et Billy Graham ont entrepris de faire avec ce personnage dans Jungle Action ». Numéro après numéro, les lecteurs bombardent Kirby de protestations, l’enjoignant de restaurer le « monde réel » de la Panthère Noire et du Wakanda dans sa gloire passée. De nombreux lecteurs, tels John Judge de Clinton, dans l’Idaho, vilipendent durement Kirby : « Se saisir du premier personnage noir de Marvel et le dépersonnaliser à ce point est criminel. »
Les tentatives maladroites de Kirby, destinées à convertir ses lecteurs à sa nouvelle vision de la Panthère Noire ne font que jeter de l’huile sur le feu. Dans le sixième numéro, Kirby se fend d’une référence controversée à Alex Haley, le gagnant du prix Pulitzer en 1976 avec son roman Racines, pour justifier son point de vue : « Comme vous l’avez sûrement déjà remarqué, mon personnage n’est ni Kunta Kinte ni un Chicken George… » Dans le neuvième numéro de Black Panther, Kirby dévoile les « Mousquetaires Noirs », avec cette phrase d’accroche en couverture : « Un holocauste menace sa terre natale – T’Challa se déchaîne ! »
De manière révélatrice, ce même numéro signe également la disparition définitive des pages consacrées au courrier des lecteurs dans Black Panther. Après la publication du douzième numéro en novembre 1978, qui couronne sa deuxième année à la tête du titre, Kirby passe discrètement le relais à Ed Hannigan et Jerry Bingham. Jim Shooter confirme alors que ce changement n’est pas dû à de mauvaises ventes, mais à une décision du seul Kirby. Trois numéros seulement après, Marvel met un terme à Black Panther, en mai 1979.
Un lieu de pouvoir
Indépendamment de la façon dont on peut lire les réactions des lecteurs de Jungle Action, il est évident que quelque chose de singulier s’est produit avec la Panthère Noire présentée par McGregor. Entre ses mains, Jungle Action est devenu l’un des titres de Marvel les plus complexes dans sa conception, autant qu’audacieux sur le plan artistique. Après la plongée dans le Wakanda, lors des premières apparitions dans Les Quatre Fantastiques, proposée pendant deux numéros par Marvel, le pays a disparu quand la Panthère Noire est devenue un immigrant en Amérique. Après des années en marge de titres aux superhéros plus traditionnels, la Panthère Noire a regagné son royaume – un pays autosuffisant imaginé avec une richesse telle que les lecteurs s’y sont fortement attachés. Ce que McGregor et son équipe ont compris, c’est précisément ce que Lee et Kirby semblent avoir réalisé quand ils ont créé le personnage : ses super-pouvoirs sont dépourvus de tout intérêt, mais le concept de Wakanda en tant que lieu exerce un pouvoir d’attraction considérable. Là où Lee et Kirby n’ont fait qu’effleurer le potentiel narratif du Wakanda, McGregor l’a développé autant que possible.
En 1999, Dwayne McDuffie, auteur de comics et co-fondateur de la plus prospère des maisons d’édition de comics noires, Milestone Comics, se remémorait de façon saisissante sa propre expérience de lecteur de « La rage de la Panthère ». Après avoir qualifié l’intrigue « d’épopée de superhéros la mieux écrite qui n’ait jamais existé », McDuffie formulait à son tour des sentiments que l’on retrouvait dans le courrier des lecteurs de Jungle Action :
« On était en 1973… Le comic en question était Jungle Action nº 6. On y retrouvait un superhéros dont je n’avais jamais entendu parler, appelé la Panthère Noire, mais à cette époque, je n’avais jamais entendu parler non plus du Black Panther Party. Je fus frappé par la dignité des personnages de ce livre. […] La Panthère Noire était le roi d’une contrée africaine mythique où les Noirs étaient visibles à tous les échelons de la société : soldats, docteurs, philosophes, balayeurs, ambassadeurs – soudain tout était possible. En l’espace de quinze pages, les Noirs passaient d’êtres invisibles à des êtres inévitables. […] J’ai abondamment parlé de l’importance du multiculturalisme dans la fiction, tout comme dans la vie. J’ai prôné le sentiment de valorisation qu’un enfant peut éprouver quand il voit son image reflétée de façon héroïque dans les médias de masse. C’est précisément ce que je ressentis cet après-midi-là en découvrant l’infâme complot ourdi par le lâche (mais nuancé) Eric Killmonger pour usurper le trône revenant de droit à la Panthère Noire. Je réalisais alors que ces histoires pouvaient parler de moi, que je pouvais en être le héros. Des années plus tard, en écrivant mon propre comic, je décrivais ce merveilleux sentiment comme “la soudaine possibilité de voler”. »

Dans cette lecture, le « véritable » super-pouvoir de la Panthère Noire ne réside pas dans ses attributs félins, mais dans sa capacité à transporter tous ses lecteurs au Wakanda – vision utopique d’un puissant État noir souverain et indépendant. Le degré de progrès technologique et social du Wakanda rivalisait (voire dépassait) celui des États-Unis, et affirmait que l’indépendance et le développement autonome de la communauté n’étaient déterminés ni géographiquement ni culturellement. Ainsi, le Wakanda de McGregor offrait aux lecteurs des possibilités alternatives pour le Black Power, et les lecteurs ont accueilli avec passion une telle opportunité, exprimée par un « Wakanda doit survivre ! » et la supplication désespérée de Jana Hollingsworth adressée à Kirby : « Je vous en prie, n’abandonnez pas ce monde réel pour foncer à travers l’univers. C’est le monde réel qui est véritablement fascinant. »
Dans sa préface à Matters of gravity: special effects and Superman in the 20th century, Scott Bukatman a ainsi saisi la dimension libératrice des super-héros de comics : « Toutes les échappées fantastiques qui s’affranchissent de la gravité […] tels les vols de Superman dans le ciel de Metropolis, nous rappellent à nos corps en nous permettant momentanément de les ressentir différemment. Il s’agit d’un effet momentané, une élévation temporaire : nous sommes toujours ramenés à nous-mêmes. Néanmoins, ces échappées constituent bien plus que des refuges face à une existence intolérable, ce sont des échappées vers des mondes aux possibilités renouvelées. »
Les superhéros sont puissants précisément dans leur capacité à transporter les fans dans des « mondes de possibilités renouvelées ». C’est à travers cette capacité créatrice, cette capacité à libérer momentanément leurs lecteurs de contraintes matérielles autrement inéluctables, en les conduisant dans des espaces aux possibilités entièrement nouvelles, que les comics de superhéros les plus importants oscillent à la frontière invisible séparant l’évasion de l’espoir. Telles de resplendissantes étoiles polaires dans le vaste et fluctuant horizon de l’imaginaire culturel américain, les superhéros des comics tracent un chemin qui a pour point de départ des désirs frustrés pour nous mener jusqu’à l’imagination productrice, concept aussi poétique qu’émancipateur, proche des « lignes de fuite » de Deleuze et Guattari : ce que Dwayne McDuffie nomme la « soudaine possibilité de voler ». C’est à travers pareille évasion créative que les super-héros des comics donnent aux lecteurs le pouvoir d’atteindre des sommets imaginatifs interdits par les configurations conventionnelles du pouvoir social.
Titre original : « Imagining Black Superpower ! Marvel Comics’ The Black Panther, 1966-1979 ». L’auteur, Casey Alt, est artiste, designer et spécialiste des médias, vivant actuellement à Taipei, Taiwan. Il est diplômé de biologie humaine et d’histoire de la philosophie à l’université de Stantford, ainsi qu’en arts du design et des médias à UCLA. Son site internet : <u2325.com>.
Notes
| ↩1 | NdT : Militant noir d’origine trinidadienne, Carmichael a été dirigeant du Student NonViolent Coordinating Committee (SNCC), organisation étudiante noire qui fait le choix de la non-mixité raciale. On lui doit la popularisation du mot d’ordre de « Black Power », auquel il consacrera un livre co-écrit avec Charles Hamilton. Après un bref passage au Black Panther Party, il quitte l’organisation suite à des désaccords sur la politique d’alliances avec les groupes radicaux blancs. Il part en Guinée en 1969 où il collabore avec le gouvernement de Sékou Touré et prend le nom de Kwame Ture. Il s’éteint en Guinée en 1998, après plusieurs dizaines d’années consacrées à la cause panafricaine. |
« Ça, c’est de la mode socialiste »
Créateurs d’État, couturières privées et pantalons moulants : s’habiller à la soviétique
Assimilée au capitalisme, à la futilité et à l’extravagance du style vestimentaire bourgeois, la mode est fortement dépréciée dans l’URSS naissante, au lendemain de la révolution d’Octobre. Prônant le rejet de la consommation ostentatoire, l’homme et la femme bolcheviques doivent faire preuve d’austérité et s’habiller simplement. Très rapidement pourtant, dès les années 1930, le concept de mode réapparaît, des politiques vestimentaires sont élaborées, une organisation bureaucratique statue sur la pertinence « soviétique » des modèles créés… Entretien avec Larissa Zakharova, historienne et auteure de S’habiller à la soviétique. La mode et le Dégel en URSS (éd. CNRS, 2012).
Ce texte est issu du numéro 2 de Jef Klak, « Bout d’ficelle », paru en mai 2015 et encore disponible en librairie.
Téléchargez l’article en PDF.
Comment en êtes-vous venue à l’étude de la mode soviétique ?
À Saint-Pétersbourg, j’ai commencé par travailler sur la redistribution du logement pendant la guerre civile (1917 à 1921). Le sujet n’avait rien à voir avec la mode, mais m’a poussée à définir le cadre théorique de ce que serait une histoire du quotidien en Union soviétique. Dans l’historiographie russophone des années 1990, l’histoire du quotidien était assez mal vue. On la considérait comme anecdotique, dissociée de la grande histoire événementielle qui elle, avait toute sa légitimité. Il se disait qu’aborder le quotidien revenait à faire une description statique et non problématisée des manières de vivre et de faire, laquelle n’avait pas un grand sens explicatif par rapport à l’expérience soviétique.
De cette historiographie russophone, je suis passée à l’historiographie francophone, et j’ai découvert les travaux de Michel de Certeau sur les arts de faire, les ruses anonymes et le bricolage qui composent le quotidien1 Michel de Certeau, L’invention du quotidien, I : Art de faire (1990) et II : Habiter, cuisiner (1994), Folio essais, Gallimard.… Il m’a semblé que ce cadre conceptuel et théorique convenait très bien à cette société de pénurie : en Union soviétique, les individus étaient contraints de s’adapter au manque et à la pénurie au quotidien, et devaient déployer toute une palette de manières de faire pour construire leur mode de vie et leur environnement matériel.
Puis j’ai découvert les travaux de Alf Lüdtke[2. Alf Lüdtke (dir.), Histoire du quotidien, Paris, Éditions de la MSH, 1994 (1989).] et de l’Alltagsgeschichte (histoire de la vie quotidienne) allemande. Ce courant insiste, de la même manière que de Certeau, sur la créativité des agents ordinaires, mais en lien étroit avec la sphère d’action politique et économique d’État. Quand je me suis intéressée à la mode en URSS, pour ma thèse de doctorat, j’ai défini le quotidien comme lieu d’intersection entre politiques d’État et réponses des individus. Ceux-ci peuvent à leur tour modifier le cours des événements et les cadres d’action des dirigeants, infléchir le cours des politiques.
Comment avez-vous procédé pour écrire votre histoire de la mode ?
L’essentiel de ma documentation provient des archives institutionnelles. De ce point de vue, l’historien de l’URSS est bien loti, parce que cet État bureaucratique a produit énormément de documentation, dans des domaines qui ne sont pas aussi bien documentés dans les sociétés démocratiques libérales. L’univers de la création vestimentaire était, parmi d’autres, une sphère très investie par l’État. Dans les sources institutionnelles, on trouve de nombreuses traces des interventions et négociations entre les dirigeants, les experts et les consommateurs.
J’ai avant tout travaillé avec les matériaux fournis par les instances de création vestimentaire : les « Maisons de modèles de vêtements ». Dans ces institutions étatiques, les créateurs étaient des fonctionnaires chargés de concevoir des modèles de vêtements pour les entreprises de confection, qui étaient souvent réutilisés par les ateliers de couture sur-mesure. Les modèles devaient correspondre au concept de mode socialiste qui avait été élaboré au préalable, et se distinguer de la mode « bourgeoise », incompatible avec la société soviétique. J’ai également consulté les fonds d’autres instances : le Conseil des ministres ; le Comité central du Parti, qui veillait à l’élaboration et à l’application des mesures prises durant l’époque khrouchtchévienne[3. Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste de l’URSS de 1953 à 1964 et président du Conseil des ministres de 1958 à 1964.]. J’ai aussi travaillé avec les documents de la Direction des statistiques, parce que les dirigeants voulaient savoir ce que les individus consommaient, de quelle manière, et dans quelle mesure ils étaient satisfaits de ce que l’État leur offrait comme biens de consommation. Enfin, j’ai utilisé les enquêtes sur les budgets des ménages, réalisées par les Directions des statistiques à travers le pays. À partir du terrain de Leningrad (Saint-Pétersbourg), j’ai sélectionné un échantillon de 465 enquêtes, dans lesquelles j’ai analysé ce que les individus achetaient, combien ils dépensaient dans les magasins d’État ou auprès de particuliers qui vendaient sur les marchés ; combien ils dépensaient dans les ateliers étatiques de couture sur mesure ; combien chez les couturiers privés.
Tous ces documents m’ont donné un tableau général des politiques menées dans le domaine de l’habillement, ainsi que des pratiques de consommation des individus ordinaires pendant la période de dégel des années 1950-1960. J’ai ensuite complété ces matériaux d’archive par une vingtaine d’entretiens avec des consommateurs de cette période, qui m’ont permis d’aborder la question des cultures de consommation : pourquoi les gens s’adressent plutôt aux couturières privées ou à un atelier de couture sur-mesure ; qui achète dans les magasins d’État, et qui refuse par principe d’y aller ?
Pouvez-vous détailler ce que vous entendez par « mode soviétique » ? Comment ce concept a-t-il émergé, et comment est-il devenu un objet politique de l’URSS ?
La formulation même de l’expression « mode soviétique » rencontre souvent des sourires sarcastiques parmi les chercheurs – il s’agirait de deux termes inconciliables. Or, pour les acteurs de l’époque soviétique, le terme avait du sens, même s’il n’avait rien d’une évidence. L’élaboration de ce concept a fait l’objet d’âpres débats au fil des changements politiques de l’État soviétique.
Dans un premier temps, au lendemain de la révolution d’Octobre, la situation est particulièrement incertaine : les entreprises de confection et de textile ferment, puis sont nationalisées, mais elles ne peuvent fonctionner, puisque le pays est en guerre civile jusqu’en 1921. L’État n’a pas encore défini de politiques dans le domaine de l’habillement. En revanche, un milieu artistique émerge, et des créateurs expérimentent différents styles. On voit apparaître, par exemple, les courants du constructivisme révolutionnaire et de l’art industriel – que l’on voulait faire descendre dans la rue et rendre accessibles à tous. Les porteurs de ces concepts et de ces expériences artistiques possèdent souvent une formation prérévolutionnaire et connaissent des créateurs occidentaux, français notamment.
Nadejda Lamanova est l’une des figures fondatrices de la mode socialiste. C’est une couturière, qui avait créé des toilettes pour la cour impériale avant la révolution. Paul Poiré, avec qui elle était en contact, pensait qu’elle resterait travailler en France après la Révolution. Mais Lamanova faisait partie de ceux qui étaient très attirés par l’idéologie bolchévique. Elle est donc restée en Russie pour élaborer le cursus de formation des créateurs, appliqué au premier Institut textile fondé à Moscou en 1919. Elle élabore le principe du costume socialiste, qui devait être « rationnel » et fonctionnel, où la forme devait être adaptée aux circonstances, à la morphologie, au type de personnalité… Il s’agissait presque d’une théorie de la mode, mais qui ne s’opposait pas encore à la mode bourgeoise occidentale. Très vite pourtant, cette élaboration théorique a été utilisée dans les débats sur l’incompatibilité de la mode, phénomène d’origine bourgeoise, avec l’économie socialiste et la société soviétique, censée être égalitaire, où les distinctions sociales étaient prohibées. Ce concept de mode soviétique a donc été élaboré à l’époque de la Nouvelle politique économique (NEP – entre 1921 et 1928), qui introduit une relative libéralisation économique et le retour d’une certaine liberté dans le quotidien, pour dynamiser le pays suite à la guerre.
À la fin des années 1920, Staline s’impose à la tête du pouvoir et met fin à la NEP. Il nationalise et centralise l’ensemble de la production, et introduit une politique d’industrialisation à marche forcée, ainsi que des cartes de rationnement dans le quotidien. Toute réflexion sur la mode devient alors complètement inappropriée, puisque les usages politiques promeuvent l’ascétisme. Le terme même de « mode » est en quelque sorte banni du vocabulaire quotidien. Les magazines apparus dans les années 1920 changent de titre : ils ne portent plus ouvertement sur la mode, mais sur « l’art de s’habiller », qui défend les idées de rationalité, de fonctionnalité, de simplicité. On ne parle plus de mode.
À la fin de la NEP, les créateurs se réfèrent-ils à l’idée de formation d’un homme nouveau pour justifier les choix esthétiques des vêtements ? Les choix formels sont-ils articulés à une idéologie ?
Le concept de mode socialiste élaboré par Nadejda Lamanova s’inscrivait déjà dans un discours général sur l’homme nouveau. Elle n’était pas la seule à promouvoir ces idées, et dialoguait constamment avec d’autres personnalités, comme le commissaire à l’Éducation (Anatoli Lounatcharski), ou le commissaire à la Santé (Nikolaï Semachko), qui promouvaient l’idée d’hygiène sociale. Le débat sur l’hygiène peut paraître un peu éloigné de celui sur la mode, mais ils ont une vraie cohérence. Dans le projet de l’homme nouveau vivant dans une société égalitaire, les propositions de Lamanova allaient dans le même sens que celles d’autres penseurs de l’époque.
Après la période d’industrialisation, un nouveau revirement survient dans la deuxième moitié des années 1930. Suite au 17e congrès du Parti en 1934, Staline déclare que les fondements du socialisme ont été posés en Union soviétique, et que l’époque de l’ascétisme est terminée. « La vie est devenue meilleure et plus joyeuse », son fameux slogan, est affiché partout. C’est dans ce cadre qu’est lancée la campagne de lutte pour la koultournost’ (voir encadré), cette acculturation de l’homme nouveau. On estime que l’idée d’hygiène sociale n’a pas suffisamment été appliquée, et l’on entreprend donc d’expliquer aux Soviétiques ce qu’est être koultourny, un « homme civilisé ». Cette lutte pour la koultournost’ entraîne le retour en force de l’idée de mode : l’homme ou la femme soviétique est « civilisé » quand il sait s’habiller avec goût et selon la mode. Par cette idée d’éducation du goût, les créateurs trouvent leur fonction dans la société soviétique : ils sont chargés d’élaborer les tendances de mode, et peuvent ainsi éduquer les consommateurs au sens du « beau ». Dans la mesure où la mode socialiste vise à donner à tous un sens de l’esthétique, on estime alors que celle-ci n’est plus problématique, puisqu’elle ne produit pas de distinction sociale.
Mode et économie planifiée font-elles bon ménage ?
Difficilement. La mode, avec le concept d’évolution des tendances, implique en effet de changer périodiquement les vêtements avant leur usure matérielle. Or, d’après les économistes soviétiques, on ne peut pas jeter les produits issus du travail humain avant leur usure physique complète : ce serait irrationnel et contre-productif. Jusqu’à la fin de l’époque soviétique, les créateurs ont buté sur l’argument selon lequel la mode ne convenait pas à une économie planifiée. Ils ont donc tenté d’élaborer un rythme spécifique à la mode socialiste, moins rapide que la mode occidentale. Ils « ralentissent » la mode en proposant plusieurs lignes simultanées : parallèlement au « fond de collection[4. Ensemble des modèles qui restent inchangés d’une collection à l’autre, malgré les changements de tendances.] » permanent, les créateurs alimentent le marché avec des tendances déjà produites lors des précédentes saisons, en même temps qu’ils produisent de nouvelles silhouettes. Ils offrent ainsi plusieurs rythmes de changements de silhouettes, et parviennent à justifier la présence de la mode dans le cadre de l’économie planifiée socialiste.
Sur quoi se fonde ce « sens du beau », censé être partagé par tous ?
Il se fonde sur la notion de « bon goût », qui implique que le « sens du beau » est le même pour tout le monde. Les créateurs élaborent des règles de bon goût complètement figées, qui n’évoluent pas dans le temps. C’est pourquoi l’idée de bon goût se substitue souvent à l’idée même de mode, jusqu’à la dénaturer, puisque la mode est censée évoluer et altérer les conventions du goût. Or les créateurs soviétiques définissent leurs fonctions sociales par un travail d’éducation des consommateurs au bon goût, et oublient que la mode peut jurer avec ses règles.
Concrètement, le bon goût de rigueur consiste à accorder les accessoires de la même couleur : le chapeau, les gants, les souliers, le sac, l’écharpe ou le foulard. Une autre règle préconise de changer de souliers en arrivant au théâtre : on laisse les bottes dans le vestiaire et on chausse des souliers élégants pour assister à un ballet, à l’opéra ou à une pièce de théâtre. Ou encore, on choisit ses vêtements en fonction des circonstances, comme cela se fait dans la mode occidentale : en France, la mode distingue les robes de cocktail, celles de l’après-midi ou du soir… Cette distinction est reprise par les créateurs soviétiques, qui y ajoutent des valeurs propres à la société socialiste. Ils introduisent par exemple la catégorie des vêtements de travail.
Le discours des créateurs est aussi beaucoup plus normatif que celui des journalistes de mode, français notamment. Les créateurs soviétiques, qui jouent également le rôle de journalistes, peuvent écrire dans la presse qu’« il est impossible de porter chez soi des robes démodées ». On cherche également à créer des vêtements d’intérieur, qui doivent eux aussi être à la mode : une des règles du bon goût dictait en effet de changer de vêtements en rentrant chez soi. On ne pouvait pas être habillé de la même manière du matin au soir, il fallait changer de tenue à plusieurs moments de la journée.
Dans vos travaux, vous parlez du rôle du Grand conseil artistique, qui sélectionnait les modèles avant leur production. Il semble que la question du bon goût faisait polémique parmi ses membres…
Le Grand conseil artistique réunissait des représentants de différents corps professionnels. Il sélectionnait les modèles élaborés par les créateurs, et pouvait imposer un véto à certains d’entre eux. On n’y discutait pas tant du goût, mais plutôt des besoins des consommateurs. Les membres de ce conseil avaient des interprétations très divergentes des ordonnances du gouvernement. Ce dernier demandait d’améliorer le quotidien des Soviétiques en fournissant aux consommateurs davantage de vêtements, beaux, pratiques, confortables, etc. Mais les termes des ordonnances étaient très vagues et c’était aux professionnels de les interpréter, de les décliner en fonction de leur définition de ce qu’étaient les « beaux » vêtements, convenables à l’homme soviétique.
Les différences entre cultures professionnelles créaient des blocages dans la communication entre les acteurs censés travailler de concert. Les « travailleurs de commerce » – les employés des magasins d’État – avaient par exemple leur propre procédé de suivi de la demande, qui se fondait sur ce qui avait été demandé pendant la période précédente. Cette définition de la demande jurait avec la notion de mode, parce qu’elle ne pouvait prendre en compte aucune nouveauté. Les travailleurs de commerce rejetaient d’emblée toute nouveauté radicale, parce qu’ils ne pouvaient être sûrs de son succès, et apparaissaient donc comme conservateurs au sein des instances de sélection.
Ces employés de magasins d’État choisissaient-ils eux-mêmes ce qu’ils faisaient entrer dans leur stock de marchandises à commercialiser ?
Les vendeurs et leurs chefs, qu’on appelait « experts en marchandises », devaient effectivement suivre la demande par le biais de feuilles de contrôle, en notant chaque transaction. La méthode de suivi n’était pas parfaite, car sans moyen de systématiser, on notait de manière un peu lacunaire, aléatoire. Il existait donc certains mécanismes de transmission de la demande. « Une femme est venue demander une robe noire pour des funérailles et n’en a pas trouvé » : c’était noté, et transmis aux entreprises de confection. Mais que faisaient celles-ci ? Elles produisaient 10 000 robes noires de funérailles, selon le plan quinquennal. Cela provoquait forcément un problème d’ajustement, entre une demande ponctuelle et ce type d’arrivages.
Il se pouvait aussi que la demande bute sur un problème de fourniture des matières premières. Si des consommateurs demandaient des robes en laine de telle silhouette, il était possible d’en obtenir le patron, mais que l’entreprise ne dispose pas de tissu en laine pour les produire en quantité suffisante. L’économie centralisée n’arrivait tout simplement pas à activer jusqu’au bout ce mécanisme de communication, qui était pourtant formellement instauré entre les différentes instances de production vestimentaire.
Pour revenir à l’idée des cultures professionnelles divergentes, c’est avant tout la nouveauté des lignes qui posaient problème aux travailleurs de commerce, qui se fondaient sur les observations des pratiques d’achat passées. Ces propositions de nouveautés étaient également problématiques pour les travailleurs des entreprises de confection. Ils avaient les chiffres du plan en tête et lorsqu’ils voyaient une ordonnance expliquant qu’il fallait produire plus de « beaux vêtements pratiques pour le consommateur soviétique », cela signifiait, pour eux, produire la même robe en 25 000 exemplaires. C’était simple : on activait les chaînes de production, et hop hop hop, c’était produit. Pour les créateurs, la mode, c’était au contraire la diversité, et produire plus de beaux vêtements voulait dire proposer une plus grande variété de silhouettes. Les entreprises étaient particulièrement résistantes à cette diversification, qui impliquait d’adapter le processus de production à chaque patron, chaque matière, et d’apprendre aux ouvrières à couper les nouveaux tissus. Dans les magasins d’État, on trouvait donc surtout des vêtements démodés, qui étaient produits selon le plan et non pas selon les propositions des créateurs.
Il y avait donc une immense différence entre ce que les créateurs proposaient et les vêtements qui parvenaient à la population…
Oui mais, néanmoins, les gens pouvaient très facilement se tenir informés des dernières créations. Les patrons des modèles validés par le Grand conseil artistique – non produits en masse – étaient présentés dans les magazines de mode. À chaque fois que l’on se rendait au cinéma, les actualités, projetées sous forme de courts-métrages avant le film, contenaient des défilés de mode ; et les émissions de radio donnaient des descriptions verbales des nouvelles silhouettes à la mode. Par ailleurs, les nouvelles collections de la Maison des modèles faisaient l’objet de présentations publiques. Les consommateurs pouvaient ensuite suivre ces suggestions, mais ils devaient se montrer ingénieux : trouver du tissu, une couturière, faire la queue dans un atelier de couture sur-mesure, ou coudre eux-mêmes. En revanche, il serait faux de dire qu’à l’inverse, les personnes qui se rendaient dans des magasins d’État choisissaient la facilité, car il s’agissait d’espaces de pénurie.
Des modèles non validés par le Grand conseil artistique pouvaient-ils circuler sur le marché ? Quelle était l’influence de ce Conseil ?
Entre 1950 et 1960, on peut aisément parler du règne des experts. Les hiérarques du Parti faisaient confiance à ces personnes issues du milieu de la mode : ils les estimaient capables de juger ce qui serait beau et approprié, puisqu’elles appuyaient leur savoir sur une conception presque scientifique de la mode socialiste. L’étendue du pouvoir de ces experts s’illustre particulièrement avec l’affaire des stiliagui. Il s’agissait de jeunes, des zazous[5. Courant de mode de la France des années 1940. Il s’agissait de jeunes gens reconnaissables à leurs vêtements anglais ou américains, et affichant leur amour du jazz.] soviétiques, qui ont commencé à porter des vêtements de production étrangère à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rapidement considérés comme des personnes inclinées devant l’Occident bourgeois et non dévouées à la cause communiste, les stiliagui étaient assimilés à des « parasites sociaux ». Cet épisode s’inscrit dans un contexte politique bien particulier, marqué par la lutte contre le cosmopolitisme de la seconde moitié des années 1940.
Les créateurs sont intervenus dans ce débat en récupérant les tendances des zazous et en les intégrant, petit à petit, à leurs créations. Le style des stiliagui s’illustrait notamment par des pantalons très étroits – on disait qu’ils devaient s’armer de savon pour les enfiler, et ces jeunes étaient comparés, dans la presse, à des perroquets. En réponse, les créateurs ont donc rétréci la largeur des pantalons, jusqu’à les faire apparaître sous cette forme dans les magasins d’État, à la fin des années 1950. Ils étaient d’ailleurs tellement étriqués que des consommateurs ont alors fait le signalement suivant : « Vos pantalons sont si serrés que les hommes soviétiques qui se respectent doivent se faire coudre des pantalons plus larges par leurs propres moyens. » En jouant un rôle de médiateur, les créateurs ont ainsi réussi à faire passer la mode antisoviétique pour soviétique : à partir du moment où la mode des stiliagui a été intégrée aux créations officielles, la stigmatisation a cessé. Cela a amené certains chercheurs à dire que le mouvement des stiliagui avait disparu à la fin des années 1950. En réalité, ils sont devenus moins visibles dans le paysage urbain, car plus de jeunes gens se sont mis à porter des pantalons étroits. Mais l’étiquette même des stiliagui qui avait une forte connotation péjorative était désormais davantage appliquée aux marginaux et aux déviants sociaux (« hooligans », « parasites », etc.) qu’aux jeunes habillés à la mode. Le fait même de porter un pantalon serré a perdu le sens politique négatif qui lui avait été assigné jusqu’alors.
Un vêtement d’inspiration occidentale n’était donc pas considéré comme une menace s’il était produit sur le sol soviétique ?
Tout en définissant la mode soviétique en opposition à la mode bourgeoise, les créateurs soviétiques se sont toujours tenus au courant de ce qui se faisait en Occident. À l’époque du Dégel (1953-1964), ils se rendaient très régulièrement en France avec l’autorisation des instances du Parti : ils avaient pour consigne d’utiliser l’expérience occidentale afin d’améliorer le système de production vestimentaire de l’URSS. Cependant, les ordonnances du gouvernement étaient très vagues ; elles ne spécifiaient pas ce qu’était l’« expérience occidentale », et laissaient la possibilité aux créateurs de rencontrer qui ils voulaient. Inspirés par leur culture professionnelle, par Nadejda Lamanova et ses contacts au sein de la haute couture, ils ont vite repéré Paris et Christian Dior – qui passaient pour l’incarnation du « meilleur ». Tandis que les discours publics relayaient, dans la presse, l’opposition entre mode bourgeoise et mode soviétique, les créateurs écrivaient, noir sur blanc dans leurs rapports de mission, à propos de la mode française, que « tout [était] parfait et [pouvait] être imité ».
Ils reprenaient ainsi les modèles parisiens dans leurs créations, et les faisaient passer pour de la mode socialiste. Il s’agissait d’un double langage, en quelque sorte, et forcément, cela ne passait pas inaperçu. Par exemple, quand les créateurs des pays socialistes se réunissaient à des congrès internationaux de mode, ils s’adressaient des reproches réciproques du type « Vos robes trapèzes ressemblent étrangement à une proposition récente d’Yves Saint Laurent », ce à quoi les créateurs interpellés répondaient « Non, c’est faux, nous nous sommes inspirés des robes traditionnelles russes à bretelles, les sarafanes ». Justifiés ainsi, ils devenaient irréprochables, puisqu’ils avaient évidemment le droit de reprendre les lignes des costumes folkloriques. Ce qui comptait, c’était les justifications qui paraîtraient dans la presse et qui permettraient de dire : « Ça, c’est de la mode socialiste ! » Au final, un citoyen soviétique qui aurait eu accès au patron d’une robe occidentale par voie de contrebande, et qui l’aurait fait reproduire chez une couturière, n’aurait pas été montré du doigt dans la rue, parce que le gouvernement faisait, tout simplement, la même chose que lui.
Contrairement à l’idée reçue d’une grande standardisation
des produits sur le marché soviétique, les vêtements présentaient donc une grande diversité…
C’est ce que l’on peut voir sur les photos prises par des particuliers – et non sur des photos officielles, car les photographes de presse devaient représenter la foule soviétique comme homogène. Entre 1950 et 1960, les silhouettes partagent de grandes similarités entre la France et l’Union soviétique, même si les conditions de production altéraient la qualité des matériaux et modifiaient les lignes des vêtements. Et puis, les citoyens soviétiques avaient aussi accès à des films étrangers dans le cadre de programmes de coopération culturelle, comme le festival de films néoréalistes italiens de 1957. Suite à la projection du film français Babette s’en va-t-en-guerre (1959) avec Brigitte Bardot, les femmes soviétiques se sont massivement coiffées « à la Babette ».
Existe-t-il une distinction sociale par la mode ? La haute couture existe-t-elle encore ?
Même si c’était une prétention du régime, la société soviétique n’a jamais été égalitaire. Très vite, les privilèges se sont institutionnalisés, et les élites ont bénéficié d’un accès facilité à des produits plus diversifiés et de meilleure qualité. Ces inégalités se justifiaient de différentes manières. À partir des années 1930, suite aux exploits d’Alexei Stakhanov, le stakhanovisme[6. Afin d’améliorer la productivité industrielle de l’URSS, le second plan quinquennal (1933-1937) est caractérisé par la création d’écoles techniques pour former et perfectionner les travailleurs, et élève au rang de « héros du travail » les ouvriers qui se démarquent par leur forte efficacité. Le plus célèbre d’entre eux est le mineur Alexeï Stakhanov qui, dans la nuit du 30 au 31 aout 1935, aurait abattu 14 fois plus de charbon que la norme établie. Cette propagande en faveur du sacrifice au travail s’accompagne de l’augmentation de contraintes et de sanctions encadrant sévèrement les ouvriers (suppression des salaires pour les travailleurs considérés inefficaces, rétablissement du livret ouvrier, allongement de la journée de travail, etc.).] fait son apparition, avec le privilège, pour les « travailleurs de choc » d’accéder à un niveau de vie supérieur à celui des autres. Par ailleurs, il se disait aussi que les travailleurs dirigeants qui avaient de lourdes responsabilités, comme celle de représenter l’Union soviétique à l’étranger, devaient avoir une apparence convenable, respectable. C’est ainsi que les « distributeurs spéciaux » ont été créés : grâce à des systèmes de distribution spécialisés et fermés, les travailleurs des différents corps ministériels et du Parti avaient droit à des biens de meilleure qualité. Les élites artistiques bénéficiaient à peu près des mêmes avantages, et je me suis rendu compte, en menant des entretiens, que certains s’évertuaient, de plus, à établir des liens informels avec les Maisons des modèles, pour y acheter les pièces uniques qui avaient servi lors de défilés de mode, selon le principe de la haute couture. Les entreprises de confection avaient tendance à simplifier les patrons envoyés par les créateurs : par souci d’efficacité, l’idée créatrice était altérée. La pièce unique créée pour le défilé n’était donc jamais reproduite à l’identique, et était forcément de meilleure qualité, légèrement différente que les vêtements produits en masse. Donc oui, bien sûr, il existait une distinction sociale par le biais de la mode.
Vous pouvez peut-être en dire un peu plus sur les pratiques
quotidiennes des consommateurs ?
J’ai distingué, très schématiquement, trois cultures de consommation par rapport à la mode : ceux qui suivent la mode, ceux qui préfèrent le classicisme des magasins d’État, et les personnes qui empruntent aux deux. Ceux qui suivent la mode ne se rendaient jamais dans des magasins d’État : ils s’adressaient à une couturière privée, à un atelier de confection, ou cousaient eux-mêmes. Ces trois manières de fabriquer correspondent à des budgets différents – le plus cher étant d’avoir recours à des couturières privées, et le moins onéreux étant de coudre soi-même.
À partir des enquêtes de budget et des entretiens que j’ai réalisés, je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de lien de corrélation entre les revenus des gens et leur culture de consommation. On pouvait avoir de très faibles ressources et suivre une mode, à partir du moment où l’on avait une machine à coudre à la maison. Ma grand-mère, par exemple, cousait pour toute la famille. Elle suivait des patrons de couture, et y ajoutait sa marque de fabrique, son style… On reconnaissait chacun de ses vêtements.
C’était une pratique courante ?
Oui, et c’était aussi encouragé par l’État car, malgré la volonté du pouvoir de satisfaire les besoins des consommateurs, il existait des problèmes d’approvisionnement et de communication entre les différents maillons de la chaîne du système de production. Aussi, en parallèle de la production d’État, on trouvait un discours sur la nécessité, pour les jeunes filles, d’apprendre la couture – « C’est toujours pratique ». Je suis née en 1977, et j’ai appris à coudre à l’école, alors qu’en France, à la même époque, les cours de couture avaient été supprimés depuis longtemps dans l’enseignement général. Il existait même des cours du soir, pour celles qui voulaient se perfectionner. Les moyens mis à disposition par l’État étaient tels que l’on pouvait ensuite transformer cette activité en profession, et donc en activité illégale, puisqu’en théorie, on avait pas le droit de faire du profit chez soi. Malgré ce paradoxe, il existait un milieu très dense de couturières expérimentées, lesquelles avaient leur clientèle.
Elles ne couraient aucun risque ?
En cas de litige, un client aurait toujours pu dénoncer sa couturière – et dans ce cas, la milice constatait la production illégale, et condamnait la personne à un ou deux ans de travaux forcés – mais en réalité, le système fonctionnait bien, parce qu’il y avait une complicité et des intérêts communs entre clientèle et couturières. Cela complétait l’offre de l’État.
Finalement, cette diversité des pratiques, cette variété des silhouettes et l’image du bien-être qui se reflètent dans les archives privées découlaient de la participation de tous ces acteurs légaux, semi-légaux et illégaux. Ce qui comptait pour les dirigeants soviétiques, c’était le résultat final : la satisfaction du consommateur. Si la foule avait l’air contente, pourquoi chercher à embêter les couturières alors qu’elles apportaient leur pierre à l’édifice du bien-être général ?
On retrouve cette attitude ambivalente pour la revente des biens occidentaux, entrés en Union soviétique par voie de contrebande ou lors des divers moments d’ouverture à l’Ouest. Par exemple, le Festival international de la jeunesse et des étudiants de 1957 a été le théâtre de ventes massives de biens étrangers. Or, vendre des vêtements dans la rue était interdit puisque considéré comme une forme de spéculation. Aussi, des « dépôts-ventes » ont été mis à disposition des étudiants étrangers pour servir de points de revente, où ils pouvaient ensuite être légalement achetés par des consommateurs soviétiques ordinaires. Les objectifs économiques n’étaient pas toujours alignés sur le discours et la logique de pureté politique.
Où se fournissaient les stiliagui ? Dans ces magasins d’occasion ?
Suite à la Seconde Guerre mondiale, les biens étrangers entrent d’abord en Union soviétique sous forme de butin de guerre, de trophées saisis par les soldats et les officiers de l’Armée rouge. Ensuite, ils entrent avec les touristes. Des fartsovchtchiki – des spéculateurs, selon le langage officiel, qui vendaient des biens de production étrangère – allaient voir les touristes étrangers et leur demandaient d’acheter leurs chemises, leurs chaussettes, tout ce qu’ils pouvaient. Puis le trafic s’est développé, et des « touristes » bien informés amenaient intentionnellement des biens à revendre parallèlement au développement des magasins d’occasion.
Même si, au début, le stiliaguisme s’est fondé sur l’usage des biens de production étrangère, la plupart de ces jeunes fabriquaient des vêtements à partir de matériaux et de vêtements soviétiques. Avant que leur style ne soit repris par les créateurs, ils rétrécissaient leurs pantalons, ils amenaient leurs chaussures chez le cordonnier pour y faire mettre des semelles compensées. Ils bricolaient ce qu’ils imaginaient être de la mode occidentale. D’ailleurs, plusieurs mémoires écrits par des stiliagui racontent leur stupeur lorsqu’ils rencontrèrent la vraie jeunesse occidentale, lors du Festival de la jeunesse de 1957 : ce qu’ils avaient imaginé n’avait rien à voir avec les pratiques quotidiennes des jeunes occidentaux, habillés de manière très simple, beaucoup moins sophistiquée qu’eux.
Des règles officielles d’attribution de vêtements existaient-elles (quotas, contrôle de l’usure) ?
Non, hormis pendant les périodes où les cartes de rationnement étaient instaurées, et où il y avait des normes d’attribution des produits de consommation ordinaires. C’est-à-dire, lors de la guerre civile (de 1917 à 1921), puis avec les grandes politiques de planification et d’industrialisation (de 1928 à 1935), pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu’en 1948, puis sous l’époque gorbatchévienne, mais cela ne concerne alors que les biens alimentaires.
En deux mots, comment la mode socialiste a-t-elle évolué jusqu’à la fin du régime ?
Après la période du Dégel, dans les années 1960 et 1970, le système soviétique parvient à améliorer les conditions de production, les salaires augmentent, le pouvoir d’achat aussi (c’est ce que l’on appelle le contrat social brejnévien), le phénomène de reproduction des élites s’installe durablement, les canaux d’arrivage des produits occidentaux se multiplient, les jeans apparaissent sur le marché soviétique, l’industrie soviétique essaie de les reproduire…
Je n’ai pas fait d’enquête pour la période postérieure, mais je sais que la femme de Gorbatchev, Raïssa Gorbatcheva, a fait en sorte qu’un magazine de mode ouest-allemand, Burda moden, soit traduit en russe. Avec la Perestroïka, la distinction discursive entre une mode soviétique et une mode bourgeoise perd définitivement sa raison d’être.
La koultournost’
Dans une brochure moscovite publiée en 1938, la koultournost’ est définie comme « un ensemble d’attitudes dans la vie quotidienne : “l’homme cultivé’’ ne jure pas, ne crache pas… Il sait se tenir à table, se montrer galant avec les dames, il connaît les bonnes manières. Il apprécie la musique, le ballet, mais ce qu’il aime par-dessus tout, ce sont les livres. » Apparue dans les années 1930, la lutte pour la koultournost’ correspond à la volonté de « civiliser » les Soviétiques. La koultournost’ s’éloigne de la notion de capital culturel, car elle ne se réduit pas à une accumulation de connaissances dans les domaines de la culture dite légitime (art, littérature, musique, formation scolaire, etc.). Elle s’apparente davantage à la notion de « civilisation des mœurs » avancée par le sociologue Norbert Elias. Modèle de l’« homme cultivé », au même titre que la soznatel’nost’ (conscience sociale), la koultournost’ comprend une forte dimension hygiénique (aspect propre, apparence soignée), la diffusion des bonnes manières (gestes, expressions verbales), des normes du bon goût et du sens esthétique, le partage d’un niveau d’éducation jugé acceptable ainsi que des bases de connaissances sur l’idéologie soviétique. Cette stratégie d’intégration au moyen de valeurs et de pratiques communes était notamment dirigée vers les paysans qui arrivaient en ville pour gonfler les rangs des ouvriers.
Notes
| ↩1 | Michel de Certeau, L’invention du quotidien, I : Art de faire (1990) et II : Habiter, cuisiner (1994), Folio essais, Gallimard. |





