Traduction par Raphaël Kempf et Otman El Mernissi
Cette traduction a été publiée dans la revue papier Jef Klak n°1 « Marabout »
Téléchargez le manuel en PDF
Traduction par Raphaël Kempf et Otman El Mernissi
Cette traduction a été publiée dans la revue papier Jef Klak n°1 « Marabout »
Téléchargez le manuel en PDF
Considéré comme le premier véritable super-héros, Superman apparaît en avril 1938, avec sa cape, ses bottes et son slip rouges, son « S » frappé sur un écu de poitrine jaune, et son justaucorps bleu, en couverture du mensuel Action Comics nº1 – édité par le futur DC comics. Face à un succès immédiat, le même éditeur publie un an après un autre personnage en cape et costume, mais sombre et masqué : The Bat-Man 1 The Bat-man perd son trait d’union après trois mois de publication, mais conserve souvent sa particule., qui fait la une du no 27 de Detective Comics. Si de nombreux autres super-héros apparaissent dans la foulée, Superman et Batman s’imposent comme les plus populaires et les plus emblématiques. Contrairement à la plupart de leurs congénères costumés, la publication mensuelle de leurs aventures ne connaîtra quasiment pas de pause. Ils ont créé et maintenu une véritable industrie, tout en alimentant régulièrement de nombreux autres médias de masse : feuilletons radiophoniques, cartoons, romans, serials, séries TV, jeux vidéos ou superproductions hollywoodiennes. Depuis plus de 75 ans, et alors que Batman V Superman : L’aube de la justice est sorti au cinéma ce mercredi 23 mars, c’est aussi deux visions de l’idéal américain de justice, des mesures antiterroristes ou des dispositifs de maintien de l’ordre qui se confrontent dans les sagas de ces super-héros.
Ce texte est issu du deuxième numéro de la version papier de Jef Klak, « Bout d’ficelle », paru en mai 2015 et encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF
« J’ai croisé beaucoup d’hommes. Certains étaient fringants, d’autres montaient un cheval blanc. Certains portaient même une couronne. Mais porter une cape sans avoir l’air stupide, voilà qui est intéressant. »
Lois Lane, Superman for all seasons
En septembre 2010, l’exposition « Habiter poétiquement (le monde) » marqua la réouverture du LaM de Villeneuve d’Ascq[2. LaM : « Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut », situé à Villeneuve-d’Ascq. Sa collection d’art brut est une donation du musée L’Aracine.]. Rapprochant des œuvres de ses collections d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, elle donnait à voir les impers que portait le plasticien Willem Van Genk pour se protéger des ondes nuisibles lorsqu’il arpentait la ville, et les robes, capes et tentures cousues et brodées dans les années 1940 par une femme anonyme de l’hôpital de Bonneval pour rejoindre son époux dans la mort.
Dans le catalogue de l’exposition, un article de Frédéric Logez[3. Frédéric Logez est écrivain et dessinateur. Il a publié en 2014 La Bataille-Arras 1917, aux éditions Degeorge, très bel album de bande dessinée sur l’offensive britannique contre les lignes allemandes en Artois, qui mobilisa tunneliers néo-zélandais, soldats australiens, terreneuviens, canadiens, anglais, gallois,…] intitulé « Seconde peau » décrit fait une anatomie comparée entre ces vêtements et les costumes collants des super-héros : « Première ou seconde peau, d’origine terrestre, extraterrestre ou divine, colorée ou non, de nature physique, technologique ou surnaturelle, le super-héros hors du commun enfile toujours un costume hors du commun. […] Pour [Superman et Batman], le processus est exactement inversé. L’un est lunaire, l’autre est solaire, mais tous deux usent d’un super-costume contre les forces du Mal. L’un, Batman, vient de la rue et utilisera l’ingénierie fine et la science pour confectionner son super-costume, sa seconde peau ; l’autre, Superman, vient de l’espace et son super-costume est sa force brute, sa seule et première peau. »
Comme le cinéma, la bande dessinée naît avec la métropole moderne, et plus que tout autre genre, les comics de super-héros inventent un nouveau rapport à la ville. Ce n’est pas un hasard si la cité fictive où s’installe Superman s’appelle Métropolis, comme la ville à deux niveaux du film éponyme de Fritz Lang en 1927, vision pessimiste de l’avenir de l’homme. La Métropolis de Superman représente d’ailleurs uniquement la ville haute du film de Lang, baignée de lumière et occupée par une élite de privilégiés, alors que Gotham City[4. Gotham est un des surnoms de New York, attribué à Washington Irving, auteur américain du début du XIXe siècle. De mai 1939 à décembre 1940, Batman rend la justice dans les rues de New York. Il ne devient le protecteur de la ville fictive de Gotham City qu’en janvier 1941. Or Gotham City s’inspire tout autant de Chicago que de New York, et serait située sur la côte Nord-Est des États-Unis, dans le New Jersey, à 60 miles au nord de Métropolis.], territoire du Batman, évoque la ville basse où sont reléguées les masses laborieuses. Son architecture, ses lumières et sa météo brumeuse s’inspirent d’ailleurs de l’expressionnisme allemand, quand la ville de Superman rappelle plutôt les architectures futuristes. Deux faces de la cité moderne, environnement naturel des super-héros – lesquels créent des manières désirables de l’habiter : perché sous la lune en haut des plus hautes tours, ou survolant les gratte-ciel en plein soleil[5. L’éditeur de comics Marvel a utilisé à fond ces nouvelles manières d’habiter la ville dans les années 1960, en choisissant comme cadre des aventures de ses nouveaux personnages, non plus des cités imaginaires comme Métropolis ou Gotham, mais New York. Et nous sommes nombreux à connaître intimement la fameuse Grosse Pomme sans y être jamais allés, grâce aux acrobaties de Spiderman ou Daredevil.].
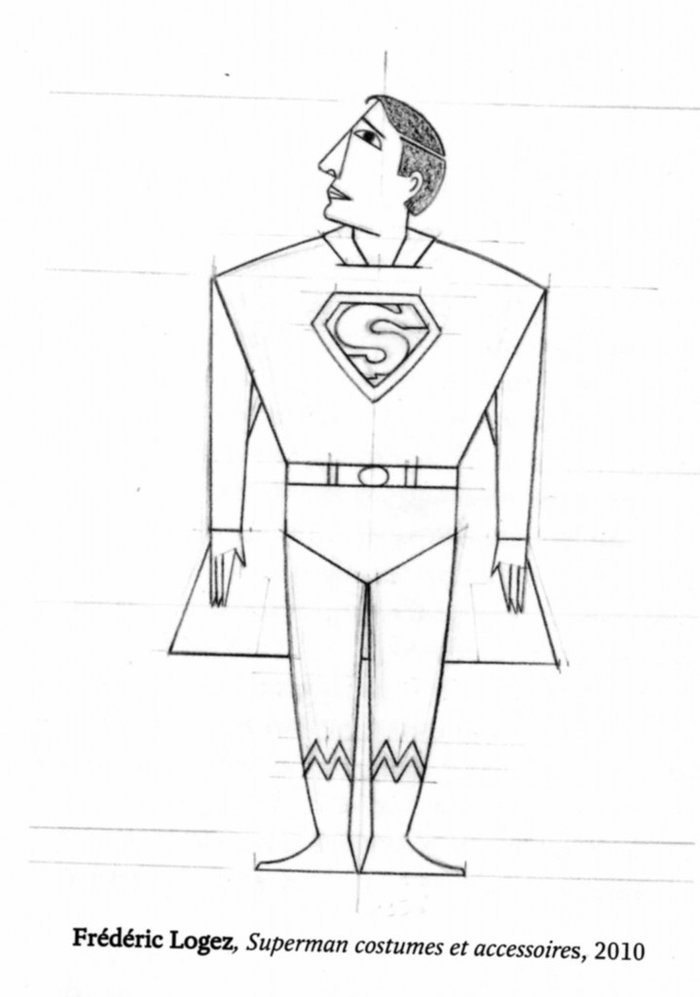
En 1933, Jerry Siegel et Joe Shuster, publiaient dans un fanzine une première version de Superman : un personnage malfaisant, ivre de pouvoir et de conquêtes, avec des pouvoirs télépathiques nés de l’expérience d’un savant fou. Cinq ans plus tard, les deux juifs new-yorkais assistent à l’arrivée de réfugiés fuyant la montée du nazisme en Europe. Face aux fantasmes de race pure et de surhommes virils aux chemises brunes et noires, Siegel et Shuster inventent un super-héros alien en costume moulant aux couleurs saturées.
Le justaucorps bleu, l’insigne et la ceinture jaune, les bottes, cape, et slip rouges de Superman s’inspirent aussi directement du costume de « L’Homme fort » des spectacles de foire. Encore une fois comme le cinéma, dont les images muettes des débuts sont commentées en direct par un bonimenteur, les comics entretiennent une filiation directe avec le cirque et les arts forains. Les super-héros jouent sur un mélange de fascination et de répulsion envers leur altérité radicale, comme les monstres de foires exhibés dans les freak shows et autres cirques Barnum au début du XXe siècle.
Les couleurs criardes de tant de costumes de super-héros s’expliquent aussi par la qualité médiocre des comics bon marchés (Detective comics valait 10 cents). Les grosses trames bavaient tellement qu’il fallait des couleurs vives pour reconnaître immédiatement les héros. Le blanc fut longtemps évité – ce qui explique peut-être que Superman ait remplacé le blanc du drapeau américain par du jaune[6. C’est pour la même raison qu’Hulk et Iron Man, qui apparurent tous deux gris et risquaient de finir imprimés en gros pâtés noirâtres, devinrent rapidement vert, et rouge et or.].
Depuis plus de 75 ans, des centaines de dessinateurs et écrivains ont pris en main les aventures de Superman, faisant évoluer son apparence dans les séries régulières, mais aussi dans de nombreuses versions alternatives ou projections futuristes[7. Les aventures de super-héros quasiment invulnérables pouvant se révéler à la longue quelque peu rébarbatives, les éditeurs ont vite publié des aventures exceptionnelles se déroulant dans le passé des personnages (les untold tales, comme les aventures de Superboy, version enfantine puis ado de Superman inventée en 1945, ou Batman : année Un qui narre les premières fois où Bruce Wayne enfile son costume de chiroptère), mais aussi des histoires présentant des versions alternatives de ces héros (les Imaginary stories, équivalents des What if de Marvel, qui mettent en scène ce qui pourrait se passer si certains détails avaient été différents, comme Superman : Red Son).]. La plupart des super-slips[8. Le terme « super-héros » est depuis 1979 une propriété de marque conjointe des deux plus gros éditeurs de comics américains : Marvel et DC. Ce sont donc les seuls à pourvoir imprimer le terme sur les couvertures de leurs magazines, ce qui oblige leurs concurrents à inventer des synonymes : ultra-héros pour Malibu, méta-humains chez Wildstorm, « Héros de la science » pour America’s Best Comics, la collection d’Alan Moore. Mais dans toutes les publications, indépendantes ou non, les super-héros sont communément désignés par des expressions ironiques se référant à leurs costumes, telles « encapés », « masques », ou même « super-slips ».] ont fini par abandonner la cape[9. Au moins depuis que Bill Dollar, super-héros d’opérette au service d’une banque, est mort abattu par des gangsters parce que sa cape était restée coincée dans un tourniquet, dans The Watchmen d’Alan Moore et Dave Gibbons, 1987.] – pas Superman. Le bleu et le rouge de son costume ont parfois changé de nuance, mais le slip est resté au-dessus du froc. La taille de l’écu s’est agrandie pour couvrir l’ensemble de la poitrine musclée. Les cheveux ont subi les effets de la mode (Ah, le « mulet » des années 1980, tempes courtes et nuque longue !), sans perdre la mèche en « S » sur le front. L’histoire de la provenance du costume et de la signification du « S » pectoral ont été révisées[10. John Byrne et George Pérez modifièrent la provenance du costume et la signification du « S » pectoral lorsqu’ils « modernisèrent » les origines de Superman en 1986 avec la mini-série Man of Steel. À l’origine, le costume et la cape ont été cousus par sa mère adoptive, et le « S » pectoral dessiné par son père adoptif en hommage à l’un de ses ancêtres, qui avait tenté de sauver des Indiens d’une épidémie : l’image est censée représenter un serpent, symbolisant la guérison. Désormais, comme dans la version cinéma de Richard Donner en 1978, le costume est une relique de la planète Krypton, dont est originaire Superman, et le « S » rouge sur fond jaune l’emblème de la dynastie El, (c’est-à-dire de la famille de Kal-El, le vrai nom de Superman), un symbole kryptonien signifiant « Espoir ». En tous cas, dans aucune version il ne s’agit vraiment d’un « S », et dans toutes, c’est l’éternelle fiancée du boy-scout en bleu, la journaliste arriviste Lois Lane, qui invente le nom de Superman à partir de ce malentendu.], mais le costume reste très proche de ses premières apparitions – contrairement à beaucoup de super-héros aux goûts plus versatiles, tels les X-men, dont l’accoutrement ne cesse de changer au gré de la mode, passant allègrement du lycra au latex ou des vêtements civils aux costumes punk, voire aux armures.
Certains dessinateurs ont réussi à livrer des images du plus puissant des Supers réellement marquantes. Ainsi Tim Sale avec son épuré Superman for all seasons, où le Grand S se fait pure ligne bleue, rouge et jaune. Ou Alex Ross et ses couvertures peintes inspirées de Norman Rockwell, mais aussi sa version de l’avenir, Kingdom come, où le passage du jaune au noir suffit à suggérer l’austère maturité de l’Homme de Demain. Sans oublier Frank Quitely avec All star Superman, dans la mise en scène d’une possible mort du Kryptonien, qui réussit à rendre crédible la double identité de Clark Kent et Superman, en opposant la puissance contenue du Grand Bleu aux postures exagérément maladroites de Kent, inspirées de la gestuelle du théâtre yiddish.
Des versions alternatives, il faut aussi retenir le savoureux Superman : Red Son où l’Homme d’Acier, s’étant à l’origine écrasé dans un kolkhoze en Ukraine au lieu d’un champ au Kansas, devient le super-héraut du communisme. Il succède à Staline, et convertit au socialisme l’ensemble des États de la Terre, à l’exception du Venezuela et des États-Unis. Ici, Superman est tout de gris et de rouge vêtu, la faucille et le marteau remplaçant le « S » sur la poitrine de son uniforme soviétique, tandis que son adversaire Batman, chapka sur les oreilles de sa cagoule, arbore « le noir de l’anarchie ».
Superman est souvent qualifié de personnage « iconique », ce qui en soit ne veut rien dire. Ou alors pour signifier qu’il est davantage une image qu’un personnage : son costume n’est pas seulement sa propre peau, il est tout entier une image animée. Une idée de l’Amérique en technicolor. L’icône est née durant la montée du nazisme en Europe, et en pleine crise économique aux États-Unis, sous la politique de « New deal » menée par le président Roosevelt. Dès la première page d’Action comics nº1, il se présente comme « champion des opprimés, la merveille physique qui a juré de vouer son existence à aider ceux dans le besoin ». Justicier progressiste, apôtre de l’individu et de l’action, sa première aventure dénonce la peine de mort, et il s’attaque aux maux de la Grande Dépression : mafia organisée, syndicats marrons, corruption politique, violence conjugale, alcoolisme, etc.
« Plus rapide qu’une balle, plus puissant qu’une locomotive, capable de sauter par-dessus des gratte-ciels d’un bond[11. Les pouvoirs de Superman sont à l’origine calqués sur ceux de John Carter, le héros d’E. R. Burroughs dans Princess of Mars (1917) et ses suites. Mars ayant une gravité moindre par rapport à la Terre, lorsque John est téléporté sur cette planète, il se retrouve doté d’une force herculéenne qui lui permet de faire des bonds gigantesques. De même Superman, qui vient de Krypton à la gravité plus élevée, ne vole pas à ses débuts, mais fait des bonds au dessus des gratte-ciels.] », il représente la modernité, tout en défendant les valeurs rurales de l’Amérique aux dépens de la ville et de ses dangers. Élevé dans la petite ville de Smallville au Kansas par un couple de vieux paysans tout droit sortis d’un film de John Ford, le bon « Supes » a grandi au biberon de leur morale manichéenne : « la Vérité, la Justice et l’idéal américain » qui devient sa devise. Mais en tant qu’alien adopté par les États-Unis, il représente surtout l’Amérique des immigrants, et revendique un humanisme multiculturel radical, sorte de politiquement correct avant l’heure.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, Superman se fait « porte-drapeau de l’Amérique », et délaisse les problématiques sociales pour combattre les nazis et les Japonais. Dès 1940, il s’envole même en Allemagne et en Russie, pour attraper Hitler et Staline par le col et les livrer au jugement de la Société des Nations à Genève. Après-guerre, l’Homme de Demain reconstruit quelques quartiers vétustes, mais passe surtout son temps à combattre des super-vilains à sa mesure, comme Lex Luthor.
À cette époque, les aventures de super-slips ne font plus recette, et la guerre froide s’accompagne d’une autocensure paralysante. En 1954, le psychiatre Fredric Wertham accuse les comics de pousser au crime leurs jeunes lecteurs[12. La campagne de Wertham contre les comics concerne tous ceux qui représentent des scènes de crimes, qu’ils soient consacrés à des histoires de gangsters et d’affaires de meurtre (un genre très populaire à l’époque), de super-héros ou d’horreur. Il insiste notamment sur l’ambiguïté de la relation affective entre Batman et Robin, son Garçon prodige.]. Les éditeurs préfèrent anticiper sur la censure gouvernementale ou parentale, et créent eux-mêmes un label de bienséance, le Comics Code Authority, qui prohibe toute représentation de la violence, de la sexualité, de la religion, du racisme, de la drogue, des vampires, loups-garous ou zombies, et impose au Bien de triompher du Mal. Ces règles poussent les encapés à se tourner vers la science-fiction. Le Kryptonien se fait alors gendarme galactique, porte l’idéal américain dans l’espace, et protège la Terre de menaces venues de lointaines planètes, comme le robot Brainac, collectionneur de villes qu’il miniaturise dans des bouteilles.
Dans les années 1970, les super-héros reprennent pied sur Terre, et le Comics Code Authority est peu à peu abandonné. Une nouvelle génération d’auteurs, qui a grandi avec ces mythes, porte un regard plus critique sur le genre. Le boy-scout en bleu commence à se poser des questions sur sa politique et sa manière manichéenne de traiter tous les problèmes à coup de bourre-pifs. Dans un épisode de 1972, « Superman est-il nécessaire ? », les Gardiens de l’Univers – extraterrestres qui surveillent les cent milliards d’étoiles de la voie lactée – accusent Superman de contribuer au « retard culturel des terriens » par son ingérence dans leurs affaires. De retour sur Terre, il défend un jeune Mexicain en grève contre son patron. Alors que les immigrants du bidonville l’acclament et demandent son aide, il commence par la leur refuser avant d’intervenir contre un séisme, puis de reconstruire leurs maisons. Mais le doute est en lui.
Dans les années 1980, le Champion de l’Amérique a de plus en plus de mal à assumer son humanisme candide. Toujours fidèle à « l’idéal américain », il apparaît souvent comme le valet servile de la politique va-t-en guerre de Ronald Reagan, que ce soit dans ses aventures ordinaires ou dans des futurs alternatifs, comme celui imaginé par Frank Miller dans The Dark Knight returns, où s’affrontent Batman et Superman : dans un avenir où les super-héros ont été interdits à l’exception de Supes, celui-ci attaque les troupes soviétiques pour protéger les intérêts américains (qui lui répondent à coup de missile thermonucléaire, provoquant un hiver nucléaire sur Gotham), et obéit à l’ordre de Reagan d’arrêter le vieillissant Batman, mort ou vif.
Dès lors, Superman, dont les pouvoirs n’ont cessé de croître (soulevant des immeubles à ses débuts, il peut désormais porter des planètes entières sur son dos), est de plus en plus dépeint comme inhumain plutôt que surhumain. Nombre d’aventures et de parodies insistent sur la dangerosité d’une telle puissance, tout en raillant son inefficacité devant la violence du monde. Dans les années 2000, Sentry[13. The Sentry est un personnage créé par Paul Jenkins et Jae Lee dans la mini-série homonyme publiée en 2000. D’abord présenté comme un héros du passé oublié de tous, même par son créateur, Stan Lee, il fut révélé par la suite qu’il ne s’agissait que d’une stratégie marketing de Marvel Comics.], la version Superman de Marvel, a la puissance d’« un million de soleils explosant », mais souffre d’un dédoublement de personnalité. Omni-man[14. Omni-Man : parodie de Superman et père d’Invincible, super-héros et titre de la parution homonyme écrite par Robert Kirkman, dessinée par Cory Walker puis par Ryan Ottley et publiée par Image Comics.], celle d’Image comics, est un extraterrestre qui se fait passer pour Protecteur de la Terre dans le seul but de la coloniser. Quant à The Authority, parodie de la Ligue de Justice[15. The Authority est une équipe de super-héros créée par Warren Ellis pour WildStorm, parodiant la Ligue de Justice d’Amérique, équipe réunissant les plus célèbres super-slips de l’éditeur DC comics : Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash…] qui réunit dans la même équipe les caricatures de Superman et Batman sous les noms d’Apollo et Midnighter (lesquels se marient et adoptent un enfant), cette série est souvent qualifiée d’anarchiste du fait de son irrévérence et de l’interventionnisme de l’équipe à un niveau mondial, ses membres n’hésitant pas à s’opposer aux États-Unis, à l’ONU ou à la France[16. Un épisode d’Action comics, daté de mars 2001, réaffirme les vieilles valeurs de Superman, en parodiant à son tour le discours anarcho-punk de la parodie. Dans cette aventure, intitulée « Qu’est-ce que la Vérité, la Justice, et l’idéal américain ont de si drôle ? », The Authority devient « l’Élite » et voici son manifeste : « Nous ne croyons pas aux Nations. Nous ne croyons pas aux traités. Ni aux frontières, aux classes ou aux programmes… Il y a d’un côté les bons, c’est-à-dire nous, et de l’autre côté les méchants, c’est-à-dire tous ceux qui traitent les autres comme de la merde pour satisfaire leurs petits besoins. Le monde nous attendait. Maintenant, il nous a. Soyez gentils ou nous raserons votre maison avec une bombe anti-connard à fragmentation. Gros bisous. » Supes finira évidemment par vaincre ces petits prétentieux et réaffirmer son rêve d’un monde de Vérité et de Justice.].
Face à cette inflation de Supers toujours plus brutaux et amoraux, le boy-Scout en bleu continue de défendre ses valeurs, mais en s’éloignant de sa nation d’adoption. Déjà dans l’adaptation cinématographique réalisée par Richard Donner en 1978, il avait commencé à promouvoir « la Vérité, la Justice et l’idéal humain », au lieu de « l’idéal américain ». Dans « L’incident » – épisode anniversaire publié dans Action comics no 900 en juin 2011 –, il va jusqu’à renoncer à la citoyenneté américaine quand des agents de la sûreté nationale lui reprochent d’avoir participé à une manifestation pacifique en Iran : « Je suis las que mes actes soient associés à la politique américaine. “La Vérité, la Justice et l’idéal américain”… Cela ne suffit plus. »
En septembre de la même année, les éditions DC décident de faire repartir à zéro les aventures de tous ses super-héros, et toutes ses publications au nº1, y compris Action comics et DC comics, dont la numérotation courrait depuis les années 1930. Ce reboot est nommé « Renaissance DC », ou « New 52 », puisque le lifting concerne alors 52 séries. Les nouvelles origines de Superman version « Renaissance » sont réécrites par Grant Morrisson, scénariste écossais qui réalise un pont entre l’Amérique de la Grande Dépression du Superman originel et celle de la crise économique des années 2010. Il renoue ainsi avec le concept fondateur : la défense des opprimés contre les élites corrompues autant que contre les savants fous, quitte à affronter les autorités.
Le jeune Superman recommence sa carrière en jean et T-shirt bleu, et seule sa cape kryptonienne raccorde avec le costume classique. Adulte, il porte un costume bleu, rouge et or, mais bien loin des collants d’avant-guerre : désormais, il s’agit d’une bio-armure kryptonienne, à la texture métallique et aux formes bodybuildées, comme dans la pesante adaptation cinématographique de Zack Znider en 2013. La référence au cirque se perd et le costume devient uniforme de combat. Fini le slip, même si une fine ceinture rouge lui dessine une sorte de tanga autour de la taille.
Bravant les impératifs techniques qui poussèrent les dessinateurs à donner des couleurs vives au costume de Superman, The Bat-man est lui aussi vêtu d’une cape et d’un slip porté au dessus de collants, mais cette fois dans des couleurs sombres, allant du gris souris au bleu nuit – à l’exception de sa bat-ceinture jaune aux sacoches pleines de gadgets. Alors que Superman se contente d’enlever ses lunettes et de changer de coiffure pour protéger son identité civile, le Batman cache son visage derrière une cagoule aux oreilles pointues. Apport essentiel à la mythologie du super-héros, le masque permet à la fois l’anonymat et la reconnaissance : il préserve l’identité secrète du super-héros, tout en donnant une visibilité à ses actions.
Si Superman s’inspire de héros de pulps et de comic strips comme Tarzan, Doc Savage ou Flash Gordon, l’homme chauve-souris tire du même fond populaire des influences plus sombres comme le célèbre The Shadow ou le Dracula des films de Tod Browning ; sans pour autant rompre avec ses origines foraines, notamment à travers le costume jaune, vert et rouge de son apprenti, Robin[17. Superman, lui, n’a pas d’apprenti costumé, mais une cousine kryptonienne, Supergirl, habillée quasiment comme lui : la jupette remplace le slip. Ainsi qu’un super-chien, Krypto, venu de la même planète et portant une cape rouge. Steaky et Comet, respectivement le super-chat et le super-cheval de Supergirl, portent eux aussi une cape et volent, tout comme le super-singe en slip Beepo. Batman s’entourera quant à lui de toute une Bat-famille amatrice de collants et cagoules à cornes : en sus d’épuiser plusieurs Robin, Batgirls, et Batwomen, il se fera également accompagner dans ses aventures d’un Bat-molosse nommé Ace, qui ne porte pas de cape mais un masque, pour ne pas qu’on le reconnaisse à partir d’une tache caractéristique sur son museau.]. Comme Superman et Batman, Robin le « jeune prodige » est d’ailleurs un orphelin, dont les parents étaient acrobates dans un cirque. Son slip à grosses mailles vertes, porté à ses débuts sans collants, est particulièrement osé.
Lors de la révision de 2011, « Renaissance DC », Batman n’adopte pas d’armure intégrale comme dans les adaptations pour le cinéma de Christopher Nolan. Il conserve sous sa cape un costume gris, désormais en nomex ignifugé, mais toujours moulant. Cependant, lui aussi abandonne le slip et les collants pour un treillis gris avec une coquille blindée protégeant ses Bat-organes reproducteurs.
Superman a souvent été comparé au président Roosevelt, tous deux prétendant lutter contre des forces hostiles, pour sortir l’Amérique de la crise et créer une société plus juste. Batman, lui, renvoie plutôt au parcours d’Edgar Hoover, qui fonda le FBI cinq ans avant la naissance du justicier masqué, et se fit le héraut de la « guerre au crime », versant policier du New Deal, censée démanteler les cartels mafieux au lendemain de l’abolition de la prohibition. Dans les années 1930, Edgar Hoover s’était fait une réputation médiatique et politique en mettant fin aux carrières de « Machine Gun » Kelly, Bonnie Parker et Klyde Barrow, John Dillinger, « Baby Face » Nelson, « Ma » Barker et Alvin Karpis – tous des bandits isolés, sans lien avec la mafia organisée en entreprises intégrées à la métropole.
Le Batman s’est quant à lui donné pour mission de venger la mort de ses parents, tués par un malfrat sur Crime Alley, en menant une lutte sans merci contre le crime. Or dès 1940, quand il prend pour partenaire le fringuant Robin et rencontre le Joker, « le Clown Prince du Crime », il devient le recours ultime contre les criminels extravagants. Véritable auxiliaire de la police (un « Bat-signal » est installé sur le toit du commissariat de Gotham en 1942), Batman mène dès lors la même politique qu’Edgar Hoover : s’attaquer aux criminels isolés ou regroupés en petites bandes, sans jamais vraiment toucher le crime organisé.
Le « plus grand détective » participe ensuite à l’effort de guerre en combattant nazis et vampires. Alors que les ventes chutent après la Seconde Guerre mondiale, il reste une des rares séries de super-héros publiées. Comme celles de Superman, ses aventures se tournent vers la science-fiction, et après l’instauration du Comics Code Authority, le ton vire à l’humour et à la dérision. En 1966, le succès de la série télé mettant en scène Batman et Robin renforce encore ce côté « second degré », et il faut attendre les années 1970 pour que le Chevalier noir revienne à des enquêtes plus sérieuses : Robin part à la faculté et Batman reprend « sa guerre au crime » en solitaire, notamment dans les aventures gothiques du jeune tandem Dennis O’Neil et Neal Adams.
En 1986, Frank Miller et David Mazzuchelli revisitent les origines du personnage dans Batman : Année Un. Ils renouent avec l’influence du roman noir par des dessins sombres et épurés, et la description minutieuse de Gotham à travers les regards croisés du Batman et du commissaire Gordon. Sans costume mais grimé, fausse cicatrice et fond de teint, le justicier échappe de peu à l’emprisonnement lors de sa première mission, et rentre en son manoir blessé. Ruminant son échec dans son fauteuil de maître, il hésite à sonner son domestique pour se faire soigner, quand une énorme chauve-souris brise la vitre de son bureau et se pose sur le buste de son père. Se rappelant la terreur qu’il avait éprouvée enfant en tombant dans une grotte pleine de ces bestioles (qui allait devenir la Batcave), il prend la décision de se déguiser en chiroptère pour insuffler cette terreur enfantine à tous les criminels.
Miller réaffirme ainsi le mythe originel de l’Homme-chauve-souris, sa doctrine politique : non pas la vengeance, mais la terreur. Pour lutter contre le crime, il ne s’agit pas d’éliminer quelques criminels par la force ; il faut inspirer en leur corps une profonde terreur. Ne pas tuer, mais frapper. Mutiler certains pour donner l’exemple à tous. Comme dans ses premières aventures, Batman n’affronte pas des bandits bariolés, mais des familles mafieuses, des flics pourris et des élites corrompues. Cela dit, dès son premier combat, ce sont bien les os de jeunes ados qu’il brise, ce qui n’est pas sans rappeler les véritables effets de toute politique sécuritaire menée sous couvert de lutte contre le terrorisme ou le crime organisé.
Alors que le costume flashy de Superman, sa « première peau », ne fait que signaler son exception, celui de Batman a dès le début une toute autre fonction symbolique : inspirer la peur. C’est dans ce sens que lors de sa création, le scénariste Bill Finger convainc le dessinateur Bob Kane de passer au gris les collants de l’Homme-chauve-souris, qu’il avait imaginé rouges, et de tracer des ovales blanc en guise d’yeux sur la cagoule à pointes. Des choix ouvrant de formidables possibilités graphiques pour les dessinateurs futurs, leur permettant d’abstraire la Créature de la Nuit dans un travail de l’ombre et de la lumière. Le plus radical dans cette voie reste sans doute Dave McKean avec son mélange de peinture, photos et collages, dans le magnifique roman graphique publié en 1989 et écrit par Grant Morrisson : Arkham Asylum.
Au fil des ans, le gris souris des dessous du Chevalier noir et le jaune de sa bat-ceinture évoluent assez peu, alors que la couleur de sa cape, sa cagoule, son slip, ses bottes et ses gants se nuancent indéfiniment, du bleu nuit au violet jusqu’au noir profond[18. Un des rares avatars vraiment coloré du Batman vient de la reprise de la série par Grant Morrisson entre 2006 et 2011. Lors de ce long run, le scénariste écossais s’ingénia à convoquer les histoires passées de l’Homme-chauve-souris comme si elles décrivaient une même biographie, multipliant les allusions aux histoires les plus extravagantes. Il exhuma par exemple une scène de 1958 : le « Batman de Zur-En-Arrh ». De ce personnage issu d’un univers alternatif, la Terre X, Morrisson fait une sorte de personnalité de rechange créée par Bruce Wayne par auto-hypnose pour se prémunir des attaques psychologiques. S’il perd la mémoire ou devient fou, l’entité prend le contrôle le temps que Bruce Wayne reprenne ses esprits. Ce qui finit par arriver : Wayne devient le Batman de Zur-En-Arrh, se confectionne un costume aux couleurs criardes, rouge, jaune, et violet, et attaque ses ennemis de manière bien plus violente que sa version grise.]. Ce sont surtout la taille de ses fausses oreilles et le dessin de chauve-souris sur sa poitrine qui sont sujettes à interprétation. Ainsi Julius Schwartz, éditeur du Batman, invente en 1964 le logo noir en forme de chauve-souris dans un cercle jaune, repris dans la série TV à succès de la fin des années 1960. L’icône, à la fois logo et écu de chevalier, s’impose plus tard à l’ensemble de la planète lors de la colossale campagne marketing pour l’adaptation cinéma de Tim Burton mise en musique par Prince en 1989.
Le Chevalier de la nuit utilise aussi régulièrement différents Bat-costumes spécifiques (aquatique, volant, ignifugé, blindé…), plus proches de l’armure que du collant. Mais contrairement aux sept dernières adaptations cinématographiques de ses exploits, où les acteurs qui l’incarnent portent des combinaisons noires aux muscles dessinés, il n’abandonne jamais vraiment les collants gris souris dans les comics, et encore moins la cape, métonymie du super-héroïsme autant que motif visuel passionnant pour tous les dessinateurs amateurs de drapés et de plis.
Au-delà de sa fonction symbolique, le casque-cagoule protège identité et crâne, et assure une liaison permanente avec le majordome-à-tout-faire Alfred. Ses lentilles blanches confèrent au Batman une vision nocturne. La cape permet de planer, et dans certaines versions de voler. Les collants deviennent peu à peu pare-balles et ignifugés. Les gants sont pourvus de trois Bat-lames et divers gadgets de rechange. Surtout, la Bat-ceinture jaune, qui ressemble à celle d’un charpentier, contient dans ses sacoches autant d’armes et d’objets insolites que le sac sans fond de Mary Poppins.
Le plus célèbre de ces gadgets est un boomerang en forme de chauve-souris, le Batarang, de divers types : tranchant, explosif, électrifié, sonique, télécommandé. Mais les sacoches contiennent davantage : Bat-grappin, Bat-griffe, Bat-bombe, Bat-gel explosif, Bat-tyrolienne, Bat-taser, Bat-filtres à airs, Bat-lanceur de bombes collantes, Bat-séquenceur cryptographique, Bat-scanner portatif, Bat-brouilleur, Bat-grenade givrante, Bat-capsules de gaz (fumigène, lacrymogène, narcotique), drogues en tous genres, médicaments et antidotes… Impossible non plus de dénombrer tous les joujoux high-tech qui encombrent la Batcave : les différentes Bat-armures, le Bat-ordinateur à émetteur holographique, le Bat-gyro (en fait un Bat-hélicoptère), le Bat-plane, la Bat-moto, les innombrables Batmobiles (62 versions entre 1941 et 1990)… D’abord équipé de simples gadgets conçus pour blesser sans tuer, Batman utilise une technologie de plus en plus sophistiquée, développant par exemple des drones de combat à oreilles de chauve-souris. Il n’est pas seulement millionnaire et ingénieux, mais dirige un conglomérat d’entreprises lui permettant d’être toujours à la pointe de l’innovation technologique, et politique[19. Selon un petit manifeste politique à la mode sur certains plateaux, À nos amis, du Comité invisible (La Fabrique), la politique révolutionnaire doit réunir les qualités du prêtre, du guerrier et du producteur. Autrement dit, articuler trois dimensions : l’esprit, la force et la richesse. L’intelligence déductive et l’imaginaire de la peur, l’entraînement intensif et la violence cathartique, la fortune et la logistique capable de financer une ingénierie high-tech : Batman mène une politique révolutionnaire.].
En 2011, le passage de Grant Morrisson comme scénariste de la série régulière du Chevalier noir, qui avait débuté en 2006, s’achève sur la création de Batman, Inc., une entreprise de sécurité internationale. À la mondialisation du crime organisé, Batman répond par la mondialisation du Batman. Après avoir orchestré la (fausse) mort de Bruce Wayne et sa succession dans le costume gris souris par Dick Grayson (le premier Robin), Grant Morrisson fait revenir l’original[20. Dans la série « Le retour de Bruce Wayne », Batman, que tout le monde croit mort, mais qui a en fait été projeté dans le temps, traverse les siècles de la préhistoire jusqu’à nos jours, en passant par les époques de la piraterie, de la chasse aux sorcières, du western et de la prohibition.
Grant Morrisson affine le mythe du costume du Batman : il le fait remonter à la préhistoire, où Bruce Wayne endosse une peau de chauve-souris géante, qui deviendra une relique sacrée veillée par une tribu vivant dans la grotte qui abritera la Batcave des siècles plus tard.], mais dans un autre rôle que celui de Protecteur de Gotham. Bruce Wayne décide de laisser cette fonction et son uniforme à son ancienne pupille, Robin, et d’endosser un nouveau costume, sans slip, afin de se consacrer à l’international à travers Batman Inc., nouvelle filiale de Wayne Entreprise.
Il recrute donc à travers la planète de nombreux super-héros et leur fournit logo chauve-souris et logistique. Il engage ainsi toute la Bat-family recomposée : Robin, Red Robin, Batgirl, Batwoman, Batwing, Huntress, Oracle, James Gordon, et parcourt le monde pour disposer d’agents dans chaque pays : Frère Chiroptère et Corbeau rouge (réserves indiennes), M. Inconnu (Japon), Black Bat (Hong Kong), Wingman (Mtamba, Afrique), Dark Ranger (Australie), El Gaucho (Argentine), Le Chevalier et l’Écuyer (GB), Nightrunner (Seine-St-Denis)[21. Nightrunner, lourdement traduit en « Parkoureur » est un super-héros français créé par le scénariste anglais David Hine et le dessinateur Tom Lyle en décembre 2010, et recruté pour Batman, Inc. en France. Son identité secrète est Bilal Asselah, jeune français d’origine algérienne et de confession musulmane, habitant Clichy-sous-Bois et adepte du Parkour (discipline sportive de déplacements dans l’espace urbain). Son frère est mort tué par la police au cours de violentes émeutes, et il n’aura alors de cesse de protéger les siens de la police… et la police des émeutiers. Ses premières apparitions dans les comics déclenchèrent une vive polémique chez les conservateurs américains qui n’apprécient pas qu’un musulman représente Batman. Malgré quelques apparitions furtives dans Batman, Inc., son histoire n’a toujours pas été publiée en France.]. Son principal critère de recrutement : des héros qui n’utilisent pas d’arme à feu et ne passent jamais la ligne éthique qu’il s’est fixée – ne pas tuer. À terme, le but est de développer des drones domestiques avec fonction de gardes du corps, bon marché : « Un Batman dans chaque maison. »
Le Vigilant en noir n’a pas toujours refusé les armes à feu. Dans ses premières aventures, il menace de mort les criminels, porte parfois un flingue, et ses adversaires meurent souvent au combat (mais toujours par accident). Fin 1941, craignant les associations de parents, le directeur de publication de DC décide que Batman ne doit plus jamais utiliser d’arme. Ceci est annoncé clairement dans le quatrième numéro du magazine Batman : « Batman ne tue jamais ni ne porte d’arme à feu ». Bob Kane et Bill Finger obtempèrent, et l’adversaire qu’affronte Bats pour la première fois dans ce numéro, le Joker, survit, et reviendra encore et encore.
Comme le New Deal de Roosevelt et la politique sécuritaire d’Edgar Hoover, Superman et Batman s’opposent moins qu’ils ne se complètent. Indépendamment de la sensibilité des auteurs qui les animent, ils incarnent chacun à leur manière l’éthique individualiste de l’Amérique, l’un en technicolor, l’autre en noir et blanc, ainsi qu’une politique d’exemplarité. Le Grand Bleu avec ses grosses valeurs cherche à donner l’exemple à tous les humains, à inspirer les futurs défenseurs du Bien. Le Justicier de la nuit veut insuffler l’effroi aux suppôts du Mal. Deux faces de la même morale manichéenne, deux instances complémentaires de jugement et de maintien de l’ordre social.
L’alien devenu Champion bariolé de l’Amérique incarne depuis sa création un universalisme candide, politiquement aussi correct qu’inoffensif. Ce qui ne l’empêche jamais d’agir en super-flic : Superman s’oppose à la peine de mort, mais ne rechigne pas à condamner régulièrement ses ennemis à l’enfermement à perpétuité dans une « dimension de poche » : la « Zone fantôme ».
Le Batman a, quant à lui, « inventé » la doctrine de la police moderne : ne plus tant entretenir une image de respectabilité, de proximité avec la population comme Superman ou le gendarme de Saint-Tropez, mais s’imposer par la peur dans la rue. Terroriser pour dissuader. Mutiler pour faire exemple. Certes, les pratiques de la police américaine, par l’usage banal de l’assassinat par arme à feu, semblent démentir cette politique de cruauté raisonnée. Dans les faits, le développement d’armes dites « non létales » n’a diminué nulle part le nombre de gens tués par la police, ni le recours aux armes à feu. Il ne fait que banaliser et raffiner les « violences légitimes » exercées par la police. En France, le récent meurtre de Rémi Fraisse à la grenade, après tant d’éborgnés au flashball dans les rues et les manifestations, nous le rappelle brutalement[22. La brutalité assumée du Batman (comme celle de la police) n’a cependant rien à voir avec le fascisme comme on l’y réduit trop souvent. Elle est profondément liée à la démocratie et à la république. Le Justicier masqué est celui qui suspend la loi pour la défendre, la « force obscure » de la démocratie. Comme le dictateur que convoquaient les citoyens romains pour sauver la république menacée (référence explicite dans le film The Dark Knight rises).].
Aucune police au monde ne s’est mise à se vêtir de collants aux couleurs primaires. L’équipement et les vêtements des forces de l’ordre, de plus en plus conçus pour l’activité physique sinon militaire, se rapprochent davantage de ceux de Batman, et plus précisément des versions cinéma de la trilogie réalisée Christopher Nolan. Les costumes des SWAT américains sont tissés des mêmes matières que les costumes du Batman de Nolan : Nomex résistant aux flammes et Kevlar pare-balles[23. Le site internet <moneysupermarket.com> a calculé le prix de la combinaison et des accessoires de Batman dans The Dark Knight rises. Devenir Batman coûterait 562 millions d’euros, construction du manoir Wayne comprise. Le costume coûterait 870 000 euros, dont la quasi-totalité pour son masque, qui vaut à lui seul 820 000 euros. Le bustier pare-balles en Kevlar vaudrait 2 500 euros, plus 950 euros de renforts en carbone ainsi qu’une coquille à 850 euros pour protéger le système reproducteur de l’Homme-chauve-souris. La cape infroissable : 32 000 euros. Pour les gadgets, 133 000 euros, l’équipement le plus cher étant le pistolet lance-grappin à 41 000 euros. Vu l’évolution du budget de l’État, même avec le développement de la politique sécuritaire, l’équipement de la police française n’est cependant pas prêt de suivre. C’est déjà ça.].
Heureusement, ce n’est sans doute pas la niaiserie du discours de Superman et le délire sécuritaire de Batman qui marquent le plus les imaginaires collectifs depuis plus de 75 ans. Comme les western, les histoires mythiques de super-héros sont en définitive moins des apologies du « vigilantisme » que des réflexions sur la puissance, la loi et la société. Ainsi, à côté des réquisitoires pour l’autodéfense de Frank Miller, d’autres auteurs, comme Alan Moore et son fameux Killing Joke, interrogent la violence abusive et la folie obsessionnelle de Batman, qui le rapprochent tant de ses vilains ennemis. Cette approche récurrente, au cœur de la trilogie Nolan, rappelle que l’action du premier super-héros de Gotham a entraîné l’apparition de super-criminels d’un degré de violence qui n’existait pas avant lui. La violence de la rue dépend directement du niveau de la « violence légitime », dans les comics celle des super-héros, en réalité celle de l’État.
Mais au-delà des interprétations contradictoires des mêmes mythes, la force politique de ces historiettes tient aussi simplement dans la puissance des images d’envol au dessus des gratte-ciels et de plongées dans les ruelles obscures, la force de l’ombre et de l’invisibilité, l’impertinence du slip et de la couleur.
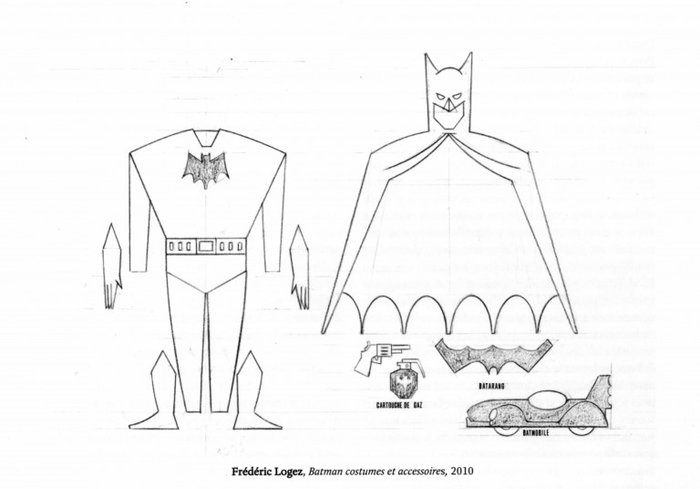
La dernière adaptation cinématographique de Batman, The Dark Knight rises, qui clôt la trilogie réalisée par Christopher Nolan, a été à la fois taxée de pro-démocrate par les Républicains, et de pro-républicaine par les Démocrates. Les Républicains considèrent que le super-méchant Bane fait référence à Bain Capital, le fonds d’investissement dirigé par leur candidat à la présidentielle, Mitt Romney. The Guardian (17 juillet 2012) estime que le film contient au contraire une « vision audacieusement capitaliste, radicalement conservatrice, et justicière qui propose de façon sérieuse, frémissante, que les souhaits des riches soient défendus dès lors qu’ils œuvrent pour le Bien. ».
En tous cas, quand le super-terroriste Bane, hybride entre un géant russe et un arabe voilé (toutes les peurs de l’Amérique condensées) commence par attaquer la Bourse pour la pirater, avant de proclamer (sous la menace d’une arme nucléaire) « rendre Gotham au peuple », difficile de ne pas voir une charge contre le mouvement Occupy Wall Street. Surtout en regard de l’insurrection qui vient ensuite, où les 99% vont allègrement expulser les riches de leurs manoirs, leur arracher leurs colliers de perles, et acclamer les Tribunaux populaires parodiant la Terreur qui suivit la Révolution française. Or même au cœur de ce chaos, Batman refuse jusqu’au bout les armes à feu. C’est sans doute une raison pour laquelle les Républicains américains, si liés aux lobbies des marchands d’armes, ne sauraient s’y reconnaître.
« The Dark Knight Rises n’est pas politique », affirme Christopher Nolan dans Rolling Stones magazine en juillet 2012. Comme la plupart des productions hollywoodiennes et des comics américains, le film est conçu pour que tous les publics s’y retrouvent, au moins partiellement. La satire d’Occupy Wall Street pour les Républicains, le discours de classe de Sélina Kyle (Catwoman, même si son nom de scène nocturne n’est jamais évoqué) pour les spectateurs marxistes, et la jouissance cathartique des scènes de destruction de la métropole participent de cette identification largement partagée. Il n’empêche, Nolan a beau jeu de proclamer ne pas délivrer de message particulier, son apologie de l’alliance des bons capitaliste et de la brave police, couplée à son mépris de classe pour ces 99% si facilement manipulables par le moindre fanatique, est franchement nauséabonde.

Histoire de la pacification, par Guillaume Trouillard pour Jef Klak.
Notes
| ↩1 | The Bat-man perd son trait d’union après trois mois de publication, mais conserve souvent sa particule. |
Traduction par Émilien Bernard
Ce texte du journaliste irakien Ghaith Abdul-Ahad, connu notamment pour ses reportages sur Al Qaeda, a été publié le 8 octobre 2015 dans la London Review of Books, sous le titre « Some tips for the long-distance traveler ». Il y raconte le trajet « ordinaire » des migrant-e-s, comme lui, venu-e-s d’Irak, de Syrie, d’Érythrée ou d’ailleurs, passant par la Turquie ou la Grèce, en route vers l’Europe du Nord. Autant de voyages que d’existences, avec leurs étapes singulières, leurs espoirs trahis et leurs rencontres anodines ou presque.

Un ami kurde résidant à Souleymaniye, au Nord de l’Irak, a récemment posté sur sa page Facebook la reproduction d’un schéma tracé à la main. Orné de petites flèches, de silhouettes humaines en bâtons, de dessins de trains et de bateaux, il détaille la manière de se rendre de l’Est de la Turquie à la frontière allemande en vingt étapes.
Une fois que vous avez effectué le trajet d’environ 1 600 kilomètres jusqu’à l’ouest de la Turquie, le voyage tel que représenté sur le dessin commence réellement, avec un taxi qui vous mène d’Izmir à la côte. Une flèche indique la prochaine étape : un bateau allant de la mer Égée à « une île grecque ». Cela vous coûte entre 950 et 1 200 euros. Un autre bateau vous conduit ensuite jusqu’à Athènes. Puis c’est à bord d’un train ressemblant à une chenille mutilée que vous vous rendez à Thessalonique. La marche, des bus et deux autres trains aux allures de chenille vous font traverser la Macédoine jusqu’à Skopje, puis la Serbie jusqu’à Belgrade. Une silhouette en bâton traverse ensuite à pied la frontière de la Hongrie, près de la ville de Szeged. Vient enfin le trajet jusqu’à Budapest en taxi, et un autre taxi à travers toute l’Autriche. En bas du schéma, une petite silhouette-bâton bondit en agitant un drapeau. Arrivée en Allemagne, elle salue Munich. Son périple de quasiment 5 000 kilomètres lui a pris environ trois semaines, pour un coût total de 2 400 dollars.
La question de la migration est au centre de quasiment toutes les conversations dans les cafés de Bagdad et Damas – de même que dans ceux des petites et grandes villes de Syrie, d’Irak et des environs. Ces débats se focalisent notamment sur les avantages et inconvénients des pays en matière d’aides sociales accordées aux migrants. Tout le monde se tient au courant des trajets les plus adaptés du moment. Dès qu’il y a de nouvelles informations et conseils de route, ils se répandent sur les réseaux sociaux – Viber, WhatsApp et Facebook. Ces temps-ci, un peu plus de 2 000 dollars et un smartphone suffisent à atteindre l’Europe. La situation diffère donc largement de celle qui avait cours à la fin des années 1990, notamment en Irak, quand les sanctions de l’ONU combinées à la dictature de Saddam empêchaient d’envisager l’exil, la survie quotidienne dépendant d’allocations du gouvernement et de maigres salaires étatiques. Très rares étaient ceux disposant d’une somme d’argent suffisante pour rejoindre l’Europe. Des dizaines de milliers de personnes quittèrent l’Irak, mais la plupart atterrirent dans la morne Amman, en Jordanie. Si beaucoup de gens parmi mes proches voulaient partir, la plupart ne purent le faire – par manque de moyens, de volonté ou simplement de chance.
Je fus l’un de ceux qui n’y parvinrent pas. J’avais passé un diplôme d’architecture et rêvais de continuer mes études à Vienne ou Beyrouth. Ou bien d’au moins décrocher un job alimentaire à Amman ou Dubaï. J’étais déserteur et n’avais donc aucun espoir d’obtenir un passeport. Ma seule solution pour quitter l’Irak était de me procurer des faux documents ou de trouver un passeur. J’ai essayé pendant trois ans, dépensant environ 3 000 dollars – une fortune, alors – donnés à un passeur. On m’a menti, trahi, et j’ai perdu tout l’argent que j’avais emprunté. Pendant neuf mois, j’ai vécu avec mes bagages bouclés, prêt à décamper. Chaque nuit, j’appelais le passeur, qui continuait à me mentir et à me dire que le jour d’après serait le bon. Finalement, j’ai abandonné, rangé mes affaires, et j’ai attendu pendant cinq autres années.
Pendant des décennies, le chemin qui menait hors de la guerre, de la destruction et de la pauvreté pour aboutir à une existence européenne sécurisée était un secret jalousement gardé : la propriété des passeurs et des mafias qui contrôlaient les routes et avaient le monopole du savoir nécessaire. Ils conduisaient leurs affaires illicites dans les cafés miteux des ruelles d’Aksaray, à Istanbul. Les migrants qui avaient eu la chance d’atteindre la Grèce pouvaient aussi les croiser dans le quartier d’Omonia, à Athènes. Ceux qui étaient parvenus jusque là étaient baladés d’un réseau à un autre. De nouveau, on leur mentait, on les manipulait. Après tout, ils n’avaient pas d’autre choix que de tendre leur argent en échange d’une promesse et d’un espoir.
Il y a toujours eu une poignée de migrants optant pour la mer Égée, mais jusqu’ici, cette route était peu empruntée. Non pas en raison d’eaux dangereuses ou de bateaux peu fiables, mais parce que la police grecque avait la réputation d’être brutale et parce qu’il était très compliqué d’obtenir l’asile à Athènes. Cette année, tout a changé. La poignée s’est transformée en marée quand le nouveau gouvernement Syriza a réécrit les règles. « Jusqu’alors, notre politique avait été de repousser les bateaux même si nous mettions des vies en danger », m’a confié un homme travaillant dans l’administration des gardes-côtes de Lesbos. « Avec ce nouveau gouvernement, c’est plutôt : “Laissez-les venir, et aidez-les s’ils en ont besoin.” » La Turquie fermant elle aussi les yeux sur le passage de migrants, les vieux réseaux de passeurs et les frontières de l’Europe ont plié sous la pression de dizaines de milliers de personnes. Les Syriens qui auparavant étaient déplacés au sein de la Jordanie, du Liban et de la Turquie ont été rejoints par des Irakiens – pour la plupart de jeunes Sunnites fuyant l’État islamique et les milices chiites –, ainsi que par un petit nombre d’Afghans, d’Érythréens et de Pakistanais, lesquels fuyaient leurs propres conflits. Tous étaient en quête de nouvelles routes, guidés par l’espoir de vies meilleures.
Les techniques de mobilisation utilisées au cours des révolutions arabes, rassemblant des milliers de manifestants en un lieu donné, sont désormais utilisées pour organiser ces nouvelles vagues de migration. Cet exode n’est plus seulement composé des plus misérables et piétinés – même si beaucoup le sont encore. C’est devenu un pèlerinage où prédominent les classes jeunes, éduquées et moyennes. La disparition des frontières européennes a provoqué l’ire de deux groupes de personnes, luttant pour restaurer l’ordre ancien : les passeurs et les dirigeants de l’Union européenne.
* *
*
À l’aube sur l’île de Lesbos, un petit homme aux cheveux gris gare sa moto sous un pin et s’assoit sur le rivage d’une plage de galets recouverte de gilets de sauvetage abandonnés – oranges, rouges et bleus. Des carcasses d’embarcations en caoutchouc gisent dans les environs. À l’horizon, de l’autre côté du détroit, les montagnes turques sont ternes : la journée s’annonce couverte. L’homme vient tous les jours sur la plage. Il prend place et attend que les migrants arrivent. De temps en temps, il scanne l’horizon avec une paire de vieilles jumelles militaires pendues à son cou. Deux de ses amis boivent du café sur une table qu’ils ont installée un peu en retrait. Ce sont tous des pêcheurs, à l’origine. Comme beaucoup d’autres sur l’île, ils se sont transformés en charognards, dépouillant les moteurs des embarcations. La loi de la mer stipule que vous pouvez conserver ce qu’elle rejette.
« Parfois, ils leur refilent de mauvais moteurs chinois », explique l’homme, désappointé. Non pas qu’il s’inquiète pour la sécurité des migrants, mais la valeur à la revente de ces trouvailles est moindre. Pour ces trois hommes, les migrants sont des « pouilleux dégoûtants » venus de « l’autre côté », mais appâtés par un bon moteur hors-bord à 200 euros, ils seront ravis de former une sorte de comité d’accueil pour les nouveaux arrivants. Dans le sillage de ces exodes à répétition fleurissent en effet divers business. À Karaköy, vieille zone portuaire d’Istanbul, des échoppes en plein air qui jusqu’à récemment vivaient de la vente de quelques cannes à pêches se refont soudain une santé économique pétaradante en se livrant au trafic de gilets de sauvetage et de moteurs pour petits canots.
Alors que le soleil grimpe dans le ciel, quatre points apparaissent à l’horizon, en provenance de la côte turque. Ils sont disposés à intervalles réguliers et l’opération semble conduite avec une rigueur presque militaire. Les points finissent par se transformer en bateaux. Trois d’entre eux cinglent vers l’est, tandis que le dernier prend en droite ligne la direction du rivage où les trois pêcheurs sont positionnés. Même un seul moteur, ce n’est pas à négliger. La matinée vient seulement de commencer. Qui sait combien d’autres vont atterrir ici avant la fin de la journée ? Une heure plus tard le bateau semble ne pas avoir bougé. « Quelque chose déconne », dit l’homme à ses amis. Grâce à ses jumelles, il peut détecter des points bleus et rouges, ainsi que des bras désespérément agités. « Le moteur est foutu », lâche-t-il.
Les trois hommes sautent sur la moto et décampent en direction des bateaux qui ont mis le cap sur l’est. Le temps qu’ils y parviennent, une longue file de personnes – hommes ployant sous leurs sacs à dos, femmes portant et traînant des enfants – a escaladé les falaises et fait son entrée dans un village en surplomb. Ils sont une centaine, voire un peu plus – la cargaison de trois bateaux. Le quatrième est pour sa part escorté jusqu’au rivage par les gardes-côtes grecs. Les hommes, femmes et enfants remplissent les rues du village, prenant pied sur les trottoirs, se reposant dans l’herbe, détonant dans le paysage. Finalement, ils rassemblent leurs possessions et commencent à marcher vers Mytilène, principale ville de Lesbos, où les migrants doivent s’enregistrer avant d’être conduits à Athènes.
La longue marche vers l’Europe a commencé. La caravane est un véritable patchwork ethnique – Afghans, Arabes, Kurdes. Tous progressent le long de la piste. La disposition des groupes évolue, selon que certains décident de se reposer, ou bien au contraire de repartir. Par moments, les marcheurs s’étalent sur un kilomètre. À d’autres, ils avancent de front, regroupés, intimidant alors les touristes et les locaux.
En chemin, ils croisent un autre groupe de marcheurs, voyageant dans la direction opposée. Arrivant de la ville et se dirigeant vers la nature sauvage, ce groupe est composé de retraités européens – allemands et britanniques. Eux sont vêtus de vêtements de randonnée clinquants, de grosses chaussures et de t-shirts. Ils ont l’air anxieux. En face viennent les migrants, en route pour la ville, nombre d’entre eux quittant leur pays pour la première fois. Ils sont exténués suite à la longue traversée, mais également de bonne humeur. Ils évoquent leurs plans pour les jours à venir et n’ont pas le temps d’admirer le panorama. « Si j’étais un touriste, ç’aurait été un endroit parfait à visiter », lâche un homme qui voyage avec sa fille, alors qu’ils traversent un autre village pittoresque, entouré de champs de cerisiers. « Peut-être qu’un jour nous reviendrons avec ton frère et ta sœur. »
Il s’appelle Khaled. Il a des yeux tristes et ses cheveux trop tôt blanchis sont coupés courts. Il ne semble pas très rassuré concernant ce voyage et n’arrête pas de demander à sa fille si elle tient le coup. Cette dernière doit avoir 12 ans. Si elle répond rarement, elle ne semble pas aussi perdue que lui. Elle se contente juste d’avancer. Tous deux se sont joints à un groupe de Syriens, mais ils ne s’assoient pas avec eux et marchent quelques pas en retrait. Il explique qu’ils souhaitent rallier le Danemark, où vit son beau-frère. Il parle avec un accent irakien marqué, mais dit venir d’Al Mayadin, bourgade syrienne proche de la frontière irakienne. Lui et sa famille ont fui après que l’État islamique a pris le contrôle de sa ville natale plus tôt dans l’année, mais il est mal à l’aise quand il s’agit d’évoquer la situation là-bas. Sa femme, son fils et une autre fille sont toujours en Turquie.
Il est interdit de transporter les « illégaux » sur les îles grecques. Bus et taxis leur sont également interdits. Tout local les transportant est passible d’une amende. Ils doivent donc marcher quarante kilomètres pour rejoindre les centres d’enregistrement. Quand une Grecque, grande et blonde, s’arrête pour proposer de transporter Khaled et sa fille, il jette un œil penaud sur le groupe de Syriens et déclare : « On est arrivés ensemble, ce serait une honte de les abandonner. Nous continuons avec eux. » Après une nouvelle heure à progresser sous le soleil, la jeune fille semble encore plus fatiguée, si bien qu’il finit par accepter quand la femme grecque réitère sa proposition. Dans la voiture, il se montre plus volubile. Il demande à sa fille de sortir son Kindle, ce qu’elle fait avant de montrer à la femme quelques images du reste de la famille.
La police contrôle les entrées du port de Mytilène. L’après-midi commence et des centaines de migrants font la queue. Beaucoup sont là depuis la nuit précédente. Ceux qui ont débarqué ce matin avec Khaled n’arriveront pas avant la tombée du soleil. Les autres s’organisent. Ici, un Libyen et ses cinq enfants ont construit une maison entre deux voitures. Deux douzaines de Somaliens et d’Afghans sont installés près de l’eau. Chaque personne doit d’abord être enregistrée avant d’être convoyée dans un terrain de jeu désaffecté, où commence l’attente du transfert à Athènes.
La femme grecque fend la foule pour se frayer un passage jusqu’au barrage policier. Elle revient quelques minutes plus tard pour emmener Khaled et sa fille à l’intérieur, où une docteure de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), organisme affilié à l’ONU, inspecte l’enfant. Italienne d’une cinquantaine d’années, la soignante est habituée aux situations de crise, mais quelque chose dans la manière dont le père agrippe la main de sa fille la fait fondre en larmes. Elle demande le passeport du père, afin qu’elle puisse activer la procédure. Il se fige, avant de déclarer qu’ils n’ont pas de passeports.
« Vous êtes syrien, c’est bien ça ? »
« Oui. »
« Dans ce cas, ça ne prendra pas longtemps. »
La Grecque leur serre la main et les laisse à l’intérieur.
Peu après, Khaled ressort de nouveau et lui fait signe.
« Je suis désolé », lâche-t-il.
« Que s’est-il passé ? »
« Je vous ai menti. Je suis irakien, pas syrien. Ma fille m’a dit que c’était une mauvaise chose de mentir aux gens qui nous aident. J’étais terrifié. Nous sommes chiites, et les Syriens avec qui on voyageait étaient tous sunnites. Je suis désolé. »
Le mensonge du père est pourtant on ne peut plus logique. Les bagarres entre groupes ethniques différents ne sont pas rares. Et il y a une autre raison : les Syriens ont droit à un traitement préférentiel en de nombreux endroits. En Grèce, par exemple, ils peuvent rester plus longtemps dans le pays après avoir reçu leurs papiers – quatre mois, contre un mois pour un Afghan.
La femme blonde qui les a transportés appartient à un petit groupe de gens travaillant à contourner la bureaucratie européenne. Ils se rencontrent dans une pièce située au rez-de-chaussée d’un bâtiment en construction, dans un village des environs de Mytilène. Parmi eux, il y a une fleuriste dépensant son salaire en essence pour transporter femmes et enfants le long des collines jusqu’à la ville ; deux docteurs s’étant portés volontaires pour traiter les nouveaux arrivants le matin sur les plages et les transporter secrètement à Mytilène la nuit ; un fonctionnaire des gardes-côtes travaillant la journée au principal centre d’accueil. Le soir venu, quand il ne joue pas au volley mais quitte sa maison pour aider les migrants. Le leader du collectif est un prêtre imposant, doté d’une barbe blanche lui arrivant à la poitrine. Le Père Papastratis se déplace en traînant une bouteille d’oxygène et des tubes sortent de ses narines. Il a 58 ans mais en paraît 70. Ses poumons sont en piètre état et il a déjà eu deux attaques. Quand son fils n’est pas dans les environs, il en profite pour fumer une cigarette.
Bien avant que certains habitants de Budapest et Vienne ne commencent à faire des dons de nourriture et d’habits aux réfugiés, et tandis que les autorités locales cherchaient encore comment réagir, ce groupe de six faisait tourner un centre d’accueil non officiel, procurant de la nourriture, un toit et une assistance médicale aux nouveaux arrivants. La fleuriste m’explique que beaucoup d’habitants de l’île sont des descendants de réfugiés chassés de Turquie des décennies plus tôt. Elle me raconte ceci alors qu’elle est au volant de sa Renault et descend la route des collines en compagnie d’une autre famille. Sur le siège arrière, une mère ferme les yeux et s’endort, un enfant sur les genoux. À ses côtés, trois autres enfants, de 9 à 14 ans. Elle les conduit au centre d’accueil du Père Papastratis. Là, un homme décharge une voiture remplie de marmites, d’une cuisinière et de sacs de pâtes. Il installe une cuisine mobile tandis que la pièce se remplit. Costas est un anarchiste qui a nourri les sans-abris d’Athènes pendant deux ans. Drôle d’attelage : un anarchiste et un prêtre orthodoxe…
Contrairement au bâtiment du Père Papastratis, le centre d’accueil géré par le gouvernement sur le terrain de jeu abandonné est un endroit horrible. Il y a des ordures partout. Des bagarres éclatent entre Syriens, Afghans et Somaliens. Deux Érythréennes se plaignent de harcèlement sexuel. Le fonctionnaire des garde-côtes – par ailleurs fils aîné du prêtre – se tient au milieu d’une foule multipliant les demandes. Une famille syrienne dont la mère souffre du cancer, deux Afghans se plaignant du fait que des Syriens ne les laissent pas recharger leurs téléphones, une femme afghane expliquant que son enfant a besoin de médicaments contre la diarrhée… Tout le monde veut savoir quand il sera possible de quitter l’île. « Pourquoi est-ce que vous nous traitez comme ça ? », demande quelqu’un. « Qu’est-ce que je peux faire ? », m’explique l’homme plus tard. « Ils veulent que je sois leur mère, leur ami, leur psychologue, et je suis juste un garde-côte. C’est de la folie. Que l’Union européenne aille se faire foutre. »
* *
*
S’ils s’en tiennent à la route tracée par le schéma, la plupart des migrants s’arrêteront brièvement à Athènes, puis continueront leur voyage via Thessalonique. Là, ils feront six heures de marche entre la gare et la frontière macédonienne. Sur la route, à côté d’une station-service déserte (l’essence est moins chère de l’autre côté de la frontière), se trouve un motel. On peut s’y reposer, acheter des provisions et recharger les téléphones. Il est probable que les deux étages du bâtiment aient été par le passé aussi désertés que la station-service, mais c’est désormais un véritable caravansérail des temps modernes. Le hall déborde de piles de boîtes de conserve, de paires de baskets, de sacs à dos et de bouteilles d’eau, le tout à des prix prohibitifs. Deux vieux Grecs servent à la louche un plat de haricots et de riz – 10 euros l’assiette. Le moindre recoin est occupé – pas une chaise ni une table de libre. Un groupe de Syriens papote en fumant. À côté d’eux, une pleine table d’Érythréens boit de la bière en silence. Le patron du motel arpente les lieux en hurlant ses ordres d’une voix rageuse, se comportant comme s’il gérait un établissement haut-de-gamme, envahi non pas par des clients mais par de la vermine. Le business est si juteux que dans le voisinage les tavernes et lieux disposant de chambres à louer affichent tous des pancartes rédigées en arabe, dans l’espoir d’attirer une partie de la nouvelle clientèle. La plupart des migrants ont de l’argent à dépenser et font peu attention aux prix. Ils sont venus avec quelques milliers d’euros, du cash provenant de la vente de leur maison et de leur voiture. Se voir facturer cinq euros pour une canette de Coca leur semble une exploitation triviale comparée au millier d’euros environ que chacun d’eux a dû payer pour une traversée sur bateau pneumatique. Laquelle leur aurait coûté quinze euros en ferry.
Depuis le motel, les migrants suivent une piste serpentant dans les champs. Des milliers de personnes les ont précédés, si bien que la terre est très tassée. Des femmes portant voiles et jupes longues se déplacent avec précaution, guidant leurs enfants. Derrière elles, il y a un groupe de hipsters syriens arborant des panamas et des t-shirts. Des diplômés des universités de Homs et Damas. L’un d’eux est un ingénieur réseau ayant prévu de se rendre en Angleterre. Plus loin se trouve un Somalien affublé d’un chapeau de cow-boy, d’un pantalon de cuir et d’un collier. Il est complètement défoncé au haschisch et communique en anglais de rappeur gangsta.
Il y a également une famille syrienne : père, mère et trois petites filles. Le père, Bassem, porte la plus jeune d’entre elles sur ses épaules. Par le passé, c’était un marchand fortuné des environs de Damas. Sa famille possédait un grand nombre de terres agricoles. En 2011, quand la révolution a éclaté, il a utilisé son argent pour financer les insurgés et a été commandant dans la guerre civile qui a suivi. « J’ai dépensé 300 000 dollars en armes et munitions, dit-il, et j’ai perdu beaucoup d’amis. Je regrette de m’être ainsi impliqué. » Quand sa zone de combat a été encerclée, il s’est envolé pour la Vallée de Bekaa, au Liban. Il souhaitait y faire profil bas, mais a vite eu des ennuis avec le Hezbollah. Son frère a été jeté en prison, tandis que lui échappait de peu à la capture. Du Liban, il s’est rendu en Turquie, où un camarade révolutionnaire et passeur lui a promis de les mettre lui et sa famille dans un ferry pour l’Italie contre 10 000 euros. Le camarade a pris l’argent et a disparu. De toutes les sommes d’argent qu’il a perdues, dit-il, c’est celle-là qui lui fait le plus mal. Il parle calmement, sans amertume. En revanche, il se dit honteux d’avoir vendu les bijoux de sa femme pour échouer ici, où ses filles dorment dans des champs.
La police grecque a abandonné l’idée de faire barrage à la frontière, ayant appris qu’il convient de laisser s’écouler le flot de migrants aussi rapidement que possible. Après tout, personne ne souhaite rester en Grèce. Il faudra encore quelques semaines à la Macédoine pour en arriver au même constat. Si bien que pour ce groupe de migrants, la route est bloquée un peu plus loin par une Land Rover et cinq policiers macédoniens. Quelques centaines de personnes doivent donc sillonner les environs de la voie ferrée afin de trouver un endroit où passer la nuit. Certains installent leurs sacs de couchage sous un pont, d’autres improvisent des tentes faites de bâches en plastique et de bâtons. Au matin, alors qu’arrivent d’autres personnes (des femmes de Sierra Leone, un Yéménite en chaise roulante, beaucoup d’autres Syriens et Irakiens) et que le campement improvisé se fait village, quelques éclaireurs arpentent la frontière pour trouver un passage sûr. À droite de la police se trouve une rivière – infranchissable. À sa gauche, des collines réputées pleines de bandits réclamant à toute personne un droit de passage de 200 euros – ils auraient « acheté » la zone. Deux jeunes Kurdes qui ont combattu à Kobané s’en approchent pour trouver un passage. À un coude du chemin, juste avant un poste de police grecque abandonné, l’un d’eux repère un chemin menant à la Macédoine à travers les buissons. Le mot tourne : une voie a été trouvée.
Un heure plus tard, une colonne de migrants s’avance dans les champs de tournesols menant aux collines. La tristesse du matin a laissé place à l’exaltation. Les garçons kurdes aident tout le monde à progresser dans les buissons, puis grimpent sur la crête pour observer la police macédonienne en-dessous, tout en roulant et fumant des cigarettes. Deux équipes de police prennent la relève, tandis qu’un chien est amené sur place. L’un des garçons finit par faire une suggestion : « Pourquoi ne pas se disposer en ligne et courir jusqu’à la frontière ? » L’idée de prendre d’assaut une frontière internationale semble insensée à de nombreux réfugiés, notamment les plus âgés, mais il n’y a pas d’autre issue. Quand la nuit tombe, toute la troupe se rue au bas des collines jusqu’à la Macédoine.
Ensuite, il s’agit de descendre jusqu’à Gevgelija, ville la plus proche. Là, dans un absurde retournement de situation, la police macédonienne enregistre poliment chaque migrant et lui donne les papiers nécessaires pour se déplacer librement dans le pays. Plus loin, je tombe sur les hipsters syriens à la station de bus. Ils parlent avec excitation et consultent Google Maps sur leurs téléphones. « Prochain arrêt, Skopje », lance l’un d’eux. Ils ont prévu toute la route à venir : la Serbie, la Hongrie et l’Autriche. L’un d’eux pense se rendre au Danemark. Ils en sont convaincus : cela ne prendra pas beaucoup de temps.
* *
*
Plus tard, je rencontre des migrants à Lojane, village habité en grande partie par des Albanais, situé à la frontière Macédoine/Serbie. Ils se regroupent et tentent de trouver le moyen de traverser une autre frontière internationale. Un nouveau jeu du chat et de la souris avec la police. Cette fois, les conditions sont plus rudes. La rumeur dit qu’il est dangereux de flâner. La place du village est vide, à l’exception d’un fermier vendant melons et tomates sur un étal, ainsi que trois hommes âgés à caquettes noires assis sur un banc. Une famille fait ensuite son apparition sur la place, le père portant un enfant et la mère tenant la main de deux petits garçons. Ils marchent rapidement sur les pas d’un adolescent, un Arabe qui ouvre la voie. Ils empruntent une rue de traverse qui vire vite à la piste, et croisent une Audi rouge sombre sans plaques d’immatriculation stationnée en bordure de route. Les quatre hommes à l’intérieur les regardent passer. La famille s’engage dans les bois bordant la Serbie, avant de disparaître à un tournant de la piste. C’est seulement quand je vois une autre famille les suivre que je comprends : les nouveaux venus sont guidés par des migrants qui les ont précédés, des gens qui connaissent les astuces de la frontière et sont rémunérés pour la faire traverser en toute sécurité. Mais les vieux réseaux de passeurs sont encore à l’affût, prêts à ré-émerger au moindre signe de contrôles frontaliers plus serrés et à s’engraisser de nouveau sur le dos de ces migrants adeptes du do it yourself.
* *
*
Tous les passeurs ne se cantonnent pas aux pistes paumées traversant les frontières. Nabil est un Suédo-Irakien particulièrement doué pour le marketing. Son boulot est devenu plus difficile récemment : qui a besoin d’un passeur s’il est possible de tracer sa propre voie vers l’Europe ? Il a pris la décision de se focaliser pour des clients plus exigeants, ceux qui souhaitent éviter à leur famille les difficultés d’une longue marche à travers les Balkans.
Je le rencontre dans le hall d’un hôtel de Bagdad, feignant d’avoir besoin de ses services. Ses cheveux couverts de gel sont teints en noir de jais. Il porte une chemise bleue à pois blancs. Une paire de Ray-Ban à son cou. Il a un jour raconté à l’un de mes amis qu’il s’habille à l’européenne pour impressionner ses clients.
« Vous ne voulez pas vous humilier en traversant l’Europe à pied, c’est bien ça ? me lance-t-il, en vendeur expérimenté. Vous préférez sans doute une stratégie vous garantissant d’obtenir un passeport suédois dans les deux ans ? » Pour une somme de 40 000 dollars, il dit pouvoir arranger un mariage avec l’une de ses amies de Malmö. « Il faudra lui donner 10 000 dollars d’avance. » Le mariage serait organisé à Bagdad, des photographies immortalisant l’instant. « Une fois que vous obtenez votre visa, garanti par un contact à l’ambassade de Suède d’un pays voisin, vous payez 15 000 dollars. Une fois en Suède, vous vous installez et vous n’avez plus à vous inquiéter. Le gouvernement vous donnera une maison et un salaire. Vous vous posez et vous attendez, jusqu’à ce qu’il vous offrent un passeport, dans un an ou deux. »
« Qu’est-ce qu’il se passe si je vous donne l’argent et que je n’obtiens pas le passeport ? »
« Je vous garantis que vous l’aurez. Je l’ai déjà fait pour des tas de gens. »
« Et si je donne l’argent à votre amie et qu’elle ne se pointe pas au mariage ? »
« Je suis votre garant », m’assure-t-il.
Il ajoute qu’il existe une option moins onéreuse, qui peut être arrangée via un réseau d’agents corrompus dans les ambassades européennes de Bagdad. Apparemment, celles d’Italie et de Pologne sont les plus faciles à soudoyer. « On peut vous obtenir un visa Schengen de cette manière, mais on ne peut pas vous garantir que vous aurez le passeport par la suite. » Le visa louche me coûterait seulement 18 000 dollars.
Image de Une :
Doris Bittar, Secured States : The Arab World
Il y a 30 ans, le 19 décembre 1985, Georges Courtois, Karim Khalki et Patrick Thiolet prenaient la cour d’assises du Tribunal de Nantes en otage. Revolvers et grenades au poing, ils convoquent les caméras de FR3 pour renverser la vapeur : pendant 34 heures, au lieu d’être condamnés ce jour pour de petits braquages, ils font en direct à la télévision le procès de la société carcérale dans laquelle ils se trouvent piégés.
Préférant la prison pour un mot juste qu’une liberté à demi-mot, Georges Courtois a passé plus de la moitié de sa vie enfermé. Il raconte ici son parcours de malfaiteur professionnel et d’homme de lettres malicieux.
Dernière et triste évasion. Dans la nuit du 16 au 17 mars 2019, dans son appartement de Quimperlé, Georges Courtois est parti dans les flammes. Le carnaval est terminé, adieu canaille. read more…
Traduction par Émilien Bernard
Texte original publié par le Brooklyn rail, juin 2015
Le 19 avril 2015, à Baltimore, Freddie Gray, Africain-Américain de 25 ans, meurt suite à de lourdes blessures perpétrées par la police lors d’une arrestation musclée. S’ensuit alors plusieurs jours d’émeutes et de pillages dans les quartiers pauvres de la ville, tandis que l’élite gouvernante noire de Baltimore décrète un couvre-feu et appelle la Garde nationale pour rétablir l’ordre. Corruption de la police, infiltration des gangs dans les institutions publiques, ou encore désagrégation du tissu social des quartiers pauvres… Curtis Price, travailleur social initiateur de Street Voice, journal de rue gratuit écrit par les marginaux de Baltimore dans les années 19901 Sélection de textes traduits en français aux éditions Verticales/Gallimard, 2003 : Street voice, paroles de l’ombre., détaille les différents ressorts de cette explosion sociale sans précédant depuis les émeutes de Los Angeles de 1992.
Note du traducteur : Le titre original de cet article de Curtis Price « Baltimore’s ‘Fire Next time’ » fait référence à un ouvrage du romancier noir américain James Baldwin, intitulé Fire Next Time (1963). En VF : La Prochaine fois, le feu. Dans cet ouvrage, Baldwin analysait les mécanismes de la discrimination raciale aux États-Unis, interrogeant notamment le rôle de la police, de l’Église et de l’école dans la perpétuation des mentalités et comportements racistes. Une approche que Curtis Price reprend ici à son compte, disséquant les divers détonateurs sociaux à l’œuvre dans le déclenchement des émeutes d’avril 2015 à Baltimore.
Le 27 avril 2015, Baltimore est entrée en éruption. La pire émeute urbaine frappant une grande ville des États-Unis depuis celle de Los Angeles en 1992. De nombreux bâtiments ont été pillés, d’autres brûlés. Le nombre d’immeubles en flammes a été si important que la ville a dû réquisitionner les casernes de pompiers des comtés environnants. Le gouverneur du Maryland a fait appel à la Garde nationale, tandis que le maire de Baltimore a mis en place un couvre-feu nocturne de cinq jours.
Si les origines et le déroulement des émeutes ont quelque chose de familier, on y trouve également des aspects inédits par rapport à celles de 1992 à Los Angeles. Dans West Baltimore, épicentre de l’émeute, les taux de mortalité infantile égalent ceux du Belize ou de la Moldavie (selon une étude de la Johns Hopkins School of Public Health[2. Voir cet article de Dan Diamond publié en 2015 : « Why Baltimore Burned ».]). Concernant l’espérance de vie, il existe un fossé de vingt ans entre les zones les plus riches de la ville et les plus pauvres[3. Ibid. ]. C’est dans cette misère sociale que s’est enracinée une économie de la drogue violente et florissante.
Pendant des années, le trafic de drogue se réduisait à la rivalité des gangs locaux s’affrontant pour des territoires. Mais au cours de la dernière décennie, ce commerce s’est structuré, avec l’irruption de cartels plus grands et ambitieux. La Black Guerrilla Family – ainsi nommée en référence à un obscur groupe nationaliste noir des années 1970 implanté dans les prisons californiennes – a par exemple mis en place une stratégie d’organisation élaborée, impliquant des groupes infiltrés au cœur des collectifs d’actions communautaires, au plus près de la rue. Elle a également publié un manifeste de développement personnel pour entrepreneurs qui a bénéficié de l’approbation publique de certains fonctionnaires haut-placés dans l’administration scolaire (dont celle d’un ancien candidat à la mairie) – lesquels n’étaient pas au courant de son lien avec les gangs[4. Voir cet article de Fenton J. et Neufeld S., publié dans le Baltimore sun en 2009 : « Educators endorse Black Guerrilla Family gang leader’s book ».].

Il fut même un temps où la BGF (ainsi qu’on l’appelle dans les quartiers pauvres) avait pris le contrôle de la prison municipale, le Baltimore City Detention Center, enrôlant les agents pénitentiaires pour y faire entrer drogue, téléphones portables et argent. Au point que l’un des principaux dirigeants de la BGF avait mis enceinte deux surveillantes du centre de détention, lesquelles se sont tatouées son nom sur le bras. Depuis, le centre de détention a fait l’objet d’une intervention policière, le contrôle a été rétabli, mais l’épisode montre l’étonnante efficacité et l’ambition du BGF. (Je connais une femme qui travaillait au département médical d’admission de la prison pendant la prise de contrôle du BGF. Elle a pris conscience qu’il s’y tramait quelque chose quand elle s’est rendu compte de la présence parmi les détenus de soi-disant SDF, lesquels étaient en fait des agents de police infiltrés. Elle les démasquait aisément : même si leurs habits étaient sales et usés, leurs chaussettes étaient toujours propres)[5. Voir « How a Gang Called the Black Guerrilla Family Took Over Baltimore’s Jails », Peters, J., 2013, Slate. ].
La police et les gangs se livrant au trafic de drogue entretiennent une relation fusionnelle. Pour la première, les seconds sont devenus un moyen de réclamer plus de financement, de moyens d’intervention et d’autorité. De leur côté, les gangs utilisent la police pour « balancer » des rivaux et s’approprier des marchés à leurs dépens. La corruption est très répandue dans la police et beaucoup d’officiers touchent des pots de vins. Certains vendent même de la drogue.
La brutalité policière est une autre réalité quotidienne. La ville a dû payer 5,7 millions de dollars de réparation aux victimes pour la seule période 2011-2014. Et cela n’est probablement que la partie émergée de l’iceberg, étant donné que nombreux sont ceux qui ne possèdent ni les ressources financières ni la persévérance nécessaires pour se lancer dans une bataille judiciaire contre un système que beaucoup considèrent – avec raison – comme leur étant totalement défavorable. Parmi les victimes, on trouve entre autres une grand-mère de 87 ans qui s’est fait déboîter l’épaule quand le flic qui l’arrêtait l’a balancé à terre[6. « The Brutality of Police Culture in Baltimore », Friedersdorf C., 2015, the Atlantic. ]. Entre juin 2012 et avril 2015, le personnel médical de la prison municipale de Baltimore a refusé d’admettre en son sein 2 600 personnes parce que leurs blessures ou maladies étaient trop graves pour être traitées en prison. Il est vrai que la plupart des problèmes de santé relevés préexistaient avant l’arrestation. Mais 123 de ces cas impliquaient un traumatisme crânien, signe indiquant généralement une arrestation mouvementée par la police[7. « Baltimore city jail refused to admit nearly 2,600 injured suspects, casting doubt on police tactics: report », New York Daily News, 2015. ].
Le niveau de violence frappant les rues a quant à lui atteint des proportions inquiétantes. Bousculer accidentellement quelqu’un sur un trottoir peut valoir de recevoir une balle dans la tête. Les fusillades ont affecté quasiment toutes les familles noires des quartiers pauvres de Baltimore, et même certaines en dehors de ces ghettos. D’ailleurs, aussi bien la maire de Baltimore (Stephanie Rawlings-Blake) que le président du City Council (Bernard « Jack » » Young) ont eu certains de leurs proches abattus dans la rue[8. Voir cet article de J. Boradwater & Fenton, « Mayor’s Cousin Fatally Shot », publié en 2013 dans le Baltimore Sun. ].
Tout le monde assiste à ces fusillades, mais plus personne n’est là quand il s’agit de témoigner ou d’identifier les tireurs. La raison en est à la fois compliquée et facilement compréhensible. Vous n’avez pas seulement à vous inquiéter des représailles – ce qui n’est au demeurant pas une crainte vaine, comme l’a montré l’attaque aux bombes incendiaires menée contre la famille Dawson sur East Preston Street, qui a fait sept victimes, parce que la mère avait pris position contre le trafic de drogue dans son voisinage –, il vous faut également vous méfier de la police. Difficile en effet de savoir quel flic est corrompu et fera tourner votre nom auprès du gang. Les rumeurs règnent dans les rues de Baltimore, certaines erronées et d’autres véridiques. Dans l’ombre, prolifèrent des individus ayant tout intérêt à promouvoir la désinformation. Comment deviner ce qui est vrai et ce qui est « du flan » ?

Il résulte de tout cela une méfiance généralisée et justifiée envers la police. Cette dernière interprète en retour le refus de collaborer des résidents comme de la complicité. Traitant chaque habitant comme un potentiel ennemi, les flics en viennent, dans des zones comme West Baltimore, à agir de la même manière que les troupes américaines au Vietnam s’attaquant aux hameaux villageois : tout le monde est un Viet-Cong potentiel. L’adoption par la ville d’une politique de tolérance zéro et les décennies de ratages concernant la guerre à la drogue n’ont fait que jeter de l’huile sur le feu. Car une arrestation n’a pas seulement des conséquences à court terme – votre dignité s’en trouve niée –, mais implique également des effets sur le long terme, notamment la difficulté à se faire embaucher dans de nombreux boulots, surtout dans le secteur des services.
Or le rejet cinglant et mérité de la police n’est qu’un aspect du déficit généralisé de confiance sociale, qui agit comme un mécanisme à la fois de survie et de défense. Il se dresse contre toute forme d’action politique ou collective au sens traditionnel du terme – même les approches les plus gauchistes. Au quotidien, cette défiance se manifeste sous une forme pernicieuse. Une femme avec laquelle j’ai travaillé refusait par exemple de faire des dépôts directs à la banque, parce qu’elle n’était pas sûre qu’« ils » n’allaient pas tenter de la voler. Elle préférait la sécurité d’un chèque. Dans mon boulot actuel, les émissions les plus populaires auprès des femmes africaines-américaines d’âge moyen sont les « documentaires » sur des crimes réels, telles que la bien nommé « Crains tes voisins », qui met en scène des crimes impliquant des personnes proches des victimes : l’amant qui se transforme en tueur sans prévenir, les voisins qui sont en fait des tueurs et violeurs en série, le pasteur marié depuis des lustres qui vole son église pour financer l’addiction au crack d’une petite amie adolescente… Tout cela a été bien résumé par une femme que j’ai un jour entendu dans le métro s’écrier avec angoisse et à tue-tête : « Ta famille te baisera encore plus que tes amis ».
La mort frappe souvent de manière aléatoire dans la rue. Cela permet également d’expliquer en partie l’explosion de colère concernant les cas de brutalités policières. Évoquant le taux de meurtres très élevé à Wilmington dans un entretien au Wall Street Journal, Hanifa Shabazz, porte-parole du Delaware City Council a en ce sens affirmé que « vous ne savez savez jamais ce qui risque de vous arriver ou qui sera la prochaine victime[9. Voir « Delaware’s Biggest City Struggles With High Murder Rate » de S. Calvert, 2015, Wall Street Journal. ] ». Au moins, avec la police, vous savez qui blâmer, tandis que lors des fusillades liées à la drogue dans les quartiers pauvres, on ne sait pas contre qui se retourner. C’est ainsi que les protestations contre la brutalité policière sont devenues de facto des soulèvements contre un mode de vie dans son ensemble. C’est l’une des nombreuses réalités cachées derrières les émeutes de Baltimore.

Pour les plus jeunes, les pressions sociales montent d’un cran. Les reality shows diffusés sur BET et VH1 mettent en scène la fabuleuse richesse des magnats du hip-hop tels que Kanye West et Rick Ross, avec leurs divers palaces et voitures de luxe, leurs nuits dans les clubs de strip-tease d’Atlanta, le cognac coulant à flot, tout un monde de biens matériels et de plaisirs sans fin qui ne seront jamais accessibles à West Baltimore, même dans un millénaire.
West Baltimore est bondé de jeunes aspirants rappeurs, vendant leurs CD faits maison aux coins des rues, concoctant leurs mix tapes dans la cave de leur grand-mère, dealant un peu d’herbe ou de coke à côté, espérant le grand succès. Leur situation n’a rien à voir avec celle de la génération précédente, où si tu ne pouvais pas chanter comme David Ruffin, tu te rangeais en te tournant vers un boulot monotone et bien payé à l’usine Chrysler. Via la démocratisation de la technologie musicale, le hip-hop a transformé toute personne dotée du bon flow et des breaks adaptés en star potentielle. Il n’y a après tout pas grand-chose séparant les capacités d’un Puff Diddy ou d’un Jay Z de celles de n’importe quel môme de West Baltimore.
Par ailleurs, tout le monde sait qu’il n’y a plus de jobs type Chrysler disponibles, mais juste des emplois précaires, dégradants et mal payés – serveurs dans un fast-food ou employé dans un hôtel pour riches touristes. Et puisque vous ne vous imaginez pas dépasser les 25 ans, il semble plus logique de vouloir tout vivre, tout de suite. Les émeutes de Baltimore n’étaient pas simplement celles de l’armée de réserve des travailleurs. Elles étaient tout autant, voire plus, les émeutes de l’armée de réserve des consommateurs – selon l’expression poignante d’un criminologiste britannique.
Cette omniprésence de la consommation et des marques a un effet contradictoire. D’un côté, elle met à jour le désir, évidemment perverti, d’obtenir davantage de la vie. D’un autre côté, elle implique une privatisation de ce même désir. L’identité disparaît devant le désir de possession – le reste n’existe plus. Ce désir de possession devient partie prenante d’une lutte pour la survie et le succès. Tout gauchiste estimant que les pillages sont le signe d’une attaque en règle contre la propriété privée serait rapidement désenchanté s’il tentait de reprendre les marchandises volées des mains d’un pilleur.
Les demandes de la gauche concernant le chômage et la réouverture des centres de loisir (beaucoup de ceux de Baltimore ont été fermés ou vendus il y a quelques années) où les mômes peuvent jouer au ping-pong et aux jeux vidéos manquent malheureusement leur cible. Oui, la pauvreté et le chômage jouent bien un rôle majeur. Mais ces facteurs matériels passent par le filtre de rêves et d’espoirs qui ne seraient même pas satisfaits si un boulot à 25 $ de l’heure avec de bons avantages tombait du ciel. Cette impatience et cette insatisfaction pavent la voie à de futurs conflits, lesquels pourraient se conclure par d’autres troubles dans les rues. Ou bien tout aussi facilement dégénérer en rixes éclair entre East et West Baltimore dans la zone portuaire.
Les plus âgés ont recours à diverses lectures de la situation. N’importe quelle personne d’âge mûr se souvient de la dévastation engendrée par les émeutes de 1968, et de la décennie de désengagement qui a frappé Pennsylvania Avenue, W. Baltimore Street et Gay Street dans l’East Side, avec ces devantures qui restaient calcinées ou barricadées de planches, et qui, pour certaines d’entre elles, le sont toujours. Si vous êtes encore plus vieux, vous vous souvenez de l’époque où Pennsylvania Avenue et la 125th Street abritaient des hauts lieux de culture luxueux, tels que le Royal Theater où se produisaient des acteurs comme Moms Mabley, Redd Foxx et Pigmeat Markham. D’autres se rappellent de leur père, qui travaillait sur les fours à charbon de Bethlehem Steel, la tâche la plus salissante et dangereuse de Sparrows Point, réservée aux travailleurs noirs : il se rendait toujours au travail en costume-cravate, pour préserver sa dignité. Bref, pour les plus vieux, les jeunes semblent emprunter une voie diabolique vers l’auto-destruction.
Pour couronner le tout, il y a cet autre facteur, la profonde férocité de l’environnement, l’absence d’espoir. Certaines institutions sociales telles que les syndicats et les groupes communautaires se sont retirés du paysage, tandis que les autres ont basculé vers une approche différente, à l’image de l’Église, qui, loin de l’évangélisme sudiste enraciné dans des pratiques sociales, se complaît aujourd’hui dans une forme d’évangélisme de la richesse. Une transformation symbolisée par l’essor de méga-pasteurs télévisés tels que T.D. Jakes. La situation sociale est devenue une version exacerbée de l’« encerclement vital » qu’Earl Shorris décrivait dans son livre du début des années 1990 au sujet de la pauvreté américaine : New american blues. Utilisant la métaphore d’animaux encerclés par des prédateurs et ne tentant pas de s’enfuir, Shorris comparait la situation désespérée des pauvres américains à un « encerclement » quotidien.
Voilà en partie ce qui a entraîné l’explosion sociale de Baltimore après la mort de Freddie Gray. Ce tableau trouvera d’autres résonances violentes dans les années à venir. Gray a été soumis à ce que les flics appellent un « Rodeo ride » : les suspects sont conduits à toute vitesse dans les rues pour engendrer une impression d’impuissance et provoquer la coopération. Lors de ce rodéo, à un moment que personne ne parvient à pointer, la moelle épinière de Freddie Gray s’est brisée. Sa mort s’ajoute à d’autres événements similaires, à l’image du décès de Tyrone West en 2012, mort d’un problème cardiaque lors d’une bousculade avec la police.
Dans la plupart de ces cas précédents, il y avait eu quelques manifestations rageuses suivies d’un rapide retour au silence. Pourquoi la mort de Gray a-t-elle donné lieu à des émeutes et pas les autre ? ─ voilà qui reste mystérieux, mais il est avéré que la couverture médiatique des émeutes de Ferguson en août 2014 a joué un rôle. Désormais, affronter la police dans la rue n’était plus quelque chose d’abstrait : vous l’avez vu à la télé l’année précédente. Si défier les flics n’était toujours pas socialement acceptable, cela devenait banal.
En réponse au décès de Gray, les jeunes ont alors utilisé les réseaux sociaux pour se donner rendez-vous dans les heures suivant l’événement à Mondawmin, vieux centre commercial situé à la frontière de West Baltimore. Pour certaines critiques, il n’y avait rien de politique dans ces émeutes, puisque de nombreux rassemblements discrets s’étaient déroulés à ce même endroit les années précédentes : des jeunes avaient déjà dévalisé ces magasins, attaquant des passants anonymes ou se battant entre eux[10. H. McDonald, 2015, « Baltimore in Flames », City Journal. ]. Il y a peut-être une part de vrai dans ce constat, mais il omet un fait important : même si la première impulsion n’était pas politique (ce qui est déjà dur à argumenter), une fois que les confrontations se sont généralisées hors de Mondawmin, tout est soudainement devenu très politique – quelles qu’aient été les intentions conscientes des émeutiers.
Dans les quelques heures qui ont suivi, les jeunes ont mené une bataille rangée avec une police prise au dépourvu, lui jetant des pierres, des briques, des bouteilles, et tout ce qu’ils avaient sous la main. Les magasins de Mondawmin ont été fracturés et pillés. Cette nuit-là, il y a eu d’importantes batailles de rues et nombre d’incendies dans toute la ville. Des voitures de police ont été brûlées, des magasins pillés. Il est vrai que les émeutes de 2015 n’ont pas atteint le niveau de celles de 1968, avec moins de zones de la ville réduites en ruines. Mais la Garde nationale a été appelée en renfort, un couvre-feu instauré. Jusqu’au FBI qui a envoyé des avions pour surveiller discrètement l’agitation. Bilan final : 200 magasins pillés, 200 personnes arrêtées et 150 départs d’incendie, incluant celui ayant frappé un centre destiné aux personnes âgées les plus pauvres, sur le point d’être inauguré, ce qui a rendu furieux beaucoup de vieux habitants du coin[11. Voir « After Cleanup from Baltimore Riots, Some Fear Economic Scars Will Linger », N. Sherman, 2015, Baltimore SUN. ].
Il est difficile de savoir à quel point l’ensemble des événements a eu un effet sur les jeunes de West Baltimore qui ont impulsé les émeutes. Leurs voix sont restées en grande partie inaudible, et ceci malgré une grosse couverture médiatique. Les porte-parole choisis par les médias pour représenter la jeunesse étaient bien souvent des étudiants noirs légèrement plus âgés, qui avaient organisé les manifestations autour de Ferguson et d’Eric Garner [mort à New York en 2014 suite à son arrestation par un policier, NdT], et qui par conséquent savaient davantage comment se comporter avec les médias – même s’ils ne faisaient pas eux-mêmes partie des rangs des émeutiers.
Reste que soudain, les jeunes gens de West Baltimore étaient écoutés, même si ce n’était que par le prisme de leurs actions. La société leur prêtait attention. CNN leur demandait ce qu’ils pensaient. De jeunes anarchistes leur fournissaient des bouteilles d’eau et des informations légales. Des étrangers d’autres villes organisaient des manifestations de soutien. Pour nombre d’entre eux, cela a dû être une expérience bouleversante, fondamentale, qui va subtilement se diffuser dans l’usine sociale de la ville pendant des années.
Au cours de cette semaine tendue, la police s’est encore davantage discréditée, notamment via les déclarations du préfet de police Anthony Batts, qui a affirmé que des mystérieux et anonymes « agitateurs extérieurs » avaient envahi Baltimore pour infiltrer les zones d’émeute. Et d’expliquer ensuite que des sources travaillant dans le renseignement auraient révélé une menace planant sur les officiers de la ville : des gangs rivaux tels que les BGF et les Crips auraient décidé de s’unir pour en « éliminer » certains en réponse à la mort de Gray. (Il s’est avéré en fait que les BGF et les autres gangs rencontraient à ce moment-là les responsables locaux des églises et les officiels de la mairie pour tenter de calmer la situation[12. Voir « Mayor, Commissioner Denounce Work Outside Agitators », de M. Puente & E. Green, 2015, Baltimore sun. Ainsi que « Baltimore police say gangs ‘teaming up’ to take out officers” de J. Fenton, Baltimore SUN, 2015 et « Experts question gang involvement in riots », de D. et Al. Donovan, 2015, Baltimore sun. ].)
Plus tard dans la semaine, le procureur général de Baltimore annonçait la mise en inculpation des six flics impliqués. Cette décision a été considérée à juste titre comme une victoire, et les rassemblements de protestation se sont soudain changé en célébrations spontanées. Quelques jours plus tard, la maire Stephanie Rawlings-Blake demandait au département de la Justice de continuer dans cette direction et d’enquêter sur les violations systématiques de la loi dans les comportements de la police. Suite à ces deux avancées, les manifestations se sont dissipées. La marche nationale organisée le lendemain des mises en examens, à laquelle avait appelé Malik Shabazz, membre des Black Lawyers for Justice et ancien dirigeant du New Black Panther Party, n’a rassemblé que quelques milliers de personnes, malgré l’annonce par Shabazz qu’il y aurait 10 000 participants marchant sur West Baltimore. Un rassemblement réclamant l’amnistie de tous les émeutiers n’attirait quant à lui que quelques douzaines de personnes, le 16 mai suivant. Désormais, les rues sont calmes.

Nul doute que les mises en examen et les enquêtes du département de la Justice ont constitué un moyen, pour la classe politique noire gouvernant Baltimore, prise au dépourvu, de rétablir le contrôle via quelques concessions. Dans les mois à venir, il y aura à coup sûr des événements orchestrés en ce sens, telles que les nébuleuses conférences « Youth Empowerment », destinées à « soigner » la ville et à évoluer dans une direction « positive » (à savoir élire davantage de Démocrates).
Ce point permet de souligner l’un des aspects les plus importants des émeutes de Baltimore, que peu d’observateurs ont noté. Elles ont été la première rébellion éclatant dans une grande ville gouvernée par des politiciens noirs. Baltimore n’est en rien Ferguson, où l’on trouve une couche minoritaire de politiques blancs établis régnant sur une population majoritairement noire et privée du droit de vote. Baltimore est au contraire gouvernée par une majorité noire depuis plus d’une décennie.
Pourtant, durant la longue marche vers le pouvoir menée par la classe politique noire via le Parti démocrate, il y a eu très peu de changements dans des zones comme West Baltimore. En fait, les choses vont de pire en pire, et peu d’efforts ont été faits pour réduire la brutalité policière systématique et le discrédit pesant sur les politiques. Les responsables noirs de Baltimore se contentent généralement de détourner le regard et de se consacrer à leurs propres intérêts en négociant une meilleure représentation de « la communauté noire ». Ainsi que le formulait Adolph Reed avec tant de flair en 1979 dans son attaque du concept de « communauté noire » : « Cette classe de “leaders” tend à généraliser leur propre intérêt puisqu’ils appréhendent leur légitimité et leur intégrité via une conceptualisation monolithique de la vie noire. En effet, cette conceptualisation est apparue dans la mythologie unitaire du nationalisme noir à la fin des années 1960. La représentation de la communauté noire en tant que sujet collectif dissimulait parfaitement le système hiérarchique qui sous-tendait les relations entre “dirigeants” et “dirigés”[13. A. Reed, 1979, « Black Particularity Reconsidered », TELOS 39, printemps. ] ».
À Baltimore, cela a mené tout droit au comportement de la précédente maire, Sheila Dixon, une populiste qui savait aussi bien séduire les gros bonnets financiers du quartier d’affaires qu’aller serrer des mains dans les rues des quartiers pauvres. Elle a finalement été inculpée et destituée pour avoir volé une poignée de cartes de Noël avec bons d’achats destinées aux enfants SDF d’un refuge.
Il est trop tôt pour savoir si la leçon que les leaders noirs vont nous vendre, au même titre que les Blancs, aura des effets durables. Mais pour Freddie Gray, le fait que ses bourreaux du 11 avril aient été des modèles de « diversité » – trois Blancs et trois Noirs, des hommes et des femmes – n’a rien changé à l’affaire. Au final, ils ont tous agi en accord avec leur rôle social.
Photos : Drew Angerer / Baltimore Unrest.
En vignette et image Une : Pennsylvania Avenue/North Avenue, 27 avril 2015, Drew Angerer.
Notes
| ↩1 | Sélection de textes traduits en français aux éditions Verticales/Gallimard, 2003 : Street voice, paroles de l’ombre. |
De la notation chorégraphique au XVIIIe siècle à la chronophotographie des années 1910, diverses méthodes ont su schématiser les déplacements des corps humains dans un espace et un temps donnés. Aujourd’hui, dans un contexte de traçabilité généralisée, l’accumulation de trajectoires chronospatiales permet d’élaborer des modèles statistiques de comportements « normaux » au sein d’une société donnée – pour mieux isoler les déviances potentielles de tel ou tel individu. Une logique non plus seulement de discipline ou de contrôle, mais de ciblage, au service des pouvoirs policiers, militaires ou économiques.
Ce texte est extrait du numéro 2 de Jef Klak, « Bout d’ficelle », dont le thème est Coudre / En découdre. Sa publication en ligne est la première d’une série limitée (1/6) de textes issus de la version papier de Jef Klak, toujours disponible en librairie.
Nous le publions en ligne à l’occasion de la sortie d’un film qui en est librement inspiré, « Patterns of life », où l’artiste Julien Prévieux a joué à reconstituer, avec des danseurs, du scotch et des lapins, une histoire des expériences de capture de mouvements, depuis l’observation par Georges Demenÿ, à la fin du XIXe siècle, des formes de marche pathologique jusqu’aux modélisations contemporaines des formes de vies normales par le renseignement américain. La bande annonce est̀ ici et à retrouver dans le cadre de son exposition au Centre Pompidou jusqu’au 1er février 2016.
En 1956, dans sa Théorie de la dérive, Guy Debord commentait une carte de Paris montrant « le tracé de tous les parcours effectués en une année par une étudiante du XVIe arrondissement : ces parcours dessinent un triangle de dimension réduite, sans échappées, dont les trois sommets sont l’École des Sciences Politiques, le domicile de la jeune fille et celui de son professeur de piano 1 Guy Debord, « Théorie de la dérive », Les lèvres nues, Nº 9, novembre 1956, dans Internationale situationniste, Allia, Paris, 1985, p. 312. ».
L’objectivation cartographique d’une forme de vie servait ici de point de départ à une critique poétique et politique de la vie quotidienne – critique de son étroitesse, de ses routines, et de la réduction du monde vécu dont celles-ci sont solidaires. Debord concluait : « Il n’est pas douteux que de tels schémas, exemples d’une poésie moderne susceptible d’entraîner de vives réactions affectives – dans ce cas l’indignation qu’il soit possible de vivre de la sorte – […] ne doivent servir aux progrès de la dérive [3. Debord, op. cit.]. »
Des créateurs de San Francisco proposent aujourd’hui d’étranges bijoux. Ce sont des petits médaillons aux formes géométriques, comme des toiles d’araignées ou des structures cristallines. Leurs motifs sont en réalité ceux de vos déplacements. Meshu – c’est le nom de cette petite entreprise d’orfèvrerie d’un nouveau genre – puise dans les données de géolocalisation collectées par votre smartphone pour en extraire la carte schématique de vos pérégrinations. C’est ce graphe, la visualisation de vos données chronospatiales, qui sert de patron pour découper, dans du métal ou dans du bois, votre pendentif personnalisé.
L’historique spatialisé de vos déplacements devient ainsi un signe cryptique que vous pouvez arborer en guise d’ornement. C’est aussi votre emblème, l’expression d’un nouvel art du portrait.
En tant qu’objets culturels, ces graphes sont à rapprocher d’un de leurs ancêtres : le portrait « à la silhouette » de la fin du XVIIIe siècle. Avec l’invention de la « machine sûre et commode pour tirer les silhouettes » de Johann Kaspar Lavater, le profil en ombre chinoise proliféra comme un objet d’engouement populaire, une véritable mode qui véhiculait des codes esthétiques inédits pour la présentation de soi, mais aussi de nouveaux supports pour un savoir anthropologique qui prétendait déchiffrer les traits de la personnalité à partir des lignes de la tête.
Le profil chronospatial partage avec l’ancien profil skiagraphique – du grec « dessin de l’ombre » ou « écriture de l’ombre » – la polyvalence de ses usages. La différence est bien sûr que le tracé se détourne ici du contour morphologique du corps pour se focaliser sur les lignes imaginaires de ses mouvements. Le profil, dès lors, doit être entendu en un sens métaphorique : il n’épouse plus la forme statique d’un corps, mais celle, dynamique, de ses trajectoires [6. Ce qui ne veut évidemment pas dire par ailleurs que les logiques d’identification biométriques s’estomperaient en cédant la place à cette autre mode de représentation – loin de là.]. C’est ce genre de corps schématique qui forme ici le sujet de mes investigations.
Depuis le XIXe siècle, les paléontologues opèrent une distinction éclairante entre les corps fossiles et les traces fossiles (body fossils/trace fossils) : « En traitant des empreintes, des moules, des contre-empreintes, écrit Alcide d’Orbigny en 1849, nous n’avons parlé que de traces organiques fossiles des parties solides des animaux enfouis dans les couches ; mais il est d’autres vestiges fossiles laissés par les corps vivants sur les sédiments non consolidés, et qui se rapportent moins à ces parties solides des corps qu’aux habitudes vitales et physiologiques de ceux-ci. Il s’agit d’empreintes de pas d’animaux, de sillons, de cannelures, de bourrelets, laissés par les organes de mouvement des animaux marcheurs et nageurs [7. Alcide d’Orbigny, Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigraphiques, Premier volume, Masson, Paris, 1849, p. 27.]. » Edward Hitchcock a baptisé ce genre de fossiles « ichnites ». En allemand, on les nomme aussi Lebenspurren : traces de vie ou « vestiges fossiles de vie ».
Tandis que le moulage d’un corps mort, prisonnier de l’argile, offre le décalque d’un solide avec ses volumes et ses textures, une série d’empreintes trouvées au sol ne fournit qu’un relevé de ses mouvements. En ce second cas, l’impression n’a pas été simultanée mais successive. La trace d’activité est une précipitation d’événements successifs dans la simultanéité d’un espace, sa solidification durable sur le plan d’une surface d’inscription. C’est l’image d’une durée spatialisée.
En 1790, Kant écrivait : « Toute forme des objets de sens […] est ou bien figure ou bien jeu ; et, dans ce dernier cas, ou bien jeu des figures (dans l’espace : la mimique et la danse) ou bien simple jeu des sensations (dans le temps) [9. Kant, Critique de la faculté de juger, Vrin, Paris, 1993, p. 91.]. » La forme d’une danse, ou plus généralement d’un mouvement perçu, n’est pas celle d’une chose, avec ses contours fixes (la forme d’un vase). Elle est un « jeu de figures » qui ne peut authentiquement apparaître que dans une double différence d’espace et de temps.
À la même époque, on inventait la sténochorégraphie : système de notation chorégraphiques. Dans les traités correspondants, une danse se présentait sous l’aspect de phrases mouvementées écrites en un curieux langage symbolique. Sur l’espace de la feuille, elles cheminaient sous l’axe chronologique horizontal de la partition musicale. Le tracé du jeu de formes n’était plus un simple relevé. Il devenait un script qui ne transcrivait l’activité que pour mieux la diriger en pratique.
Dans les années 1910, deux disciples de Taylor [11. Frederick Winslow Taylor (1856-1915), ingénieur américain, promoteur le plus connu de l’organisation scientifique du travail et du management scientifique : le taylorisme.], Lilian et Frank B. Gilbreth, mirent au point un dispositif qu’ils appelèrent le « chronocyclographe ». Après avoir fixé de petites ampoules électriques aux mains d’un travailleur, ils le photographiaient, en durée d’exposition longue, en train d’effectuer sa tâche. Ils obtenaient ainsi une image représentant « la trajectoire continue d’un cycle de mouvements [12. Frank Bunker Gilbreth, Lillian Moller Gilbreth, Applied Motion Study : A Collection of Papers On the Efficient Method to Industrial Preparedness, Sturgis and Walton, New York, 1917, p. 46.] » apparaissant en lignes blanches sur l’émulsion photographique.
« Une bonne manière d’illustrer la façon dont un modèle de mouvement nous permet de le visualiser est de le comparer au sillage que laisse un paquebot sur l’océan », expliquait alors un jeune ingénieur enthousiaste[14. Gilbreth, op. cit., p. 207.]. De façon plus générale, les différentes techniques dont je traite ici ont en commun d’être des façons de capturer des sillages ou d’adjoindre des effets de traînes plus ou moins durables à des activités qui n’en ont pas nécessairement de façon spontanée[15. Sur ces notions, voir Georges Didi-Huberman, Phalènes, Éditions de Minuit, Paris 2013.].
En ce cas, spécifiquement, la tâche d’extraction de la trajectoire est confiée à la photographie, ou plus précisément à la chronophotographie : en traitant la source lumineuse comme une « encre spatio-temporelle », les procédés chronophotographiques « constituent en quelque sorte des bougés, des “traînes” dirait Didi-Huberman, dans le sens où elles laissent apparaître un déplacement du mobile par sa présence étendue en différents points de l’image, paraissant ainsi simultanés[16. Caroline Chik, L’image paradoxale, Fixité et mouvement, Presses universitaires du Septentrion, Villeneuve-d’Ascq, 2011, p. 90.] ». On rend ainsi visible l’invisible. Mais il est également vrai que ce procédé de visualisation recouvre une opération concomitante d’invisibilisation ou d’effacement. Sur le cliché des Gilbreth, le corps du travailleur se floute en un halo indistinct à l’arrière-plan. Le corps disparait littéralement derrière les lignes de son geste. Du corps évanescent, il ne reste plus que le fossile éblouissant de ses mouvements passés.
Michel Foucault a montré que les dispositifs disciplinaires des XVIIIe et XIXe siècles mobilisaient « une sorte de schéma anatomo-chronologique du comportement[17. Michel Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, Paris, 1975, p. 153.] ». Mais ce n’est plus exactement ce dont il s’agit ici. Si le schéma est toujours en un sens chronologique (et même chronospatial), il n’est plus anatomique. Du corps vivant du travailleur, on ne retient plus que « l’orbite du mouvement [18. Gilbreth, op. cit., p. 46.] ». Une « orbite » – la métaphore est instructive : on passe pour ainsi dire d’une anatomie à une micro-astronomie du geste productif, où les lueurs des petites ampoules électriques auraient remplacé celles des astres, quoique pour un tout autre genre d’étude.
Or ces orbites, il ne s’agit pas seulement de les visualiser, mais aussi de les modéliser pour mieux les transformer. Si on analyse les trajectoires de mouvement, c’est afin de les épurer, de les débarrasser de leurs détours inutiles : principe « d’élimination des déchets [19. Ibid., p. 130.] ». La modélisation est un prélude à la standardisation : « En comparant de tels graphes ou modèles montrant les trajectoires de différents opérateurs en train de faire le même genre de travail, il est possible d’en déduire quelle est la méthode la plus efficiente et de l’ériger en standard [20. Ibid., p. 91.]. » La méthode, étymologiquement, c’est le chemin à suivre. Le standard, c’est le chemin le plus court, le plus économique[21. Le standard est non seulement le meilleur itinéraire gestuel en termes de productivité pour une activité donnée, mais aussi une norme transférable. En consultant une sorte de répertoire des gestes efficaces, on pourra, dans une logique de benchmarking avant la lettre, exporter d’un métier ou d’une profession à un autre le segment de geste le plus économe. Ibid. p. 92.].
Les Gilbreth sculptent aussi ces modèles de mouvement en trois dimensions avec du fil de fer et s’en servent « pour apprendre la trajectoire du mouvement [22. Ibid. p. 125.] » aux opérateurs. Le geste du travailleur, redessiné en laboratoire, retourne dans l’atelier sous forme modifiée – cette fois comme un fil conducteur auquel les corps productifs doivent conformer leur danse.
Au milieu des années 1960, un chercheur de l’Académie soviétique des sciences, Alfred Yarbus, publia un livre qui révolutionna l’étude de la vision[23. Alfred Yarbus, Eye Movements and vision, Plenum press, New York, 1967.]. Pour ses expériences, il avait utilisé une machine perfectionnée, un peu comme cet appareil où l’on pose le menton dans un cabinet ophtalmologique, mais équipé de caméras. Ayant enregistré les micromouvements des yeux, il pouvait ensuite retracer le parcours rapide qu’effectue inconsciemment un sujet lorsqu’il pose le regard sur un tableau. Ces dessins, avec leurs saccades et leurs points de fixation, ressemblent beaucoup aux photographies des Gilbreth. Ce sont eux aussi des sortes de cartes de gestes, mais de gestes oculaires, où l’objet de la visualisation n’est autre que l’acte même de voir[24. Voir à ce propos le travail de l’artiste Julien Prévieux, « Esthétique des statistiques » dans Statactivisme : Comment lutter avec des nombres, Isabelle Bruno, Emmanuel Didier, Julien Prévieux (dir.), éd. Zones/La Découverte, Paris, 2014, <www.previeux.net/html/textes/statact.html>.].
Les technologies d’eye-tracking sont aujourd’hui mobilisées par la recherche marketing. À l’âge de l’économie de l’attention, on scrute méthodiquement le regard de l’utilisateur ou du client afin de mieux le capter. On produit ainsi des « cartes thermiques » des mouvements des yeux qui permettent de faire des « tests d’usabilité » et de choisir la design route la plus efficace pour un graphisme donné.
Cette méthode d’analyse s’applique au design des pages web, au packaging des produits, mais aussi à l’architecture même des espaces de vente. Certains magasins couplent aujourd’hui les vidéos de leurs caméras de surveillance au signal des smartphones captés sur leur réseau wifi afin de retracer les déambulations de leurs clients[27. Voir Stephanie Clifford, Quentin Hardy, « Big Data Hits Real Life », New York Times, 14/07/2013, <www.nytimes.com/2013/07/15/business/attention-shopper-stores-are-tracking-your-cell.html?pagewanted=all&_r=0>.]. Dans l’espace physique, le client est un œil, mais un œil qui a des jambes. En fonction des données comportementales ainsi recueillies, on pourra reconfigurer la disposition de l’espace de vente afin d’optimiser ses propriétés de capture de l’attention.
Malgré la ressemblance entre ces graphes et ceux des Gilbreth, le type de normativité à l’œuvre n’est pas le même. Le rapport salarial est structuré par un rapport de contrainte qui donne fondamentalement à la norme une valeur de commandement. Dans la sphère marchande, c’est par des moyens plus détournés qu’un schème d’activité se trouve prescrit à des corps. En ce cas, la stratégie consiste à redessiner l’espace du visible afin d’orienter et d’aimanter les mobilités oculaires et corporelles selon des itinéraires de navigation préétablis. Cette normativité procède selon des tactiques de captation par design.
Au début des années 1960, des éthologues américains se mirent à utiliser de nouveaux transmetteurs radio afin d’étudier les déplacements d’animaux sauvages. Ces appareils, fixés sur le corps de lapins à queue blanche ou de cerfs de Virginie, permettaient de connaître leur position et de retracer leurs itinéraires[29. Voir par exemple John R. Tester, Dwain W. Warner and William W.
Cochran, « A Radio-Tracking System for Studying Movements of Deer » dans The Journal of Wildlife Management Vol. 28, Nº 1 (Janv., 1964), pp. 42-45.]. Face à la masse de données rapidement produite par de tels systèmes de radio-tracking, on s’attela aussi, avec les moyens de l’époque, à concevoir des programmes informatiques capables de convertir automatiquement ces données en cartes.
L’essor des technologies de télémétrie inspira également d’autres disciplines. En 1964, à Harvard, Ralph Schwitzgebel, épaulé par son frère jumeau Robert, comme lui psychologue du comportement, mit au point un « système de supervision comportementale équipé d’un bracelet émetteur ». Cet appareil, testé sur de « jeunes délinquants », annonçait le bracelet électronique ensuite adopté par le système pénal. On rêvait de remplacer les vieilles techniques d’enfermement par de nouvelles technologies de contrôle en milieu ouvert. Les jumeaux imaginèrent à cette fin un petit appareil portatif capable d’enregistrer et de transmettre par radio diverses données comportementales, dont la position géographique du porteur, mais aussi des informations sur son « pouls, ses ondes cérébrales, sa consommation d’alcool, et autres faits physiologiques »[31. « Anthropotelemetry : Dr. Schwitzgebel’s Machine », Harvard Law Review, Vol. 80, Nº 2 (Déc., 1966), pp. 403-421, p. 409.]. Si les capteurs du mouchard électronique signalaient un comportement à risque, on pouvait localiser l’individu et, au besoin, intervenir de façon préventive.
Mais ce qui motivait cette invention était aussi, très profondément, de l’ordre d’une libido sciendi[32. Libido sciendi : désir de connaître.]. En automatisant la collecte à distance de données comportementales, le bracelet électronique allait permettre aux sciences du comportement de disposer en continu de masses de renseignements détaillés sur les faits et gestes de la vie quotidienne. Pourquoi le psychologue ne pouvait-il pas lui aussi se brancher, comme l’éthologue, sur son propre réseau de colliers-transpondeurs placés sur le corps d’animaux humains ? Cet art de la mesure à distance appliqué aux conduites humaines fut baptisé « anthropotélémétrie ».
La tâche de collecte qui devait être confiée à des capteurs spéciaux est aujourd’hui en grande partie accomplie par des individus qui auto-documentent leurs propres activités dans un contexte de traçabilité généralisée. Tom MacWright est un ingénieur en systèmes d’information géographique. Il est aussi, à ses heures perdues, un coureur amateur. Il a récemment créé une application qui lui permet de visualiser à la fois le chemin qu’il parcourt dans la ville et les variations de son rythme cardiaque durant l’effort.
Cette carte illustre un principe important, celui de la « fusion des données » (datafusion) : des données glanées à partir de sources hétérogènes peuvent être épinglées sur un même corps schématique chronospatial. Il suffit pour cela que ces informations aient été préalablement référencées selon des coordonnées spatio-temporelles.
Toujours dans les années 1960, un courant très novateur de la géographie humaine entreprit de révolutionner sa discipline : c’était le projet de la chronogéographie (time-geography). L’idée fondamentale était que l’on pouvait rendre compte des vies humaines en les traitant comme des trajectoires (paths) dans l’espace-temps. Cela impliquait entre autres choses d’inventer des cartes d’un nouveau genre, des cartes qui intégreraient le temps à l’espace. Torsten Hägerstrand, l’un des pères fondateurs de cette méthodologie, en résumait ainsi les postulats : « Dans l’espace-temps, l’individu décrit une trajectoire (path) […]. Le concept de trajectoire de vie (ou de trajectoire intermédiaire, comme par exemple la trajectoire d’une journée, la trajectoire d’une semaine, etc.) peut aisément être exposé graphiquement à condition de replier l’espace tridimensionnel sur […] une île plate à deux dimensions, et d’introduire un axe perpendiculaire afin de représenter le temps[34. Torsten Hägerstrand, « What about people in regional science ? », Papers of the Regional Science Association, Volume 24 (1), 1970, pp. 6–21, p. 10.]. »
Voici un premier exemple de ce genre de représentation tridimensionnelle, rudimentaire encore. Sur une carte en relief ont été fichées des tiges verticales sur lesquelles on enroule un fil qui figure l’itinéraire d’un individu au cours d’une période donnée :
Ce genre de représentation cartographique a aujourd’hui été intégré à de puissants systèmes d’information géographique utilisés pour conduire des études d’« analyse géo-visuelle ».
Comme le souligne Mark Monmonier, ce genre d’objet est fondamentalement « de la cartographie (mapping) plutôt que de simples cartes (maps), dans la mesure où la cartographie ne se réduit pas à des cartes statiques imprimées sur du papier ou affichées sur des écrans d’ordinateurs. Dans les nouvelles cartographies de la surveillance, les cartes que l’on a sous les yeux ont moins d’importance que les systèmes spatiaux qui stockent et qui intègrent un ensemble de faits concernant les endroits où nous vivons et où nous travaillons[37. Mark Monmonier, Spying with Maps: Surveillance Technologies and the Future of Privacy , University of Chicago Press, Chicago, 2004, p. 1.] ».
Les instruments de la chronogéographie élaborés dans les années 1960 avaient surtout été pensés comme des moyens de planification urbaine et sociale associés à des visées politiques réformistes. Aujourd’hui, de nouvelles fonctions, bien moins bienveillantes, leur sont de plus en plus assignées. Le postulat fondamental de la time-geography, selon lequel « les biographies individuelles peuvent être suivies et retracées comme des “trajectoires dans l’espace-temps” [38. David Harvey, The condition of postmodernity, Wiley-Blackwell, London, 1991, p. 211.] » est en effet actuellement en passe de devenir le soubassement épistémologique de toutes les autres pratiques de pouvoir.
Depuis 2010, les plus hautes autorités du renseignement états-unien ont édicté les principes d’un nouveau paradigme. C’est la doctrine du « Renseignement fondé sur l’activité (Activity Based Intelligence – ABI) » élaborée sous l’égide de la sœur siamoise mais encore méconnue de la NSA, la National Geospatial Intelligence Agency (NGA)[39. La NGA ou Agence nationale géospatiale est l’agence de renseignement américaine chargée de la collecte et de l’analyse de l’imagerie, par contraste avec la NSA, historiquement centrée sur les signaux électromagnétiques.]. Les théoriciens du renseignement décrivent ce tournant comme la conversion à une nouvelle philosophie, à une nouvelle méthode de connaissance.
Comme le résume le géographe Derek Gregory, il s’agit de « suivre plusieurs individus à travers différents réseaux sociaux, afin d’établir une forme ou un “schéma de vie” (pattern of life), conformément au paradigme du “Renseignement fondé sur l’activité” qui forme aujourd’hui le cœur de la doctrine contre-insurrectionnelle[40. Derek Gregory, « Lines of descent », Open democracy, 8 novembre 2011, <www.opendemocracy.net/derek-gregory/lines-of-descent>. Sur les patterns of life, on se reportera à l’article de Derek Gregory publié dans Radical Philosophy et traduit dans le numéro Marabout de Jef Klak « Géographies du drone » et au livre Théorie du drone, Grégoire Chamayou, éd. La Fabrique.] ». Gregory le décrit de façon très évocatrice comme « une sorte de rythmanalyse militarisée, et même comme une géographie du temps, armée jusqu’aux dents », fondée sur l’usage de programmes qui « fusionnent et visualisent des données géo-spatiales et temporelles que le renseignement collecte à partir de sources multiples (“en combinant le où, le quand et le qui”) en les disposant dans un cadre tridimensionnel qui reprend les diagrammes standards de la chronogéographie développée par le géographe suédois Torsten Hägerstrand dans les années 1960 et 1970 [41. Derek Gregory, « From a view to a kill: drones and late modern war », Theory, culture and society, 28 (6) (2011), pp. 188-215, p. 195 et 208.]. »
Cette méthodologie se fonde entre autres choses sur un usage du datamining[42. Datamining : forage ou prospection de données. Le terme désigne un ensemble de méthodes informatiques visant à extraire du savoir pertinent à partir de masses de données brutes.] appliqué à des trajectoires de mouvements afin de découvrir, au sein de gigantesques pelotes de trajets, des periodic patterns ou des « signatures » correspondant à des segments d’habitudes caractéristiques. Au-delà d’un relevé des différents itinéraires singuliers, on vise ici autre chose : l’extraction progressive de schèmes d’activité. Les traits de trajets régulièrement empruntés s’épaississent alors progressivement à l’écran, tout comme les itinéraires fréquemment parcourus par les bêtes d’un troupeau creusent leurs sillons dans l’herbe d’un pré.
Voici, à titre d’exemple, l’une des cartes produites par un module d’Activity Based Intelligence élaboré par des ingénieurs de Lockheed Martin et testé sur les trajets de taxis d’une ville américaine :
Mais ce qui vaut pour des courses de taxis peut bien sûr s’appliquer à d’autres objets, dont les trajets piétonniers de villageois irakiens scrutés par la caméra d’un drone :
À l’origine, la chronogéographie naît d’un refus de la prédominance des méthodes strictement statistiques en sciences sociales. Lorsque l’on se contente de décrire la réalité sociale par des agrégats de grands nombres, tels que fournis par exemple par un recensement, regrettait Hägerstrand, « on considère la population comme étant faite de “dividuels’’ plutôt que d’individus[45. Hägertsrand, op. cit., p. 9.] ». Des agrégats statistiques tels que le PIB ou les tranches de revenus ne nous donnent pas accès à un savoir primaire sur des individus, mais seulement, de façon indirecte, à des êtres statistiques que l’on reconstruit comme des fractions d’un nombre global.
La chronogéographie prétendait au contraire repartir des individus tels qu’ils existent de façon continue en tant que points physiques affectés de trajectoires spatio-temporelles. La conviction était qu’entre le travail du biographe et celui du statisticien, « il y a une zone entre chien et loup à explorer, où l’idée fondamentale est que les gens conservent leur identité dans le temps […] et que les agrégats de comportement n’échappent pas non plus à la règle[46. Ibid., p. 9] ». En d’autres termes, comme le résume le géographe Nigel Thrift, la chronogéographie partait d’un principe méthodologique d’« indivisibilité de l’être humain[47. Nigel Thrift, An introduction to time geography, Institute of British geographers, London, 1977, p. 6.] ». Ce qui était alors proposé aux sciences sociales, c’était de rebâtir des agrégats de données à partir de la granularité insécable d’individus dont la « corporéité vivante » pouvait être schématiquement saisie par des trajectoires traçables et mesurables dans l’espace-temps.
Il est frappant que, pour exprimer cette idée, Hägerstrand ait recouru à un vocabulaire que Deleuze emploie à son tour plus de vingt ans plus tard afin de caractériser ce qu’il appelle les « sociétés de contrôle » : « On ne se trouve plus, diagnostique le philosophe, devant le couple masse-individu. Les individus sont devenus des “dividuels”, et les masses, des échantillons, des données[48. Gilles Deleuze, « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », Pourparlers, Les Éditions de Minuit, Paris, 1990, pp. 240-247, p. 244.] ». D’un côté, il y aurait les sociétés de discipline, structurées par un rapport entre individu et masse, et, de l’autre, des sociétés de contrôle, articulées sur le couple dividuel/base de données. D’un côté, des institutions d’enfermement, de l’autre, des dispositifs de contrôle déployés dans des milieux ouverts. D’un côté, la signature et le matricule pris comme signes de l’individualité disciplinaire, et, de l’autre, le chiffre et le mot de passe pris comme sésames pour les portiques du contrôle…
Cette distinction notionnelle entre dividuel et individuel, Hägerstrand et Deleuze l’avaient tous deux empruntée aux recherches sur la forme que le peintre Paul Klee avait entrepris dans l’entre-deux-guerres. Elle se schématisait pour lui de la façon suivante :
L’individuel s’illustre par une figure linéaire, celle d’un corps (figure 2). Elle se définit négativement comme ce dont on ne peut retrancher une partie sans détruire le tout, sans le rendre méconnaissable. En ce sens, l’individuel est d’abord un indivisible : sa division aurait pour effet, par mutilation, d’en détruire l’unité organique constitutive. Le dividuel se signale au contraire par sa divisibilité. Divisez ou découpez les lignes de la figure 1, retranchez-en une ou plusieurs, le motif ne se dissoudra pas pour autant. Il demeurera malgré sa partition. C’est la différence entre le motif d’une tapisserie, aux rythmes répétitifs, et le dessin de la forme organique d’un corps.
Ce que dit Hägerstrand, au début des années 1970, sur le mode d’une prescription de méthode, c’est en substance qu’il faut passer de (1) à (2), c’est-à-dire remplacer, au titre d’élément de base du savoir, la dividualité statistique par l’individualité chronospatiale.
Ce que dit Deleuze à la fin des années 1990, mais sur le mode cette fois d’un diagnostic historique et politique, c’est que nous serions en partie en train de passer de (2) à (1) – c’est-à-dire qu’à d’anciennes machines de pouvoir centrées sur l’individualité (isolable et aux contours déterminés) se substitueraient de nouvelles, dont l’objet serait le « dividuel » (sans cesse subdivisé et sur lequel on peut donc démultiplier les points de contrôle).
Mais qu’advient-il du diagnostic de Deleuze lorsque le postulat de base de la chronogéographie, à savoir fonder l’agrégation des données sur une indexation individuelle de trajectoires chronospatiales, se généralise au point de devenir le socle opérationnel effectif de toute une série de pratiques de pouvoir ?
Ce que l’on obtient alors, c’est, en première analyse, tout autre chose que du dividuel – au contraire même : des individualités chrono-géographiques prises comme objets à la fois de connaissance et d’intervention. Comme l’explique Derek Gregory, l’usage actuel de « divers moyens électroniques pour identifier, traquer et localiser » des cibles constitue en réalité un processus de « production technique d’individus comme artefacts et algorithmes »[50. <geographicalimaginations.com/tag/glenn-greenwald>]. Si Gregory a raison d’y voir un mode d’individuation spécifique, la question reste de savoir comment le caractériser conceptuellement.
L’une des difficultés est que cela cadre mal avec la catégorie d’individualisation disciplinaire rappelée par Deleuze dans son « Post-scriptum » : les technologies en question se déploient certes dans des milieux ouverts, et ceci, elles le partagent avec le modèle du contrôle, mais, dans le même temps, elles se focalisent aussi sur la recherche de « signatures » – c’est-à-dire, à en croire Deleuze, sur l’un des signes de prédilection de la discipline. En outre, si ces procédures d’analyse se focalisent sur des individualités-trajectoires pensées comme des unités chronospatiales indivisibles, elles procèdent aussi par agrégation de données, par composition de matière dividuelle stockée dans des banques de données et traitée de façon algorithmique. En fait, elles ne se laissent subsumer sous aucune des deux grandes catégories proposées par Deleuze. Elles ne correspondent ni vraiment à l’individualisation de la discipline, ni vraiment à la « dividualisation » du contrôle.
Pour saisir ce à quoi l’on a affaire ici, je crois qu’il faut mobiliser une tierce figure, également présente chez Klee, celle d’une « synthèse dividuel-individuel[51. Ibid., p. 63.] » :
Dividuel et individuel ne s’opposent pas nécessairement, ils peuvent aussi se combiner. Cette troisième figure synthéthique se produit lorsque « certaines activités engendrent des structure formelles définies qui, de façon observable, deviennent des individus[53. Ibid., p. 247.] », c’est-à-dire lorsque « les caractères structurels s’assemblent rythmiquement en une totalité individuelle[54. Ibid., p. 234.] ». La trame dividuelle mouvementée sur laquelle la figure linéaire de l’individualité se découpe en même temps qu’elle en définit le contour externe prend alors l’aspect d’une grille dansante.
L’objet du pouvoir n’est ici ni l’individu pris comme élément dans une masse, ni le dividuel pris comme chiffre dans une base de donnée, mais autre chose : des individualités-trajectoires tissées de dividualités statistiques et découpées sur une trame d’activités où elles se singularisent dans le temps comme des unités perceptibles.
La production de cette forme d’individualité ne relève pas de la discipline, pas non plus du contrôle, mais du ciblage dans ses formes les plus contemporaines. Que celui-ci soit policier, militaire ou marchand, il partage les mêmes traits formels. Une hypothèse probable est qu’au-delà des sociétés de discipline ou de contrôle, nous entrions à présent dans des sociétés ciblées.
Pour les spécialistes du renseignement militaire qui ont promu ce genre de méthodologies dans leur champ, l’espoir initial était, conformément à un modèle d’« Intelligence, de surveillance et de reconnaisssance (ISR) » hérité de la guerre froide, de parvenir à modéliser des « signatures » comportementales caractéristiques de formes de vies « terroristes ». Mais cette ambition se heurte à (au moins) un problème épistémologique fondamental. Dans des contextes « où les “mauvais” éléments ressemblent comme deux gouttes d’eau aux “bons” [55. Mark Phillips, « A brief overview of ABI and Human Domain Analytics », Trajectory Magazine, 2012. <trajectorymagazine.com/web-exclusives/item/1369-human-domain-analytics.html>. ] », les cibles sont dépourvues de signature claire permettant leur détection directe.
Or, ceci, les spécialistes du renseignement ne l’ignorent pas. À telle enseigne qu’ils présentent aujourd’hui le paradigme du Renseignement fondé sur l’activité comme une tentative pour surmonter cet obstacle : « Dans des environnements où il n’existe aucune différence visuelle entre ami et ennemi, c’est par leurs actions que les ennemis se rendent visibles[56. Edwin Tse, « Activity Based Intelligence Challenges », Northrop Grumman, IMSC Spring Retreat, 7 mars 2013.]. » Et c’est cette tâche-là, établir la distinction entre ami et ennemi, que l’on espère derechef pouvoir confier à des algorithmes.
Dans les discours de la méthode qu’ils rédigent, la formulation du problème prend des tournures quasi-métaphysiques. Le mystère est le suivant : comment découvrir des « inconnus inconnus[57. Ibid.] » (sic) ? Un inconnu connu est un individu dont on ignore l’identité singulière, l’état civil, mais dont les attributs repérables correspondent à un type répertorié. Un inconnu inconnu est celui qui échappe à la fois à une identification singulière et à une identification générique : on ne sait ni qui il est (on ignore son nom, voire son visage), ni ce qu’il est (son profil d’activité ne correspond pas à ceux déjà catalogués).
La solution vers laquelle on se tourne alors est d’une certaine manière comprise dans l’énoncé du problème : pour pouvoir repérer des formes inconnues, il faut logiquement déjà disposer d’un répertoire de formes connues. L’idée est donc de cerner le typique pour repérer l’atypique. On développe alors des « schémas de vie (patterns of life) permettant d’identifier les activités normales et les activités anormales[58. « From data to decisions III », IBM Center for the Business of Government, nov. 2013, p. 32. <govexec.com/media/gbc/docs/pdfs_edit/111213cc1.pdf>. Ce qui implique, soit dit en passant d’étendre tendanciellement ce genre de surveillance ou de dataveillance renforcée à toutes les activités et à toutes les vies.] ».
Dans un tel modèle, en « accumulant des tracés dans le temps », on peut par exemple « modéliser les mouvements des piétons et détecter des anomalies par rapport à des tendances comportementales apprises[59. Kevin Streib, Matt Nedrich, Karthik Sankaranarayanan James W. Davis « Interactive Visualization and Behavior Analysis for Video Surveillance », SIAM Data Mining International Conference on datamining, Columbus, Ohio, 2010.] ». Une fois que l’on a par exemple identifié les itinéraires « normaux » d’un porteur de plateau-repas dans une cantine, on peut par contraste voir émerger un certain nombre de trajectoires aberrantes :
Mais, au-delà des tests conduits en espace confiné, l’objectif est de déployer ces méthodologies de tri comportemental au sein de programmes de « Détection des anomalies à grande échelle » :
La définition du « normal » dont ces systèmes disposent est purement empirique : elle est apprise par la machine sur la base de relevés de fréquences et de répétitions. Et c’est un écart avec de tels schémas de régularité – une anomalie plutôt qu’une anormalité – qui déclenchera des « alertes de comportement anormal » s’affichant en teintes rouge orangé sur l’écran de l’analyste.
L’un des problèmes classiques, avec ce genre de conception de la normalité, c’est que l’« on devra nécessairement, comme l’expliquait en son temps le philosophe et médecin Georges Canguilhem, tenir pour anormal – c’est-à-dire, croit-on, pathologique – tout individu anomal (porteur d’anomalies), c’est-à-dire aberrant par rapport à un type statistiquement défini[62. Georges Canguilhem, « Le normal et le pathologique », dans La connaissance de la vie, Vrin, Paris, 1992, p. 208.] ». Alors qu’un écart singulier peut être interprété de diverses manières, par exemple « comme un échec ou comme un essai, comme une faute ou comme une aventure[63. Ibid., p. 205.] », ce genre de dispositif paranoïaque va se mettre à le signaler comme une menace potentielle : « ALERTE ».
De façon assez ironique, c’est au sein même de sociétés dont l’idéologie dominante avait érigé en valeur sacrée la liberté individuelle de suivre sa propre way of life que la singularité d’un tel cheminement va finir par se signaler automatiquement comme suspecte. Mais il faut souligner que ceci ne repose plus, en l’occurrence, sur une logique disciplinaire. En utilisant des schémas chronospatiaux pour filtrer des comportements, ces dispositifs-là n’ont par eux-mêmes aucun modèle de conduite déterminé à imposer aux diverses vies qu’ils scrutent. Leur normativité sans norme est animée par une autre visée, par un autre genre d’appétit dévorant : repérer des écarts afin d’« acquérir des cibles », et ceci dans un mode de pensée où, les cibles étant inconnues, c’est l’inconnu qui devient cible. Une autre façon de le dire est que, dans de tels régimes de savoir et de pouvoir, une cible potentielle se signale fondamentalement comme une dérive.
Pour aller plus loin :
Bande annonce de Patterns of life par Julien Prévieux :
:
En ligne sur le site de Jef Klak :
Géographies du drone. Les quatre lieux d’une guerre sans fontières, par Derek Gregory..
Traduction Émilien Bernard, avec le concours de Grégoire Chamayou, paru dans la revue anglaise Radical Philosophy 183 (janvier/février 2014)
Mortels algorithmes. Du code pénal au code létal, par Susan Schuppli.
Traduction Lucie Gerber, paru dans la revue Radical Philosophy 187 (sept/oct 2014).
Notes
| ↩1 | Guy Debord, « Théorie de la dérive », Les lèvres nues, Nº 9, novembre 1956, dans Internationale situationniste, Allia, Paris, 1985, p. 312. |
Octobre 2005 : le ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy se rend sur la Dalle d’Argenteuil et, sous les projectiles des habitant-e-s, crie à qui veut l’entendre : « Vous en avez assez de cette bande de racailles, hé bien, on va vous en débarrasser. » Dix ans après, la nuit du 14 Juillet 2015, près de cette même dalle d’Argenteuil, Amine joue dans son quartier et reçoit un tir de Flash-Ball dans le testicule.
Cette bavure structurelle a poussé le Défenseur des Droits à recommander l’abandon de certaines armes de la police.
Réponse sous forme de mise au point de l’Assemblée des blessées, des familles et des Collectifs contre les violences policières.
Lettre ouverte au Défenseur des Droits
À la suite du rapport de la Commission d’Enquête Parlementaire concernant le maintien de l’ordre et de l’Inspection Général des Services, vous préconisez l’abandon du Flash-Ball super-pro®.
« Le maintien du Flash-Ball super-pro® en dotation est en effet une source potentielle de tensions et contestations de l’action des forces de sécurité, ainsi que le démontre l’émergence d’actions communes, en justice, comme de sensibilisation de la société sur les caractéristiques de cette arme, à l’initiative de victimes de tirs de Flash-Ball super-pro®. »
Sachez, Monsieur le défenseur des droits, qu’au sein de l’Assemblée des Blessées, autant de personnes ont été blessées et mutilées par des tirs de Flash-Ball super-pro® que par des tirs de Lanceurs de Balles de Défense 40×46 (LBD 40).
Aussi la manière dont vous qualifiez les membres de notre assemblée est fausse. Ceci est regrettable car nous avons toujours pris le soin de condamner ces deux armes. Si vous n’avez jamais pris le temps de lire nos interventions et nos témoignages, c’est fort dommageable compte tenu de notre statut de victimes et de votre statut de Défenseur des Droits. Si vous travestissez la vérité sans aucun égard pour le combat que nous menons, c’est simplement détestable.
Mais peut-être faut-il rappeler au plus grand nombre les caractéristiques de ces deux armes car les institutions policières et les médias alimentent volontairement un flou à leur propos. L’une et l’autre sont des armes à feu projetant des projectiles en caoutchouc.
• Le Flash-Ball super-pro® est le premier arrivé sur le marché. C’est une arme de poing, utilisée par la police depuis 1995. Elle est particulièrement imprécise. C’est pour cette raison que vous demandez sa suspension puis son retrait. Depuis quelques années déjà, cette arme est abandonnée progressivement au profit du LBD 40.
• Le LBD 40 est une arme d’épaule de type fusil, doté d’un viseur militaire et d’un canon rayé. Plus précis et plus puissant, il fait officiellement partie des « armes à feu à usage militaire » (catégorie A). Aujourd’hui, ce second modèle est le plus répandu et engendre le plus de blessures graves dans les périphéries des métropoles comme dans les manifestations. À Argenteuil, le jeune garçon grièvement blessé a très certainement été touché par un tir de LBD 40.
Alors monsieur, le Défenseur des Droits, si nous souscrivons au moratoire sur le Flash-Ball super-pro® et si comme vous, nous demandons qu’il soit interdit, nous ne comprenons pas pourquoi une telle omission concernant le LBD 40, allant jusqu’au travestissement de la vérité, de ce que nous sommes, de ce qui nous a blessé.
Disons les choses comme elles sont, en l’état, vous ne demandez pas l’interdiction du Flash-Ball mais son remplacement par un autre plus puissant et précis qui est la cause de très nombreuses mutilations.
On se souvient comment suite à la mort de Rémi Fraisse, le ministère de l’Intérieur avait, dans une magistrale opération de communication, suspendu un seul type de grenade en maintenant l’emploi de toute une gamme tout aussi dangereuse.
Si vous obtenez l’interdiction du Flash-Ball super-pro® seulement, il ne faudra pas attendre longtemps pour que de nouvelles mutilations viennent défrayer la chronique.
Pour cela, nous demandons que le moratoire concerne aussi le LBD 40 de manière à obtenir à terme l’interdiction de tous les types de Flash-Ball.
En revanche, nous saluons fortement votre analyse et critique du règlement du 2 septembre 2014 concernant l’usage du Flash-Ball super-pro® et du LBD 40 qui comme vous le démontrez, vise explicitement à disculper les policiers tireurs. Toutes les interdictions formelles de tirer au visage et dans les parties génitales ont disparu, la distance de tir minimum en dessous de laquelle il est interdit de tirer, aussi. Ce qui constitue un très grave recul.
C’est la réponse à nos revendications, à nos initiatives judiciaires et politiques : un tour de passe-passe. Si ces nouvelles dispositions n’étaient pas simplement meurtrières, on rirait de leur petitesse.
Pour toutes ces raisons, nous continuerons de réclamer l’arrêt de l’utilisation d’armes de guerre sur la population civile.
Nota : Flash-Ball est une marque déposée. Par métonymie, il désigne aujourd’hui dans le vocabulaire courant, tous les types de lanceurs de balles en caoutchouc.
23 juillet 2105
Contact : assemblee.des.blesses@gmail.com
NB : L’assemblée appelle à se rendre au rassemblement samedi 25 juillet à 14h à Argenteuil, devant la sous-préfecture, en soutien au jeune garçon blessé par un tir de LBD 40.
Pour aller plus loin :
Se défendre de la police / collectif 8 juillet
Un bilan des violences policières du 14 juillet 2015 / Paris-luttes.infos
Bavures policières mortelles : trente ans de quasi impunité ? / Basta !
—
L’Assemblée des blessés à l’Assemblée nationale. L’intervention eut lieu le jeudi 19 mars 2015, lors de la Commission d’enquête parlementaire sur le maintien de l’ordre.
La transcription de l’intervention ici.
https://www.youtube.com/watch?v=SHNKWC-ErfY&feature=youtu.be
Doucement mais sûrement, la liberté d’expression est en passe d’être réduite à peau de chagrin. De la loi anti-terrorisme de 2014 à la multiplication des procédures pour outrage ou provocation à la commission d’actes délictueux, les mots mènent de plus en plus en prison. Quant au droit de la presse, il est lui aussi attaqué par des procureurs nostalgiques des lois scélérates de la fin du XIXe siècle. Avec le procès du 29 juin 2015 contre une personne soupçonnée d’être directrice de publication du site d’information Iaata à Toulouse, on voit clairement s’affirmer le retour du délit d’opinion – contrairement aux grands discours sur la liberté d’expression de ces derniers temps.
Voici un communiqué écrit et signé par des journaux, revues et sites d’information indépendants, avant la discussion publique et la conférence de presse du lundi 22 juin 2015 à 19h30 au Zabar (116 Rue de Ménilmontant, 75020 Paris, Métro Ménilmontant ou Jourdain).
Pour toute information, contact presse ou pour apporter votre signature : soutieniaata(chez)riseup.net.
Télécharger le communiqué en PDF.
Télécharger le dossier de presse en PDF.
C’est pour un article anonyme paru sur un site d’information indépendant (Iaata) qu’une personne passera en procès le 29 juin 2015 à Toulouse, risquant 5 ans d’emprisonnement et une lourde amende. Le texte incriminé par le parquet local donnait des conseils de résistance face à la violence des charges policières en manifestation (dont celui-ci : « À plusieurs, on peut rapidement mettre une voiture en travers de la route, voir l’enflammer »). Ces positions peuvent être discutées, et cette discussion fait partie du débat démocratique. Or le procureur en a décidé autrement, et a fait arrêter une personne soupçonnée d’être directrice de publication de Iaata, sur la maigre base d’anciennes traces numériques liant cette personne au site1 C’est la société Gandi, pourvoyeuse de noms de domaine, qui a fourni aux enquêteurs l’information selon laquelle le mis en examen serait à l’origine de l’achat du nom de domaine auprès … Continue reading (voir Annexe 1). Elle a été relâchée après une garde en vue, en attente de son jugement.
Sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse de 1881, maintes fois modifiée depuis, il est reproché à cette personne d’avoir « directement provoqué à la commission d’atteintes à la vie, à l’intégrité de la personne et à la commission de destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes ». Si la loi de 1881 était à l’époque considérée comme un progrès pour la liberté d’expression car elle protégeait un peu mieux de la censure, les lois dites « scélérates » de 1893-1894 supprimèrent quant à elles certaines garanties, et aggravèrent drastiquement les peines d’emprisonnement. Ces lois servirent à enfermer des anarchistes à tour de bras pour avoir émis publiquement des opinions contraires à celles du pouvoir en place. Et c’est via un alinéa toujours existant de l’article 24 de la loi de 1881 – « Cris et chants séditieux » – qu’on condamnait ceux qui chantaient « L’Internationale » pendant le régime de Vichy. C’est enfin sur la base d’un article de la loi scélérate du 12 décembre 1893 – toujours en vigueur aujourd’hui – qu’on peut encore mettre en détention provisoire une personne suspectée d’avoir tenu des propos provoquant ou faisant l’apologie de crimes et délits.
Aujourd’hui, si cette infraction de provocation et apologie de crimes et délits est sporadiquement mobilisée, ce n’est pas pour poursuivre ceux qui appellent à brûler des lieux de culte, ceux qui proposent de nettoyer une cité au kärcher, pas plus que les milices d’extrême droite proposant d’aller régler leur compte aux Zadistes de Sivens [2. Cette dernière provocation s’étant suivie d’effets. « À Sivens, les milices de la FDSEA multiplient les agressions dans l’impunité », 5 mars 2015, Grégoire Souchay, Reporterre.net]. Cette loi ne semble servir aux procureurs et juges d’instruction que pour réprimer des propos de ras-le-bol face à la police.
Le 16 juin 2015, le site d’information Le Jura Libertaire était quant à lui condamné pour diffamation envers la police, qualifiée de « troupes d’assassins » dans un article sur le meurtre de Karim Boudouda en juillet 2010, commis par la Brigade anticriminalité (BAC) à la Villeneuve (Grenoble). Le verdict est tombé : une amende de 100 euros pour avoir employé le terme d’« assassins », qui sous-entend en droit une préméditation, jugée « inadaptée » à la situation. Est-ce à dire que « dispositif meurtrier » conviendrait mieux ? Soit. Pour les juges du droit de la Presse, si la police a parfois tort, ce n’est jamais au point de donner raison à un média libre.
Ainsi l’enjeu d’une telle attaque judiciaire n’est-elle pas d’empêcher que soient commises des atteintes à l’intégrité physique de personnes via des écrits publics – si tant est qu’imposer la censure à un média indépendant empêche quoi que ce soit. Il s’agit en revanche de réprimer toute critique consistante des forces de l’ordre. Et, plus spécifiquement dans cette affaire, d’intimider toutes celles et ceux qui proposent une contre-information, de briser les liens entre mouvement social et diffusion d’informations autonomes, bref, de bâillonner la presse indépendante qui, depuis quelques années, fait montre d’une vivacité et d’une utilité sociale grandissantes (voir Annexe 2).
Prenant le relai des Indymedias créés dans les années 1990, Iaata participe en effet d’un réseau de nouveaux médias sur Internet (Mutu), organisés en mutuelle, avec un principe de fonctionnement horizontal et de publication libre, ouverte au grand public. Sans système pyramidal, dans une volonté de prises de décisions collectives et en lien avec les mouvements sociaux, il serait bien malaisé d’en déterminer le chef, le directeur ou le responsable juridique à même de répondre aux accusations du ministère public. Et face à l’anesthésie des capacités de contre-pouvoir de la presse détenue par des grands groupes industriels et commerciaux (seuls quatre titres « nationaux d’information politique et générale » sont encore épargnés par cette mainmise [3. À savoir La Croix, L’Humanité, Charlie Hebdo et Le Canard enchaîné. Voir « La presse sous la pression des milliardaires », Le Canard enchaîné, 3 juin 2015.]), il est bien légitime que s’expérimentent d’autres manières de fabriquer et de diffuser de l’information critique.
Pendant ce temps, à l’Assemblée nationale, les débats ne portent pas sur l’appui de telles initiatives pour préserver la liberté d’expression et la diversité des récits, mais plutôt sur les moyens d’améliorer la collusion entre police et médias de masse. C’est ce qu’on lit dans un rapport remis à l’Assemblée nationale en mai 2015 : « Journalistes et forces de l’ordre ont tout à la fois un intérêt commun et un devoir de travailler ensemble et, à tout le moins, de ne pas nuire à l’exercice du métier de l’autre. En effet, la transparence sur leur professionnalisme et sur l’attitude violente et/ou délictueuse de certains manifestants ne peut que servir les missions des forces mobiles et, si certains ont déploré devant la commission la diffusion de montages grossiers caricaturant l’action des forces de l’ordre à Sivens, elle était le fait des organes de communication “officielle” et monopolistique (sic) de la ZAD [4. Rapport fait à l’Assemblée nationale au nom de la commission d’enquête « chargée d’établir un état des lieux et de faire des propositions en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection des personnes et des biens », Noël Mamère, président ; Pascal Popelin, rapporteur, 21 mai 2015. Notons que le « monopole » de la communication dont fait état ce rapport désigne quelques blogs et sites d’information indépendants, dont les capacités de diffusion sont encore loin de pouvoir porter de l’ombre aux quotidiens et hebdomadaires de la presse mainstream.]. » Le rapport dont est issue cette proposition, contraire aux principes les plus élémentaires d’indépendance et d’équilibre des pouvoirs, et notamment de ceux issus de la société civile, fait suite à la mort d’un jeune homme, Rémi Fraisse, causée par le « dispositif meurtrier » des gendarmes mobiles sur le site de Sivens, où un barrage depuis désavoué par l’État était prévu par les caciques locaux.
Or c’est bien dans ce contexte qu’il faut analyser l’enquête visant le supposé directeur de publication de Iaata par le parquet de Toulouse. En effet, depuis le meurtre de Rémi Fraisse en octobre 2014, de nombreuses manifestations réclamant justice ont eu lieu un peu partout en France, et notamment à Toulouse, métropole la plus proche. Bilan (provisoire) : 69 arrestations, 40 procès, des dizaines de milliers d’euros d’amende, des mois de prison avec sursis, 9 personnes écrouées, et des procédures toujours en cours. Ces manifestations sévèrement réprimées n’ont pratiquement pas été couvertes par les grands médias. Rappelons également que la mort de Rémi Fraisse à Sivens accompagne celle de dizaines de personnes du fait des forces de police chaque année (voir Annexe 3).
Tel est donc le cadre de ce procès contre la presse indépendante : les mesures de maintien de l’ordre sont aujourd’hui de réels dispositifs de guerre civile : armures high-tech portées par les policiers, armes entraînant la mort et la mutilation (flashballs, tasers, grenades, etc.), arrestations massives et systématiques… Rappelons enfin que les manifestations sont de plus en plus bridées et encadrées, au point de reléguer le droit de se rassembler à une liberté sous conditions : du service minimum qui affaiblit le droit de grève aux interdictions de manifester contre les violences policières [5. À ce sujet, voir par exemple « Le droit de manifester aboli par la préfecture ? », Collectif 8 juillet.] jusqu’à la proposition (dans le rapport précité) d’arrêter des suspects avant même qu’ils aient eu l’idée de la moindre infraction – et de leur interdire a priori toute participation aux manifestations [6. « Dans l’éventail des outils graduels de gestion des manifestations à disposition des préfets, le Rapporteur estime également que devrait être envisagée la possibilité très encadrée d’interdire à un ou plusieurs individus de participer à une manifestation sur la voie publique. », rapport cité.].
Par ailleurs, le nombre de procès pour outrage et rébellion à agents a littéralement explosé ces dernières années : sachant pertinemment que leur parole vaut plus que celle de leurs interpellés devant un tribunal et que ce genre de procédures est un bon moyen d’arrondir leurs fins de mois, les policiers n’hésitent plus à retourner la moindre tentative de se protéger de leurs coups en poursuites judiciaires (les condamnations pour « outrages, rébellion et autres atteintes à l’ordre administratif et judiciaire » ont augmenté de 74% en 20 ans, passant de 15 090 en 1990 à 26 299 en 2009) [7. « 20 ans de condamnations pour crimes et délits », Infostat Justice n° 114, avril 2011, ministère de la Justice. Voir également COllectif pour une DÉpénalisation du Délit d’Outrage / Contre les violences policières. Les dépenses publiques liées à la protection juridique accordée aux policiers victimes d’outrages, de rébellions ou de violences ont quant à elles augmenté de plus de 50% depuis 2006, de 8,7 millions d’euros à 13,2 millions d’euros en 2012. « Évolution et maîtrise des dépenses de contentieux à la charge du ministère de l’Intérieur », 20 décembre 2013, rapport de l’IGA, ministère de l’Intérieur.].
Depuis plus d’une dizaine d’années, les politiques se sont également fait la main en exigeant la condamnation de nombreux artistes de rap « issus de l’immigration » (dixit le député UMP Michel Raison) – NTM, La Rumeur, Ministère A.M.E.R., Monsieur R., etc. – pour des « paroles agressives à l’encontre des autorités ou insultantes pour les forces de l’ordre et les symboles de notre République » (Nathalie Goulet, sénatrice centriste). Malgré de longues procédures judiciaires, peu de sanctions sont tombées, mais cela a permis d’alimenter la propagande de la peur selon laquelle « le message de violence de ces rappeurs reçu par des jeunes déracinés, déculturés, peut légitimer chez eux l’incivilité, au pire le terrorisme » (Didier Grosdidier, député UMP).
Bref, un bâillon généralisé se met en place en France, qui ne se limite pas à ces cas, mais s’inscrit dans une logique générale de prévention des critiques portant sur un pouvoir de plus en plus policier. Ainsi la loi du 13 novembre 2014 sur le terrorisme porte-t-elle gravement atteinte à la liberté d’expression en intégrant également les délits de provocation et d’apologie du terrorisme au Code pénal. Cette simple modification de procédure a de lourdes conséquences : elle prive des garanties de la loi de 1881 les personnes dont les mots, les pensées sont considérés par des procureurs inflexibles comme « provoquant ou faisant l’apologie du terrorisme » avec toute l’imprécision que recouvre la définition de tels actes : « une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». En permettant d’utiliser la procédure de comparution immédiate dans ces cas, cette loi augmente considérablement le risque d’emprisonnement.
À cela s’ajoute la loi sur le renseignement, en passe d’être votée le 16 juin 2015, qui légalisera la surveillance généralisée et a priori des collectifs qui s’opposent aux politiques du gouvernement, ou pour citer Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur « des mouvements qui en raison des actions qu’ils déclenchent peuvent se trouver à l’origine de violences pouvant porter atteinte aux principes fondamentaux de la République [8. « Cazeneuve refuse d’exclure les mouvements sociaux du champ de la loi renseignement », La chaîne parlementaire, 31 mars 2015.]. » L’idéologie est la même : on ne s’attaque pas aux groupes ayant commis des infractions, mais à ceux qui « peuvent se trouver à l’origine » de tels faits. La boucle est bouclée : un simple soupçon permet de punir.
À quelles autres formes d’expression s’étendra cette criminalisation de propos publics ? Quand on ne pourra plus dire, en fera-t-on moins ? En 2015, après s’être gargarisée de la liberté d’expression en étant Charlie, la France emprisonne pour des mots. De nombreuses condamnations sont tombées depuis le 7 janvier, pour l’exemple, à l’encontre de pauvres hères ayant déclaré « Je ne suis pas Charlie », ou équivalent. Au lieu de discussions et de pédagogie, de nombreux établissements scolaires ont fait appel aux forces de l’ordre pour ramener au poste des gamins ayant refusé la minute de silence après le massacre contre l’équipe de Charlie Hebdo. Pas à pas, la « République » remet donc le délit d’opinion en vigueur et se dote d’un arsenal juridique qui n’a d’équivalent que celui de sa police.
Faire taire au lieu de comprendre et d’agir, intimider celles et ceux qui veulent redonner un sens à la presse libre, réprimer celles et ceux qui luttent pour davantage de justice sociale, masquer les crimes policiers par la censure : autant de manifestations d’un pouvoir d’État qui oublie qu’ainsi il ne fait que renforcer la colère et les solidarités contre son arbitraire. Aussi appelons-nous à nous réunir en préparation du procès du 29 juin 2015, à aiguiser nos résistances et, face à cette gestion policière des désordres sociaux produits par une politique entièrement fondée sur le maintien de l’ordre, à nous moquer de leur panique autoritaire.
Discussion publique et conférence de presse le lundi 22 juin 2015 à 19h30 au Zabar : 116, Rue de Ménilmontant, 75020 Paris, Métro Ménilmontant ou Jourdain
Premiers signataires : Jef Klak, Revue Z, Article 11, Paris-luttes.info, CQFD, La lettre à Lulu, La Rotative, Éditions Libertalia, Le Jura Libertaire, Le collectif Bon pied Bon œil, La Brique, Rebellyon.info, Lutopik, Primitivi, Indymedia Nantes, Radio Zinzine, Brest Médias libres, Zélium, Espoir Chiapas, Rennes Info, Reporterre, l’Actu des luttes, Radio Canut, Canal Sud, Radiorageuses, Contre-faits, Nebuleuses.info, Indymedia Grenoble… (23 juin 2015)
*
NB : Lundi 29 juin de 12h30 à 14h, l’émission Le front du lundi sur Canal Sud (92.2 FM à Toulouse ou en ligne ici) sera en direct depuis le tribunal de Toulouse pour le procès de 1 74 09 99 accusé de diriger la publication du site d’information collaboratif toulousain « IAATA ».
Son procès sera l’occasion d’un rassemblement – pique-nique devant le Palais de Justice de Toulouse. L’occasion aussi de revenir sur plusieurs luttes récentes à Toulouse et alentours, sous forme de montages son et surtout d’interviews de personnes présentes.
Pour retransmettre cette émission, contacter lefrontdulundi(chez)gmail.com
Sont attendu.e.s :
– Des enseignants du collège Bellefontaine, mutés de force, en attendant d’autres sanctions, suite à une grève.
– Le collectif antinucléaire Sud Est, poursuivi en diffamation par Areva suite à un article.
– La Caisse d’autodéfense juridique (CAJ), qui tente d’apporter un soutien concret aux personnes confrontées à la justice et à la prison.
– Riposte Radicale, collectif transpédésbiEsgouines non mixte, inquiété pour des « outrages ».
– Le Clime (collectif de lutte et d’information migrants), qui viendra parler de la situation des personnes privées de papiers.
– Le Strass, syndicat de travailleuses du sexe, qui a connu quelques
déboires avec la police dans sa lutte contre les arrêtés anti-prostitution.
– Le comité de soutien à Gaétan, militant condamné en appel à 6 mois de prison pour de prétendues « violences » lors d’une manifestation après la mort de Rémi Fraisse.
– Des membres de la CREA, qui depuis quatre ans réquisitionnent des bâtiments vides… et collectionnent procès et expulsions parfois
illégales, souvent violentes.
– Le collectif Tant qu’il y aura des bouilles, qui lutte contre le projet de barrage à Sivens.
– etc.
Également, si vous souhaitez évoquer ce procès à l’antenne, des montages sont disponibles sur Sons en lutte
Illustration : Emory Douglas, 1969.
ANNEXE 1
A/ L’article incriminé
21 février : Lapins de Garenne, acte 2
B/ Les articles parus depuis dans les médias indépendants
Face à la répression, l’information est une arme : soutien à IAATA.info
Censure et répression à Toulouse, Iaata.info sur le grill
Menacé de prison pour avoir relayé sur Internet des conseils en manif
*
ANNEXE 2
Citons les collectifs d’animation et de modération de Rebellyon, Paris-Luttes.info, Brest-Info, Renverse.ch, la Rotative, Reims médias libres,IAATA, Rennes Info, le Jura libertaire, Article 11, Soyons sauvages, Espoir Chiapas, Collectif Bon pied bon oeil, Atelier médias libres, Courant Alternatif, Éditions Acratie, Panthères enragées, Primitivi, Éditions Albache, Jef Klak, le Numéro Zéro, La Brique, La Lettre à Lulu, Révolte numérique, Radio Zinzine, zad.nadir.org, Contre-faits, Collectif Ciné 2000, l’Actu des luttes (FPP), RésisteR! (Nancy), Lutopik, le collectif Contre Les Abus Policiers – C.L.A.P33, L’Orchestre Poétique d’Avant-guerre O.P.A., L’Envolée (pour en finir avec toutes les prisons), Lundi Matin, Radio Canut, Lignes de force, Demain le Grand Soir, Archyves, Revue Z, Le Canard sauvage, Indymedia Nantes, Hors Sol, Confusionnisme.info, Mille Babords, Iacam, La Gazette de Gouzy, le Monde libertaire, Regarde à Vue, radio Canal Sud, La Horde, radio La Locale (Ariège), Collectif de Infoaut, Éditions Entremonde, Éditions Libertalia, Acrimed, radio Bartas(Lozère), Antifa-net.fr, Les Morback Vénères, CQFD, Indymedia Lille, Le Lot en action…
*
ANNEXE 3
• Voir « Homicides, accidents, “malaises”, légitime défense : 50 ans de morts par la police », par Ivan du Roy et Ludo Simbille, 13 mars 2014, Basta !
• Récemment, Amadou Koumé à Paris, Abdelhak Gorafia à Roissy, Pierre Cayet à Saint-Denis, Abdoulaye Camara au Havre, Morad à Marseille, Houcine Bouras à Colmar, Bilal Nzohabonayo à Tours, Rémi Fraisse sur la ZAD de Sivens, Timothée Lake à Toulouse, Pierre-Eliot Zighem à Tourcoing sont morts entre les mains de la police, sans compter les nombreuses et nombreux mutilé-e-s et blessé-e-s par les armes policières.
• Voir les sites de Quartiers libres et d’Angles Morts, ainsi que la foule de Comités Vérité et justice qui ont éclos ces dernières années.
Notes
| ↩1 | C’est la société Gandi, pourvoyeuse de noms de domaine, qui a fourni aux enquêteurs l’information selon laquelle le mis en examen serait à l’origine de l’achat du nom de domaine auprès de ses services. |
Après des millénaires durant lesquels les graffitis faisaient partie du paysage urbain, le XIXe siècle a inauguré leur criminalisation : les transformations urbanistiques de Paris sous le préfet Haussmann ont développé une forme d’architecture préventive, renouvelée au XXe siècle en réponse à l’explosion des tags. Si la lutte anti-graffiti était initialement liée à la traque de l’écrit « subversif », depuis la fin du XXe siècle elle réfute toute considération d’ordre moral, associant désormais systématiquement cette pratique au vandalisme et à la pollution visuelle. Seul un caractère esthétique lui ouvre parfois les portes d’une reconnaissance, bien souvent intéressée.
Dans la cage d’escalier d’une habitation de Pompéi, un anonyme du Ier siècle écrivit : « Mur, je suis surpris que tu ne te sois pas effondré sous le poids des bêtises de tous ceux qui ont écrit sur toi. » Depuis que la parole peut séjourner dans les lettres, le graffiti accompagne les époques, passant du caillou à la craie, du crayon au feutre ou à la bombe de peinture.
Si la survie d’une inscription a longtemps relevé de la tolérance du propriétaire du mur concerné, un tournant s’opère au milieu du XIXe siècle, avec la première interdiction formelle d’orner l’espace commun d’un écrit non-autorisé. En France, la mise en place de la « délinquance graphique » se fait en deux temps : d’abord dans les années 18501 Philippe Artières, La police de l’écriture, l’invention de la délinquance graphique 1852-1945, La Découverte, 2013., avec le début de la prolifération massive des écrits de rue, puis au début des années 1990, avec l’explosion du tag, qui rebat les cartes du cadre culturel et juridique de la lutte contre le graffiti, évoluant du champ de la calomnie et de la diffamation[2. Loi du 17 mai 1817.] vers celui de la destruction de biens[3. Loi du 22 juillet 1992.].

La première apparition du mot graffiti dans la langue française date de 1856 : il est né du travail sur les fouilles de Pompéi, pour qualifier des écritures murales en dehors de celles des institutions reconnues (clergé, instances publiques).
Cette identification sert à mieux mettre en valeur les écrits officiels, elle est alors imprégnée d’un certain mépris : le graffiti est le fait de groupes marginaux, un autre reflet de la « décadence » de l’Empire romain (au côté du nombre élevé de bordels et de fresques érotiques, ayant interloqué les XVIIIe et XIXe siècles). La création du nouveau mot se relie aussi à son contexte historique, marqué par une prolifération et une diversification impressionnante des écritures de rue.

Depuis le début du XIXe siècle, l’alphabétisation croissante, le développement des techniques d’imprimerie et les secousses politiques ont contribué à un renouveau graphique dans les rues, en particulier à Paris. Désormais, l’émeute n’est plus uniquement accompagnée de chants et de cris, elle s’enrichit de slogans laissés sur les murs, d’affiches, de phrases séditieuses, d’appels à la manifestation ou à des réunions publiques.
En riposte aux expressions populaires, la lutte contre le graffiti s’élabore en deux volets : policier et architectural. L’haussmannisation de la cité (1850-1870) est l’étape décisive : l’augmentation des pouvoirs des préfets parisiens, la rationalisation urbanistique, l’assainissement des rues favorisent la condamnation du graffiti. Le policier doit désormais, entre autres missions, relever les écrits subversifs, tandis que l’alignement des façades, l’obligation de leur nettoyage par les propriétaires, l’omniprésence de lignes de refend (ces stries horizontales sculptées sur les immeubles) repoussent affichage sauvage et textes inscrits. La réaction repose aussi sur une idéologie hygiéniste : la ville d’Haussmann se doit d’être saine pour les corps comme pour les esprits. Des considérations médicales, sociales et politiques concourent à débarrasser la ville de ses immondices médiévales – et le graffiti en fait partie.
À cette charge s’ajoute un mouvement de reconquête de l’écrit public par les institutions. L’obligation des plaques de rue à Paris depuis 1847 prend un nouveau sens avec la IIIe République : la façon de les nommer acquiert un caractère mémoriel et patriotique. Le vocabulaire républicain prolifère et s’affirme sur les monuments : devise, RF, école primaire, maison d’arrêt, préfecture… La décennie 1880-1890 légifère sur toutes les formes d’écrit public : de la réglementation des inscriptions sur les tombes à l’immatriculation des voitures. Apogée de cette énergie législative, les plaques émaillées et les fameux pochoirs : « Défense d’afficher, loi du 29 juillet 1881. »
Cet encadrement participe de ce que le sociologue Émile Durkheim analysait en son temps comme la rétrocession historique des libertés collectives au profit des libertés individuelles[4. De la division du travail social, 1893, disponible aux éditions PUF.]. À la fin du XIXe siècle, en accordant plus de place à l’individu – en termes de participation politique, de droit ou d’expression –, l’État légifère et encadre des faits sociaux qui lui échappaient auparavant (organisation du travail, assistance et charité, éducation, etc.). La loi de 1881 est par exemple rédigée en faveur de la liberté de la presse : cette dernière est libre de s’exprimer, mais dans un cadre et par des moyens qui sont restreints.
La fin du XXe siècle est quant à elle confrontée à une explosion fluorescente, un véritable engouement populaire pour les tags (signatures). Initialement limité au marquage territorial de gangs américains (Crisps, Bloods, Latin Kings), l’usage de la bombe aérosol, permettant d’allier rapidité d’exécution, portabilité et résistance de la peinture, se répand et atteint la France au début des années 1980. Dans un premier temps, les médias accueillent très favorablement cette pratique, considérée comme un des piliers du mouvement hip-hop et un moyen créatif de détourner la jeunesse des affres de la violence et de la drogue.
Mais très vite, les pouvoirs publics s’orientent vers une politique de répression, s’appuyant sur les travaux de sociologues américains qui développent en 1982 la « théorie de la vitre brisée[5. James Q. Wilson & George L. Kelling, « The Broken window theory: the police and neighborhood safety », The Atlantic, 1982.] » : les petites détériorations que subit l’espace public accélèrent nécessairement le délabrement plus général, encourageant de nouvelles dégradations. Les autorités sont censées intervenir au plus vite pour rétablir la propreté du mur, sinon l’invasion des formes colorées est inévitable.
Après l’arrivée du tag « vandale », en particulier sur les trains, les regards commencent donc à changer. Un fait divers choque particulièrement l’opinion publique, le « Massacre de la station Louvre-Rivoli » en 1992. La redécoration de la vitrine du métro parisien fait suite à une série d’interpellations motivée par la RATP, qui venait tout juste de conclure une convention avec le Tribunal de grande instance de Créteil. Désormais, les tagueurs interpelés seront systématiquement convoqués chez le juge, à moins qu’ils n’acceptent le nettoyage des dégâts « effectués au feutre, à la bombe, à l’encre de Chine ou au moyen de tout autre procédé ». Dès lors, tags et graffitis se retrouvent souvent confondus et intègrent la catégorie émergente de « pollution visuelle ».
Ils deviennent un symbole d’insécurité et incarnent la manifestation de la petite délinquance au sein de communautés délaissées par les pouvoirs publics. La réponse des institutions s’appuie d’abord sur des campagnes de sensibilisation (SNCF[6. « Nous nous mobilisons parce que nous avons un sentiment de rejet profond contre ces signatures abjectes et sans vie qui hantent nos villes. », « Oui à la fresque, non au tag », Prospectus de sensibilisation de la SNCF destiné aux usagers, 1991.] puis RATP), puis sur une politique d’effacement systématique (à partir de 1996 pour la Ville de Paris), suivant l’exemple des actions menées par la mairie de New York depuis 1981. Des machines sont inventées ad hoc : elles propulsent un jet d’eau à haute pression, mélangé avec des solvants et du sable, mais endommagent partiellement les façades. À l’initiative de Jacques Chirac, alors maire de Paris, l’encadrement de la vente des outils (bombes, marqueurs) est décidé en 1992 (interdiction aux mineurs, limitation de la taille des feutres).
La réaction est également répressive : des brigades conjointes RATP/SNCF/Police nationale sont rapidement montées. La modification du Code pénal envers les « inscriptions non-autorisées » les associe désormais à la destruction de biens, même si, lors des débats parlementaires relatifs à cette loi du 22 juillet 1992, la question du tag avait été soulevée comme nouvelle manifestation culturelle.
Architecture et urbanisme concourent également à encadrer le graffiti nouveau. « L’architecture de prévention situationnelle » a pour objectif de garantir la sécurité dans les espaces publics par des dispositions spatiales et matérielles ; celles contre le graffiti côtoient des dispositifs anti-sans-abris, la vidéo-surveillance, la mise en place de codes aux portails des immeubles, etc. Des façades sont revêtues de quadrillages et de motifs géométriques qui empêchent la lisibilité des inscriptions, des murs anti-tags sont érigés (recouverts de vernis spéciaux et rythmés par des stries régulières).
Le street-art joue à cet égard un jeu trouble : la création du terme constitue elle-même une nouvelle charge lexicale dépréciant l’écrit de rue, et si cet « art » parvient à acquérir une légitimité et une reconnaissance dans l’espace public, c’est le plus souvent en investissant une paroi recouverte de graffitis et de tags plus free-style. Des artistes peuvent se voir ainsi attribuer un emplacement[7. À l’exemple du M.U.R., cadre fixé sur une grande façade non alignée de la rue Oberkampf à Paris, recevant à intervalle régulier l’œuvre d’un artiste différent.] délimité sur un mur : une fresque servant à repousser les inscriptions sauvages.
Cette institutionnalisation du graffiti suggère donc la dépossession de l’œuvre réalisée à la bombe au profit « d’artistes », exécutant dans un cadre précis une réalisation d’ordre esthétique, signée. La captation des tracés acryliques permet de présenter la ville comme parcourue d’espaces de liberté et, par-delà, à légitimer l’effacement des suites de lettres éparses non autorisées. Le street-art enrichit ainsi le catalogue monnayable de l’art contemporain, qu’il soit officiel ou sauvage, avec des intentions lucratives ou désintéressées. Il suscite une concurrence accrue sur les murs, et précipite encore plus le simple graffiti dans le registre de la souillure occasionnée par des groupes marginaux.
Manifestation des pensées qui parcourent le corps social et des individualités qui le composent, l’écrit de rue reflète les attitudes culturelles d’une population, sa propension à s’exprimer. Le graffiti pompéien est lui-même le seul vestige du latin écrit par les classes populaires. Loin de se réduire à la contestation politique ou l’anticonformisme, à l’affirmation d’une présence ou de poésie urbaine, le graffiti reste simplement un échange différé entre un passant avisé et un auteur roublard (souvent aviné). Pour reprendre les mots attribués à Salvador Dali, il « reste un mot merdeux, une insulte aux constipés de l’esprit ».
Notes
| ↩1 | Philippe Artières, La police de l’écriture, l’invention de la délinquance graphique 1852-1945, La Découverte, 2013. |
Traduction par Émilien Bernard
(Avec le concours de Grégoire Chamayou)
L’usage devenu banal des drones sur les champs de bataille en transforme la géographie. La guerre n’a plus de lieu spécifique, et ne répond presque plus à la définition classique. C’est dans des zones aux limites indéfinies qu’interviennent ces avions sans pilote, dirigés comme des jouets, par des humains à des milliers de kilomètres. Professeur de géographie à l’université de la Colombie-Britannique de Vancouver, Derek Gregory propose de repenser l’espace géopolitique à l’aune de ces nouvelles pratiques : aussi loin soit-il, le « pilote » du drone n’est finalement qu’à cinquante centimètres de la zone de conflit, matérialisée par son seul écran d’ordinateur. La guerre devient aussi intime que virtuelle. La cible n’est plus un ennemi indifférencié, mais un criminel connu, dont l’assassinat se joue des questionnements moraux, malgré les efforts des juristes de l’armée pour les légitimer.
Texte original : « Drone geographies », publié dans le numéro 183 de la revue anglaise Radical Philosophy (janvier/février 2014). Radical Philosophy est un magazine de philosophie féministe et socialiste créé en 1972, et paraissant tous les deux mois.
Ce texte est extrait de la partie hors thème du numéro 1 de Jef Klak, « Marabout », dont le thème est Croire/Pouvoir. Sa publication en ligne est la quatrième d’une série limitée (4/6) de textes issue de la version papier de Jef Klak, toujours disponible en librairie.
L’an dernier, Apple a rejeté à trois reprises une application de Josh Begley intitulée « Drones+ ». Son principe ? Envoyer une notification en pushA à l’utilisateur dès que tombait la nouvelle d’une frappe de drone américain. Apple a considéré que beaucoup pourraient trouver l’application « contestable » (la marque n’a en revanche rien dit de ce que les utilisateurs pourraient penser de ces frappes). Alors qu’il défendait sa thèse devant l’université de New York plus tôt cette année, Begley s’est interrogé : « Souhaitons-nous être autant connectés à notre politique étrangère qu’à nos smartphones ? […] Voulons-nous que ces objets soient le lien par lequel nous expérimentons la guerre télécommandée1 Josh Begley, « Dronestream », New York University, 15 mai 2013, vimeo.com/67691389. ? » Ce sont de bonnes questions, et Apple y a répondu de manière tranchée. Plusieurs artistes ont eu recours aux plates-formes numériques pour mettre en lumière les lieux où s’exerce la violence à distance – je pense en particulier à Dronestream du même Begley et à Dronestagram de James Bridle, mais il y en a de nombreux autres2 Voir dronestre.am et dronestagram.tumblr.com. Pour une synthèse des interventions sur les drones en arts visuels, voir Elspeth van Veeren, « Drone Imaginaries : There Is More Than … Continue reading. Leur travail m’a poussé à réfléchir aux multiples et complexes cadres géographiques au sein desquels s’inscrivent ces opérations. Dans cet article, je me focaliserai sur quatre d’entre eux.
Mon approche est à la fois resserrée et globale. Elle est resserrée parce que j’aborde uniquement l’utilisation des drones de type Predator et Reaper par l’US Air Force en Afghanistan et en Irak (parfois en tant que bras armé du JSOC – Joint Special Operation CommandB), ainsi que leur implication dans des assassinats ciblés sous l’égide de la CIA au Pakistan, au Yémen et en Somalie. D’autres corps d’armée de pointe usent également de drones, balistiques ou dédiés à l’Istar (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & ReconnaissanceC), en tant qu’entités agissantes d’une violence militaire organisée en réseau, mais il est encore plus difficile de détailler leurs opérations. L’US Army et les Marines ont ainsi recours à des drones, mais la plupart sont de petite taille et leur champ d’intervention se limite à des tâches de surveillance et de reconnaissance pour le combat rapproché et les attaques terrestres.
Cependant, malgré ces limitations, mon propos se veut global, parce que je souhaite mettre au jour la matrice de violence militaire que ces plates-formes à distance contribuent à activer. Nombre des réponses critiques aux drones sont excessivement focalisées sur l’aspect technique (ou techno-culturel) de cet objet – le drone – et ignorent pratiquement ses dispositifs et évolutions plus larges. Cette tendance relève à mes yeux d’une erreur autant analytique que politique.
Le premier cadre géographique que j’aborderai se trouve au cœur des États-Unis, où sont dirigées ces opérations à distance que l’US Air Force décrit comme le fait de « projeter du pouvoir sans projeter de vulnérabilité ». Bien sûr, les Predators et Reapers sont stationnés dans les zones de conflit, ou à proximité. C’est également le cas des « équipes de lancement et de récupération » qui assurent les décollages et les atterrissages de ces engins via des liaisons diffusées en ondes courtes sur la bande CD. Étant donné les problèmes techniques qui accablent ces « appareils volants imprévisibles » – pour reprendre l’expression de Jordan Crandall –, il faut aussi conserver des équipes de maintenance fournies sur le théâtre d’opérations pour l’entretien des aéronefs3 Jordan Crandall, « Ontologies of the Wayward Drone : A Salvage Operation », 11 février 2011, ctheory.net/articles.aspx?id=693..
Dès lors qu’il est en l’air, cependant, le contrôle du drone est généralement confié à des équipes de vol stationnées sur le territoire terrestre des États-Unis via un satellite à bande kuE, relié à une station terrestre de la base aérienne allemande de Ramstein et un câble à fibre optique traversant l’Atlantique. Le réseau inclut également des officiers supérieurs et des juristes militaires, qui supervisent les opérations depuis l’US Central Command’s Combined Operation Center de la base aérienne d’Al Udeid au Qatar. Enfin, des spécialistes en analyse de l’image liés à l’Air Force’s Distributed Common Ground System scrutent minutieusement l’intégralité des vidéos enregistrées par les engins volants. Considérés dans leur ensemble, les quatre avions qui constituent une Patrouille aérienne de combat capable de fournir une couverture 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 mobilisent 192 personnes, la majorité d’entre elles (133) étant situées hors de la zone de combat et de tout danger immédiat.
On court ici le risque de glisser de la forme « guerre » vers une forme de politique de la vengeance, évolution impliquant virtuellement que tous les risques sont transférés sur les habitants des pays étrangers4 Martin Shaw, The New Western Way of War: Risk Transfer War and Its Crisis in Iraq, Polity Press, Cambridge, 2005. Shaw ne mentionne pas les drones et souligne que le transfert de risque caractérise … Continue reading. Les populations vivant dans les zones exposées à des attaques taxent fréquemment les frappes par drones d’actes lâches, mais le fait que la majorité de ceux qui contrôlent ces missions en réseau ne mettent pas leur vie en danger a également provoqué divers débats aux États-Unis sur l’éthique militaire et le code d’honneur. Les critiques ont invoqué le principe de la réciprocité des risques, c’est-à-dire ce que Clausewitz avait décrit comme la force morale impliquée dans toute guerre : pour tuer dans l’honneur, le soldat doit être prêt à mourir. Aujourd’hui, le combattant à distance reste le vecteur de la violence, mais il n’est plus sa victime potentielle5 Grégoire Chamayou, Théorie du drone, La Fabrique, Paris, 2013, p. 139–50 ; j’ai abordé le sujet dans « From invisibility to vulnerability », 8 août … Continue reading.
Des voix critiques ont ainsi ridiculisé les équipages de drones en les qualifiant de « guerriers en cabine », menant la guerre comme on se rend au bureau6 Lambèr Royakkers et Rinie van Est, « The Cubicle Warrior : The Marionette of Digitized Warfare », Ethics and Information Technology, vol. 12, no 3, 2010, p. 289–96.. Les engins volants sans pilotes peuvent effectuer des vols d’au moins dix-huit heures – certains ont réalisé des vols de plus de quarante heures – et cela requiert un personnel capable de travailler par tranches de dix ou douze heures, alternant entre leur foyer et le travail. Nombre d’entre eux ont déclaré que cette répartition leur posait des difficultés considérables.
Comme c’était déjà le cas dans les guerres précédentes, les équipages d’avions conventionnels sont d’abord déployés dans des lieux éloignés du conflit. Lorsqu’ils retournent à leurs bases à la fin d’une mission, ils restent cantonnés au sein d’un espace militaire qui leur permet de rester fixés sur l’objectif et de sauvegarder leur « intégrité psychique ». C’est également le cas pour les équipages de lancement et de récupération. Mais c’est beaucoup plus compliqué pour ceux qui travaillent dans des unités dédiées aux Predators et aux Reapers, stationnées aux États-Unis. L’un d’eux a ainsi résumé le problème en expliquant qu’ils « font le trajet jusqu’à leur travail aux heures de pointe, se glissent sur un siège situé en face d’une rangée d’écrans, dirigent un engin de guerre aéroporté en vue de lancer des missiles sur un ennemi situé à des milliers de kilomètres, avant de récupérer les gosses à l’école sur le chemin du retour ou d’acheter une brique de lait à l’épicerie du coin et de rentrer chez eux pour le dîner. » Il décrivait cette situation comme « une existence schizophrénique, répartie en deux mondes ». La pancarte à l’entrée de la base aérienne de Creech annonce « Vous entrez sur le CENTCOM AOR [Aire d’OpéRation] », mais « On aurait tout aussi bien pu écrire “Vous entrez sur le territoire d’Alice au pays des merveilles et de Lewis Caroll’’, vu la manière dont mes deux mondes restaient étrangers l’un à l’autre »7 Matt Martin avec Charles W. Sasser, Predator. The Remote control Air War over Iraq and Afghanistan : A Pilot’s Story, Zenith, Minneapolis, 2010, p. 44–45. Dans une veine encore plus … Continue reading. « La chose la plus étrange à mes yeux , a expliqué un pilote, est de se lever le matin, de conduire mes enfants à l’école puis de tuer des gens8 Rob Blackhurst, « The Air Force Men Who Fly Drones in Afghanistan by Remote Control », Telegraph, 24 septembre 2012.. » Un autre confirme qu’il existe « une déconnexion particulière liée au fait de livrer une guerre par écran interposé, depuis un fauteuil rembourré, dans une banlieue américaine », avant de rentrer chez lui, « toujours tout seul avec ses pensées et le poids de ce qu’il avait fait »9 Notez que ce n’est pas le fait de tuer qui est étrange – après tout ce que des officiers sont entraînés à faire –, mais sa proximité avec la vie quotidienne..
Les combattants à distance sont peut-être plus vulnérables à cette forme de stress et d’instabilité post-traumatiques – le résultat moins de ce qu’ils ont vu que de ce qu’ils ont fait, même si les deux sont évidemment liés. Cet état est sans doute aggravé par les perpétuels allers-retours entre les deux mondes10 Élisabeth Bumiller, « A Day Job Waiting for a Kill Shot a World Away », New York Times, 29 juillet 2012. Voir aussi Elijah Solomon Hurwitz, « Drone Pilots : “overpaid, … Continue reading.
Dans Grounded, pièce de théâtre de George Brant, une pilote décrit sa difficulté à maintenir la séparation nécessaire pour décompresser ; progressivement, et de manière de plus en plus marquée, l’un des deux espaces a tendance à se fixer en surimpression sur l’autre ; l’organe précis et fixe (semblable au regard de la Gorgone) se voit remplacé par une vision brouillée et elle finit par ne plus savoir où (ni qui) elle est. Les deux mondes commencent à n’en faire qu’un : le désert emprunté lors de ses trajets de retour nocturne de Creech ressemble désormais aux paysages désertiques, grisés, d’Afghanistan, tandis que le visage d’une enfant sur son écran, la fille d’une cible prioritaire, se transforme en celui de son propre enfant11 George Brant, Grounded, Oberon Books, London, 2013. Tout comme le 5000 Feet is the Best d’Omer Fast, le statut fictionnel de ce travail ne l’empêche pas d’être fondé sur une lecture … Continue reading. La mise en scène de Brant est d’autant plus marquante que l’attention du public a habilement été distraite, de manière à ce qu’il ne comprenne pas tout de suite cette évidence : lui aussi est contrôlé à distance, « télécommandé ».
Quand des voix critiques s’élèvent pour dénoncer les frappes de drones dirigées par la CIA au Pakistan ou ailleurs, qu’elles demandent à en connaître les fondements juridiques ainsi que les règles et procédures suivies, elles détournent l’attention publique du Waziristan vers Washington. Madiha Tahir a dénoncé le fonctionnement de ce qu’elle nomme « la performance théâtrale de fausse confidentialité » de l’administration Obama concernant ses guerres de drone dans les « Régions tribales fédéralement administrées du Pakistan », performance qui permet de focaliser l’opinion sur le spectacle de la politique américaine plutôt que vers les corps des Pakistanais gisant au sol.
Par l’intermédiaire de ce spectacle de foire atrocement efficace, Obama et son armée d’aboyeurs et de bonimenteurs (des porte-parole parlant « sous couvert de l’anonymat » parce qu’ils ne sont « pas autorisés à parler officiellement » ainsi que des baratineurs servant de façade officielle, comme Harold Kohn et John Brennan12 Koh a travaillé comme conseiller juridique au département d’État tandis que Brennan a fait la plupart de ses déclarations en tant que Deputy National Security Advisor for Homelands Security … Continue reading) ne mettent pas seulement en scène un secret erroné, mais également son opposé : une fausse intimité par laquelle le débat public se focalise sur la transparence et la responsabilité, comme si c’était le seul domaine qui importait. Au vrai, explique Tahir, « quand vous demandez aux personnes qui vivent sous la menace des drones ce qu’eux voudraient, ils ne répondent pas “la transparence et la responsabilité”. Ils disent qu’ils veulent la fin des tueries. Ils veulent cesser de mourir. Cesser de se rendre aux funérailles – et d’être bombardés même quand ils pleurent leurs morts. La transparence et la responsabilité sont pour eux des problèmes abstraits qui n’ont pas grand-chose à voir avec la réalité concrète de ces crimes réguliers et systématiques »13 Madiha Tahir, « Louder than Bombs », New Inquiry 6, 2012. Il y a une autre objection contre les sirènes de la « transparence et de la responsabilité ». Fleur … Continue reading.
La deuxième série de cadres géographiques que j’aimerais étudier a trait aux étranges connexions qui permettent ces opérations. Tuer d’une distance toujours plus grande est un leitmotiv dans l’histoire de la guerre. L’aviateur américain Charles Lindbergh voyait cette caractéristique comme la plus représentative des guerres modernes, celles où « quelqu’un tue à distance, mais ne le réalise pas en le faisant ». Loin de se représenter « les corps mutilés et agonisants » sur la terre ferme, écrivait-il en 1944, l’aviateur se sent davantage extérieur, comme s’il « voyait la scène se dérouler sur l’écran d’un cinéma, dans un théâtre situé à l’autre bout du monde »14 Michael Sherry, The Rise of American Air Power: The Creation of Armageddon, Yale University Press, New Haven CT, 1987, p. 209–210. Pour toutes ces raisons, il semble naïf de s’opposer aux … Continue reading. Nombre de commentateurs ont affirmé que la prophétie de Lindbergh s’était réalisée – et radicalisée – dans la guerre des drones contemporaine.
Il est certain que l’on tue désormais d’une distance toujours plus grande et que le meurtre n’est plus seulement projeté sur un écran, mais également exécuté par son intermédiaire. De nombreux critiques insistent sur le fait que l’indifférence s’accroît avec la distance, même si le processus n’est pas aussi automatique que beaucoup le croient. Dans ses Lettres sur les aveugles (1749), Denis Diderot demandait : « Nous-mêmes, ne cessons-nous pas de compatir lorsque la distance ou la petitesse des objets produit le même effet sur nous que la privation de la vue sur les aveugles ? » Sa question résonne à travers l’histoire plus tardive du bombardement. Un Commandant de bombardier de la RAF, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, parlait à n’en pas douter au nom d’innombrables camarades quand il admit que « ces lumières scintillantes sur un arrière-fond de velours n’étaient en rien des gens pour moi, juste des cibles. Ce sont la distance et l’absence de visibilité qui vous permet de faire ces choses »15 Harold Nash, cité par James Taylor et Martin Davidson, Bomber Crew, Hodder & Stoughton, London, 2004, p. 447 ; et Derek Gregory, « Lines of Descent », dans Peter Adey, Mark … Continue reading. La différence aujourd’hui ? Les retours vidéo filmés par les drones compensent ce manque de visibilité. Or les critiques insistent sur le fait que l’impression de détachement n’est pas seulement conservée par l’écran lui-même, mais également aggravée par lui. L’écran ramènerait la violence militaire au statut de jeu vidéo et inculquerait une « mentalité PlayStation » à ceux qui la perpètrent.
Le sujet est cependant considérablement plus compliqué qu’on pourrait le penser. Les jeux vidéo contemporains sont hautement immersifs, et les vidéos en haute résolution fournies par les drones permettent aux équipages de rétorquer qu’ils ne sont pas situés à des milliers de kilomètres des zones de guerre, mais plutôt à cinquante centimètres : la distance entre l’œil et l’écran. La sensation de proximité visuelle est aussi palpable que convaincante. En outre, les équipes sont souvent chargées de traquer une personne pendant des semaines entières, voire des mois : « On les voit en train de jouer avec leurs chiens ou de faire leur lessive. On connaît leurs habitudes comme on connaît celles de nos voisins. On se rend même à leurs enterrements16 Philip Alston, « Report of the United Nations, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions : Study on Targeted Killings », mai 2010 ; Chris Cole, Mary … Continue reading. » Voilà pourquoi ce même officier suggère que « d’une certaine manière, la guerre est devenue intime ». Un autre insiste sur le fait que lui et ses collègues « comprennent que les existences aperçues sur l’écran sont aussi réelles que les nôtres »17 « We are Predator / UAV Pilot / Operators Currently in Afghanistan », janvier 2013, reddit.com/r/IAmA/comments/17j9wa/e_are_predator_uav_pilotoperators_currently_in.. Le journaliste Mark Bowden fait écho à ces sentiments. « Les pilotes de drone deviennent intimes avec leurs victimes », écrit-il, ajoutant qu’ils les observent dans « leur vie au quotidien, auprès de leurs femmes et de leurs amis, de leurs enfants ». Ce qu’il désigne comme « la clarté éblouissante de l’image offerte par l’optique des drones » implique que « la guerre télécommandée se révèle chargée d’intimité »18 Mark Bowden, « The Killing Machines », The Atlantic, 14 septembre 2013..
Cette « course à l’intime » est devenue de plus en plus déterminante dans de nombreuses opérations militaires. Elle se révèle ici – comme partout ailleurs19 Derek Gregory, « The Rush to the Intimate: Counterinsurgency and the Cultural Turn », Radical Philosophy 150, 2008, p. 8–23. – violemment intrusive et chargée de questions en suspens. Et les conditions dans lesquelles elle se déroule sont révélatrices. Premièrement, les équipages peuvent voir sans être vus. Comme l’explique Grégoire Chamayou dans Théorie du drone (éd. La Fabrique, 2013) : « Le fait que le tueur et sa victime ne soient pas inscrits dans des “champs perceptifs réciproques” facilite l’administration de la violence20 Chamayou, Théorie du drone, p. 167 ; Stanley Milgram, Obedience to Authority : An Experimental View, Harper & Row, New York, 1974.. » La séparation physique entre un acte et ses conséquences est grandement accentuée dans les opérations à distances. Un état de fait aggravé par la répartition des rôles dans la chaîne de commandement : des officiers supérieurs, des juristes militaires, des spécialistes de l’image et des commandants de l’armée de terre étudient avec attention les retours vidéo des Predators et des Reapers. Cela contribue à répartir le « personnel » d’une telle manière que, pour beaucoup de membres de l’équipe, l’acte en question en devient également plus impersonnel21 Le réseau sert aussi à distribuer la responsabilité : « La responsabilité pour le tir pouvait être disséminée sur toute la chaîne, à un grand nombre de personnes : le … Continue reading. La technologie nous « hypnotise », explique le reporter Mark Benjamin, mais « elle rend également le fait de tuer un autre être humain sinistrement impersonnel »22 Mark Benjamin, « Killing “Bubba” from the Skies », Salon, 15 février 2008, salon.com/2008/02/15/air_war..
Les enregistrements vidéo mettent en scène ce qu’Harun Farocki désigne sous le terme d’« images opérationnelles », « qui ne représentent pas un objet, mais font partie d’une opération »23 Harun Farocki, « Phantom Images », Public 29, 2004, p. 12–24 ; c’est moi qui souligne.. Le caractère « impersonnel » de l’opération n’est pas uniquement fonction de la technologie : ce qui importe est justement son incorporation au sein d’un processus – une procédure opérationnelle standard – et d’une chaîne de commande qui est à la fois techno-scientifique et quasi juridique. Cette alliance est cruciale. Eyal Weizman note que les programmes utilisés pour estimer les dommages collatéraux activent une forme d’instrumentalisation calculée, qui fonctionne non seulement pour améliorer les opérations en question, mais également pour les justifier. En résumé : « La violence légifère24 « C’est le geste même de calculer – le fait même qu’un calcul ait eu lieu – qui justifie leurs agissements » ; Eyal Weizman, The Least of All Possible Evils: Humanitarian … Continue reading. » Le meurtre est conduit sous la bannière de la Raison militaire, qui investit le processus avec un détachement expressément conçu pour minimiser les réponses émotionnelles. Le tout est composé d’une économie visuelle intrinsèque qui imprègne l’opération d’une signification particulièrement tronquée. Ainsi que l’observe Nasser Hussain, le son modèle l’image, et dans le cas de l’assassinat à distance, « l’absence de son synchronisé transforme l’image en un monde fantôme, dans lequel les figures semblent dénuées de vie, même avant qu’elles ne soient tuées. Le regard oscille en silence. Le détachement que craignent les critiques du drone provient en partie du silence associé aux séquences »25 Nasser Hussain, « The Sound of Terror: Phenomenology of a Drone Strike », Boston Review, 16 octobre 2013, bostonreview.net/world/hussain-drone-phenomenology..
Il faut aux membres des équipes entre six et douze mois pour absorber les connaissances techniques nécessaires aux opérations menées à distance. « Tu te mets chaque jour un peu plus dans la position où tu considères que c’est la vraie vie, que tu y es vraiment », a expliqué un opérateur de capteurs à Omer Fast. Mais, continuait-il, « tu deviens dans le même temps de plus en plus distant émotionnellement »26 Fast, 5.000 Feet is the Best, p. 100.. Autre citation parlante, celle de cet officier qui plus haut évoquait la guerre en expliquant qu’elle devenait plus « intime » : « Je ne décrirais jamais cela comme une connexion émotionnelle, mais plutôt comme une forme […] de sérieux. J’ai observé cet individu, et, quel que soit le nombre d’enfants qu’il ait, quelle que soit la proximité de sa femme […], ma mission est de l’abattre. Le caractère dramatique de ce geste est évident : je vais faire ce geste et cela va affecter sa famille27 David Wood, « Drone Strikes : A Candid, Chilling Conversation with Top US Drone Pilot », Huffington Post, 15 mai 2013, huffingtonpost.com/2013/05/15/dronestrikes_n_3280023.html.. »
Cette forme d’intimité envahissante et intrusive – Matthew Power la désigne comme une « intimité voyeuriste28 Matthew Power, « Confessions of a Drone Warrior », GQ, 23 octobre 2013. » – ne favorise pas l’identification à ceux dont les existences sont sous surveillance. Ils restent obstinément autres, position qui ressort parfaitement du témoignage d’une femme pilote expliquant qu’« elle ne voulait pas être comme ces femmes afghanes qu’elle observait – soumises et voilées de la tête aux pieds »29 Abé, « Dreams ». La passivité présumée des Afghans en général et de femmes afghanes en particulier est un lieu commun des récits orientalistes-humanitaires de la guerre comme … Continue reading. Ce sentiment d’altérité n’est pas que le produit d’une séparation culturelle ; il découle également d’une herméneutique techno-culturelle de la suspicion. Quand les équipes manœuvrant des drones sont appelées en renfort pour fournir un appui aérien rapproché aux troupes terrestres, leur géographie sensorielle se diversifie parce qu’ils ne sont plus seulement immergés dans des retours vidéo, mais également dans un flux de communications radio et de messages en réseau avec les troupes de terrain via mIRC F. Ce faisant, elles sont insérées dans ce que le Colonel Kent McDonald de l’École médicale d’aérospatiale de l’US Air Force décrit comme une « relation virtuelle » avec les soldats terrestres. Cette relation ne peut exister pour les « autres », qui restent définis uniquement par leur signature optique30 Je pense ici à l’incident de « tir ami » –le premier du genre ayant impliqué un drone – au cours duquel les signatures infrarouges d’un Marine et d’un soldat de la Navy … Continue reading (une dépersonnalisation que les soldats américains ne connaissent jamais, sauf accidentG)31 Élisabeth Bumiller, « Air Force Drone Operators Report High Levels of Stress », New York Times, 18 décembre 2011.. Malgré des limites évidentes, cette interaction entre équipes de drones et équipes terrestres constitue une relation fondée sur la réciprocité et dont les « autres » sont complètement exclus. Un officier dépeignait ceci en ces termes : « Ceux qui utilisent ce système sont très impliqués personnellement dans le combat. Vous entendez les rafales d’AK 47 et l’intensité des voix appelant à l’aide sur la radio. Vous regardez cette personne, vous êtes à 50 cm d’elle, et vous utilisez tous les moyens à votre portée pour la sortir de ses ennuis32 Megan McCloskey, « Two Worlds of a Drone Pilot », Stars and Stripes, 27 octobre 2009. Grossman suggère qu’un sentiment de responsabilité envers ses camarades-soldats est un … Continue reading. »
« L’intimité » est par conséquent développée dans un champ culturel divisé (une autre forme de rupture induite par le contrôle à distance) dans lequel les équipages sont tellement appelés à s’identifier à leurs camarades de combat qu’ils sont prédisposés à interpréter toute autre action (soit : toute action d’un « autre ») comme hostile ou dangereuse. Cela a parfois des conséquences désastreuses pour des innocents33 Dans mon texte « Lines of Descent », je décris un tel accident dans la province afghane d’Uruzgan en février 2010, au cours duquel 33 civils furent tués et plus d’une douzaine … Continue reading. Peu importe que les investigations militaires portant sur des dommages collatéraux évoquent souvent « l’erreur humaine plutôt que les dysfonctionnements de la machine » – ce qui est relativement vrai, et soulève d’autres questions éthiques34 Cf. Jeremy Packer et Joshua Reeves, « Romancing the Drone : Military Desire and Anthrophobia from SAGE to Swarm », Canadian Journal of Communications 38, 2013, … Continue reading –, car les erreurs de ce type sont avant tout produites par la fonction opérationnelle d’un système techno-culturel dont les dispositions favorisent de telles issues.
« Si les individus utilisent des instruments technologiques, explique Judith Butler, l’inverse est également vrai : ces instruments utilisent eux-mêmes les individus (ils les positionnent, leur fournissent des perspectives, établissent les trajectoires de leurs actions) ; ils encadrent et forment tous ceux qui entrent dans leur champ visuel ou sonore, mais aussi, réciproquement, ceux qui n’en font pas partie35 Judith Butler, Frames of War : When Is Life Grievable ?, Verso, London and New York, 2010, p. XI ; Caroline Holmqvist, « Undoing War : War Ontologies and the Materiality of … Continue reading. »
Ce n’est pas le cas des situations d’appui aérien de proximité, mais quand les équipages sont impliqués dans des missions d’assassinats ciblés, elles œuvrent main dans la main avec la Joint Prioritized Effects ListH de l’armée (ou, dans le cas d’attaques aériennes dirigées par la CIA, dans la « Disposition MatrixI » approuvée par le Centre de Contre-terrorisme36 Daniel Kleidman, Kill or Capture: The War on Terror and the Soul of the Obama Presidency, Houghton Mifflin, New York, 2012 ; Greg Miller, « Plan for Hunting Terrorists Signals U.S. … Continue reading), des dispositifs desquels la présomption d’innocence a déjà été évacuée. La description que fait Martin de la nouvelle norme en matière de ciblage est révélatrice : « Je doute que les pilotes et équipages de B-17 ou de B-29 se tracassaient autant en lâchant des tonnes de bombes sur Dresde ou Berlin que moi lorsque j’ai dû supprimer un criminel roulant en voiture », explique-t-il en évoquant l’assassinat d’une cible connue sous le nom de « Rocket Man », à Sadr City. L’équipage chargé de cette mission avait beaucoup délibéré : « Nous devions nous montrer prudents en réalisant un tir dans cet environnement, pour éviter la mort d’une poignée de personnes qui ne méritaient pas nécessairement d’être tuées37 Martin et Sasser, Predator, p. 50–53 ; Andrew McGinn, « Local Drone Pilot Explains Missions », Dayton Daily News, 22 juin 2013.. »
Le recours décontracté à un langage vernaculaire du maintien de l’ordre – « On a dégommé le criminel ! » – n’a rien d’exceptionnel. Il est intégré au dispositif administratif qui autorise l’assassinat ciblé et relève du processus plus général de judiciarisation de la « kill chain ». Les juristes militaires insistent sur l’importance de récolter ce qu’ils désignent comme une « chaine de garde à vue optique » tout au long de « la poursuite de la cible ». Ce sont des juristes du ministère de la Défense, pas des avocats de la défense, et leurs formulations font évidemment peser la balance au détriment de ceux qui sont pris dans le champ des opérations militaires38 Ces modalités rendent impossible ce que Joseph Pugliese décrit comme un « système général d’échange » entre le dispositif chasseur-tueur « et ses victimes anonymes, qui ne … Continue reading.
Ces considérations recoupent une troisième sorte de géographie qui se développe en rapport avec l’assassinat ciblé. Ce dernier, je dois insister sur ce point, n’est pas la seule fonction remplie par les drones. Et cette tâche n’est d’ailleurs pas non plus leur apanage, ainsi que des dissidents russes et des scientifiques iraniens l’ont appris à leurs dépens – à Londres pour les premiers, à Téhéran pour les seconds. Néanmoins, de nombreux commentateurs ont insisté sur le fait que l’utilisation de drones, particulièrement en matière de frappes ciblées, menaçait de transformer le lieu et la signification de la guerre elle-même.
Le terme « champ de bataille » renvoie autant à un espace physique qu’à un espace normatif. Sa déconstruction physique s’est accélérée depuis au moins la Première Guerre mondiale, quand le recours au bombardement a redessiné les contours de la mise à mort d’une manière si dramatique que Giulio Douhet a pu déclarer qu’à l’avenir « l’espace du champ de bataille ne sera plus limité que par les frontières des pays en guerre, tandis que tous leurs citoyens deviendront combattants, puisque chacun d’entre eux sera exposé aux offensives aériennes de l’ennemi. Il n’y aura plus de distinction entre soldats et civils »39 Giulio Douhet, The Command of the Air, trad. Dino Ferrari, University of Alabama Press, Tuscaloosa, 1988, p. 10 (première édition en italien en 1921) ; Voir Thomas Hipler, Bombing the … Continue reading.
Les drones ont désormais dissous ces limites physiques. L’un des objectifs centraux en matière de politique étrangère de l’administration Bush, qui a animé ses successeurs avec une férocité tout aussi marquée, était de mener « des conflits dans des pays avec qui nous ne sommes pas en guerre ». Les drones ont ainsi transgressé de façon répétée et routinière ces frontières en matière de pays belligérants, assignés qu’ils étaient à la poursuite de missions transnationales de chasseurs-tueurs – tout particulièrement dans le cadre de la guerre « secrète » au Pakistan40 Maria Ryan, « “War in countries we’re not at war with” : The “War on Terror” on the Periphery from Bush to Obama », International Politics 48, 2011, p. 364–389. … Continue reading.
Cependant, en un contraste marqué avec les pronostics lugubres de Douhet concernant la reconfiguration de l’espace normatif de la guerre – qui ont été tristement confirmés par chaque campagne de bombardement stratégique depuis la Première Guerre mondiale41 Yuri Tanaka et Marilyn B. Young, éds, Bombing Civilians : A Twentieth-century History, New Press, New York, 2010. –, les drones auraient également renforcé le principe de bonne distinction des cibles. Leurs promoteurs affirment que leur présence sur la durée et leurs capacités améliorées de surveillance garantissent un respect sans précédent des obligations en matière de droit humanitaire international concernant la distinction entre combattants et civils42 Voir Michael Lewis et Emily Crawford, « Drones and Distinction », University of Sydney Law School, Legal Studies Research paper 13/35, 2013; Jack Beard, « Law and War in the … Continue reading. Ce débat recoupe forcément deux champs, l’un fondé sur les faits – le nombre de morts et de blessés43 Il n’existe pas de statistiques spécifiques pour les victimes directement causées par des drones en Afghanistan, mais étant donné que les drones sont aussi utilisés pour fournir des … Continue reading – l’autre sur l’aspect sémantique, ce dernier interrogeant les frontières entre combattant et civil dans un cadre de guerre irrégulière. Mais il est également sous-tendu par une problématique normative, et même par un « nomos » – quelque chose approchant du sentiment d’agencement spatial proposé par Carl SchmittJ. La raison en est qu’au cœur même de la réponse américaine au 11-Septembre reposait ce que Frédéric Mégret voit comme « une tentative délibérée de manipuler ce qui constitue le champ de bataille et de le transcender dans des évolutions qui libèrent la violence plus qu’elles ne la contraignent »44 Frédéric Mégret, « War and the Vanishing Battlefield », Loyola University Chicago International Law Review, vol. 9, no 1, 2012, p. 131–155, p. 148.. Cela conduit au projet concerté de transformer l’un des principaux registres de l’imaginaire de la guerre, avec l’accent mis sur l’individualisation de la mise à mort45 Samuel Issacharoff et Richard Pildes, « Drones and the Dilemma of Modern Warfare », dans Peter Bergen et Daniel Rothenberg, édit., Drone Wars : The Transformation of Armed Conflict … Continue reading.
Pratiquement et théoriquement, l’individualisation aseptise le champ de bataille : l’opinion publique n’est plus confrontée aux images de destruction à grande échelle provoquée par le bombardement de villes entières ou par celles de tapis de bombes s’abattant sur des villages en pleine forêt tropicale. « Rien à voir avec Dresde », m’a-t-on répété inlassablement, comme s’il s’agissait du standard approprié pour juger de la conduite contemporaine d’une guerre. Ces frappes contre des individus sont des ponctuations au sein de ce que Jeremy Scahill nomme des « guerres sales », lesquelles « libèrent la violence » et menacent de transformer la terre entière en champ de bataille46 Scahill, Dirty Wars. Scahill mentionne un mémo de Rumsfeld en 2004 : « Le monde entier est un champ de bataille » (p. 173). Comme je vais le dire plus loin cependant, cela ne veut … Continue reading.
Dans les guerres conventionnelles, les combattants sont autorisés à tuer sur le fondement de ce que Paul Kahn désigne comme leur identité corporative : « Le combattant ne porte pas la responsabilité individuelle de ses actions, parce que ses actes ne sont pas plus les siens que les nôtres. […] La guerre est un conflit entre des sujets appartenant à une corporation et inaccessibles à la notion ordinaire de responsabilité individuelle, plutôt qu’entre soldats ou officiers. »
L’ennemi peut être tué, quel que soit ce qu’il ou elle est en train de faire (excepté s’il se rend). Juridiquement, il n’y a pas de différence entre le fait de tuer un général ou de tuer son chauffeur, entre lancer un missile sur une batterie qui menace votre engin volant où lâcher une bombe sur un baraquement en pleine nuit. « L’ennemi est toujours dénué de visage, explique Kahn, parce que nous n’attachons pas plus d’importance à son histoire personnelle qu’à ses espoirs pour le futur. » Les combattants sont par conséquent vulnérables à la violence non seulement parce qu’ils sont ses vecteurs, mais également parce qu’ils sont enrôlés dans le mécanisme qui l’autorise : ils sont tués non pas en tant qu’individus, mais en tant que porteurs contingents (parce que temporaires) d’une corporation supposée hostile.
Mais désormais, dans la mesure où la force militaire est dirigée contre des individus spécifiques sur la base d’actes déterminés qu’ils ont commis ou, par extension préventive, sont susceptibles de commettre, apparaît une subjectivité politique différente, dans laquelle l’ennemi se voit transformé en criminel. « Le criminel est toujours un individu, écrit Kahn, ce n’est pas le cas de l’ennemi »47 Paul Kahn, « Imagining Warfare », European Journal of International Law, vol. 24, no 1, 2013, p. 199–226..
Cet état de fait présente au moins quatre implications en matière de géographie de la violence militaire. Premièrement, l’individualisation transforme les contours du renseignement. À tel point que Peter Scheer suggère que « la logique de la guerre et celle du renseignement ont permuté, l’une devenant l’image en miroir de l’autre »48 Peter Scheer, « Connecting the Dots between Drone Killings and Newly Exposed Government Surveillance », Huffington Post, 8 juin 2013.. Tandis que le ciblage s’est focalisé sur les individus, la collecte de renseignements s’est transformée en exploitation de bases de données et en interception de ces mêmes données à une échelle planétaire. Il est naturellement difficile de relier ces points de manière détaillée, mais les intrusions planétaires de la National Security Agency (NSA) ont été largement documentées par Glenn Greenwald, qui a utilisé des informations classifiées fournies par un ancien contractuel de la NSA, Edward Snowden.
Bien que l’on n’ait accès qu’à un instantané grossier des capacités de ses Opérations de collecte globale, « Boundless InformantK » constitue une couverture de haute volée mise en place pour une multitude de systèmes interconnectés. Pris dans leur ensemble, ces documents cartographient une dimension fondamentale de la guerre sans frontières. Le Pakistan s’affirme ainsi comme l’une des cibles principales de la surveillance secrète, tandis qu’Hassan Ghul, chef des opérations militaires d’Al Qaeda a été une Cible prioritaire particulièrement suivie. Une série de communications interceptées ont fourni à la Counter Terrorism Mission Aligned Cell (CT-MAC) de la NSA un « vecteur » des codes utilisés par Ghul tandis qu’il gravitait dans les environs des Régions tribales fédéralement administrées du Pakistan (il passait en fait d’une maison sécurisée à une autre). Finalement, on intercepta un e-mail de sa femme qui contenait suffisamment d’informations pour établir les coordonnées précises nécessaires à une frappe de drone. Elle se déroula près de Mir Ali, dans le Waziristan du Nord, et le tua, ainsi que deux de ses compagnons le 1er octobre 201249 Glenn Greenwald et Ewan MacAskill, « Boundless Informant: The NSA’s Secret Tool to Track Global Surveillance Data », Guardian, 11 juin 2013 ; Greg Miller, Julie Tait et … Continue reading. Dans ce cas précis, et sûrement dans beaucoup d’autres, l’espace de l’individu pris comme cible est un bon exemple de ce que Rob Kitchin et Martin Dodge nomment « espace/code », un espace produit et activé par un logiciel et qui, dans sa spatialité, est « à la fois local et global, situé en un lieu précis, mais accessible de n’importe quel endroit via le réseau »50 Rob Kitchin et Martin Dodge, Code/Space : Software and Everyday Life, MIT Press, Cambridge MA, 2012, p. 17. .
Deuxièmement, l’individualisation implique un ensemble de techniques juridiques chargées d’identifier positivement, détecter et traiter l’individu-cible – ce qui élargit le champ d’action juridique de la violence militaire : « Dans la mesure où quelqu’un peut être ciblé en vue de l’usage de la force militaire (capture, détention, assassinat) uniquement en raison des actes précis et spécifiques auxquels il ou elle a participé, la violence militaire se rapproche de plus en plus aujourd’hui d’une “judiciarisation” implicite de la responsabilité individuelle51 Issacharoff et Pildes, « Drones and the Dilemma of Modern Warfare ». Cela accentue l’incorporation croissante des juristes à la kill-chain. Voir Craig Jones, « War, Law and … Continue reading. »
La distinction traditionnelle entre les opérations militaires et celles relevant de la police, les unes étant tournées vers « l’extérieur » et les autres vers « l’intérieur », s’était déjà trouvée bousculée, notamment par l’utilisation de l’expression fourre-tout « Forces de sécurité ». Elle est aujourd’hui rendue encore plus perméable par ce que Chamayou désigne comme une « doctrine étatique de violence non-conventionnelle », combinant des éléments relevant aussi bien des opérations militaires que des opérations policières, sans réellement s’inscrire précisément dans l’un de ces champs : « des opérations hybrides, enfants terribles de la police et de l’armée, de la guerre et de la chasse52 Chamayou, Théorie du drone, p. 51 ; cf. Colleen Bell, Jan Bachmann et Caroline Holmqvist, édit., The New Interventionism: Perspectives on War–Police Assemblages, Routledge, Londres, 2014.. » Ces nouveaux vecteurs de la violence étatique traversent les frontières dans les deux sens, aussi bien vers l’intérieur que vers l’extérieur. Dans la vision horrifiée qu’en donne Kahn, ils incarnent « le pouvoir politique considéré comme une administration de la mort ». Ne correspondant ni à l’état de guerre ni au maintien de l’ordre, « cette nouvelle forme de violence », conclut-il, « doit être vue comme la forme high-tech d’un régime de disparition »53 Kahn, « Imagining Warfare », p. 226. Cette modalité du pouvoir aérien peut être qualifiée de « police » dans le sens foucaldien proposé par Mark Neocleous, mais je ne … Continue reading.
Troisièmement, l’individualisation renvoie à la production technique d’un individu sous la forme d’un objet à cibler, loin des bouffées d’humanité qui jaillissent brièvement sur les écrans vidéos des Predators. La personne est appréhendée via une image sur écran, une trace sur un réseau et une signature sur un capteur. L’individu-cible qui en résulte est à la fois artificiel et compressé. Les « cibles prioritaires » sont nommées et font l’objet de « frappes de personnalité » (même si en Afghanistan nombre d’entre elles n’étaient en fait que des individus liés de manière plus ou moins marquée aux combattants aguerris des talibans ou d’Al Qaeda), mais la plupart des mises à mort ciblées sont dirigées contre des sujets anonymes (« sans visage »)54 Kevin Jon Heller, « “One hell of a killing machine” : Signature Strikes and International Law », Journal of International Criminal Justice 11, 2013, p. 89–119.. Ils sont introduits dans le champ de vision militaire par une rythmanalyse L et une étude des réseaux qui font apparaître des éléments dénotant un « schéma de vie » suspect, une sorte de balistique de l’espace-temps, dont les méthodes d’exécution ont été parfaitement disséquées par Joseph Pugliese : « Le terme militaire de “schéma de vie” est imprégné de deux systèmes entrelacés de compréhension scientifique : algorithmique et biologique. Dans le premier, le sujet humain détecté par les caméras de surveillance des drones est transformé via des algorithmes en une séquence de chiffres modélisée : des suites numériques de zéros et de uns. Converti en données numériques codées en tant que “schéma de vie”, le sujet humain ciblé est réduit à un simulacre anonyme qui tressaute sur l’écran et peut être efficacement liquidé via un “schéma de mort” déclenché par un joystick. Analysés à travers la vision scientifique de la biologie clinique, “les schémas de vie” connectent les technologies de surveillance des drones aux techniques d’une science instrumentaliste, à sa vision constitutive de détachement objectif et à sa production de violence exterminatrice. Les “schémas de vie” sont ce que l’on découvre et analyse dans les boîtes de Pétri d’un laboratoire55 Pugliese, State Violence, p. 193–194. Pour une discussion de l’imaginaire biopolitique qu’organisent ces métaphores, voir Colleen Bell, « Hybrid Warfare and Its … Continue reading. »
L’acte de tuer se voit considéré comme le point culminant de l’histoire naturelle de la destruction – dans un sens qui n’est précisément pas celui que pointait W.G. Sebald56 Derek Gregory, « “Doors into nowhere” : Dead Cities and the Natural History of Destruction », dans Peter Meusburger, Michael Heffernan et Edgar Wunder, édit., Cultural … Continue reading – et les cibles sont prises en compte « individuellement » dans un registre beaucoup plus comptable que corporel. Les autres victimes qui sont accessoirement tuées au cours d’une frappe restent la plupart du temps non identifiées par ceux qui sont responsables de leur mort : « dommages collatéraux » frappant des individus dont l’anonymat confirme qu’ils ne sont pas considérés comme tels, mais comme tributaires d’une punition collective57 Gregory, « Potential Lives »..
Par le biais de cette focalisation sur une mise à mort unique – via une « frappe chirurgicale » –, les autres personnes affectées sont placées hors du tableau. Toute mort entraîne des effets qui dépassent largement la simple question de la victime concernée, mais ceux qui planifient et exécutent un meurtre ciblé ne sont concernés que par le sort du terroriste ou du réseau insurgé à laquelle la cible est supposée être attachée. Pourtant, ces opérations provoquent, de manière annexe, mais pas accidentelle, d’immenses dégâts dans le tissu social dont il ou elle faisait partie – sa famille étendue, la communauté locale, etc. La sensation de perte continue à hanter d’innombrables autres individus (qui ne sont jamais comptabilisés)58 Ces effets en réseau sont devenus un grand classique des bombardements modernes. Lorsque l’armée israélienne à Gaza ou l’armée américaine en Irak affirment avoir « seulement » … Continue reading. Amnesty International a ainsi documenté une frappe qui s’est déroulée près du village de Ghundi Kala, dans le Waziristan du Nord, le 24 octobre 2012, incluant dans son étude une photographie annotée montrant la position de la famille de Mamana Bibi qui travaillait dans les champs avec elle quand elle fut tuée. Personne n’a expliqué pourquoi la grand-mère était visée, mais son fils, réconfortant les petits-enfants de Mamana traumatisés par ce qu’ils avaient vu cet après-midi ensoleillé, expliqua qu’« elle était le lien qui maintenait l’unité de notre famille. Depuis sa mort, le lien est coupé et la vie n’est plus la même. Nous nous sentons seuls et perdus »59 Will I Be Next ? US Drone Strikes in Pakistan, Amnesty International, Washington DC, 22 octobre 2013, p. 18–23. Il y a eu plusieurs tentatives pour discréditer le rapport d’Amnesty, dont … Continue reading. L’attention des critiques s’est focalisée, de manière conséquente et compréhensible, sur la constitution de ce que Judith Butler nomme une « vie dont on peut porter le deuil », mais il semble tout aussi important de cerner ce qui constitue une « vie survivante »60 Judith Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Verso, Londres et New York, 2004; Butler, Frames of War..
Il faut sans aucun doute nous interroger, avec Madiha Tahir, sur ce que ressent quelqu’un qui vit parmi les ruines, ce qu’il en coûte de faire face à un sentiment de perte qui est à la fois profondément personnel et irrémédiablement collectif61 Madiha Tahir, « The Business of Haunting », 2 septembre 2013, woundsofwaziristan.com/business-of-haunting.. La même question a hanté l’histoire du bombardement pendant une centaine d’années, mais sa gravité n’est en rien atténuée par le fait que les Predators et Reapers ont remplacé les bombardiers Lancaster et les Forteresses volantes.
Quatrième point : l’individualisation implique que la guerre suive à la trace l’individu-cible. C’est une forme de ciblage dynamique poussé à l’extrême. La chasse à l’homme fonctionne sur les logiques de poursuite et d’évasion, explique Chamayou, de prédateur et de proie – l’un avance tandis que l’autre fuit62 Chamayou, Théorie du drone, ch. 6. Les chasses à l’homme ne traite pas directement des drones, mais voir son article « The Manhunt Doctrine », Radical Philosophy 169, … Continue reading. En Afghanistan et au Pakistan, cela a débouché sur une danse macabre* dans laquelle les insurgés traversent la frontière de l’Afghanistan au début de la saison des combats, au printemps, et font ensuite retraite dans leurs sanctuaires pakistanais à la fin de l’été. Mais l’espace militaire et paramilitaire n’est plus circonscrit par quelque champ de bataille que ce soit, ni par une zone de guerre limitée : le lieu de la frappe ciblée est défini par la présence fugitive de l’ennemi-proie. Il n’y a clairement plus d’alternatives. Les départements américains de contre-insurrection et de contre-terrorisme travaillent main dans la main à cet effet. Leurs opérations « kinétiques » mortelles déploient des drones pour des combats sur le front en Afghanistan et pour des frappes ciblées en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen, en Somalie et ailleurs. Mais il y a une distinction importante entre les deux. Kahn explique que la force létale peut légalement être tournée contre un ennemi en raison de son statut : c’est la logique de la guerre telle que supervisée par le droit international humanitaire (parfois appelé droit des conflits armés).
Mais la force létale ne peut être utilisée contre quelqu’un soupçonné d’être un criminel qu’après qu’il ait montré des « signes de dangerosité » : c’est la logique du maintien de l’ordre sous l’égide du droit international humanitaire. Les raisons juridiques invoquées par les Américains pour justifier leurs assassinats ciblés brouillent la frontière entre les deux. L’administration Obama insiste sur le fait que le droit international humanitaire donnerait le cadre opérationnel légal de son recours à la force létale dans ses campagnes de contre-insurrection et de contre-terrorisme, mais elle a également invoqué ce que ses experts juridiques ont désigné comme une « extension » du concept d’imminence, ceci afin d’étendre la poche temporelle au sein de laquelle des individus ciblés sont susceptibles de représenter une menace pour les États-Unis. Sa justification repose ainsi sur l’idée d’autodéfense63 Pour un résumé de ces arguments, voir Thomas Gregory, « Drones : Mapping the Legal Debate », New Zealand Centre for Human Rights Law, Policy and Practice, avril 2013, et, avec … Continue reading. Cela renvoie à cette idée de sphère spatiale de l’assassinat ciblé, parce que l’affirmation des conflits armés transnationaux entre acteurs étatiques et non étatiques, en tant que modalité dominante de la guerre moderne récente, relocalise les assassinats sur un terrain juridiquement non balisé, dans lequel la cible se resserre sur le corps humain d’un individu tandis que le champ de la violence militaire tend à s’étirer jusqu’aux limites du globe.
Chamayou décrit ce phénomène comme une dialectique entre la spécification et la globalisation. « La zone de conflit armé, fragmentée en “kill-box’’ miniaturisables, tend idéalement à se réduire au seul corps de l’ennemi-proie – le corps comme champ de bataille. » Il ajoute : « C’est parce que nous pouvons viser nos cibles avec précision que nous pouvons, disent en substance les militaires et la CIA, les frapper où bon nous semble, et ce même en dehors de toute zone de guerre »64 Chamayou, Théorie du drone, p. 86.. Cette perspective d’un terrain de chasse global produit et ponctué par des « zones mobiles d’exception » perturbe profondément la plupart des critiques65 Joseph Pugliese, « Prosthetics of Law and the Anomic Violence of Drones », Griffith Law Review, vol. 20, no 4, 2011, p. 944..
De telles considérations s’insèrent directement dans une quatrième et dernière série de cadres géographiques qui tracent les contours de ce que Ian Shaw appelle « un empire prédateur ». Un empire par lequel le monde deviendrait une « zone de tir à volonté », selon l’expression de Fred Kaplan66 Ian Shaw, « Predator Empire: The Geopolitics of US Drone Warfare », Geopolitics, vol. 18, no 3, 2013, p. 536–559 ; Fred Kaplan, « The World as Free-fire … Continue reading. Les indices de cette évolution sautent aux yeux. En mars 2011, les Predators et Reapers de l’US Air Force ont réalisé un million d’heures de vol en zone de combat. En octobre 2013, ce chiffre avait déjà doublé. Le Pentagone a en outre pris la décision en janvier 2012 d’augmenter le nombre de drones armés de 30 % en vue de développer une capacité militaire « moins encombrante et plus agile ». Il a également chargé l’armée de l’air de constituer 65 patrouilles aériennes de combat d’ici 2014, avec une capacité à « monter » à 85. Les opérations à distance se sont également étendues de la base aérienne de Creech à plusieurs autres bases des États-Unis, tandis que les USA ont déployé des drones au sein de conflits et d’« opérations contingentes hors du continent » en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Mali, au Pakistan, en Somalie et au Yémen.
Or certaines précautions sont de mise. L’Empire Prédateur de Shaw évoque « les stratégies, pratiques et technologies gravitant autour du déploiement des drones chargés de frappes ciblées », mais uniquement pour réduire l’espace fonctionnel de leur usage à l’assassinat. Et pourtant, son livre étend également leur champ d’action : « Partout et nulle part, les drones sont devenus des outils souverains de vie et de mort », administrés via ce qu’il appelle « une géographie étendue des bases de drones »67 Shaw, « Predator Empire », p. 5 et 14.. Son index géographique est inspiré de celui de Nick Turse, dont l’article « l’empire secret des bases de drones » liste plus de soixante sites. Plus de la moitié d’entre eux sont situés à l’intérieur des États-Unis, bien loin de ce qu’il désigne comme les « joyaux extérieurs de la couronne » (dont certains me semblent davantage relever de la verroterie)68 Nick Turse, « America’s Secret Empire of Drone Bases », TomDispatch, 16 octobre 2011..
Peut-être que ce dernier point importe peu ; l’objectif des opérations à distance étant précisément de faire usage de la puissance depuis la « patrie ». Mais ces chasseurs-tueurs ont comparativement un rayon d’action limité – environ 1 250 kilomètres pour un Reaper et 1 850 pour un Predator –, si bien que leurs bases doivent être situées à proximité du théâtre des opérations. D’où leurs équipes de lancement et récupération déployées sur place. Le Pentagone s’est lancé dans diverses expérimentations conçues pour améliorer la flexibilité opérationnelle, notamment le lancement de drones depuis des avions-cargos, ou la conception de bases pour drones pliables dans des containers de cargos, ceci afin qu’elles puissent être déployées rapidement et que les engins volants puissent être lancés dans les quatre heures suivant leur arrivée69 John Reed, « The Air Force’s Drone Base in a Box », 17 septembre 2013, foreignpolicy.com..
Mais dans leurs formes présentes et dans un avenir proche, ces tentatives n’impliquent pas des armes à portée mondiale (les États-Unis ont déjà développé de terrifiantes aptitudes en la matière, et sont en train d’en développer d’autres, à l’image du Prompt Global Strike, qui sera capable d’effectuer une frappe de missile conventionnel partout dans le monde en moins d’une heure)70 Le RQ-4 Global Hawk est un drone de surveillance à longue portée, mais il n’est pas armé.. Ces plates-formes commandées à distance sont également particulièrement limitées dans leurs aptitudes sur le terrain où elles pourraient être utilisées. Elles sont lentes – la vitesse de croisière d’un Predator est d’environ 135 km/h, celle d’un Reaper de 370 km/h – et loin d’être agiles, si bien qu’elles sont vulnérables aux attaques aériennes. Elles volent à des altitudes qui les mettent à portée des défenses anti-aériennes et ne peuvent donc opérer dans les espaces de combat A2/AD (accès interdit, zone non autorisée)71 La catégorie des procédés « anti-accès » recouvre des mesures de longue portée destinées à tenir à distance une force armée loin d’une zone d’opérations, tandis que le … Continue reading. En septembre 2013, le Général Mike Hostage, commandant de l’USAF Air Combat Command, les décrivait comme « inutiles dans un environnement hostile ». Même en tenant compte des conflits entre services portant des visions différentes de la puissance aérienne, ces limitations ne poussent pas à considérer les Predators et les Reapers en tant que positions avancées de l’Empire américain – même en tant qu’unités de substitution72 John Reed, « Predator Drones “Useless in Most Wars”, Top Air Force General Says », 19 septembre 2013, foreignpolicy.com..
Il ne s’agit pas ici de contester la réalité palpable de l’impérialisme américain, dont l’empreinte militaire est apposée sur plus d’un millier de bases tout autour du monde. Ni de minimiser ses tentatives sans précédent d’établir un système de surveillance globale à trois niveaux incluant des drones non armés à l’image du Global Hawk73 Alfred McCoy, « Imperial Illusions : Information Infrastructure and the Future of US Global Power », dans Alfred McCoy, Josep Fradera et Stephen Jacobson, édit., Endless … Continue reading. Mais son pouvoir militaire et sa capacité de violence militaire sans équivalent sont investis dans des projets plus ambitieux que les Predators et les Reapers.
Cela ne veut pas dire que nous pouvons fermer les yeux sur leur développement et leur déploiement. De nombreux autres pays ont déjà développé, ou sont en train de le faire, une expérience en matière de drones militaires ; la plupart de ces programmes touchent à des engins dépourvus d’armes, mais dans la mesure où ils peuvent être utilisés dans des guerres pour diriger, via leur réseau, des frappes aériennes conventionnelles, la distinction n’est pas si rassurante qu’elle peut sembler l’être74 Rob O’Gorman and Chris Abbott, Remote Control War : Unmanned Combat Air Vehicles in China, India, Iran, Israel, Russia and Turkey, Open Briefing, 20 septembre 2013.. En outre, les coûts financiers d’une technologie telle que le drone tendent à se réduire, si bien que la perspective d’acteurs non étatiques utilisant les drones pour lancer des attaques devient de moins en moins improbable75 David Hastings Dunn, « Drones : Disembodied Aerial Warfare and the Unarticulated Threat », International Affairs, vol. 89, no 5, 2013, p. 1237–1246. D’autres … Continue reading.
Ce qui est certain, c’est que le concept de « zone de tir à volonté » de Kaplan, qui réutilise l’un des slogans les plus effroyables de la guerre du Vietnam, semble pousser l’analyse trop loin. Ce que j’ai décrit comme « une guerre sans frontières » est également une guerre se déroulant quelque part. Quand les États-Unis font usage de drones armés pour exporter leur guerre hors des zones d’hostilité déclarées, ils visent immanquablement certaines des populations les plus vulnérables et dénuées de défense de la terre, lesquelles ont souvent vu leurs propres gouvernements se faire les complices de ces frappes mortelles76 Derek Gregory, « The Everywhere War », Geographical Journal, vol. 177, no 3, 2011, p. 238–250.. Dans ces régions, il n’y a pas de sirènes d’alerte aérienne, pas de défenses ou d’abris antiaériens ; et généralement des services médicaux d’urgence très limités et incapables de venir en aide aux innocents frappés.
Mon propos porte sur un champ qui évolue rapidement. Toute une série d’usages pacifiques pour les drones non armés se développe à grande vitesse, et même ceux que j’ai évoqués ici se trouvent, à l’image d’autres systèmes militaires modernes, accolés à des séries de technologies civiles que la plupart d’entre nous considèrent comme des acquis. C’est en fait précisément de cette manière que les drones armés – leurs technologies, leurs représentations et dispositifs – sont devenus un pan à part entière de la vie quotidienne, qui exige de notre part une vigilance poussée. Ainsi que je le suggérais en commençant, ce sont souvent les artistes qui ont pris les devants dans la remise en cause de ces développements. James Bridle l’expliquait brillamment : « Nous vivons tous sous l’ombre du drone, même si la plupart d’entre nous ont la chance de ne pas vivre directement sous son feu. Mais l’attitude qu’ils représentent – celle de la technologie utilisée de manière dissimulée et violente ; du brouillage de la morale et de la culpabilité ; de l’illusion de l’omniscience et de l’omnipotence ; de la valeur toujours plus réduite accordée à la vie des autres ; de, pour le dire franchement, la guerre perpétuelle – devrait tous nous concerner77 James Bridle, « Under the Shadow of the Drone », 11 octobre 2012, booktwo.org/notebook/drone-shadows ; voir aussi mon billet « Situational Awareness », 3 mai … Continue reading. »
C’est à ce niveau, également, que la « fracture télécommandée » qui caractérise ces opérations est la plus insidieuse. Le débat public aux États-Unis s’est focalisé sur la question du rôle du président dans l’autorisation de l’assassinat de citoyens américains et sur la menace que fait peser la surveillance des drones sur la vie privée. Même ceux qui enquêtent sur la machinerie juridico-administrative via laquelle l’administration Obama conduit ses assassinats ciblés concentrent leurs critiques sur Washington. Tandis que ceux qui interrogent la pratique des opérations à distance évoquent uniquement les bases aériennes situées sur le territoire des États-Unis.
Ce sont des sujets importants, mais nous devrions nous sentir tout autant concernés par la manière dont les drones ont transformé le lieu de vie d’autres personnes en zone mortuaire. Je comprends tout à fait les vives critiques de Roger Stahl concernant la fascination des médias envers les pilotes de drones et la manière dont ils domestiquent habilement la guerre. Les médias réécrivent ainsi la logique de la sécurité nationale et invitent le lecteur-spectateur à se transporter aisément « de la cuisine au cockpit »78 Roger Stahl, « What the Drone Saw : The Cultural Optics of the Unmanned War », Australian Journal of International Affairs, vol. 67, no 5, 2013, p. 659–674.. Mais l’interpénétration de la guerre et de la paix ouvrent un champ géographique encore plus large. Voici ce que déclarait le photoreporter Noor Behram, qui a passé des années à courageusement documenter les effets des frappes de drones sur son Waziristan du Nord natal : « C’était un jour comme les autres dans le Waziristan. Sortir de la maison, remarquer un drone dans le ciel, continuer à mener ta vie sans savoir s’il va te cibler. Ce jour-là, cela s’est passé dans la matinée, alors que j’étais chez moi en train de jouer avec mes enfants. J’ai remarqué le drone et j’ai commencé à le filmer avec ma caméra. Puis je l’ai suivi…79 paglen.tumblr.com/post/30105766943/ reaper-drone-over-waziristan-shot-by-noor-behram ; pour une analyse du travail de Behram, voir Spencer Ackerman, « Rare Photographs Show Ground … Continue reading »
Il faut se munir d’un objectif grand-angle pour saisir les géographies que j’ai mises en exergue dans ce texte. Les drones ont indubitablement fait évoluer la conduite de la guerre contemporaine – et dans le cas des assassinats ciblés, ils ont radicalement transformé l’idée même de conflit armé. Mais leur usage ne peut être dissocié de la matrice de violence militaire et paramilitaire dont ils font intégralement partie. Et c’est cette matrice qui devrait être la cible principale de l’analyse critique et de l’action politique.
Illustrations : James Bridle / Drone Shadows :
Short Term Memory Loss
Pour aller plus loin :
Le site de Derek Gregory : Geographical Imaginations.
Sur Jef Klak : Mortels algorithmes. Du code pénal au code létal, par Susan Schuppli. Traduit de l’anglais par Lucie Gerber, paru dans la revue Radical Philosophy 187 (sept/oct 2014).
Sur Article 11 : « À jouer la guéguerre des machines, nous serons toujours perdants ». Entretien croisé avec Grégoire Chamayou et Thomas Hippler. Propos recueillis par Ferdinand Cazalis.
Théorie du drone, Grégoire Chamayou, éd. La Fabrique, 2013, en librairie.












Notes
| ↩1 | Josh Begley, « Dronestream », New York University, 15 mai 2013, vimeo.com/67691389. |
| ↩2 | Voir dronestre.am et dronestagram.tumblr.com. Pour une synthèse des interventions sur les drones en arts visuels, voir Elspeth van Veeren, « Drone Imaginaries : There Is More Than One Way to Visualise a Drone », academia.edu/2905784/Drone_Imaginaries_There_ is_more_than_one_way_to_imagine_a_drone ; Honor Harger, « Unmanned Aerial Ecologies », lighthouse.org.uk/news/unmanned-aerial-ecologies-proto-drones-airspace-and-canaries-in-the-mine ; Matt Delmont, « Drone Encounters : Noor Behram, Omar Fast and Visual Critiques of Drone Warfare, American Quarterly, vol. 65, no 1, 2013, p. 193–202. |
| ↩3 | Jordan Crandall, « Ontologies of the Wayward Drone : A Salvage Operation », 11 février 2011, ctheory.net/articles.aspx?id=693. |
| ↩4 | Martin Shaw, The New Western Way of War: Risk Transfer War and Its Crisis in Iraq, Polity Press, Cambridge, 2005. Shaw ne mentionne pas les drones et souligne que le transfert de risque caractérise la guerre à l’ère de la modernité tardive. En fait, les puissances militaires avancées ont toujours cherché à engager des conflits asymétriques – et cela ne vaut pas seulement pour leurs luttes contre des acteurs non étatiques – et préféré être capables de submerger leurs ennemis grâce à leur supériorité technologique. |
| ↩5 | Grégoire Chamayou, Théorie du drone, La Fabrique, Paris, 2013, p. 139–50 ; j’ai abordé le sujet dans « From invisibility to vulnerability », 8 août 2013, geographicalimaginations.com/2013/08/08/theory-of-the-drone-8-from-invisibility-to-vulnerability/. Chamayou expose très efficacement les vertus (et les virilités) masculinistes inscrites dans ces codes. Voir aussi, sur ce thème Mary Manjikian, « Becoming Unmanned : The Gendering of Lethal Autonomous Warfare Technology », International Feminist Journal of Politics, 2013. |
| ↩6 | Lambèr Royakkers et Rinie van Est, « The Cubicle Warrior : The Marionette of Digitized Warfare », Ethics and Information Technology, vol. 12, no 3, 2010, p. 289–96. |
| ↩7 | Matt Martin avec Charles W. Sasser, Predator. The Remote control Air War over Iraq and Afghanistan : A Pilot’s Story, Zenith, Minneapolis, 2010, p. 44–45. Dans une veine encore plus surréaliste (et sur le mode d’un impérialisme ahurissant), il faut mentionner cet autre geste de compartimentation : lorsque Robert Caplan a visité la base de Creech, son guide lui a expliqué : « Dans cet Algeco, c’est l’Irak ; dans l’autre, c’est l’Afghanistan. » Voir « Hunting the Taliban in Las Vegas », The Atlantic, vol. 298, no 2, 2006, p. 81. |
| ↩8 | Rob Blackhurst, « The Air Force Men Who Fly Drones in Afghanistan by Remote Control », Telegraph, 24 septembre 2012. |
| ↩9 | Notez que ce n’est pas le fait de tuer qui est étrange – après tout ce que des officiers sont entraînés à faire –, mais sa proximité avec la vie quotidienne. |
| ↩10 | Élisabeth Bumiller, « A Day Job Waiting for a Kill Shot a World Away », New York Times, 29 juillet 2012. Voir aussi Elijah Solomon Hurwitz, « Drone Pilots : “overpaid, underworked and bored” », Mother Jones, 18 Juin 2013. Pour une analyse détaillée des conditions de travail des opérateurs de drones, voir Peter Asaro, « The Labor of Surveillance : New Subjectivities of Military Drone Operators », Social Semiotics, vol. 23, no 2, 2013, p. 196–224. |
| ↩11 | George Brant, Grounded, Oberon Books, London, 2013. Tout comme le 5000 Feet is the Best d’Omer Fast, le statut fictionnel de ce travail ne l’empêche pas d’être fondé sur une lecture minutieuse d’entretiens et de rapports sur l’activité d’équipages de drones bien réels. |
| ↩12 | Koh a travaillé comme conseiller juridique au département d’État tandis que Brennan a fait la plupart de ses déclarations en tant que Deputy National Security Advisor for Homelands Security and Counterterrorism, avant de devenir directeur de la CIA en mars 2013. |
| ↩13 | Madiha Tahir, « Louder than Bombs », New Inquiry 6, 2012. Il y a une autre objection contre les sirènes de la « transparence et de la responsabilité ». Fleur Johns souligne le côté fantasmatique de ces revendications en rappelant que le droit international n’a sans doute jamais été capable de fournir le genre de contrôle que les critiques exigent de lui : « La technologie de meurtre automatisé dernier cri ne semble trouver d’équivalent que dans un autre genre de technologie de contrôle télécommandé, tout aussi obscure, mais programmée pour rendre transparent un pouvoir qui se situe pourtant perpétuellement ailleurs que là où il est. » Voir Non-legality in International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, p. 6. |
| ↩14 | Michael Sherry, The Rise of American Air Power: The Creation of Armageddon, Yale University Press, New Haven CT, 1987, p. 209–210. Pour toutes ces raisons, il semble naïf de s’opposer aux drones en ce qu’ils tuent à distance. Non seulement c’est là un trait ancien de l’histoire militaire, mais, si vous pensez qu’il est mal de tuer à 12 000 km de distance, à quelle distance pensez-vous que ce soit acceptable ? |
| ↩15 | Harold Nash, cité par James Taylor et Martin Davidson, Bomber Crew, Hodder & Stoughton, London, 2004, p. 447 ; et Derek Gregory, « Lines of Descent », dans Peter Adey, Mark Whitehead et Alison Williams, édit., From Above: War, Violence and Verticality, Hurst, London, 2013, p. 41–70. |
| ↩16 | Philip Alston, « Report of the United Nations, Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions : Study on Targeted Killings », mai 2010 ; Chris Cole, Mary Dobbing et Amy Hailwood, Convenient Killing : Armed Drones and the « Playstation » Mentality, Fellowship of Reconciliation, Oxford, 2010. Dave Grossman, On Killing : The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, Bay Back Books, New York, 1995. Nicola Abé, « Dreams in Infrared : The Woes of an American Drone Operator », Spiegel Online, 14 décembre 2012, spiegel.de/international/world/pain-continues-after-warfor-american-drone-pilot-a-872726.html. |
| ↩17 | « We are Predator / UAV Pilot / Operators Currently in Afghanistan », janvier 2013, reddit.com/r/IAmA/comments/17j9wa/e_are_predator_uav_pilotoperators_currently_in. |
| ↩18 | Mark Bowden, « The Killing Machines », The Atlantic, 14 septembre 2013. |
| ↩19 | Derek Gregory, « The Rush to the Intimate: Counterinsurgency and the Cultural Turn », Radical Philosophy 150, 2008, p. 8–23. |
| ↩20 | Chamayou, Théorie du drone, p. 167 ; Stanley Milgram, Obedience to Authority : An Experimental View, Harper & Row, New York, 1974. |
| ↩21 | Le réseau sert aussi à distribuer la responsabilité : « La responsabilité pour le tir pouvait être disséminée sur toute la chaîne, à un grand nombre de personnes : le pilote, l’opérateur de capteurs, le commandant des forces terrestres. Cela voulait dire que personne ne pouvait être personnellement tenu pour responsable. » (Martin et Sasser, Predator, p. 212). |
| ↩22 | Mark Benjamin, « Killing “Bubba” from the Skies », Salon, 15 février 2008, salon.com/2008/02/15/air_war. |
| ↩23 | Harun Farocki, « Phantom Images », Public 29, 2004, p. 12–24 ; c’est moi qui souligne. |
| ↩24 | « C’est le geste même de calculer – le fait même qu’un calcul ait eu lieu – qui justifie leurs agissements » ; Eyal Weizman, The Least of All Possible Evils: Humanitarian Violence from Arendt to Gaza, Verso, Londres et New York, 2012, p. 12. Réciproquement, le droit international œuvre à établir ce que Madiha Tahir nomme « le bon ordre de violence ». |
| ↩25 | Nasser Hussain, « The Sound of Terror: Phenomenology of a Drone Strike », Boston Review, 16 octobre 2013, bostonreview.net/world/hussain-drone-phenomenology. |
| ↩26 | Fast, 5.000 Feet is the Best, p. 100. |
| ↩27 | David Wood, « Drone Strikes : A Candid, Chilling Conversation with Top US Drone Pilot », Huffington Post, 15 mai 2013, huffingtonpost.com/2013/05/15/dronestrikes_n_3280023.html. |
| ↩28 | Matthew Power, « Confessions of a Drone Warrior », GQ, 23 octobre 2013. |
| ↩29 | Abé, « Dreams ». La passivité présumée des Afghans en général et de femmes afghanes en particulier est un lieu commun des récits orientalistes-humanitaires de la guerre comme « mission de sauvetage ». Voir Thomas Gregory, « Potential Lives, Impossible Deaths : Afghanistan, Civilian Casualties and the Politics of Intelligibility », International Feminist Journal of Politics, vol. 14, no 3, 2012, p. 327–347. |
| ↩30 | Je pense ici à l’incident de « tir ami » –le premier du genre ayant impliqué un drone – au cours duquel les signatures infrarouges d’un Marine et d’un soldat de la Navy captées par un drone Predator qui volait au-dessus d’un combat à Sangin dans la province d’Helmand en Afghanistan en avril 2011 furent prises pour celles d’ennemis. Voir Ewan MacAskill, « Two US Soldiers Killed in Friendly-fire Drone Attack in Afghanistan », Guardian, 11 avril 2011; Jill Laster et Ben Iannota, « Hard Lessons from Predator Strike Gone Wrong », Air Force Times, 19 février 2012. |
| ↩31 | Élisabeth Bumiller, « Air Force Drone Operators Report High Levels of Stress », New York Times, 18 décembre 2011. |
| ↩32 | Megan McCloskey, « Two Worlds of a Drone Pilot », Stars and Stripes, 27 octobre 2009. Grossman suggère qu’un sentiment de responsabilité envers ses camarades-soldats est un moyen puissant pour dépasser la résistance au fait de tuer (On Killing, p. 90, 149 et 150). |
| ↩33 | Dans mon texte « Lines of Descent », je décris un tel accident dans la province afghane d’Uruzgan en février 2010, au cours duquel 33 civils furent tués et plus d’une douzaine blessés. Je fournis une analyse détaillée de cette attaque et d’autres dans mon texte « Militarized Vision », geographicalimaginations.com/2013/08/02/militarized-vision/. |
| ↩34 | Cf. Jeremy Packer et Joshua Reeves, « Romancing the Drone : Military Desire and Anthrophobia from SAGE to Swarm », Canadian Journal of Communications 38, 2013, p. 324. Neta Crawford souligne l’importance qu’il y a à élargir la perspective et à passer de la responsabilité individuelle à la responsabilité collective. Voir Accountability for Killing : Moral Responsibility for Collateral Damage in America’s Post-9/11 Wars, Oxford University Press, 2013. |
| ↩35 | Judith Butler, Frames of War : When Is Life Grievable ?, Verso, London and New York, 2010, p. XI ; Caroline Holmqvist, « Undoing War : War Ontologies and the Materiality of Drone Warfare », Millennium, vol. 41, no 3, 2013, p. 535–552. Voir aussi Lucy Suchman, « Situational Awareness : Deadly Bioconvergence at the Boundaries of Bodies and Machines », Mediatropes 13, 2013. |
| ↩36 | Daniel Kleidman, Kill or Capture: The War on Terror and the Soul of the Obama Presidency, Houghton Mifflin, New York, 2012 ; Greg Miller, « Plan for Hunting Terrorists Signals U.S. Intends to Keep Adding Names to Kill Lists », Washington Post, 23 octobre 2012 ; Ian Cobain, « Obama’s Secret Kill List – the Disposition Matrix », Guardian, 14 juillet 2013. |
| ↩37 | Martin et Sasser, Predator, p. 50–53 ; Andrew McGinn, « Local Drone Pilot Explains Missions », Dayton Daily News, 22 juin 2013. |
| ↩38 | Ces modalités rendent impossible ce que Joseph Pugliese décrit comme un « système général d’échange » entre le dispositif chasseur-tueur « et ses victimes anonymes, qui ne se doutent de rien, et qui n’ont ni le droit de répondre ni aucun accès à des procédures judiciaires ». Voir State Violence and the Execution of the Law: Biopolitical Caesurae of Torture, Black Sites, Drones, Routledge, New York, 2013, p. 209. |
| ↩39 | Giulio Douhet, The Command of the Air, trad. Dino Ferrari, University of Alabama Press, Tuscaloosa, 1988, p. 10 (première édition en italien en 1921) ; Voir Thomas Hipler, Bombing the People : Giulio Douhet and the Foundations of Airpower Strategy 1884–1939, Cambridge University Press, Cambridge, 2013. Il faut souligner que cette préoccupation était euro-américaine. En 1932, le Haut-commissaire britannique en Irak insistait encore sur le fait que « le terme de “population civile” a un sens très différent en Irak par rapport à celui qu’il a en Europe » – de sorte que les sensibleries européennes concernant les victimes civiles étaient ici, à tous les sens du terme, déplacées : « la population masculine dans son ensemble est composée de combattants potentiels », expliquait-il, « étant donné que les tribus sont lourdement armées ». Le même genre de justifications grotesques avait toujours cours, plus de soixante-dix ans plus tard, dans les guerres qui furent menées dans l’ombre portée du 11-Septembre. |
| ↩40 | Maria Ryan, « “War in countries we’re not at war with” : The “War on Terror” on the Periphery from Bush to Obama », International Politics 48, 2011, p. 364–389. Comme l’écrit Michael Hastings : « La nature télécommandée des missions par drones permet aux politiciens de faire la guerre tout en prétendant que nous ne sommes pas en guerre » ; voir « How America Goes to War in Secret », Rolling Stone, 16 avril 2012. |
| ↩41 | Yuri Tanaka et Marilyn B. Young, éds, Bombing Civilians : A Twentieth-century History, New Press, New York, 2010. |
| ↩42 | Voir Michael Lewis et Emily Crawford, « Drones and Distinction », University of Sydney Law School, Legal Studies Research paper 13/35, 2013; Jack Beard, « Law and War in the Virtual Era », American Journal of International Law 103, 2009, p. 403–445. Sur la longue généalogie de la protection des civils dans les conflits armés, voir Helen Kinsella, The Image before the Weapon : A Critical History of the Distinction between Combatant and Civilian, Cornell University Press, Ithaca NY, 2011. |
| ↩43 | Il n’existe pas de statistiques spécifiques pour les victimes directement causées par des drones en Afghanistan, mais étant donné que les drones sont aussi utilisés pour fournir des « yeux » à des attaques menées par des avions conventionnels ou des hélicoptères, la comptabilité serait de toute façon difficile à interpréter. Il n’y a pas non plus de chiffres satisfaisants pour les frappes dites clandestines au Pakistan, au Yémen ou en Somalie, mais les estimations les plus fiables ont été fournies par le Bureau of Investigative Journalism : thebureauinvestigates.com/blog/category/projects/drones. |
| ↩44 | Frédéric Mégret, « War and the Vanishing Battlefield », Loyola University Chicago International Law Review, vol. 9, no 1, 2012, p. 131–155, p. 148. |
| ↩45 | Samuel Issacharoff et Richard Pildes, « Drones and the Dilemma of Modern Warfare », dans Peter Bergen et Daniel Rothenberg, édit., Drone Wars : The Transformation of Armed Conflict and the Promise of Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2013 et NYU School of Law, Public Law & Legal Theory Research Paper Series Working Paper No. 13–34, juin 2013 ; voir aussi Samuel Ischaroff et Richard Pildes, « Targeted Warfare: Individuating Enemy Responsibility », NYU School of Law, Public Law & Legal Theory Working Papers 343, avril 2013. |
| ↩46 | Scahill, Dirty Wars. Scahill mentionne un mémo de Rumsfeld en 2004 : « Le monde entier est un champ de bataille » (p. 173). Comme je vais le dire plus loin cependant, cela ne veut pas dire que les drones sont le seul – ni le plus important – fer de lance dans cette nouvelle forme de violence militaire et paramilitaire. |
| ↩47 | Paul Kahn, « Imagining Warfare », European Journal of International Law, vol. 24, no 1, 2013, p. 199–226. |
| ↩48 | Peter Scheer, « Connecting the Dots between Drone Killings and Newly Exposed Government Surveillance », Huffington Post, 8 juin 2013. |
| ↩49 | Glenn Greenwald et Ewan MacAskill, « Boundless Informant: The NSA’s Secret Tool to Track Global Surveillance Data », Guardian, 11 juin 2013 ; Greg Miller, Julie Tait et Barton Gellman, « Documents Reveal NSA’s Extensive Involvement in Targeted Killing Program », Washington Post, 16 octobre 2013. |
| ↩50 | Rob Kitchin et Martin Dodge, Code/Space : Software and Everyday Life, MIT Press, Cambridge MA, 2012, p. 17. |
| ↩51 | Issacharoff et Pildes, « Drones and the Dilemma of Modern Warfare ». Cela accentue l’incorporation croissante des juristes à la kill-chain. Voir Craig Jones, « War, Law and Space », warlawspace.com. |
| ↩52 | Chamayou, Théorie du drone, p. 51 ; cf. Colleen Bell, Jan Bachmann et Caroline Holmqvist, édit., The New Interventionism: Perspectives on War–Police Assemblages, Routledge, Londres, 2014. |
| ↩53 | Kahn, « Imagining Warfare », p. 226. Cette modalité du pouvoir aérien peut être qualifiée de « police » dans le sens foucaldien proposé par Mark Neocleous, mais je ne suis pas sûr que ce soit là une théorisation utile pour d’autres modalités du pouvoir aérien. Il existe des continuités entre la « police par les airs » coloniale et les opérations américaines actuelles au Pakistan, au Yémen et en Somalie – y compris le fait de tirer parti d’un espace aérien incontesté –, mais je ne pense pas qu’il soit pertinent d’appliquer ce modèle aux autres guerres de bombardement ; cf. Mark Neocleous, « Air Power as Police Power », Environment and Planning D : Society & Space 31, 2013, p. 578–593 ; « Police Power All the Way to Heaven : Cujus est Solum and the No-Fly Zone », Radical Philosophy 182, 2013, p. 5–14. |
| ↩54 | Kevin Jon Heller, « “One hell of a killing machine” : Signature Strikes and International Law », Journal of International Criminal Justice 11, 2013, p. 89–119. |
| ↩55 | Pugliese, State Violence, p. 193–194. Pour une discussion de l’imaginaire biopolitique qu’organisent ces métaphores, voir Colleen Bell, « Hybrid Warfare and Its Metaphors », Humanity, vol. 3, no 2, 2012, p. 225–247 ; « War and the Allegory of Medical Intervention », International Political Sociology, vol. 6, no 3, 2012, p. 325–328. |
| ↩56 | Derek Gregory, « “Doors into nowhere” : Dead Cities and the Natural History of Destruction », dans Peter Meusburger, Michael Heffernan et Edgar Wunder, édit., Cultural Memories, Springer, Heidelberg, 2011, p. 249–283. |
| ↩57 | Gregory, « Potential Lives ». |
| ↩58 | Ces effets en réseau sont devenus un grand classique des bombardements modernes. Lorsque l’armée israélienne à Gaza ou l’armée américaine en Irak affirment avoir « seulement » bombardé une centrale électrique et délibérément choisi de le faire à 2 heures du matin, au moment où seule une équipe réduite se trouve dans les locaux, ils jouent les faux ingénus. Car ils savent très bien qu’une centrale électrique hors d’usage signifie que l’eau ne peut plus être pompée, que les eaux usées ne peuvent plus être traitées, que la nourriture ne peut plus être réfrigérée, que les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner – de sorte que les effets de la frappe se répercutent dans l’espace et dans le temps bien au-delà du point d’impact initial. La cible est choisie de façon à minimiser la perception immédiate de la frappe tout en maximisant des effets de vague qui se trouvent déplacés dans le temps, dans l’espace et dans la conscience du public. Voir Samuel Weber, Targets of Opportunity : On the Militarization of Thinking, Fordham University Press, New York, 2005. |
| ↩59 | Will I Be Next ? US Drone Strikes in Pakistan, Amnesty International, Washington DC, 22 octobre 2013, p. 18–23. Il y a eu plusieurs tentatives pour discréditer le rapport d’Amnesty, dont les allégations de Michael Lewis, selon lesquelles cette frappe aurait pu être le fait d’un F-16 pakistanais : « The Misleading Human Rights Watch and Amnesty International Reports on US Drones », 8 novembre 2013, sur opiniojuris.org. Il est avéré que les populations de ces provinces vivent sous la menace de frappes aériennes conduites à la fois par les États-Unis et l’Armée de l’air pakistanaise, comme Amnesty l’a montré en détail. Voir mon billet de blog : « Air Strikes in Pakistan’s Borderlands », 19 mars 2013, geographicalimaginations.com/2013/03/19/air-strikes-in-pakistans-borderlands, et « Dirty Dancing and Spaces of Exception in Pakistan’ », 24 mars 2013, geographicalimaginations.com/2013/03/24/dirty-dancing-and-spaces-of-exception-in-pakistan. Mais les deux sont assez fréquentes pour que les gens fassent la différence. L’attaque n’a pas été conduite par des hélicoptères ou des avions de combat. Comme le petit-fils de Mamana Bibi l’a expliqué en décrivant les différents sons : « Je connais la différence. » Cette déclaration aussi simple qu’effrayante nous rappelle l’enveloppe de peur sous laquelle vivent ces gens ordinaires : un espace de violence potentielle permanente, que vient réactiver et aggraver chaque nouvelle frappe. |
| ↩60 | Judith Butler, Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, Verso, Londres et New York, 2004; Butler, Frames of War. |
| ↩61 | Madiha Tahir, « The Business of Haunting », 2 septembre 2013, woundsofwaziristan.com/business-of-haunting. |
| ↩62 | Chamayou, Théorie du drone, ch. 6. Les chasses à l’homme ne traite pas directement des drones, mais voir son article « The Manhunt Doctrine », Radical Philosophy 169, September–October 2011. |
| ↩63 | Pour un résumé de ces arguments, voir Thomas Gregory, « Drones : Mapping the Legal Debate », New Zealand Centre for Human Rights Law, Policy and Practice, avril 2013, et, avec d’autres conclusions, Michael Lewis, « Drones and the Boundaries of the Battlefield », Texas International Law Journal, vol. 47, no 2, 2012, p. 293–314. Les principes du droit international humanitaire étaient au cœur des objections formulées par le rapporteur spécial de l’ONU sur les exécutions extra-judiciaires Philip Alston ; voir « The CIA and Targeted Killing beyond Borders », Harvard National Security Journal 2, 2011, p. 283–446. |
| ↩64 | Chamayou, Théorie du drone, p. 86. |
| ↩65 | Joseph Pugliese, « Prosthetics of Law and the Anomic Violence of Drones », Griffith Law Review, vol. 20, no 4, 2011, p. 944. |
| ↩66 | Ian Shaw, « Predator Empire: The Geopolitics of US Drone Warfare », Geopolitics, vol. 18, no 3, 2013, p. 536–559 ; Fred Kaplan, « The World as Free-fire Zone », MIT Technology Review, 7 juin 2013, technologyreview.com/featuredstory/515806/the-world-as-free-fire-zone. |
| ↩67 | Shaw, « Predator Empire », p. 5 et 14. |
| ↩68 | Nick Turse, « America’s Secret Empire of Drone Bases », TomDispatch, 16 octobre 2011. |
| ↩69 | John Reed, « The Air Force’s Drone Base in a Box », 17 septembre 2013, foreignpolicy.com. |
| ↩70 | Le RQ-4 Global Hawk est un drone de surveillance à longue portée, mais il n’est pas armé. |
| ↩71 | La catégorie des procédés « anti-accès » recouvre des mesures de longue portée destinées à tenir à distance une force armée loin d’une zone d’opérations, tandis que le « déni d’accès » implique des mesures de courte portée qui restreignent la liberté de manœuvre dans la zone concernée. Voir « Joint Operational Access Concept », US Department of Defense, 17 janvier 2012, à cette adresse : defense.gov/pubs/pdfs/joac_jan202012_signed.pdf ; « Release of the Joint Operational Access Concept », 17 janvier 2012, dodlive.mil/index.php/2012/01/release-of-the-joint-operational-access-concept-joac. |
| ↩72 | John Reed, « Predator Drones “Useless in Most Wars”, Top Air Force General Says », 19 septembre 2013, foreignpolicy.com. |
| ↩73 | Alfred McCoy, « Imperial Illusions : Information Infrastructure and the Future of US Global Power », dans Alfred McCoy, Josep Fradera et Stephen Jacobson, édit., Endless Empire : Spain’s Retreat, Europe’s Eclipse, America’s Decline, University of Wisconsin Press, Madison, 2012, p. 360–386. |
| ↩74 | Rob O’Gorman and Chris Abbott, Remote Control War : Unmanned Combat Air Vehicles in China, India, Iran, Israel, Russia and Turkey, Open Briefing, 20 septembre 2013. |
| ↩75 | David Hastings Dunn, « Drones : Disembodied Aerial Warfare and the Unarticulated Threat », International Affairs, vol. 89, no 5, 2013, p. 1237–1246. D’autres commentateurs sont plus sceptiques sur la prolifération des drones armés, ne serait-ce que parce que leur fabrication dépend d’une chaîne limitée de fournisseurs pour une infrastructure capable d’activer l’écosystème industriel requis pour leurs opérations à distance. Voir par exemple Andrea Gilli et Mauro Gilli, « Attack of the Drones : Should We Fear the Proliferation of Unarmed Aerial Vehicles? », article présenté devant l’Association américaine des sciences politiques, conférence annuelle, août-septembre. 2013, academia.edu/4331462/Attack_of_the_Drones_Should_We_Fear_The_Proliferation_of_Unmanned_Aerial_Vehicles. |
| ↩76 | Derek Gregory, « The Everywhere War », Geographical Journal, vol. 177, no 3, 2011, p. 238–250. |
| ↩77 | James Bridle, « Under the Shadow of the Drone », 11 octobre 2012, booktwo.org/notebook/drone-shadows ; voir aussi mon billet « Situational Awareness », 3 mai 2013, geographicalimaginations.com/2013/05/03/ situational-awareness. |
| ↩78 | Roger Stahl, « What the Drone Saw : The Cultural Optics of the Unmanned War », Australian Journal of International Affairs, vol. 67, no 5, 2013, p. 659–674. |
| ↩79 | paglen.tumblr.com/post/30105766943/ reaper-drone-over-waziristan-shot-by-noor-behram ; pour une analyse du travail de Behram, voir Spencer Ackerman, « Rare Photographs Show Ground Zero of the Drone War », 12 décembre 2011, wired.com/dangerroom/2011/12/ photos-pakistan-drone-war ; Delmont, « Drone Encounters ». |