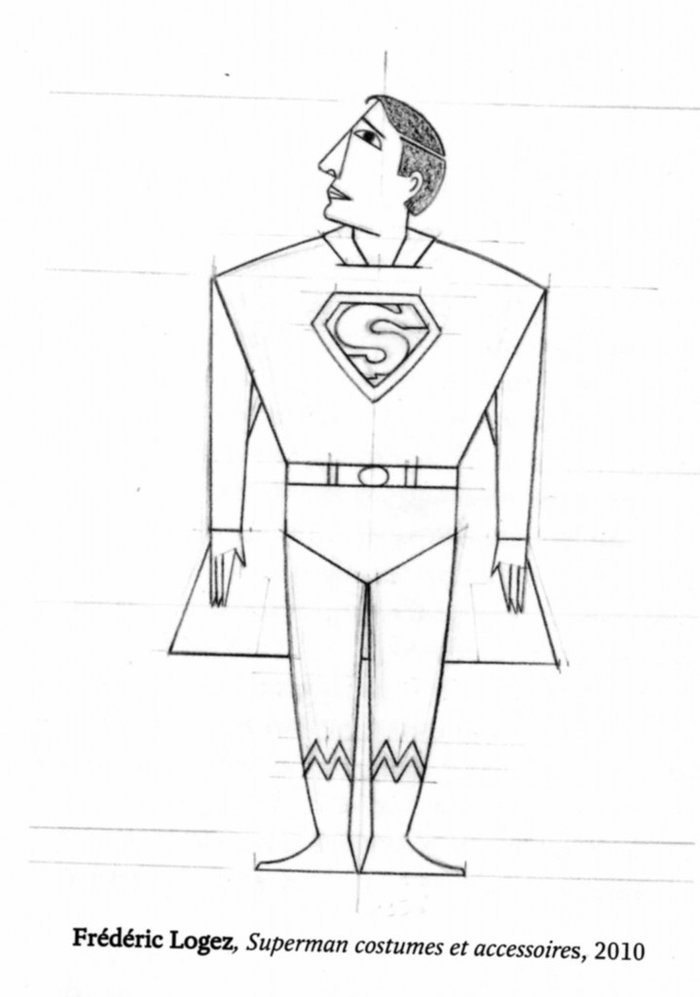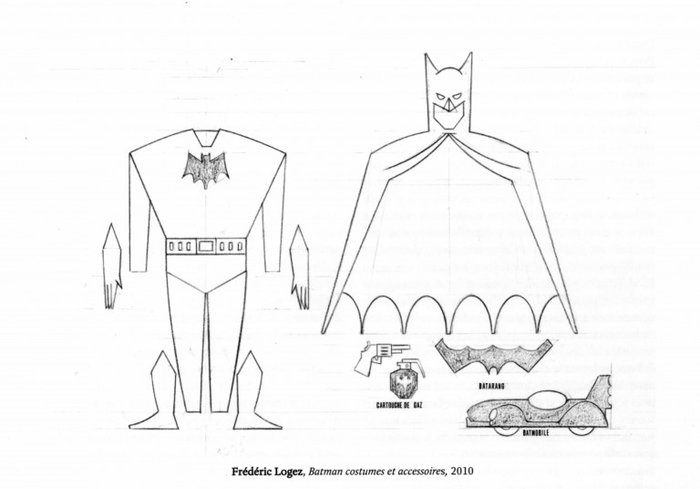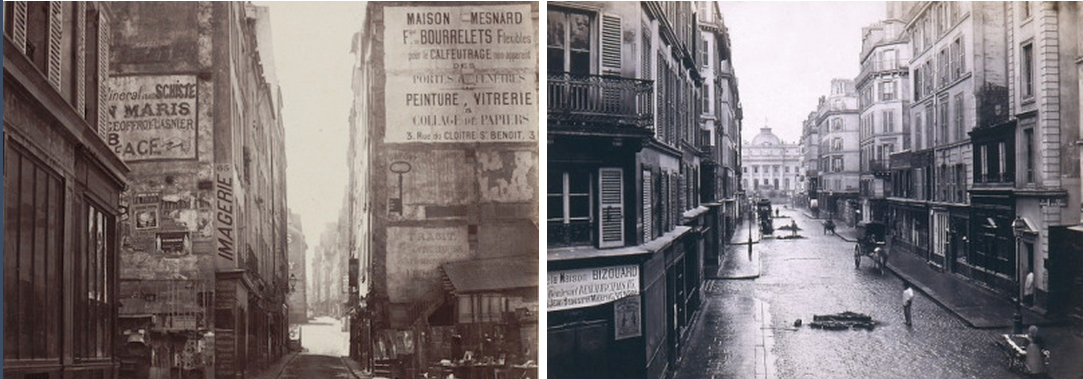Goguenard, béret de travers, clope au bec, Woody Guthrie se frayait son propre chemin, loin des mondanités et des tentations de reconnaissance, convaincu que ses semblables, un jour, feraient ravaler leurs méfaits à tous les patrons de ce monde… Cette chronique musicale est publiée à la fois sur Article11 et sur Jef Klak. Comme un passage de flambeau, sachant que les prochains textes de ce type rédigés par votre serviteur seront publiés exclusivement chez l’ami Jef. Et chose surprenante pour le site de Jef Klak : les commentaires sont activés !
« Eh, Woody Guthrie, je t’ai écrit une chanson / Sur un étrange vieux monde qui poursuit sa course /
Il semble malade, affamé, fatigué, déchiré / On dirait qu’il se meurt, mais il vient à peine de naître. »
Bob Dylan, « Song to Woody »1 « Hey, hey Woody Guthrie, I wrote you a song, / About a funny old world that’s a coming along, / Seems sick and it’s hungry, it’s tired and it’s torn / It looks like it’s a … Continue reading
« Les gens m’aimaient, me détestaient, marchaient avec moi, me marchaient dessus, me criaient haro ou bravo, me louaient ou me huaient, et bientôt j’avais été invité et vidé par chaque lieu de distraction public qui existe dans ce pays. Mais je décrétai que les chansons étaient une musique et un langage sans frontières. »
Woody Guthrie, En route pour la gloire
Lire l’article en PDF
Woody Guthrie, tu aurais aimé le rencontrer au bord d’une route poussiéreuse écrasée de chaleur, sa chemise à carreaux empesée de sueur et ses traits tirés de fatigue. Il t’aurait salué de sa voix traînante d’Okie et t’aurait traité en camarade de galère, simplement, sans en faire des tonnes. Vous auriez peut-être partagé quelques gorgées d’un vin fortifié bon marché, du Thunderbird par exemple, ou du Cisco, puis quelques tranches de pastèque pour faire passer l’infâme goût des assommoirs made in USA, avant de repartir chacun de votre côté. Ou bien, l’humeur s’y prêtant, vous auriez taillé la route ensemble pendant quelques jours, poussant lentement, à pied, en stop ou en wagon de marchandise vers la Californie, les Appalaches, Des Moines ou le Minnesota… Freewheelin’.
Le soir, au coin du feu, vous auriez englouti un frugal repas avec quelques traîne-savates du même acabit, des ivrognes, des pauvres hères, des malchanceux, des fugueurs, ceux-là mêmes qu’il décrivit si bien dans son autobiographie (partiellement romancée) En route pour la gloire : « Je m’assis le dos contre le mur, observant ces hommes tourmentés, enchevêtrés, désordonnés. Voyageant à la dure. Habillés à la dure. Partis pour une sacrée longue solitude. Plus rugueux qu’un épi. Plus sauvages qu’un bâton. […] Discutant pire qu’un arbre bourré de pies. En désordre. Des gens désorientés, opprimés. » Au vrai : son public favori. Si bien qu’il aurait sorti sa guitare ornée de sa célèbre inscription balistique – « This guitar kills fascists » – et entonné quelques classiques de la hobo-sphère repris en cœur par la troupe avinée.
Un matin, au réveil, malheur, il aurait décampé sans demander son reste, dans un nuage de poussière. La route ce jour-là aurait été plus rude, diminuée de sa présence, orpheline. Un seul Woody vous manque et tout est déplumé.
* * *
Difficile de le nier, surtout au regard de ce qui précède : Woody Guthrie invite aux poncifs, aux envolées lyriques teintées de ce sépia nostalgique qu’arborent tant de grandes figures américaines du XXe siècle. Yep, il est difficile de trouver quelqu’un plus solidement arrimé à l’imaginaire ricain du vagabond insoumis. Il y a du Huckleberry Finn dans sa trajectoire, du Thoreau, du Agee – Louons maintenant les grands hommes ! –, du Boxcar Bertha, du Kerouac et du Steinbeck.
Né en 1912 à Okemah, dans l’Oklahoma – doublement Okie donc –, Woody Guthrie est très vite jeté sur la route par la Grande Dépression qui ravage sa région natale, cette catastrophe si puissamment contée dans Les Raisins de la colère[2. Évoquant sa chanson « Tom Joad », Steinbeck écrira : « J’ai mis trois ans à écrire ce foutu bouquin, et cet enfant de salaud en a fait autant en dix-sept couplets ! » ]. « Je voulais être mon propre patron », écrivait-il dans En route pour la gloire. « Avoir mon propre boulot quel qu’il soit et me débrouiller tout seul. » Dont acte : alors qu’ils sont des millions à vagabonder sur les routes, en quête d’un boulot, d’un refuge, d’un salaire, lui se fait très vite troubadour, chanteur itinérant dénonçant la misère, les patrons voyous et leurs milices ; tout en encensant les syndicats, les luttes sociales, les étincelles venues du peuple. Partout où il débarque, en Californie ou à New York, il a en stock des chansons adaptées aux luttes du moment, des ballades remontées. Un avion rempli de Mexicains expulsés s’écrase dans l’indifférence générale ? Il dégaine « Deportee (Plane Wreck at Los Gatos) », égrainant les noms des victimes[3. « Goodbye my Juan, goodbye Roselita / Adios mis amigos Jesus y Maria / You won’t have a name when you ride the big airplane / And all they will call you will be / Deportee »]qu’il n’enregistra jamais, au contraire du grand Cisco Houston.
https://www.youtube.com/watch?v=zOqjlRsUnBM
Les fascistes gagnent du terrain en Europe ? Il balance « All You Fascists Bound to Loose », pour leur annoncer qu’ils vont se faire marave sévère[4. « I’m gonna tell you fascists / You may be surprised / The people in this world / Are getting organized / You’re bound to lose / You fascists bound to lose. »]. L’activiste Tom Mooney est libéré après avoir durablement croupi en prison sous de fausses accusations ? Il compose d’une traite « Tom Mooney is Free », pour clamer que « La vérité ne peut-être entravée par une chaîne ». Et quand il participe avec Alan Lomax et Pete Seeger à la confection d’un recueil de chansons sur les luttes populaires, le titre choisi ne prend pas de gants : Hard Hitting Songs for Hard Hit People, soit, plus ou moins, Des chansons qui frappent fort pour ceux qui en prennent plein la gueule.
Bref, un battant cognant fort après avoir trop encaissé. Qui n’aura de cesse de parcourir le pays, fendant la misère les yeux grand ouverts, vagabond dans l’âme. Dans Like a rolling stone ; Bob Dylan à la croisée des chemins, Greil Marcus le définit comme « le troubadour des dépossédés, le poète de la Grande Dépression, le fantôme de la route américaine, un homme balayé par le vent et fait de poussière ». Une « poussière » qui lui colle bigrement à la peau dès qu’il s’agit de l’évoquer. Comme si le sang palpitant dans ses veines avait peu à peu été contaminé par les débris de la route, chargé de scories vagabondes. Le premier chapitre de son autobiographie en regorge d’ailleurs littéralement, de cette poussière mauvaise piquant les gorges, saturant les poumons, entravant l’horizon et « volant dans l’air comme si on était en train de la déverser avec des camions ».
Il faut dire qu’outre celle de la route, il connaît très jeune celle charriée par le terrible phénomène du Dust Bowl, ces tempêtes de poussière semblables aux plaies d’Égypte ravageant les Grandes Plaines américaines et ruinant des milliers de fermiers[5. Sa chanson « Dust Storm Disaster » détaille ainsi un jour de catastrophe : « Le 14e jour d’avril 1935 / Frappa la pire des tempêtes de sable à avoir jamais emplies le ciel / Vous pouviez voir cette tempête approcher, les nuages d’un noir de mort / Et à travers notre grande nation, elle imprima une piste funèbre. » ]. Un phénomène écologico-économique, lié autant à la sécheresse qu’au surlabourage et l’érosion qu’il entraîne. Leurs fermes et récoltes ensevelies, les familles de fermiers font leurs baluchons avant de rejoindre le ruban gris que Steinbeck appelait la « route mère » – cette Road 66 ouvrant sur l’Ouest. Pour l’Oklahoma natal de Woody, c’est 15% de la population qui est ainsi jeté sur les routes. Adieu veaux, vaches, cocon ; bonjour exil, misère, rejet. « Ensevelies nos clôtures, ensevelies nos granges / Ensevelis nos tracteurs, par cette tempête de poussière sauvage / On a chargé nos guimbardes et empilé nos familles à l’intérieur, / On s’est jeté sur cette autoroute pour ne plus jamais revenir[6. « It covered up our fences, it covered up our barns, / It covered up our tractors in this wild and dusty storm. / We loaded our jalopies and piled our families in, / We rattled down that highway to never come back again. » ]. », chante-t-il dans « Dust Storm Disaster ».
Woody Guthrie a consacré un album entier à cette catastrophe, Dust Bowl Ballads, enregistré à New York en 1940. Des chansons simples, touchantes, dépeignant sans en rajouter le terrible destin des exilés économiques : « Je suis un réfugié du Dust Bowl, / Et je me demande si je resterai toujours / Un réfugié du Dust Bowl[7. « I’m a dust bowl refugee, / And I wonder will I always / Be a dust bowl refugee ? »] ? », geint-il doucement dans « Dust Storm Refugee », chanson intemporelle qui s’appliquerait tout aussi bien aux jours actuels et à leurs persistants relents d’exclusion.
* * *
Si les compositions de Woody traversent si bien le temps, c’est parce qu’elles ne s’embarrassent pas de chichis. Une guitare, quelques accords, des paroles simples et acérées, et les voilà lancées. « Par dessus tout, les chansons de Woody ont le génie de la simplicité. N’importe quel imbécile peut être compliqué, mais il faut du génie pour atteindre la simplicité », écrivait son ami et camarade de lutte Pete Seeger[8. Dans The incompleat folk singer. À noter que Seeger avait lui écrit sur son banjo : « This machine surrounds hate and forces it to surrender ». ].
Au fond, ce qu’il y a de plus sympathique dans la figure de Woody Guthrie, c’est sans doute sa modestie. Ce côté rustique mis en avant, assumé, revendiqué comme un gage d’honnêteté. « On va montrer à ces fascistes ce qu’une bande de péquenauds peuvent faire », lâche-t-il, rigolard, en introduction de « All You Fascists Bound to Loose ». Comme si la solution n’allait pas venir d’une posture théorique élitiste, mais plutôt d’un bon sens populaire qui finirait forcément par triompher. Goguenard, béret de travers, clope au bec, le petit barde se frayait son propre chemin, loin des mondanités et des tentations de reconnaissance, convaincu que ses semblables, un jour, feraient ravaler leurs méfaits à tous les patrons de ce monde.
Rétrospectivement, le constat semble un brin naïf (quoique…). Mais c’est aussi ce qui fait sa beauté. Malgré tout les motifs de déploration, il restait habité par l’idée d’un avenir scintillant – « Je déteste quand une chanson vous fait croire que vous êtes né pour perdre », martelait-il. La Grande Dépression avait frappé, il avait assisté – de loin, en tant que matelot – aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, il avait frôlé en victime la folie du maccarthysme, mais qu’importe : il ne lâchait pas l’espérance. Car les combats de Woody et de ses pairs s’inscrivaient dans des certitudes inébranlables, dont celle qu’ils allaient gagner, vu qu’ils étaient du bon côté de la barrière. Évoquant les années 1930 telles que Guthrie les lui avaient contées, le très jeune Bob Dylan expliquait ceci en 1963 : « Je ne sais pas comment on en est arrivés là, mais cela ne semble plus si simple. Il n’y a plus seulement deux camps, vous voyez ? Le temps du noir et blanc est fini. »
De l’eau a coulé sous les ponts. Des hectolitres bien vaseux. Woody Guthrie n’est pas totalement entré dans la mémoire universelle, contrairement à la légende Dylan, beaucoup plus sophistiquée, fascinante de génie, et aussi – il faut bien l’avouer – moins répétitive. Et s’il est permis de rire jaune devant le constat formulé par Dylan en 1963 – qu’aurait-il dit s’il avait eu 20 ans aujourd’hui plutôt que dans les sixties ? –, il est aussi permis de saluer bien haut la mémoire du sieur Woody Guthrie.
On peut d’ailleurs reprocher beaucoup de choses à Dylan, sa suffisance légendaire, son virage chrétien, une flopée d’albums hideux, mais il y a un élément qu’on ne pourra jamais lui retirer (outre une myriade de disques débordés par la grâce), c’est sa dévotion maintes fois confirmée envers son maître Guthrie. Alors que ce dernier se mourait dans un hôpital de la côte Est, grignoté par une maladie dégénérative, un Dylan encore juvénile lui rendit de multiples visites. « Woody me demandait toujours de lui rapporter des cigarettes, des Raleigh », écrivait Dylan dans ses Chroniques, avant d’évoquer sa profonde tristesse à voir son héros si diminué. Pour évacuer cette tristesse, tenter de lui remonter le moral, il lui chantait des chansons. Aussi bien les siennes que celles de l’homme alité. Parmi ses propres compositions, celle qui serait enregistrée sur son premier album, « Song To Woody », magnifique hommage et troublant passage de flambeau : « Je te chante cette chanson, mais je ne la chanterai jamais assez, / Car ils sont peu nombreux les hommes, / À avoir fait ce que tu as fait[9. « I’m a singing you the song, but I can’t sing enough, / Cause there’s not many men / That done the things that you’ve done. »]. »
Quant à la reprise que fait Dylan de « Pastures of Plenty », entonnée d’une voix douce sur un enregistrement peu connu, alors qu’il est très jeune, elle charrie avec elle toute la beauté de l’univers de Woody. Une tristesse fondamentale, mais également un émerveillement devant ces « pâturages d’abondance », la bonté de la terre nourricière et sa beauté, la fierté du labeur accompli et des mains crevassées d’ampoules. Toutes choses que Woody avait également chantées dans « This Land Is Your Land », mais de manière moins subtile. Ici, la musique se fait route, façonne des paysages, des montagnes, des ruisseaux insoumis, des forêts de poings levés. L’essence même de Woody Guthrie.
Pour aller plus loin :
Le site Les Mots Sont Importants a publié un bon article sur Woody Guthrie à l’occasion du centenaire de sa naissance. À lire ici.
Notes
| ↩1 | « Hey, hey Woody Guthrie, I wrote you a song, / About a funny old world that’s a coming along, / Seems sick and it’s hungry, it’s tired and it’s torn / It looks like it’s a dying and it’s hardly been born. » |