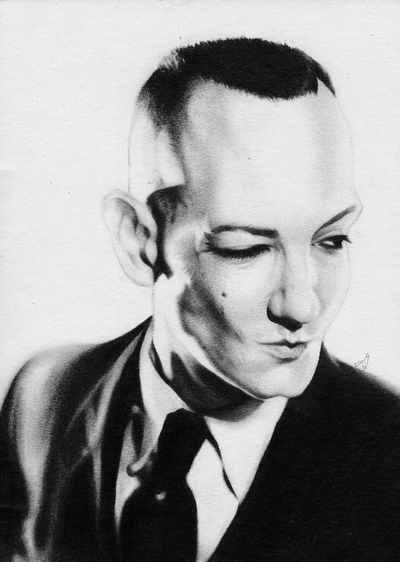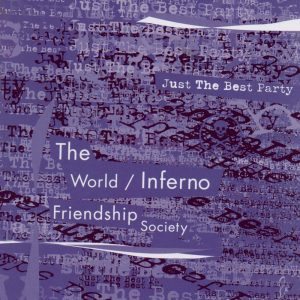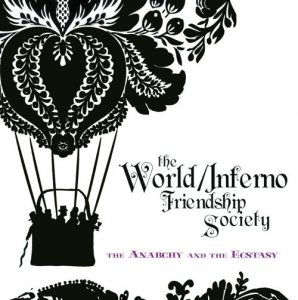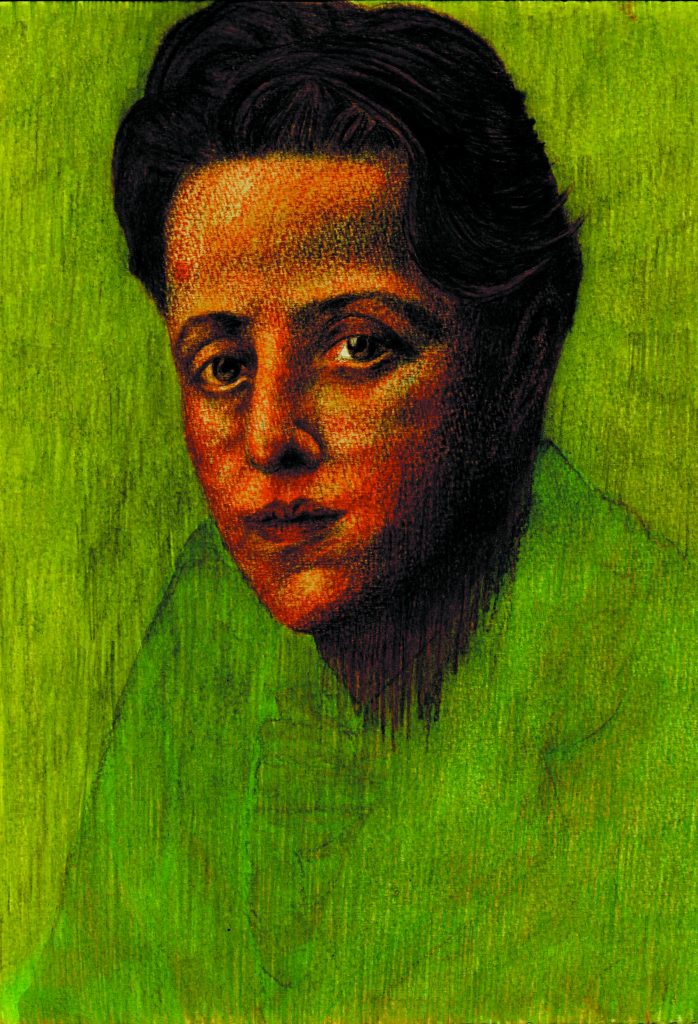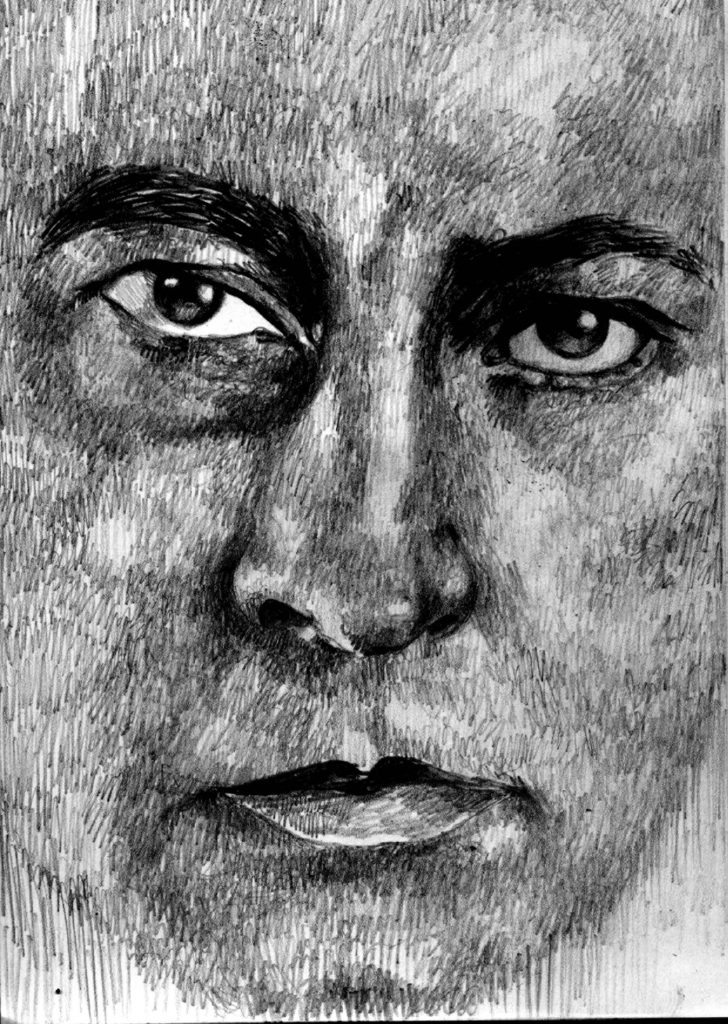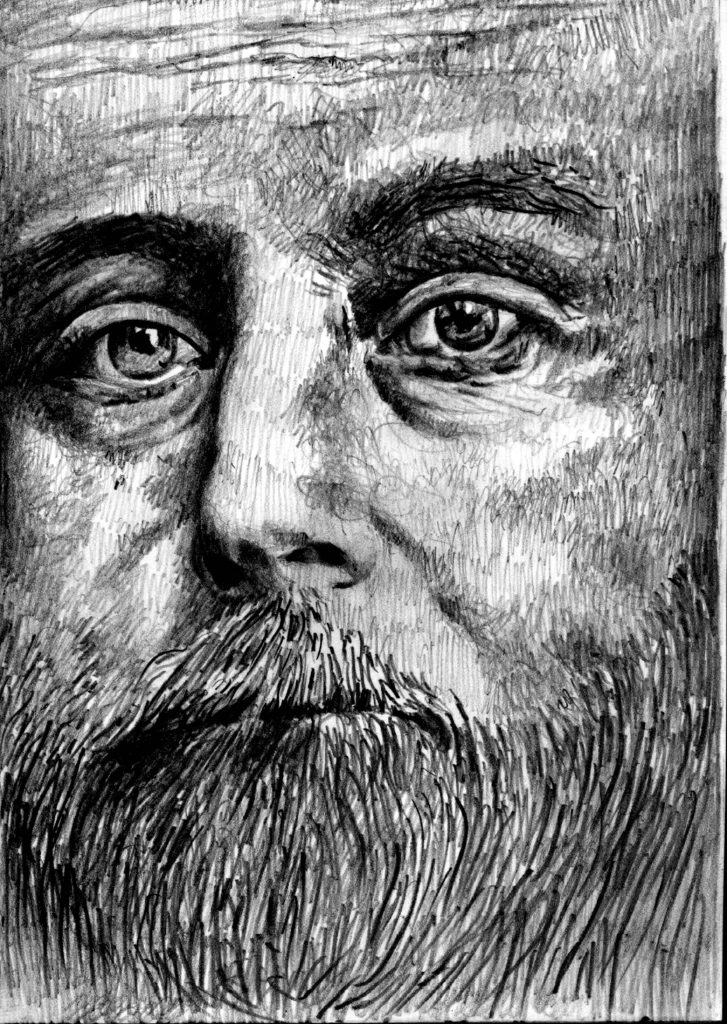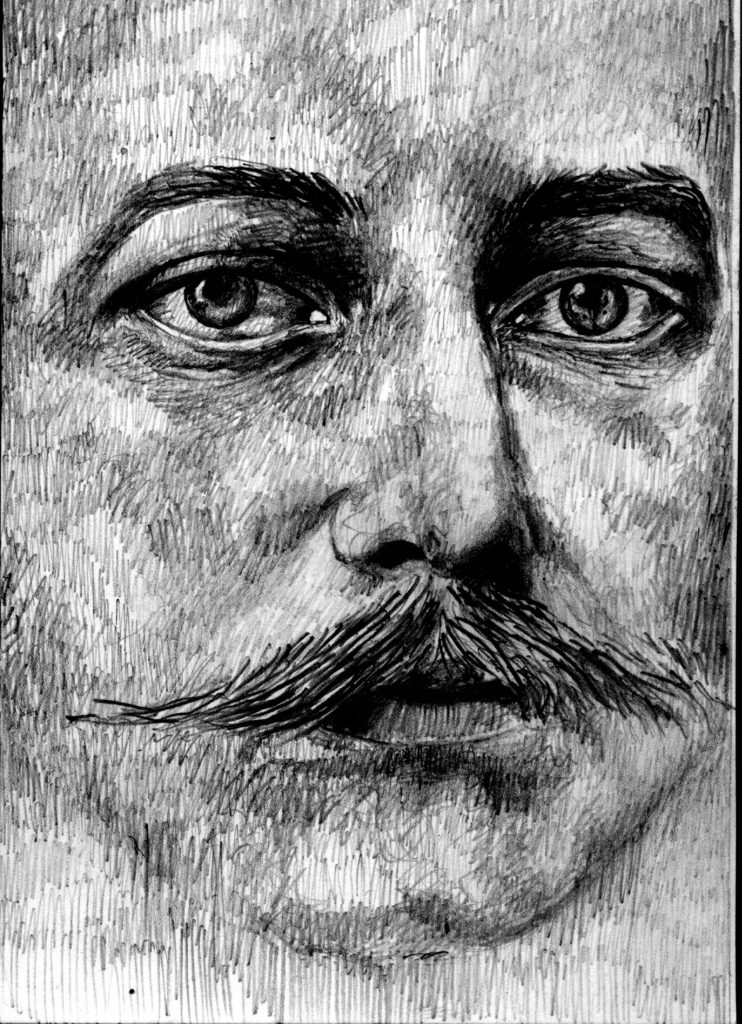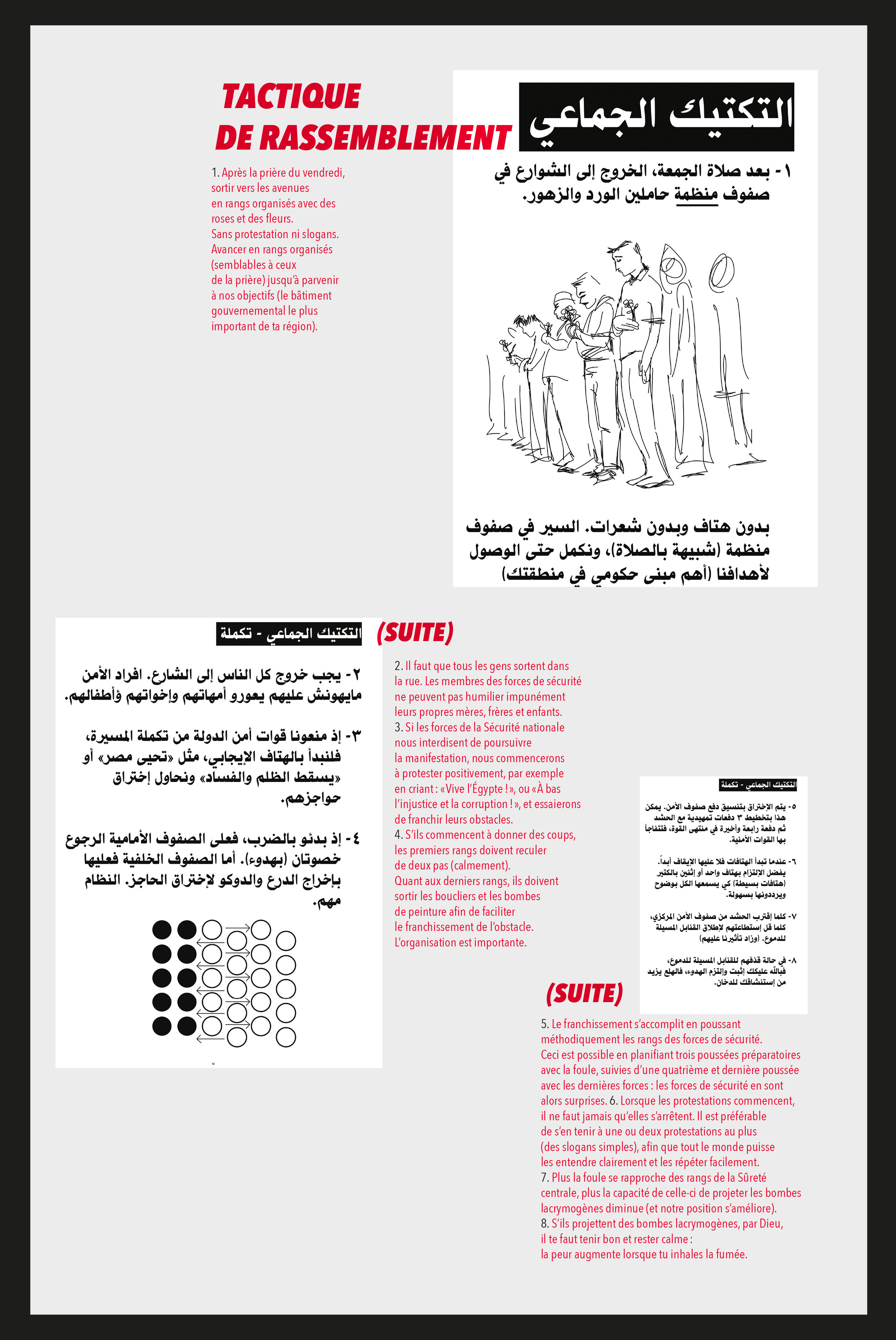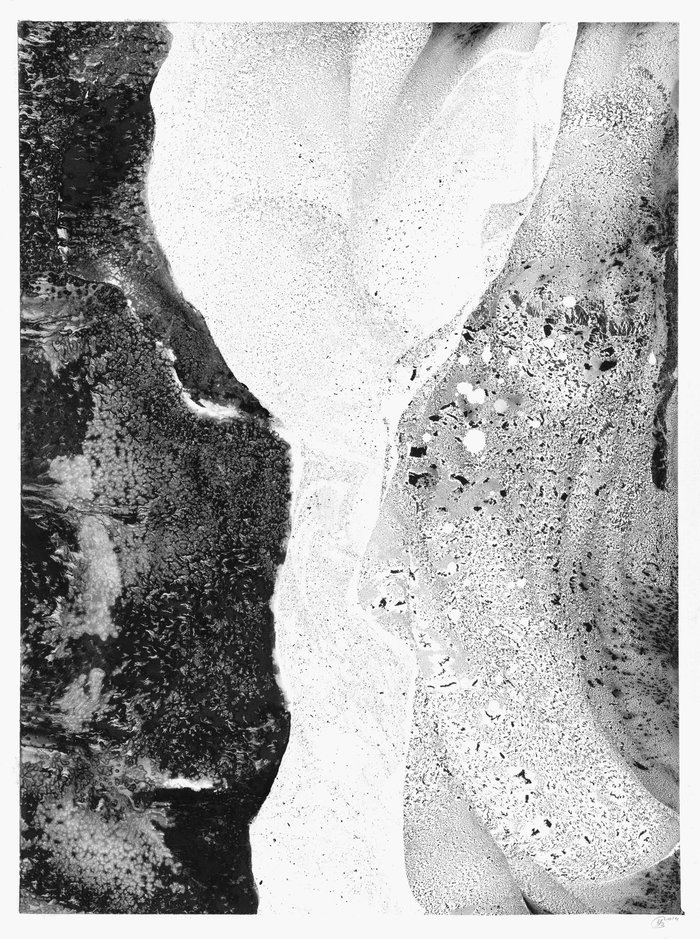C’est toujours au sein d’une idéologie que de nouvelles idées naissent. Des idées : autres. Souvent, elles viennent d’ailleurs. Cela fonctionne par râpes. Dans le monde mondialisé, qui est d’une complexion complexe, cela devient de plus en plus compliqué. On peut se demander si l’ailleurs existe, et si oui pour combien de temps.
C’est comme les bouquetins : il y en a dans les Alpes, mais finalement assez peu et parce qu’on les y a réintroduits.