Sortie pipi du matin, changer l’eau, recharger les croquettes, promenade au parc après le bureau… Pour bon nombre d’êtres humains, être propriétaire d’un chien est une occupation à mi-temps. Dans une démarche radicalement opposée, les maîtres vivant dans la rue s’impliquent totalement dans leur quotidien avec leur compagnon à quatre pattes. Une vie à partager les galères de l’exclusion, certes, mais aussi à transmettre les savoir-faire de la zone aux autres habitants des marges, humains aussi bien que canins. Même si elle est difficilement reconnue comme telle, cette éducation est souvent une question de survie. read more…
Selle de ch’val
Chienne de vie
Nou3 : l’humain, le cyborg et les espèces compagnes
Et si Médor et Pupuce devenaient des armes de destruction massive ? C’est ce que le tandem écossais Morrison/Quitely a imaginé pour son one shot comic book : Nou3, pur shoot stroboscopique de gore à fourrure. Histoire de réaliser une bonne fois pour toute que la guerre « zéro mort » n’existe que dans l’imagination des responsables de com’ en kaki.
Cet article est issu du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF.
Un dictateur en short et ses gardes du corps se font massacrer dans une somptueuse villa. Trois masses de métal surgissent de la maison juste avant son explosion, puis regagnent la remorque d’un camion garé devant. Dans le camion portant l’inscription « Animalerie », des hommes enlèvent leurs trois casques, découvrant un chien, un chat, et un lapin. Ce sont en fait des biorgs, animaux chirurgicalement et génétiquement modifiés par l’US Air Force pour piloter des armures de combats. « 3 », le lapin, libère des gaz létaux et pose des mines comme autant de petites crottes ; « 2 », le chat, est un combattant furtif des plus fatals, et « 1 », le chien, est un véritable petit tank. Après cet essai concluant sur le terrain, l’armée décide de passer à la phase suivante – « l’animal nouveau 4 » –, et ordonne l’euthanasie de ces prototypes. La scientifique qui les a éduqués désactive alors leurs entraves chimiques, et les trois biorgs s’évadent. Commence une traque sanglante où l’armée va se heurter à ces animaux-machines de guerre qu’elle a créés.
Ce n’est qu’un chien, ne vous attendez pas à des sonnets de Shakespeare.
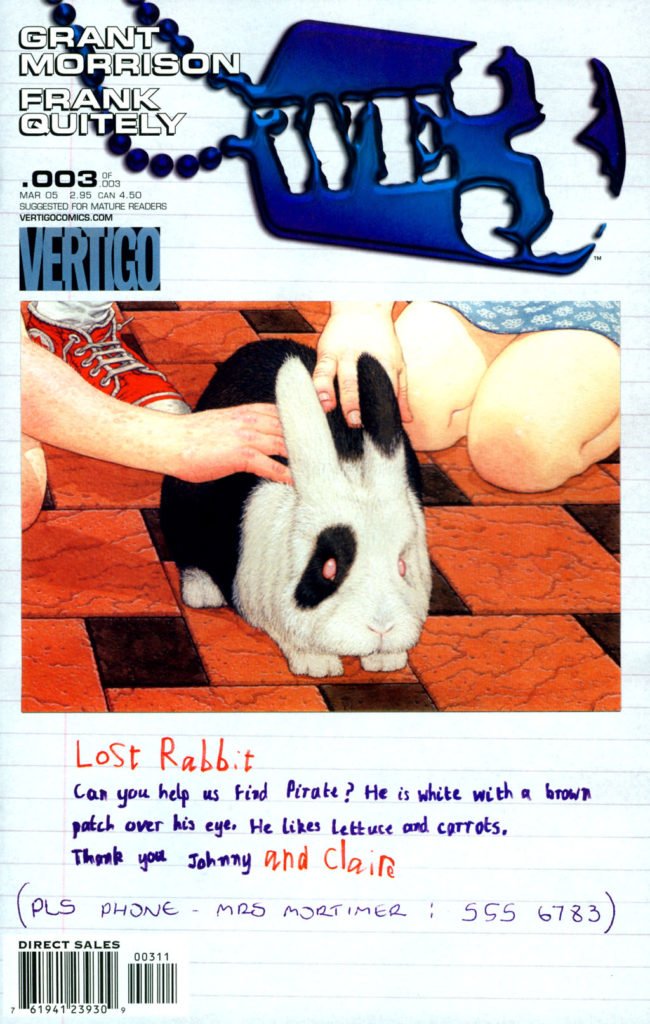
Les deux écossais Frank Quitely et Grant Morrison travaillent régulièrement ensemble – le premier assurant le dessin, le second le scénario –, leur association révélant le meilleur de chacun. Ce fut le cas lors de leur rencontre en 1996, pour les aventures surréalistes de Flex Mentallo – « l’Homme du Mystère du Muscle » qui tord la réalité en bandant ses muscles et a conscience d’être un personnage de fiction –, ainsi que pour leur reprise des NeW-X-MeN en 2001, et surtout pour Nou3 et All-Star Superman. Ce dernier, commencé en 2005, année de publication de Nou3, remporta d’ailleurs d’innombrables récompenses et un succès public assez exceptionnel pour une énième histoire du plus vieux des super-slips.
Frank Quitely, dont le pseudonyme est un anagramme de « quite frankly » (« en toute franchise »), est tout aussi à l’aise pour rendre dans le moindre détail des paysages réalistes, que dans la subtile exagération de certaines postures ou expressions faciales, telles les poses culturistes de Flex Mentallo avec son slip léopard et son torse difforme et velu, directement inspirées des réclames pour la méthode de développement musculaire du professeur Charles Atlas des vieux comics. Son trait méticuleux évoque parfois le regretté Moebius, par cette sorte de puissance douce, de mélancolie souriante, que dégagent certains de ses dessins. Ainsi de son Superman All-star tout en décontraction, rayonnant de force, qui s’inspire de la posture tranquille d’un fan déguisé en Kryptonnien, et tranche radicalement avec la tension ultra-virile que proposent l’écrasante majorité des représentations de ses contemporains. Le dessinateur écossais partage également avec l’auteur français des aventures muettes d’Arzach un goût pour les lèvres pulpeuses, mais surtout pour la narration sans paroles : certains épisodes de ses NeW-X-MeN, comme de longues séquences de Nou3, se déroulant quasiment sans texte.

Bon sang, il faut être taré pour apprendre à parler à une machine à tuer.
Nou3 est une œuvre d’une grande simplicité. Loin des scénarios complexes qui ont fait la réputation de Grant Morrison [voir encadré en fin de texte], son histoire, comme sa structure en trois chapitres – format plutôt rare dans les comics – sont minimales, et ses personnages simplifiés jusqu’au stéréotype. 1 le chien est indéfectiblement fidèle à l’humain et veut « rentrer maison » ; 2 le chat est caractériel et ne pense qu’à manger ; et 3 le lapin suit les autres sans dire grand-chose. Certes, leur « maîtresse » leur a appris des rudiments de langage humain, mais leur lexique SMS – « 1 sait 0 ! » – est rudimentaire, purement utilitaire, et à la limite du ridicule. Les animaux humains ne sont pas mieux traités : il y a le scientifique lâche et carriériste, son assistante empathique avec les animaux, que sa culpabilité pousse à trahir ses patrons, le sénateur aux dents longues et blanches, le général aussi stupide qu’impitoyable, les soldats chairs à canon muets, et le clochard au cœur pur.

Vous y voyez peut-être le triomphe de notre savoir-faire biotechnologique, moi, je ne vois que trois petites bêtes en colère…
Grant Morrison et Frank Quitely ont tout misé sur le découpage et la mise en page : « La simplicité de cette histoire nous permettait de nous livrer à un découpage beaucoup plus expérimental, et c’est ainsi que Frank Quitely et moi-même avons envisagé la réalisation des planches avec en tête l’idée de suggérer une perception non humaine de l’espace 1 Les citations de Grant Morrison et Frank Quitely sont extraites des bonus de l’édition française publiée par Urban comics.. »
Morrison qualifie le résultat de « western manga ». La perception non humaine de l’espace et du temps se traduit par un découpage tout en dilatation, des actions de quelques secondes se déployant en de multiples cases – ce qui distingue en effet le manga des comics américains et surtout de la BD franco-belge, où les actions sont au contraire très contractées. Mais les expérimentations de Morrison et Quitely ne s’arrêtent pas à un tel découpage à la japonaise. Les compères veulent « aborder ces planches non pas comme un espace plat en deux dimensions sur lequel nous “collions” mécaniquement nos cases, mais comme un espace 3D dans lequel ces mêmes cases pourraient être “accrochées” ou “en rotation”, voire empilées les unes sur les autres ». Ils multiplient donc les tentatives formelles plus ou moins heureuses, comme dans cette scène inaugurale où la mort du dictateur est donnée à voir sur une double page selon le point de vue subjectif des multiples balles qui le transpercent. Scène qui a le mérite d’« effacer tous les doutes des lecteurs quant au degré de gore utilisé dans cette émouvante histoire d’animaux calinoux », mais qui est finalement assez vaine. D’autres séquences sont plus réussies, telle l’évasion des cobayes, quasi muette, qui s’étend sur six pages et cent huit cases, chacune ayant été dessinée individuellement, avant que lui soit attribué un code couleur correspondant à une des caméras de surveillance captant la scène.
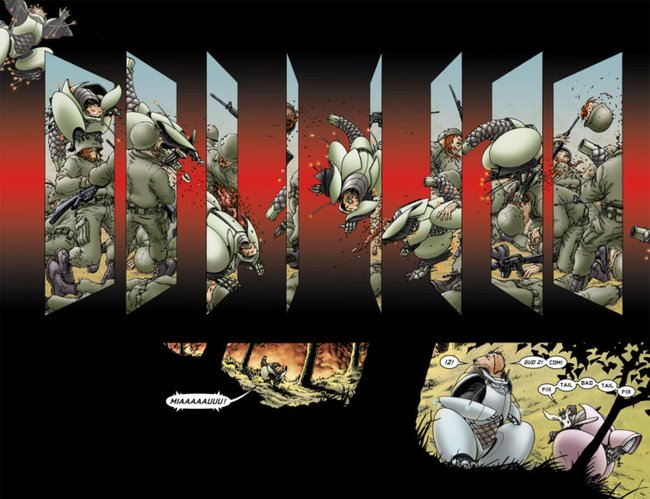
Au final, ce ne sont pas tant les scènes d’action au découpage sophistiqué – et souvent peu lisible – qui font de ce comic book une réussite, mais son savant dosage entre gros plans détaillés et doubles pages aérées, son rythme tout en accélérations et ralentissements, son équilibre entre violence et empathie. Le western selon Grant Morrison et Frank Quitely ? « L’abondance viscérale et quasi chirurgicale de tripes et de boyaux distillés dans l’œuvre, s’explique Grant Morrison, […] sert à contrebalancer le sentimentalisme inévitable lorsqu’on évoque nos animaux à fourrure. » Mais c’est justement ce mélange contre nature – ou plutôt naturel, trop naturel – qui fait la force de cette œuvre aussi minimaliste que virtuose.

Maintenant qu’on maîtrise la technologie, je veux des animaux avec la gueule de l’emploi, vous savez comment sont les gens.
Krypto, le chien de Superman, est souvent très humanisé – il pense et parle comme un humain –, y compris dans la version cartoon de la série animée Krypto the super-dog. Dans All-star Superman au contraire, Frank Quitely le dessine avec les postures caractéristiques d’un golden retriever, à ceci près que cette variété kryptonienne rapporte, en volant, des arbres entiers et porte fièrement, accrochée à son collier, une cape rouge frappée du « S » familial du plus puissant des encapés. De même, les biorgs de Nou3 ne sont ni anthropomorphisés ni anonymisés sous leurs exosquelettes mécaniques, mais apparaissent dans toute leur singularité d’espèces domestiques : 1 est un beau bâtard marron croisé labrador, qui répondait au nom de Bandit ; 2 est une chatte tigrée rousse avec le museau et le bout de la queue blancs que ses maîtres appelaient Minette, et 3 est un lapin blanc avec une tache sur l’œil auparavant prénommé Pirate.

Les trois animaux-machines de guerre ont chacun leur histoire, que le tandem écossais convoque en utilisant comme couverture de chacun des trois épisodes un avis de recherche collé dans les rues par leurs jeunes maîtres suite à leur disparition. L’écriture enfantine et les photos des gentilles bêtes dans leur foyer renforcent l’empathie qu’on peut avoir pour ces cobayes en cavale. Morrison et Quitely s’appuient, consciemment ou non, sur un phénomène connu en biologie du développement sous le nom de néoténie – littéralement « rétention de jeunesse » : la conservation de caractéristiques juvéniles chez les adultes d’une espèce. Ce phénomène se retrouve essentiellement chez les insectes, les amphibiens – remarquablement chez l’axolotl, qui peut procréer tout en restant une larve toute sa vie – et chez les animaux domestiques. Ainsi les chiens aboient et les chats ronronnent toute leur vie d’adulte, quand leurs cousins loups et chats sauvages ne le font qu’enfant. L’adulte humain serait de la même manière « un fœtus de primate parvenu à maturité sexuelle » [2. Louis Bolk, anatomiste et biologiste néerlandais du début du XXe siècle, connu pour sa « théorie de la fœtalisation » selon laquelle l’humain serait un être vivant au développement progressivement ralenti, théorie réhabilitée et réinterprétée par le paléontologue Stephen Jay Gould dans les années 1970.]. Selon les évolutionnistes, ces traits juvéniles auraient une fonction de séduction, aussi bien à l’intérieur d’une même espèce qu’entre espèces différentes, ce qui expliquerait la tendresse éprouvée pour les animaux domestiques. L’industrie du spectacle utilise d’ailleurs très bien cette attractivité, comme le montre clairement l’évolution du personnage de Mickey au cours du temps : souris adulte à ses débuts, elle devient de plus en plus enfantine, donc attractive [3. Voir le chapitre « Hommage biologique à Mickey » dans Le Pouce du Panda de Stephen Jay Gould (Le Seuil). Beaucoup d’objets techniques suivent d’ailleurs la même évolution néoténique que Mickey, tels les voitures ou les ordinateurs Mac, aux formes de plus en plus arrondies.].
La sympathie éprouvée pour les trois fugitifs s’appuie donc sur leurs museaux juvéniles, mais également sur leur solidarité et leur amitié interspécifique qui répondent à l’individualisme des humains et du projet censé les remplacer : « l’animal nouveau 4 », un mastiff augmenté et radioguidé – opposition individu/collectif qui fit les beaux jours des comics mettant en scène des équipes de super-slips, et particulièrement des X-Men.
D’ici novembre, Dan Washington posera son cul gominé dans le Bureau ovale. Il veut produire en masse les biorgs et mettre fin à la guerre conventionnelle.
Selon les militaires, gouvernants et responsables de recherche, le projet « Nou3 » n’avait d’autre objectif que de sauver des vies humaines sur le champ de bataille. Et c’est bien cette hypocrisie d’une guerre « zéro mort » que mettent en pièce Morrison et Quitely, rappelant avec force hémoglobine que, même menée par des animaux militarisés, la guerre tue, et tuera.
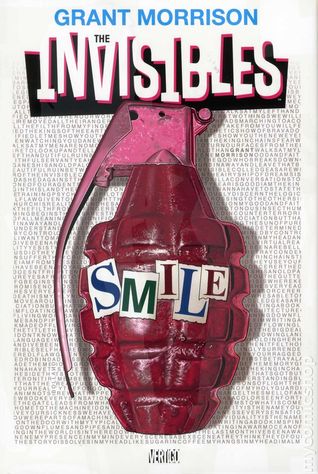
Nou3 ne prétend pas offrir un point de vue original sur l’humain et les autres animaux – il ne s’agit nullement d’un manifeste cyborg ou en faveur des espèces compagnes. Plutôt un brûlot antimilitariste en forme de mélodrame gore et animalier, où empathie naturelle pour les compagnons à quatre pattes et fantasme de sauvagerie et d’instrumentalisation guerrière s’entrechoquent dialectiquement. Bons démiurges, Grant Morrison et Frank Quitely ont cependant l’attention de réserver aux évadés survivants sinon un happy end, du moins une seconde chance. L’humain qui leur offre ce nouveau départ est d’ailleurs un de ces personnages en marge qu’affectionne Morrison depuis toujours : un SDF, croisé au pire de la traque, qui se révèle d’un grand bon sens face aux questions de l’armée à la poursuite des fugitifs :
Avez-vous vu quelque chose ? Il y a une grosse récompense. De l’argent, vous sauriez quoi en faire, non ? Quelqu’un comme vous. – Ouais ouais. C’est clair. Mais nan. J’ai rien vu, bande d’enculés de fascistes.

GRANT MORRISON, LE NON-SENS DU MERVEILLEUX
L’écossais Grant Morrison travaille pour l’industrie américaine du comics depuis trente ans, où il publie aussi bien des projets originaux que des réhabilitations de personnages oubliés ou des redéfinitions de poids lourds. Il est depuis la fin des années 2000 l’un des principaux scénaristes de la firme DC Comics, dont il supervise les événements et les personnages les plus importants. Il a ainsi revisité de fond en comble la biographie de Batman de 2006 à 2011, restaurant la loufoquerie de ses débuts et rompant complètement avec la version « réaliste » et réactionnaire du Vigilant en noir qui s’était imposée depuis les versions de Frank Miller dans les années 1980. À partir de 2011, il a même pu enfin réaliser un projet que son employeur principal lui avait jusqu’ici refusé : réinventer les débuts de Superman, à qui il fait quitter son slip et ses collants pour un jean et un T-shirt frappé de son logo familial [4. Voir l’article « Super-slips VS Bat-masques. Vérité et Justice VS Terreur et Sécurité », dans Jef Klak no2, « Bout d’ficelle », 2015.].
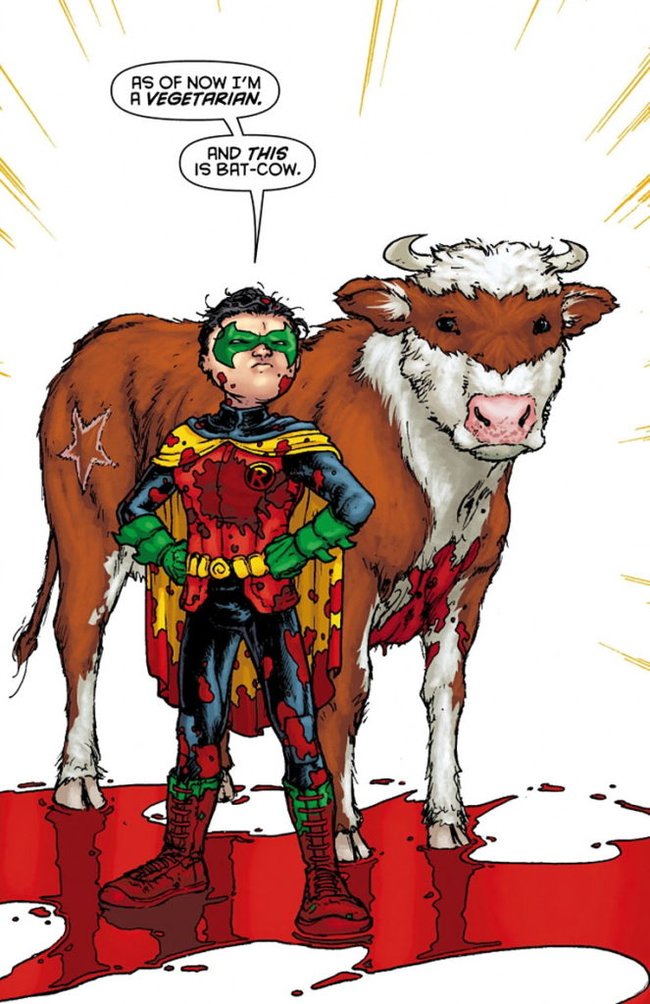
Sa première contribution aux comics américains s’intéresse déjà aux relations entre les hommes et les animaux. En 1988, DC Comics [5. DC Comics avait alors accepté deux propositions de l’écossais : la relance d’Animal man, ainsi qu’une histoire du Chevalier noir enfermé à l’Asile d’Arkham avec ses ennemis les plus fous. Cette aventure de Batman de l’autre côté du miroir deviendra l’un des « romans graphiques » les plus réédités : Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth, magnifiquement peint par l’Anglais Dave MC Kean.] avait en effet accepté de lui confier la reprise d’un personnage mineur créé en 1965 : Animal man. Grant Morrison se targuait d’être le seul à ne pas avoir oublié ce personnage capable de capter les capacités des animaux proches de lui : le pouvoir de régénération d’un ver de terre, la faculté de voler d’un oiseau, la possibilité de se dupliquer comme une bactérie… Morrison en fait un père de famille au chômage et militant végétarien, évoluant dans des enquêtes sur l’industrie agro-alimentaire et les laboratoires pharmaceutiques expérimentant sur les animaux [6. Grant Morrison devient alors lui-même végétarien, et le restera.]. Le scénariste écossais est alors très critique envers la vague grim & gritty [7. Cette vague « dure et sombre » creuse artificiellement l’approche déconstructive et réaliste ouverte par Alan Moore et Frank Miller en plongeant d’improbables hommes-plantes ou hommes-chauve-souris dans la réalité sordide des années 1980, notamment avec les séries Swamp Thing et The Watchmen pour le premier, et The Dark knights returns et Batman : Année Un pour le second.], ce virage violent et à la noirceur forcée que prennent nombre de comics de l’époque. Grant Morrison préfère plonger Animal man dans des aventures de plus en plus farfelues. Celui-ci rencontre ainsi en plein désert des Rocheuses un homme-loup condamné par un mystérieux « Dieu Tyran » à mourir et renaître sans fin – protagoniste qui n’est autre que Vil Coyote, le souffre-douleur de Bip-Bip, le Roadrunner des cartoons de Chuck Jones.

Lors d’un rituel chamanique, Animal man prend conscience de son statut de personnage de fiction, et casse le « quatrième mur » en s’adressant directement au lecteur : « Je vous vois ». Après une virée dans les Limbes, qui abritent d’autres héros oubliés, il débouche à Northampton et rencontre celui qui est à l’origine de ses récents déboires – notamment le massacre de sa femme et ses enfants : non pas un super-vilain, mais son créateur, Grant Morrison lui-même. Dans un long dialogue avec son personnage, celui-ci en profite pour critiquer son travail sur le début de la série : mal écrit, trop réaliste, trop militant, trop moralisateur, et reposant sur la celle trop facile du problème écologique du moment. Pour le dernier épisode qu’il écrit, Morrison offre donc à sa créature un happy end en ressuscitant sa famille, à l’encontre du « réalisme » le plus élémentaire.
Grant Morrison poursuit ses expérimentations narratives et méta-textuelles dans les séries DC qui suivent, particulièrement Doom Patrol – qui revisite une autre série des années 1960 et qu’il écrit sous l’influence de psychotropes et à l’aide des techniques d’écriture automatique des surréalistes – et sa délirante série originale, Les Invisibles, au projet des plus modestes : « C’est la BD que j’ai voulu écrire toute ma vie, une BD sur tout : l’action, la philosophie, la paranoïa, le sexe, la magie, la biographie, les voyages, les drogues, les religions, les ovnis… Et quand nous atteindrons la conclusion, je vous promets de révéler qui règne sur le monde, pourquoi nos vies sont ainsi, et ce qui nous arrive quand nous mourrons. »
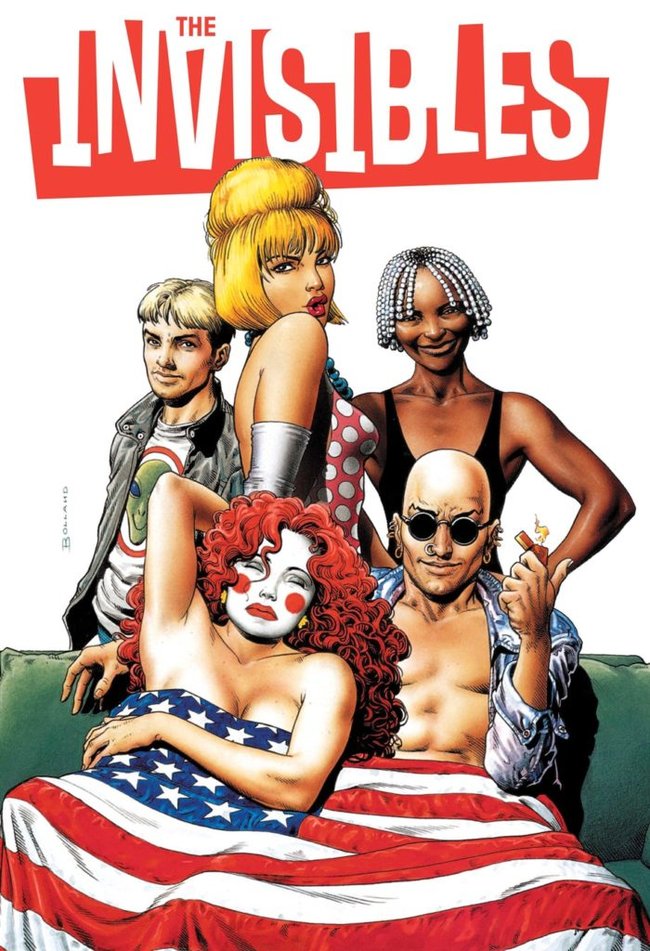
Au début des années 2000, il fait un passage remarqué chez Marvel notamment sur la série NeW-X-MeN, où il explore les implications politiques, médiatiques et générationnelles du « phénomène mutant » [8. La particularité des X-Men et autres mutants est que leurs pouvoirs leur viennent d’une mutation génétique.]. Mais Grant Morrison ne tarde pas à revenir à son écurie originelle, pour ne plus la quitter. DC lui laisse alors le champ libre pour écrire l’ambitieuse méga-série Seven Soldiers of Victory qui remet à jour des héros oubliés [9. Cette fois, Grant Morrison exhume des limbes du catalogue DC sept outsiders : Mister Miracle, Guardian, Klarion, Bulleteer, le Monstre de Frankenstein, Zatanna et Shining Knight. La méga-série consiste en sept mini-séries – et autant de dessinateurs – de quatre épisodes chacune, reliées par une introduction et un épilogue, soit trente numéros en tout.], ainsi qu’All-Star Superman, maxi-série qui ne revisite ou ne relance pas Superman, mais réalise une nouvelle synthèse du mythe aussi bien pour les lecteurs novices que confirmés. C’est à cette époque qu’il publie également chez DC trois mini-séries : Vimanarama, hybridant mythes hindous pakistanais et super-dieux à la Jack Kirby, en réaction à la vague raciste post-11- Septembre ; Seaguy, épopée picaresque d’un super-héros en combinaison de plongée dans un monde post-utopique qui n’a plus besoin de lui, et We3, qu’Urban comics traduira Nou3 lorsqu’il aura la bonne idée de le rééditer en 2012.
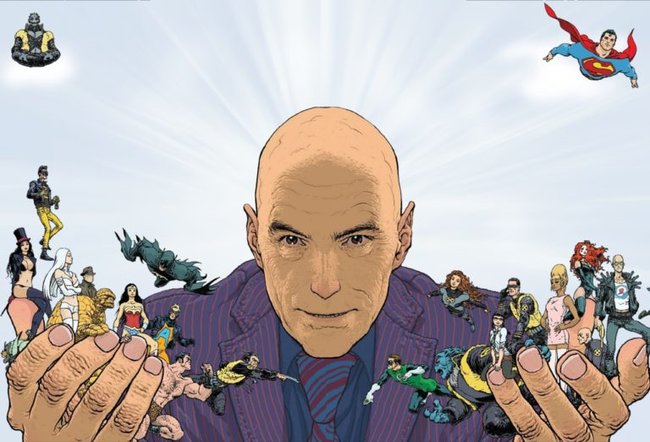
K9S, THE ROBOCOP-DOGS
En octobre 2015, Argo, chien policier au Texas, eut droit sur son lit d’euthanasie à un dernier appel radio de la police locale – rituel normalement réservé aux officiers disparus. Une vidéo de la scène circula sur les réseaux sociaux et devint rapidement virale, le bureau du shérif se retrouvant inondé de donations et d’odes poétiques au héros défunt. Argo était l’un des milliers de chiens qui travaillent pour l’armée ou la police américaine, que leurs collègues nomment « K9s » – abréviation phonétique de « canine [unit]s ». Sélectionnés, entraînés et importés d’Europe par des éleveurs spécialisés, ces chiens sont dressés pour mordre et déchirer des membres humains, ainsi que pour détecter des drogues ou des explosifs. Ils sont désormais aussi équipés de toutes sortes de technologies protectrices valant plusieurs milliers de dollars : dents en titanes, gilets pare-balles, caméras mobiles spécialement conçues pour des chiens.
Les bavures meurtrières et autres dégâts collatéraux commis par ces chiens de guerre sont légion, mais la sympathie du public leur reste acquise, comme l’a encore montré l’émoi collectif suite à la mort de Diesel, chien d’assaut du Raid tué lors de l’opération spectaculaire de la police à Saint-Denis en novembre 2015 (sans doute sous les balles de ses « collègues » humains). Cette popularité est en tous cas instrumentalisée par la police et l’armée pour adoucir leur image, les mascottes canines servant souvent d’outil de communication lors de rencontres publiques, voire des visites d’écoles. Grant Morrison et Frank Quitely ne sont pas les seuls à profiter du potentiel empathique des espèces compagnes…
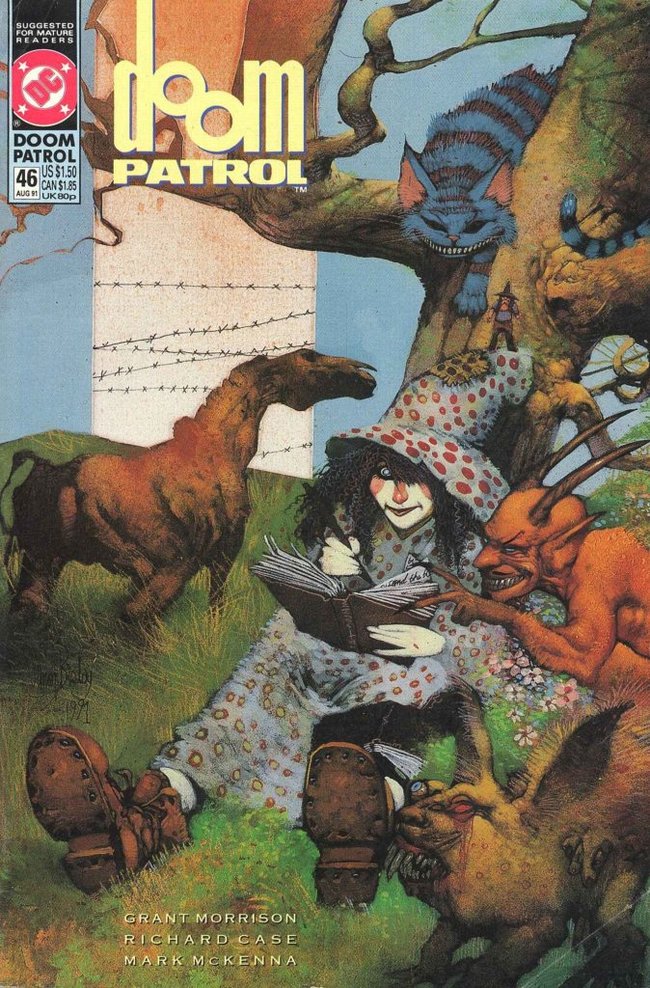
Notes
| ↩1 | Les citations de Grant Morrison et Frank Quitely sont extraites des bonus de l’édition française publiée par Urban comics. |
« Faire du cinéma comme on occupe des zones à défendre »
ZAD, rituel, micropolitique et cinéma : entretien avec les Scotcheuses
Dans l’histoire du cinéma, y compris celle du cinéma militant, on trouve peu de films réalisés collectivement, c’est-à-dire des productions où chacun prend part à la réalisation, de manière horizontale et non hiérarchique. En France, il y a les exemples célèbres des différents groupes de la fin des années 1960 et des années 1970, groupes Medvedkine 1 Les groupes Medvedkine, actifs entre 1967 et 1974, ont regroupé des ouvriers de l’usine Rhodia de Besançon et de celle de Peugeot à Sochaux pour faire des films en collaboration avec des … Continue reading ou Dziga Vertov [2. Le groupe Dziga Vertov, autour de Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin, a produit une série de longs-métrages marxistes-léninistes entre 1968 et 1972. ] en tête. À la même période, on peut aussi citer Cinema Action au Royaume-Uni, le Kasseler Filmkollektiv en RFA, des collectifs participant au mouvement des Newsreels aux États-Unis, d’autres en Amérique du Sud. Sans oublier les collectifs féminins comme le Collettivo Femminista di Cinema di Roma, London Women’s Film Group, le Frauenfilmteam de Berlin, et en France, autour de Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Ioana Wieder [3. Voir par exemple la rétrospective « United we stand, divided we fall » au festival Doclisboa en 2012 (doclisboa.org) et celle toute récente des films distribués par la Hamburger Filmmacher Cooperative au cinéma Kino im Sprengel de Hanovre (kino-im-sprengel.de). Voir également les sites du Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir et de l’association Carole Roussopoulos.]… Aujourd’hui, les exemples de créations collectives dans le champ du cinéma se font plus rares. C’est pourtant le choix fait par les Scotcheuses, un groupe mouvant, fabriquant des films en Super 8, formé en 2013, et qui a déjà finalisé quatre films. Les trois premiers ont été fabriqués dans des temps très courts, tournés, développés et montés sur le lieu même du tournage et montrés sous une forme performative avec un accompagnement sonore en direct. No Ouestern, leur dernière production, a été réalisé en un an sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec un temps d’écriture préalable, pour aboutir à une forme fixée, accompagné d’un son synchronisé à la projection.
Cet entretien est issu du troisième numéro de la revue papier Jef Klak, « Selle de ch’val », toujours disponible en librairie ou par abonnement.
++ Bonus son et vidéo en fin de texte ++
⋅ Anomalies, un ciné-tract contre le puçage des animaux
⋅ Une carte postale contre le projet d’enfouissement de Bure
Télécharger l’article en PDF.
Pour commencer, est-ce que vous pourriez donner la généalogie et décrire l’évolution de la méthode des Scotcheuses jusqu’à la bascule que représente cette dernière expérience de No Ouestern ?
Benoît : Le premier film, qui s’appelait Le Bal des absent.es, nous l’avons fait pendant une « fête des morts » dans les Landes. C’était une invitation à se retrouver autour de spectacles, de concerts, de films, à prendre un temps collectif pour échanger autour de la mort – après s’être dit qu’on était souvent assez seuls par rapport à cette question. L’idée de faire un film pendant la fête et de le projeter, c’était pour certaines des Scotcheuses inventer comme une forme de rituel qui permettait de se retrouver le dernier soir autour de ce qu’on venait de vivre, pour rassembler quelque chose. L’idée s’était déjà installée de faire des films ensemble et de témoigner des façons dont on vit, qu’on pourrait appeler « autonomes » au sens large : des manières collectives, où l’on essaie de réinterroger les questions de savoir, de hiérarchie, d’autorité, d’échange, de partage. Comme il y a peu de films qui parlent de ça, l’objectif était d’en témoigner en procédant de la même façon qu’on fait tout le reste, c’est-à-dire en s’organisant collectivement de manière horizontale.
Lionel : À l’issue de la projection, un copain nous a tout de suite proposé de reproduire l’expérience lors d’une fête organisée tous les ans par des éleveurs sur un causse du Tarn. Beaucoup parmi nous avaient envie de s’attaquer à la question de la fiction, en Super 8, et d’expérimenter ça en faisant un film collectif, c’est-à-dire où tout se décide avec tout le monde. Ceux qui organisaient cette fête étaient engagés dans une lutte : l’Union européenne et les gros syndicats agricoles cherchent à imposer aux éleveurs le puçage électronique des brebis [4. Depuis 2005, l’Union européenne a initié une réforme de l’identification des moutons et des chèvres. En France, tous les ovins et caprins sont désormais obligés d’être pucés électroniquement depuis juillet 2014. La puce implantée dans l’oreille des animaux permettrait une gestion informatisée des troupeaux et limiterait les risques sanitaires.], avec chantage aux subventions et compagnie. De nombreux petits éleveurs dans cette région refusaient ce puçage. Des gens solidaires venaient assister aux contrôles des institutions vétérinaires pour expliquer leur refus et à quel point cette surveillance était invasive et agressive.
Cette action ressemble à celles menées par les collectifs de chômeurs et précaires, qui font des accompagnements collectifs dans les Pôle Emploi ou lors de contrôles à domicile de la CAF. Avec ceux qui avaient participé à ces actions, on a élaboré un scénario de fiction qu’on a tourné pendant cette fête. On a aussi récupéré un reportage vidéo filmé au moment de ces actions et, plus tard, une émission radio où des éleveurs témoignaient de leurs pratiques et de leurs luttes. Avec de la musique jouée en direct lors de la fête et réenregistrée ensuite, le montage de l’ensemble a donné un petit film assez simple qui mélange à la fois le vrai contrôle et sa version fictive et burlesque.
Laurence : Sur les films suivants, il y avait une envie à la fois de s’inscrire dans une durée plus longue, d’élargir le groupe des Scotcheuses et, pour quelques-unes d’entre nous, d’aller à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, tout en réfléchissant à ne pas « arriver, filmer puis repartir en étant contentes d’être venues ». On s’est associées avec un atelier du Transfo [5. Un squat ouvert en 2012 à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, expulsé en 2014.] qui était issu du collectif de soutien de Notre-Dame-des-Landes et qui avait construit une cabane sur la ZAD. À partir de là, il y a eu l’envie d’une première phase d’ateliers communs où serait mise en jeu la circulation des savoirs pour la prise de vue avec la caméra, le développement des Super 8 et le montage.
Pour aller à la rencontre des gens sur place, nous sommes allées à la Châtaigne, un espace qui a pour vocation l’accueil des collectifs, mais qui, à ce moment-là, était au point mort par rapport à la dynamique de la ZAD. Pour que le lieu puisse être praticable, nous avons d’abord prévu une semaine de chantier de « réhabilitation ». La semaine d’ateliers qui a suivi a été très vivante : « On a quatre jours, on va faire tourner la caméra ! » Plein d’idées ont fusé sur le papier, qu’on n’a pas voulu hiérarchiser pour rester dans la spontanéité et l’envie de faire. Ensuite, dans un autre lieu de la ZAD, la Wardine, un labo a été aménagé pour qu’on puisse développer les films sur place.
À l’issue de cette semaine, on a finalement projeté le tout. Ce qui était assez chouette par rapport à ce lieu, c’est que beaucoup de personnes de la ZAD qui n’avaient pas forcément participé aux ateliers ont remis les pieds à la Châtaigne. À la tombée de la nuit, l’ambiance était très festive, au-delà d’une simple projection. On a cette énergie-là, et le désir d’étendre la fonction d’accueil de la projection, avec une bouffe collective et une attention particulière pour aménager l’endroit. Nous avions disposé dans l’espace les masques utilisés pour le film, qui avaient été réalisés à l’occasion d’une grande manif de soutien à Notre-Dame-des-Landes le 22 février 2014 à Nantes. On les avait disposés comme des espèces de totems. Cet ensemble de petites attentions à ce qui va se jouer pour une représentation a donné naissance à Sème ton western. Tout en se disant que ce n’était qu’une première étape vers un film plus conséquent, avec un processus collectif d’écriture en plusieurs phases, qui allait prendre plus de temps et appeler d’autres enjeux que cette spontanéité et cette urgence qui sont notre marque de fabrique.
Lionel : Contrairement aux expériences précédentes, qui étaient plutôt de l’ordre de la performance, puisqu’on accompagnait en direct la projection, il y avait l’envie de prendre le temps de fabriquer un film autonome, c’est-à-dire qui puisse être diffusé en tant que tel, avec sa bande-son associée. Pour les autres films, on avait bien fini par faire des DVD, d’autant qu’avec le Super 8, le film s’altère peu à peu au gré des projections, mais comme la forme avait été produite pour être montrée avec un accompagnement musical, la version DVD était beaucoup moins forte que le live.
Était-ce à cause d’une frustration par rapport à la période précédente, ou bien simplement la volonté d’engager une autre forme d’expérience ? Maintenant que vous avez fait les deux, est-ce que vous envisageriez de revenir à la forme « performance » pour un futur projet ou bien vous pensez que c’est un passage plus définitif ?
Lionel : Ça venait de l’envie de faire aussi autre chose, même si ça a donné lieu à pas mal de discussions.
Benoît : Je pense qu’il n’y a pas une seule réponse à cette question, chacun peut avoir la sienne. Ce qu’on tente de faire, c’est de mettre en place une méthode et une forme, de construire un film ou un ciné-concert sans qu’il y ait de décision au départ : c’est un processus où l’on conçoit le film en le fabriquant. Nous débattons aussi de la question du temps, avec l’idée que la contrainte peut aider. Même pour No Ouestern, en l’espace d’un an, il y a eu deux sessions d’écriture de dix jours, une session de tournage de quinze jours, et deux sessions de montage de dix jours, ce qui est plutôt court pour un film fait à vingt personnes et qui dure vingt-cinq minutes…
Jean : Mis bout à bout, ça fait un mois et cinq jours !
Laurence : Cela dit, le temps de digestion est à chaque fois important. Comme ça se passait à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où certaines d’entre nous n’étaient jamais venues, il fallait construire des liens sur place, ce qui n’est pas quelque chose qu’on peut prendre à la légère. Venir une première fois, puis une seconde, etc., a permis que le film s’intègre dans la logique du lieu. Ça n’aurait pas du tout été pareil si on était parties là-bas un été pour faire le film en un mois.
L’écriture a été pensée de façon suffisamment large, comme un canevas, pour intégrer à chaque fois l’obligation du présent, avec une façon de s’organiser qui permettait d’intégrer des gens qui n’avaient pas participé à toutes les étapes. Les conséquences de cette réécriture permanente ont pu être un peu douloureuses, parce qu’il a fallu que chacun puisse trouver sa place à chaque étape, mais globalement ça a fonctionné. Le collectif a pu rester ouvert ou fluctuant, avec certaines personnes qui assuraient la continuité.
Vous avez parlé de rituel, et je pense que c’est quelque chose de central dans le travail des Scotcheuses – dans la fabrication et au moment de la projection, comme vous l’avez souligné. Qui dit rituel, dit croyance, et je voulais vous interroger sur le choix de travailler avec le Super 8, avec le support film.
Marc : Il y a la question de la rareté du matériau, qui rend tout geste de tournage important et qui impose une réflexion en amont. Nous sommes très nombreuses à prendre les décisions, et ce temps préalable au déclenchement de la caméra nous permet de penser ensemble et de nous mettre d’accord. Si on n’est pas d’accord, on ne le fait pas, parce qu’on ne va pas déclencher des tournages sans avoir une envie commune. Par ailleurs, le temps de montage s’en trouve raccourci parce qu’on a peu de rushes. C’est vrai à la fois sur le dernier film, qui a été écrit d’un bout à l’autre avec un découpage précis, et sur les autres qui ont été montés sans structure préétablie comme Sème ton western, qui était comme un grand puzzle assemblé à l’intuition. Ce sont des outils finalement assez simples, qui permettent de transmettre un savoir technique par rapport à l’image et au son : c’est une bonne manière d’apprendre à faire un film. Enfin, bien sûr, il y a une question esthétique… Filmer en Super 8 permet de s’échapper du réel, et on peut plus facilement créer un monde à part entière.
Jean : C’est comme si on défendait une zone en faisant ce type de cinéma. C’est en lien avec tout un mouvement, avec toute une croyance, comme tu disais. Mais la croyance en un collectif sans hiérarchie contient sa part de fantasme, et à un moment ou l’autre, des rapports de force apparaissent et sont toujours très difficiles à résoudre. On croit au possible, et on se retrouve confronté à un réel qui est autre, un réel où il y a toujours des hommes, avec leurs problèmes de subjectivité, de représentation de ce qu’ils sont.
Laurence : Il y a des femmes aussi !
Jean : Je voulais dire des êtres…
Laurence : Je déconne…
Benoît : On est aussi extrêmement attachées à projeter en Super 8. C’est tout le processus de la prise de vue jusqu’à la projection qu’on essaie de tenir. Je ne sais pas si on peut parler de rituel, mais c’est sûr qu’on accorde beaucoup d’importance au moment où l’on donne à voir le film, quelque chose qui se pense et où l’accueil est important. À cet endroit, ce n’est pas la même chose de projeter en Super 8 ou en vidéo. Est-ce que cela tient à un rapport sensible avec l’image qui est projetée ? À l’objet projecteur qui trône au milieu, avec sa singularité ? Déjà, le fait de devoir monter les pellicules au Scotch – c’est pour ça qu’on s’appelle les Scotcheuses –, c’est un autre rapport au montage. L’approche est beaucoup plus intuitive que devant un logiciel de montage ; cela permet de se saisir très vite de ce qu’est le montage sans passer par tout un apprentissage technique rébarbatif. Cela fabrique du commun, peut-être plus facilement qu’avec la vidéo numérique : il est plus facile de se retrouver autour d’images qu’on vient de développer et qui sèchent sur un fil à linge que devant des piles de disques durs. Et à la fin, il y a une plus grande évidence à se dire : « On a fait ça toutes ensemble ».

Peut-être parce qu’il y a un objet…
Benoît : Un objet palpable, visible, avec lequel on a un rapport…
Laurence : Charnel !
Jean : Quand j’étais plus jeune, je faisais de la musique électro-acoustique avec de la bande magnétique. Lorsque les bandes magnétiques ont disparu, ça a rompu quelque chose et je n’ai jamais pu m’y remettre.
Lionel : À cette question du Super 8, il y a aussi une réponse pragmatique : on pouvait le faire parce que certaines bossaient avec un lieu, L’Abominable [6. Laboratoire cinématographique partagé situé à La Courneuve. www.l-abominable.org], qui est organisé autour des formats argentiques. Nous voulions sortir cette technique-là d’une structure un peu lourde, trouver des formes plus légères pour pouvoir le faire dehors, mais c’est l’accès aux matérialités du L’Abo qui l’a rendu possible. Pour moi, la croyance intervenait plutôt dans la possibilité du collectif, et le choix du Super 8 dans la volonté de casser un certain rapport aux images : contrairement aux expériences d’il y a trente ans, aujourd’hui, tout le monde a déjà un petit peu filmé, et le choix du Super 8 permet de remettre un peu d’étrangeté. Grâce à cette technique un peu étrange, on apporte de l’égalité, parce que même celles d’entre nous qui ont déjà une pratique du cinéma doivent faire face à quelque chose de nouveau.
Est-ce que vous pourriez développer un peu la question de la circulation des connaissances, et du déminage des effets d’autorité que les connaissances techniques procurent ? C’est assez impressionnant de voir comment, chez les Scotcheuses, il y a la fabrication du film, mais aussi de tout un ensemble de choses en parallèle, comme de multiples ateliers où des groupes s’affairent : faire la cuisine pour vingt personnes, répéter la musique, faire une affiche, fabriquer des livrets pour accompagner le DVD, etc. Ce n’est évidemment pas sans rappeler un espace militant où, à l’occasion d’un mouvement, ce type de composition peut-être très fort. Mais quelles sont les parts de réalité et de fantasme dans la circulation et le partage des connaissances ?
Stéphanie : Comment déjouer le fait que, dans les moments d’urgence, ce soient les personnes qui ont le savoir qui prennent la main ? Quand il faut installer la projection, comment éviter qu’invariablement ce soient celles qui savent faire le câblage qui s’y collent, que celles qui savent manipuler le projecteur projettent et que celles qui savent couper les gâteaux coupent les gâteaux ? C’est ce qu’on tente de bouger, même si parfois on se fait rattraper. Nos rapports au savoir évoluent, on se transmet des pratiques, c’est sans cesse en mouvement. D’ailleurs, d’ici peu on va se retrouver pendant une semaine, sans rien d’autre de prévu que faire à manger et manger, toutes ensemble. Pour prendre le temps, justement.

La question a-t-elle été différente pour les trois premiers films que pour No Ouestern ? Ce n’était pas la même temporalité, pas la même énergie, pas la même volonté de fabriquer un objet aussi « fini »…
Lionel : Oui, mais par exemple, dès le deuxième film, Anomalies, il y avait une séquence d’animation. Cela venait du fait que certaines tripaient sur l’animation, mais aussi que ça permettait de faire quelque chose d’autre. Sur le montage de No Ouestern, nous étions vraiment très nombreuses, et nous n’aurions pas toutes pu être, huit heures par jour, autour de l’ordinateur. La fabrique du livret qui accompagne le DVD s’est faite en parallèle, ce qui permettait à chacune de trouver sa place sans être contrainte de glander pendant que d’autres travaillaient. Une place trouvée en fonction de ses affinités, de ses envies de faire, y compris de ses névroses. Qu’il y ait plusieurs ateliers en même temps, ça peut aussi parfois servir de zone de fuite…
Jean : Ça a pu se passer avec la musique dans certains cas. À un moment, on s’est retrouvées à seulement deux pour faire la musique au fond d’un jardin, coincées là-dedans, sans trouver la possibilité de le développer avec d’autres. C’était difficile. Dans la musique aussi, il y a tout un savoir, qui vient d’une pratique. Après, il y a ceux qui disent savoir et qui deviennent des professeurs, et inversement ceux qui sont toujours en quête de savoir. Du coup, le rapport est difficile dans la restitution, et cela tombait parfois dans des rapports un peu névrotiques.
Laurence : Si on est conscient de son savoir et qu’on ne le manipule pas à des fins de domination, il y a quelque chose d’autre qui se joue dans cette restitution – même si des fois, il y a ce que vous appelez des névroses. Nous sommes toutes des puissances désirantes qui formons un collectif ; on a fait un film à vingt, et on pourrait faire vingt films, mais on a décidé d’en faire un ensemble. Et parfois, ça bascule parce qu’il y a des affects narcissiques qui ne lâchent pas, ou des enjeux interpersonnels qui viennent se mêler à tout ça : c’est là qu’il peut y avoir une fragilisation du collectif. Ou alors, il arrive que des rapports de domination qu’on ne voudrait pas voir apparaître interviennent, mais je ne crois pas que ce soit exclusivement lié à la détention d’un savoir.
Il y a aussi le rapport à l’ego, à l’humilité, à cette créativité que chacune a, et qui nous rend complémentaires. Parce que si certaines savent faire du cinéma, d’autres savent faire du théâtre ou autre chose. Même aujourd’hui où l’on est en train de faire des livrets, ça joue, parce qu’on fait tout à la main, et que faire des pochoirs aussi, ça s’apprend. Si le collectif n’est pas attentif, il peut broyer celles et ceux qui le composent. Les individus y restent des individus s’ils ne jouent pas le jeu du « Et si je laissais les autres faire, même si ce n’est pas mon idée ? Tiens, essayons ». Ça n’a pas toujours été le cas, et ce serait un vœu pieux de dire que, demain, on aura toutes une véritable humilité et une vraie écoute…

Est-ce que vous trouvez tout de même les moyens de déjouer ces choses-là ?
Jean : Quelque part, on a réussi à les déjouer, puisque les films existent ! Après, pour chacun dans son château d’ego, il y a des défaites. Il y a des affrontements, des souffrances, c’est pas le monde des Bisounours, mais ce qui nous importe, c’est que « l’outil Scotcheuses » se développe. Ce n’est pas une idéologie, peut-être même pas tant une croyance, c’est avant tout un outil qui est en train de s’affiner. On commence à se connaître et à connaître nos défauts par rapport au savoir. Notre rapport au savoir est un rapport de désir, ce qui est normal, mais l’un peut instrumentaliser l’autre : on veut avoir le savoir pour pouvoir faire advenir son désir.
Benoît : Il y a aussi la tension entre l’ambition et les attentes qu’on peut mettre dans les choses qu’on fait et l’attention au processus qu’on vit ensemble. Il peut y avoir des conflits autour de ça, qui peuvent se loger aussi bien sur la bouffe que sur le film ou la musique. Ce ne sont pas que des histoires de savoir ou d’ego, ça peut être aussi des formes d’ambition ou d’exigence, ou la peur de ne pas être à la hauteur, qui fait qu’on ne fait plus attention aux autres. Comment on s’en sort ? Quand il y a des crises, on se réunit, et c’est par la parole que ça passe, puis on se remet au travail… C’est tellement des histoires d’enjeux imbriqués les uns dans les autres qu’il n’y a pas de méthode miracle. Comme dans tous les espaces collectifs, c’est une attention à avoir, en ayant pour la plupart eu l’occasion de déminer les rapports de domination, le tout combiné à une pensée féministe assez présente dans les Scotcheuses.
Lionel : Toute activité collective, et même solitaire, génère des souffrances et du plaisir. Comme l’envisage la psychothérapie institutionnelle, quand il y a un collectif, il faut aussi le soigner en tant que tel, pour qu’il ne crée pas trop de pathologies. Mais en plus de cette difficulté du collectif, quand on fabrique un film et qu’on le montre à d’autres, c’est important d’aboutir, parce que sinon c’est très décevant, et il y a de grandes chances que l’expérience ne puisse pas se poursuivre. Chez les Scotcheuses, à chaque fois, nous avons utilisé l’urgence, la date butoir, le fait de se fixer des objectifs dans le temps pour nous obliger à finir un objet.
Marc : Toute cette discussion, ça me chamboule un peu. Quand on me demande ce que je retiens de cette expérience, je suis très enthousiaste, et au final, les films eux-mêmes en tant que résultats importent moins que l’expérience de vie. Aujourd’hui, on parle beaucoup de choses négatives, mais personnellement, j’ai ressenti une grande évidence à beaucoup de moments, et j’ai connu très peu de souffrance. Aucune, en fait. Même s’il y a des concessions, qu’on ne va pas forcément au bout de ses idées ou de son ressenti, on l’accepte sans que ce soit forcément une souffrance. Ça peut aussi être agréable de se dire : « J’arrive à dépasser mon ego, j’arrive à apprendre », et c’est ultra important dans ce collectif-là, parce qu’on est tout le temps en recherche. On cherche une forme de fabrication d’objets filmiques que personne ne nous a apprise. C’est ça qui est hyper vivant et excitant : remettre en question les façons de faire, tout en créant et en vivant ensemble.
Laurence : Cela vient aussi d’une forme d’amitié entre nous qui se développe. Même s’il y a des formes de vexations ou de frustrations, c’est à l’intérieur d’un collectif uni par du commun. Je me souviens, à la fin de la première session de montage sur la ZAD, où c’était quand même assez tendu, on a eu une discussion : certaines choses ont émergé, d’autres se sont réglées de manière interpersonnelle, d’autres ne se sont pas réglées, mais il n’empêche que le soir même, on présentait un « ours polaire [7. En argot de cinéma, un « ours » est une forme inachevée d’un montage.] » comme on l’avait appelé, et on était toutes là. C’était quand même une très belle soirée. Je crois que savoir être dans une forme de festivité nous a toujours tenues ensemble.
Jean : La restitution nous réunit à chaque fois, nous ressoude, et dans ce sens-là, le mot rituel n’est pas faux. Comme si on gagnait du terrain sur ce qui s’impose constamment dans le quotidien de l’existence. Comme les copains et copines qui défrichent la terre, et c’est pour ça qu’à la ZAD, ils nous ont dit qu’on apportait une certaine fraîcheur, dans le sens où ils s’apercevaient qu’on peut aussi faire du cinéma de la manière dont on occupe des Zones à défendre. C’est cette position qui m’intéresse dans ce collectif.
Lionel : Et réciproquement, je ne suis pas sûr qu’on aurait réussi à faire un film « toutes seules », à trente, dans une zone autarcique, si on n’avait pas été si bien accueillies par la ZAD. C’était sans doute parce qu’on amenait du dehors à un moment où les gens de la ZAD en avaient besoin, mais pour nous, ils créaient aussi un rapport à un extérieur qui nous aidait beaucoup dans les problèmes du groupe.
Stéphanie : Je peux parler ? C’est ça aussi, les Scotcheuses. Il faut se battre pour prendre la parole !
Jean : Avec soi-même…
Stéphanie : Oui, avec soi-même, mais aussi avec les temps morts qui n’existent pas entre les gens qui parlent, et c’est difficile aussi parfois. Pour moi, ce qui est chouette dans les Scotcheuses, c’est une capacité d’accueil, même quand tu ne vas pas bien. Être toujours dans le faire, dans le faire des choses ensemble, ça permet d’être avec d’autres, et même si tu ne fais rien, ça bouge des trucs. Cette capacité d’accueil, elle n’est pas là seulement quand tu ne vas pas bien, c’est une ouverture à la rencontre et une capacité à s’intégrer dans des dynamiques qui sont là où nous sommes en étant véritablement « dedans », en n’étant pas simplement en regard de quelque chose qui se passe.

Quel a été votre rapport aux réalités politiques dans la fabrication et la diffusion des films ? Dans les deux films qui ont été tournés à Notre-Dame-des-Landes, un certain nombre d’éléments sont facilement reconnaissables par ceux qui connaissent ces endroits-là, et pour les autres, une très forte sensation d’étrangeté peut faire penser à des films hors-sol comme Week-end [8. Week-end est un film de Jean-Luc Godard de 1967, le dernier avant la période du groupe Dziga Vertov, qui met en scène un week-end chaotique d’un couple de petits bourgeois perdus dans une Seine-et-Oise insurrectionnelle et sanglante.] ou Tràs-os-Montes [9. Tràs-os-Montes est un film portugais de Margarida Cordeiro et Antonio Reis de 1976 tourné dans la région éponyme, à mi-chemin entre documentaire et merveilleux.]. Avec le risque que ceux qui sont plus du côté militant trouvent ça trop mou, que les documentaristes trouvent ça trop énigmatique, que ceux de la fiction trouvent ça trop contingenté par le réel, tout en trouvant la bonne distance par rapport à la réalité, celle qui vous va en tant que Scotcheuses.
Laurence : Bien sûr, la question « À qui s’adresse-t-on ? » s’est posée. D’emblée, l’idée n’était pas de faire un film didactique pour expliquer ce qu’était la ZAD, mais plutôt de faire quelque chose qui nous ressemble, car la plupart d’entre nous sont engagées dans des luttes. De fait, nous avions un langage commun et il n’était pas question de le nier. Qu’il y ait des choses qui puissent paraître de l’autoréférence, nous en avions conscience, mais nous ne voulions pas nous autocensurer.
Il faut assumer d’être situé. On ne peut pas échapper à son propre langage, à ses propres codes, à ses propres imaginaires, sous prétexte qu’on l’a décidé. À la fois on en avait conscience, et à la fois on s’est interrogées là-dessus. Je me souviens d’une conversation : « Est-ce que ça ne fait pas un film qui ne parle qu’aux potes ? » Et en même temps, que No Ouestern soit sans paroles fait qu’il est regardable par des gens qui ne parlent pas français, c’est une décision qui a été prise consciemment. Des choses dans le film peuvent paraître mystérieuses, mais l’objet film n’est pas complètement décontextualisé, il y a le livret qui l’accompagne. Nous, lors d’une projection, on est là pour que des questions émergent et que ça donne lieu à un voyage pour aller rencontrer la réalité de la ZAD. Pour les militants, c’est vrai que le film ne reflète pas totalement la conflictualité, qu’il peut contribuer à une forme de mythification de la ZAD, sans être pour autant dans la carte postale.
Benoît : Il faut avoir confiance dans le fait qu’en ne séparant pas la manière dont on vit, ce qu’on vit avec les gens et le fait de fabriquer un film, ça peut toucher plein de personnes. Il faut dire aussi que la ZAD est un endroit extrêmement puissant, et qu’une caméra enregistre le réel : ça parle directement, parce que rien que les constructions qu’on y voit sont déjà riches d’imaginaire.
Est-ce que vous vous posez la question du rapport à la convention, dans le sens où, dans une fabrication collective, il y a un écueil qui serait que le consensus aille vers le plus commun, mais dans le mauvais sens du terme, c’est-à-dire le plus convenu ?
Lionel : J’ai l’impression que ce n’est pas un écueil dans lequel on est tombées, sans doute parce qu’il y avait beaucoup de gens dans le collectif qui avaient une vraie confiance dans la possibilité qu’une décision collective ne soit pas un consensus mou, même si cela nous obligeait à pousser les discussions assez loin et à atteindre parfois de hauts niveaux de fatigue ou de conflit. Nous avons aussi tenté de l’éviter par les méthodes de travail. Aucune Scotcheuse n’a participé à l’écriture de toutes les scènes, et on s’est toutes individuellement impliquées dans certaines scènes plus que d’autres. Cette tentative de composer des imaginaires très différents a peut-être un peu desservi l’unité du film, mais en tous cas, ça n’a pas produit de consensus mou.
Jean : Comme c’est le non-savoir qui est commun, ce serait difficile de tomber dans un consensus idiot et plat. Je le sais par rapport à la musique. La musique peut être intéressante à partir du moment où il y a du non-savoir organisé qui produit quelque chose qui, à l’écoute, est aussi intéressant que s’il y avait du savoir.
Bonus 1 : Anomalies
Anomalies est un cinétract tourné en super 8 par le collectif des Scotcheuses, un docu-fiction sur les éleveurs de moutons qui refusent le puçage de leurs bêtes, réalisé lors d’une fête sur un causse du Tarn, mêlant récits de luttes, discussions, banquets, musiques, danses, spectacles… Nos hôtes, éleveurs de brebis, étant en lutte contre les contraintes et les contrôles imposés par les réglementations européennes et françaises, nous leur avons proposé de faire ce film et de le montrer le dernier jour de la fête. Au départ, il y a ce qu’ils vivent et ce qu’ils défendent dans leur refus, et à l’arrivée un conte burlesque des temps modernes, projeté avec ou sans accompagnement musical suivant les forces en présence…
Pour aller plus loin :
Bonus 2 : Carte postale de Radio Scotcheuses dans la Meuse
Les Scotcheuses travaillent aujourd’hui à la de fabrication d’un film d’anticipation post-apocalyptique, une fiction avec des personnages en prise avec la catastrophe, autour de Bure et du projet de site d’enfouissement de déchets nucléaire Cigéo.
Plusieurs sessions d’écriture, d’atelier Super 8, de prise de son, d’invention de saynètes théâtrales, ou de fabrication musicale, ont déjà eu lieu avec celles et ceux qui luttent contre la méga-poubelle nucléaire meusienne.
Pour cette republication, elles nous ont envoyé cette carte postale sonore, réalisée lors du premier temps de tournage du film à venir.
Pour aller plus loin :
Notes
| ↩1 | Les groupes Medvedkine, actifs entre 1967 et 1974, ont regroupé des ouvriers de l’usine Rhodia de Besançon et de celle de Peugeot à Sochaux pour faire des films en collaboration avec des cinéastes et des techniciens connus, dont Chris Marker. |
Le loup de Moscou
Un bestiaire de Vladimir Vyssotski
Chanteur-loup, poète-cheval et gueule d’acteur, Vladimir Vyssotski chante démuselé les silences soviétiques. Vie à vif d’un anticonformiste à guitare, dont la voix rugueuse hurle et arrache la liberté. Portrait animalier de celui qui « trottait autrement ».
Télécharger l’article en PDF.
NB : sauf mention contraire, toutes les traductions du russe, y compris les paroles de chansons, sont d’Yves Gauthier.
Cet article est issu du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », traitant des relations entre les humains et les autres animaux, et toujours disponible en librairie.
Automne 2015. Moscou. La librairie BiblioGlobus, rue Miasnitskaïa. Les caissières du rez-de-chaussée ronchonnent, dignes héritières des acariâtres vendeuses soviétiques, mais le magasinier du 1er étage semble danser d’un rayon à l’autre avec son escabeau, émouvant Noureïev à la calvitie plantée de rares touffes blanches. Lui seul semble danser dans ce labyrinthe où le lecteur lambda se perdra, malgré les bornes électroniques censées le renseigner.
– Avez-vous un rayon « Vyssotski » ?
Il s’éponge le front.
– Non. Enfin, si, un peu partout : « Littérature soviétique », « Poésie », « Théâtre », « Biographies », « Nouvelles et récits », « People ». On sait plus où le mettre. (Il sourit.) On pourrait aussi le mettre au rayon « Monde animal ».
Il reprend son escabeau et s’éloigne en sifflotant « La Chansonnette du perroquet pirate » (Vyssotski, 1973).
« Je n’ai jamais été perroquet… »
« Il y a, dans le disque Alice au pays des merveilles, l’histoire d’un perroquet qui raconte comment il en est venu à vivre cette vie-là de navigateur, pirate, etc. Je chante moi-même le perroquet. À ce propos, je tiens à balayer la question qu’on me pose toujours : est-ce que je suis celui que je chante ? Qu’on se le dise, je n’ai jamais été perroquet, ni au propre ni au figuré. D’ailleurs, je suis tout le contraire d’un perroquet 1 Propos enregistrés le 21 février 1980 lors d’un concert public donné à Dolgoproudny, dans la région de Moscou.. »
Un perroquet sans l’être. Au cirque, il y a l’ours et le montreur d’ours. Tout en se défendant de l’un ou l’autre, Vyssotski aura cherché les deux à la fois, par son pouvoir de réincarnation, de mélange des focales et des genres.
Inclassable
Un artiste à la croisée, voilà Vladimir Vyssotski (1938- 1980), chanteur-compositeur russo-soviétique : « Je suis ce que je suis. Un poète, un compositeur, un acteur… Peut-être trouvera-t-on un mot nouveau dans le futur. Mais pour l’instant ce mot n’existe pas [2. Interview télévisée enregistrée le 14 septembre 1979 dans les studios de Piatigorsk par le journaliste Valéry Perevoztchikov.]. » Un peu méchant, le poète russe Evgueni Evtouchenko dira (en 1987) que Vyssotski n’était ni un grand poète, ni un grand compositeur, ni un grand acteur, mais grand dans le mélange des arts. « C’était un grand caractère russe. Il y avait en lui quelque chose qui tenait de Stenka Razine, de Pougatchev, une soif de liberté, une soif inextinguible, quoi qu’on fasse pour lui tordre le cou [3. Propos tenus devant la caméra d’Eldar Riazanov pour son film Quatre rencontres avec Vladimir Vyssotski, 1987, production Gosteleradio SSSR.]. »
De là, peut-être, l’impossibilité de le comparer pour le présenter au monde ; qu’il soit traduit dans 157 langues ne suffit pas à lui trouver d’équivalent. Pour donner au public (notamment francophone) une idée du bouillant Vyssotski, il faudrait touiller dans un même saladier François Villon, Georges Brassens, Gérard Philippe et Jean Gabin (Voir Annexe en fin de texte).
Au nom du loup
Il y a comme une intimité organique, symbolique, quasi mystique, entre le chanteur et l’animal. En 1967, Serge Reggiani sort un disque avec Les loups sont entrés dans Paris, chanson écrite par Albert Vidalie. Le vinyle atterrit aussitôt à Moscou dans la valise de la traductrice Michèle Kahn, pour tomber dans l’oreille de Vyssotski qui fréquente le foyer moscovite de la Française. « À force de faire tourner ce disque, Volodia [surnom de V. V.] l’a usé jusqu’à la corde [4. « La passion française de Vladimir Vyssotski », interview de Michèle Kahn par Ekaterina Sajneva, Moskovski Komsomolets, 24 janvier 2005.]… », dit celle qui, plus tard, traduira pour lui ses chansons en français.
David Karapétian, ayant partagé la vie de Michèle Kahn, constate finement dans ses mémoires Vladimir Vyssotski entre le verbe et la gloire : « Ce qui intéressait Volodia, c’était moins le texte que le style d’interprétation de Serge Reggiani, cette manière magistrale qu’il avait d’imiter le hurlement du loup. “Les lou-oups… ouououh…” Une fois entré dans le coeur écorché de Vyssotski, ce refrain hurlant l’incita à écrire sa Chasse aux loups [1968], par la grâce de quoi la meute impitoyable des prédateurs se transforma en un peuple d’éternels martyrs aux yeux jaunes. On aurait dit que l’ancien galopin [du quartier populaire moscovite] de la Samotioka était lié à la France par le fil invisible de la fatalité. Longtemps encore ces “loups français” allégoriques obsédèrent son âme avide de tout. Dans le genre mauvais garçon, tel François Villon, il pouvait faire irruption dans le silence tranquille de notre chambre à coucher par un coup de fil intempestif, au beau milieu de la nuit, et alors l’oreille encore ensommeillée de Michèle furibonde entendait tonner “Les lou-oups… ouououh”. »
Dès lors, ces lou-oups ne sortiront plus de sa gorge. Ni de sa réputation : le bestiaire mental des Russes place Vyssotski au chapitre des loups. Dans le seul dessin animé auquel l’acteur ait prêté sa voix, Le Magicien de la ville d’émeraude (1974), c’est précisément un loup qu’il sonorise, personnage inexistant dans le conte original d’Alexandre Volkov et peut-être créé sur mesure par le scénariste Alexandre Koumm. Il faut citer aussi le célébrissime dessin animé soviétique Attends voir ! (Nou Pogodi ! à partir de 1969) – série culte s’il en est – dont le héros est un loup fripon toujours aux trousses d’un lapin plus malin que lui : son créateur Viatcheslav Kotionotchkine (1927-2000) avait évidemment choisi la voix de Vyssotski pour celle dudit polisson, mais « Niet ! » s’était récriée la censure. Le réalisateur se vengera plus tard en plaçant quelques-unes des chansons de l’acteur dans ses films.
Fable tragique d’une tension extrême, et pièce maîtresse du répertoire de Vyssotski, La Chasse aux loups (1968) sonne à la fois transparente et cryptée dans nos oreilles françaises. Pourtant, une seule clé suffit : l’une des méthodes de chasse au loup les plus pratiquées en Russie est celle dite des fanions. Elle consiste à dérouler à hauteur de museau un cordon de fanions rouges espacés d’une trentaine de centimètres les uns des autres autour d’un périmètre où des loups ont été repérés. Des tireurs sont apostés le long du cordon à intervalles réguliers (on laisse entre chacun une portée de fusil). Au centre du périmètre commence une battue. Les loups traqués cherchent à s’échapper, mais danger ! ils s’arrêtent net devant les fanions, non parce qu’ils sont rouges (le loup est daltonien !), mais parce qu’associés à la présence de l’homme et à son odeur. Les tireurs embusqués n’ont plus qu’à décharger leurs basses oeuvres.
Peu de loups parviennent à surmonter le blocage « psychologique » du cordon à fanions rouges… Son franchissement devient pour le poète l’acte transgressif – symboliquement et socialement. Vyssotski se saisit de cette image pour peindre en un chant tragique les rapports qui se jouent entre loup-poète et État-chasseur :
Course éperdue, j’ai les tendons qui craquent,
Aujourd’hui encore comme hier déjà,
Ils m’ont pris à la traque, pris à la traque,
Et rabattu sur des tireurs en joie.
Dans les sapins claquent les canons doubles,
Où les chasseurs se sont dissimulés,
Et roulent les loups sur la neige, roulent,
À des cibles vivantes assimilés.
C’est la chasse aux loups qui fait rage,
c’est la chasse aux loups !
Aux gros pères à poil gris comme
aux petits loulous.
Tous les rabatteurs crient, les chiens
s’arrachent la glotte,
Sang sur la neige et drapeaux rouges
à l’air qui flottent.
À ce jeu-là, pas d’égalité,
Les chasseurs tirent sans coup férir,
Leurs drapeaux bornent nos libertés,
Ne jamais sortir de leur ligne de mire.
Jamais un loup n’enfreint la tradition,
C’est mis dans le crâne des louveteaux
Quand la louve allaite ses nourrissons :
« Interdit, mon p’tit,
de braver l’drapeau ! »
C’est la chasse aux loups qui fait rage,
c’est la chasse aux loups !
Aux gros pères à poil gris comme
aux petits loulous.
Tous les rabatteurs crient, les chiens
s’arrachent la glotte,
Sang sur la neige et drapeaux rouges
à l’air qui flottent.
Nous avons la patte et le croc féroces
Alors pourquoi, dis, toi le chef des loups
Courons-nous au feu de toutes nos forces
Sans même tenter de braver l’tabou ?
Mais le loup n’a point d’autre destinée,
Et pour moi déjà, c’est la fin du drame
Celui à qui j’étais prédestiné
Avec un sourire lève son arme.
C’est la chasse aux loups qui fait rage,
C’est la chasse aux loups !
Aux gros pères à poil gris comme
aux petits loulous.
Tous les rabatteurs crient, les chiens
s’arrachent la glotte,
Sang sur la neige et drapeaux rouges
à l’air qui flottent.
Je suis entré en désobéissance,
La vie prend le dessus,
Derrière mon dos j’entends, ô jouissance,
Les « oh ! » et les « ah ! » des gens déçus.
Course éperdue, j’ai les tendons qui craquent,
Mais aujourd’hui ce n’est plus comme hier,
Ils m’ont pris à la traque, pris à la traque,
J’ai laissé les chasseurs plantés derrière.
C’est la chasse aux loups qui fait rage,
c’est la chasse aux loups !
Aux gros pères à poil gris comme
aux petits loulous.
Tous les rabatteurs crient, les chiens
s’arrachent la glotte,
Sang sur la neige et drapeaux rouges
à l’air qui flottent.
Chanson phare parmi les plus censurées de l’auteur : les « chasseurs » s’étaient sentis visés. Il faut dire qu’elle fut écrite en réponse à une campagne de dénigrement menée dans la presse contre Vyssotski, le menaçant du pire. Aujourd’hui que Vyssotski est déifié, statufié, cela semble lointain, quand bien même il resterait de vieilles injustices. Témoin, ce journaliste vyssotskophile, Alexeï Vénédiktov, le 16 avril 2015, à la faveur d’une conférence de presse présidentielle d’un autre Vladimir :
« Vous êtes de Saint-Pétersbourg, Vladimir Vladimirovitch [Poutine], et moi de Moscou, mais… à Moscou, il n’y a toujours pas de rue Vladimir Vyssotski. Trente-cinq ans se sont écoulés depuis sa mort, et rien ! Impossible de faire bouger les choses ! Or la législation moscovite permet au président d’intervenir, et alors le gouvernement de Moscou pourra rebaptiser la rue Marxiste, qui mène au théâtre de la Taganka [où Vyssotski fit sa carrière] en rue Vladimir Vyssotski. Peut-être pourra-t-on du même coup inaugurer le pont Nemtsov [où l’opposant Boris Nemtsov fut assassiné devant le Kremlin le 27 février 2015] ? » Cent jours plus tard, les officiels faisaient tomber le voile de la plaque « rue Vladimir Vyssotski ».
À ce propos, le sculpteur Mikhaïl Chemiakine m’a confié cette année que lui-même, à l’occasion d’un tête-à-tête, s’était ouvert à Poutine de cette inquiétude : pourquoi ne pas cultiver au niveau de l’État la mémoire du loup-poète Vyssotski, son ami ? Et Chemiakine, ancien artiste dissident jadis assigné de force à l’internement psychiatrique puis chassé d’URSS en 1971, n’a pas été peu surpris d’entendre de la bouche de l’ancien officier du KGB Poutine, devenu président : « Ma jeunesse a baigné dans l’oeuvre de Vyssotski. » C’était le génie du poète à la guitare : fédérer les âmes – des chasseurs et des loups – par la force sublimatoire de son chant. Savoir parler au roi comme au peuple… Molière sut le faire, pourquoi pas Vyssotski ?
La chasse aux loups n’a pas cessé, cinquante ans après la mort du poète. Les Tchétchènes, chez qui le loup est un animal totémique, en ont fait un chant phare, symbole de la fierté de leur peuple. De cette chanson, la télévision tchétchène a tiré un clip sur des images d’archives de l’encerclement de Grozny par les troupes russes lors de la première guerre de Tchétchénie (1994-1996), et sur les mots « pris à la traque, pris à la traque » jaillit à l’écran le jeune Ramzan Kadyrov, actuel président de la Tchétchénie, en tenue de combat, fusil mitrailleur à l’épaule, brêlé de cartouchières, prêt à franchir les fanions rouges…
Dix ans après sa Chasse aux loups, Vyssotski revient avec La Chasse en hélicoptère (1978), d’une violence inouïe, autrement désespérée, car cette fois les loups pourchassés par les « libellules d’acier » sont réduits à l’état de chiens asservis, à l’image de cette scène finale du Fond de l’air est rouge, film de Chris Marker sorti la même année avec en exergue cette citation du poème (traduction Chris Marker) :
La queue entre les jambes, comme des chiens ;
Tourné vers le ciel, votre museau étonné…
Est-ce le châtiment qui tombe des cieux,
Ou bien la fin du monde ?
Tout se tord dans vos têtes.
Mais on vous a tirés debout depuis
les libellules d’acier…
Sourions à l’ennemi de notre sourire de loup
Pour couper court aux rumeurs.
Mais sur la neige tatouée de sang :
notre signature –
Nous ne sommes plus des loups.
https://www.youtube.com/watch?v=6ZOr2ZWF_YU
Noblesse du loup, donc, mais crapulerie du chien : « Des loups nous sommes, belle est notre vie de loups. / Des chiens vous êtes, et crèverez comme des chiens », tonne Vyssotski dans cette même Chasse en hélicoptère. Clin d’oeil solidaire à Victor Hugo : « Quand je vois ces chiens, je regrette les loups. »
Chez Vyssotski, le loup prend le contrepied de la tradition, c’est un héros à la fois tragique et positif. « Avec moi, dit-il, tout est à rebours. Si un jour je me noie, cherchez-moi dans le sens contraire du courant [5. Cité par le cinéaste Stanislav Govoroukhine dans le recueil Vladimir Vyssotski et le cinéma, sous la direction de I.I.Rogovoï, éd. Kinoteatr, 1989.]. »
Un centaure en poésie
La version vyssotskienne des Yeux noirs (1974) ravale cependant le loup à sa fonction première de bête de proie. Le chant conte l’ivre et folle chevauchée du poète à l’assaut de la sylve, la bouche fleurie de mots d’amour désespérés, une meute de loups à ses trousses :
Et je gueule aux loups :
Meute de malheur !
Mes chevaux sont fous,
Piqués par la peur…
Course enivrante, mais qui dessoûle le poète, et dont les chevaux sortent vainqueurs, semant la meute. Étrange victoire de Vyssotski contre lui-même, où l’homme-loup (sa part de brigand libertaire) se fait battre par l’homme-cheval (sa part de guerrier). Car le cheval est l’autre nature de V. V., et L’Ambleur (1970) peut être regardé comme le pendant chevaleresque de La Chasse aux loups. Là, Vyssotski se voit comme « un cheval qui va l’amble ». Parce qu’aller l’amble, en russe, se dit « marcher autrement » :
Je trotte, oui, mais je trotte autrement
Par les champs, les flaques et la rosée.
Ils disent de moi que je vais amblant,
Que je me distingue de la mêlée.
Il se décrit en pleine course, écumant, les flancs piqués, le mors à la bouche, tiré à la bride, et surtout regimbant : d’accord pour courir dans le peloton, « mais pas sous une selle et pas bridé ». Et Vyssotski ne serait pas Vyssotski s’il ne finissait par faire tomber son jockey pour passer le premier la ligne d’arrivée, lequel jockey achève la course en claudiquant « par les champs, les flaques et la rosée », semblable à ce chasseur déjoué par le loup profanateur de drapeaux rouges. On ne bride pas un poète comme on sangle un cheval ; on ne l’abat pas non plus comme un loup.
Chez V. V., quand un cheval entre dans la fable, les arpèges de guitare tournent insensiblement à la romance tsigane, à la mélodie russe archétypale, le poète vous transporte dans les entrailles de la culture populaire. Neige, traîneaux, clochettes, beffrois bulbeux. Vous doutez de l’âme russe ? Vous la prenez pour une chimère chevrotante ? Les Chevaux obstinés vous remettront d’entrée sur les rails de la Russie éternelle, magnifiquement désespérée, résignée toujours, soumise jamais, mystique à ses heures, comprenne qui pourra. « Chevaux antiques, chevaux aguerris,/Que de guerriers triomphants nous montèrent ! /Que d’illustres peintres d’icônes/Nous couvrirent les sabots d’or… » (poème inachevé, date inconnue).
Il existe une prolifique iconographie vyssotskienne où, parfois, le poète est à juste titre figuré en centaure – moitié homme, moitié cheval. « Le cheval est un pégase monté par un poète » (1977) [6. Extrait de la chanson (non retenue) « Incendies » composée en 1977 pour le film Oubliez le mot « mort » de S.Gasparov, 1979.]. Le cheval, dans ses chansons, c’est la fuite éperdue, l’ivresse, une course effrénée vers quelque chose qui tiendrait à la fois du salut et de la perdition, un horizon désiré en même temps que conjuré. Dans Les Chevaux obstinés (1972), V. V. se voit longer en traîneau le bord d’un gouffre, sur le fil, la cravache à la main, plein d’une pulsion contradictoire, pressant et refrénant ses chevaux, manquant d’air, buvant le vent, avalant la brume, pressentant sa perte avec une « exultation mortelle », aussi léger qu’un « duvet dans l’ouragan », mais oh ! tout doux, tout doux les chevaux, qu’au moins vous retardiez d’un rien l’heure du trépas…
Plus doux, plus doux l’allure, chevaux,
votre allure effrénée !
Tant pis si la cravache claque autant…
Ah ! drôles de chevaux que vous êtes,
obstinés, obstinés…
De vivre et de chanter je n’ai pas eu le temps !
Mes chevaux j’abreuv’rai,
Mon couplet j’achèv’rai,
Que je fasse un instant front au vide béant !…
La fable exotique
À voir ces loups tragiques et ces chevaux fatals, on se rembrunit malgré soi. Heureusement, la fable vyssotskienne irradie la joie par un héros salvateur : l’animal exotique. Tel L’Éléphant blanc (1972), conte au début enjoué dans lequel un seigneur indien lui offre un pachyderme :
À dos d’éléphant j’étais comme un dieu
Je parcourais l’Inde, ce pays radieux.
Jusqu’où n’avons-nous pas poussé
nos errances,
Serrés l’un contre l’autre, et foin de l’indigence !
Plus joyeuse encore est l’image du perroquet : celui de la Chansonnette du perroquet pirate, écrite pour le spectacle radiophonique Alice au pays des merveilles (1973), est un bijou de bonne humeur. Le vieil oiseau, en son temps fait prisonnier par Cortés, ne cesse de marteler par vengeance « “Caramba !” “Corrida !” et “Bon sang de bois !” », jusqu’à ce jour de tempête où il est capturé par des pirates qu’il doit servir cent ans. Finalement vendu comme esclave pour trois sous, il envoie une bordée d’injures à la face d’un pacha turc qui, d’horreur, brise en deux son poignard à mains nues…
J’ai visité l’Inde, et l’Iran, et l’Irak,
J’suis pas une dinde ni quelqu’un de braque.
(Seuls les sauvages à ces bêtises croient.)
Caramba ! Corrida ! Et bon sang de bois !
Mais, au chapitre des contes à plumes exotiques, le plus célèbre est Ce qu’il advint en Afrique, que l’on connaît aussi sous le titre de Girafe est grande (1969) : girafe amoureuse d’une antilope, et toute la faune de « la chaude et jaune Afrique » de s’en émouvoir :
Alors gronda tout un caquet,
Et seul un très vieux perroquet
Cria très fort d’entre les arbres
Girafe est grande, ça la regarde !
Face au scandale, la girafe fait valoir son droit à l’amour. « Nous sommes tous égaux », proteste-t-elle :
Et si tous mes congénères
Veulent s’en prendre à ma peau,
Ne me faites pas la guerre,
Je quitterai le troupeau.
Et pour finir avec la morale de l’histoire :
Girafe n’avait pas tous les torts,
Car le fautif, c’est l’autr’ Nestor,
Qu’avait crié d’entre les arbres
Girafe est grande, ça la regarde…
Annexe :
Le Vyssotski à la française (recette originale)
Un zeste de François Villon
Suivez les conseils de Mikhaïl Chemiakine, sculpteur, peintre et graphiste ami de Vladimir Vyssotski, issu comme lui de la contre-culture : « Par son côté bringueur, par la souffrance et l’amertume qui transpirent de ses chansons, Vyssotski s’apparente de très près à la figure médiévale de l’effronté moqueur qui dénonce sans trembler les tenants du pouvoir, cette figure du gibier de potence fort en thème persécuté tout à la fois par les autorités religieuses et séculières – j’ai nommé François Villon. »
https://www.youtube.com/watch?v=FWsj0h3ZFNQ
Une pincée de Georges Brassens
De Vyssotski, on dit parfois « le Brassens russe », comparaison efficace et justifiée : même mariage de la poésie et de la guitare, même originalité vocale, même anticonformisme esthétique et social. Mais si Brassens écrit « mourir pour des idées, d’accord, mais de mort lente », on ne peut imaginer ces mots dans la bouche de Vyssotski qui fait tout comme au bord de la mort, comme si c’était la dernière fois. Pour une idée, pour un amour, pour un ami, pour une rime, pour une chanson, une vérité, le Russe meurt tous les jours. Non qu’il le veuille, mais parce qu’il y est prêt. D’ailleurs, qu’est-ce qu’un poète qui ne meurt pas ? Que serait un art – en Russie du moins – où l’on ne risquerait pas sa vie ? « Ainsi meurent les poètes : ils explosent », écrivait le grand Petrov-Vodkine, artiste peintre, à la mort d’Andreï Bely, dans les années trente du siècle passé, et ces mots collent on ne peut mieux au destin de Vyssotski.
Un fond de Gérard Philippe
Vyssotski le rejoint par le théâtre, l’un ayant joué Hugo, l’autre Pouchkine, les deux s’étant coulés dans les habits de héros de Shakespeare, Richard II pour le Français, Hamlet pour le Russe, l’un comme l’autre marqués à vie par ces rôles, l’un comme l’autre aussi nationaux qu’universels, inséparables des planches qui firent leur gloire, enlevés par la mort dans la fleur de leur jeunesse.
https://www.youtube.com/watch?v=oXl5ixBtjpY
Un museau de Jean Gabin
Le cinéma en commun, et leur ressemblance physiologique, cette virilité poétique qui fait toute la différence entre le héros masculin et le sac de testostérones, cette touchante cigarette, moitié vice, moitié aveu de faiblesse, ce regard de dureté-tendresse. Et ce même baryton… Une sauce à l’américaine La voix de Vyssotski, rauque et râpeuse, est marquée d’une rudesse sexuée, animale, comme un brame d’élan : le stentor du héros de Homère, une voix d’airain, très proche de certaines voix noires américaines, et notamment de Louis Armstrong qu’il adorait et savait imiter. Sa voix colle à la philosophie de ses chansons : « Mon chant est presque un cri », dira-t-il.
De son baryton, Vyssotski vocalise les consonnes, il les roule à la façon du r russe, les sculpte, les enrichit de modulations nouvelles. D’où cette manière si personnelle, inimitable, de sculpter les mots avec la râpe de sa voix singulière, ce rugissement, ce grondement de loup.
Pour aller plus loin :
Vladimir Vyssotski, Un cri dans le ciel russe, Yves Gauthier. Éditions Transboréal
Notes
| ↩1 | Propos enregistrés le 21 février 1980 lors d’un concert public donné à Dolgoproudny, dans la région de Moscou. |
Poing par poing, une éducation populaire
École sauvage et travailleurs organisés
Avec le concours de Jean-Baptiste Bernard
La grande crise argentine, qui a frappé le pays entre 1998 et 2002, n’a pas seulement généré de la sueur, du sang et des larmes. L’épisode a aussi été l’occasion de multiplier les expérimentations passionnantes. Parmi elles, les ouvertures d’écoles populaires, initiées en 2004 à Buenos Aires avant d’essaimer dans les autres grandes villes, sont indissociables des célèbres transformations d’entreprises en coopératives par leurs ouvriers. Car c’est souvent dans les locaux des usines récupérées que les professeurs et militants de l’éducation populaire donnent leurs cours. Et c’est très largement à destination des ouvriers qu’ils dispensent leur enseignement. Rencontre avec Fernando Lazaro et Ezequiel Alfieri, deux militants pédagogiques ayant participé à l’ouverture de l’école de la Maderera Cordoba, une usine de bois récupérée par ses travailleurs en 2002. Une occasion de découvrir, à travers cet établissement hors normes de quatre-vingt-dix élèves, le mouvement dans lequel il s’inscrit.
Ce texte est issu du troisième numéro de la revue Jef Klak, « Selle de ch’val », encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF.
Décembre 2014, Buenos Aires. Au 3165 de l’avenida Cordoba, l’ambiance est studieuse. Dans une grande salle commune, des élèves planchent sur leurs examens de fin d’année. Non loin, dans un petit bureau trop vite bondé, Fernando Lazaro et Ezequiel Alfieri discutent pédagogie. Les deux militants échangent sous les portraits et photos trônant au mur – en vrac, Paulo Freire 1 Pédagogue brésilien et apôtre d’une alphabétisation militante, comme moyen de lutter contre l’oppression. , Ernesto Guevara, des Indiens mapuches, quelques mères de la place de Mai, et le wiphala [2. Le terme désigne les drapeaux rectangulaires aux sept couleurs utilisés par les ethnies des Andes. ] des peuples indigènes. Le ton est donné. Ce bâtiment est celui de la Maderera Cordoba, une usine de bois récupérée par ses ouvriers à la fin de la grande crise argentine. Si le pays est alors en souffrance, l’époque est aussi à l’effervescence sociale et pédagogique. D’un côté, les travailleurs multiplient les reprises d’usines en coopérative, pour éviter leur fermeture. De l’autre, des professeurs et étudiants commencent à unir leurs forces pour ouvrir des écoles sauvages, et ainsi lutter contre la « mal-éducation ». Tous défendent au fond une même culture populaire, qu’elle soit de métier ou de lutte. Il s’agit d’apprendre pour se donner les moyens de faire et d’être ensemble.
Ce mouvement d’ouverture des bachilleratos populares – que nous traduirons ici par « écoles populaires » – prend véritablement forme dans la capitale argentine au mitan des années 2000, avant de se répandre dans les villes de province. Tous les établissements ouverts fonctionnent sur le même principe : chaque jour, des étudiants et professeurs y donnent cours à des habitants du quartier n’ayant jamais (ou très peu) fréquenté l’école. Les cursus dispensés durent généralement trois ans et sont validés par l’obtention du baccalauréat.
Tout commence en 2004, quand un groupe de militants pédagogiques de Buenos Aires (dont Fernando et Ezequiel) ouvre une école populaire au sein de l’usine récupérée IMPA [3. Industrias Metalurgicas y Plasticas Argentina. ]. Il s’agit du premier établissement autogéré né du mouvement social argentin, et son exemple fait vite tache d’huile. Dans les mois qui suivent, les ouvertures d’écoles se multiplient, portées par le dynamisme du mouvement des entreprises récupérées
Il en va ainsi de l’école populaire de la Maderera Cordoba, qui voit le jour en 2005, avec pour ambition première de permettre aux travailleurs de l’usine de décrocher leur bac. Mais il s’agit aussi d’apporter des armes à ces gens qui se battent depuis trois ans pour maintenir à flot une entreprise désertée par ses cadres et son patron. Sont donc enseignés les rudiments nécessaires au montage administratif et à la gestion d’une usine en coopérative.
Cependant, l’enjeu de cette lutte dépasse le strict cadre des salles de classe. Toutes les équipes pédagogiques partagent un même objectif : la reconnaissance de ces écoles populaires par l’État. Elles souhaitent amener la puissance publique à valider le rôle éducatif joué par leurs établissements dans les zones où l’offre scolaire est inexistante ou inaccessible. Et à reconnaître qu’ils permettent de dépasser le clivage public/privé, inopérant en termes d’expérimentation éducative. Bref, les militants entendent que l’État facilite les initiatives autonomes là où il s’est montré incapable de répondre aux besoins en matière d’éducation.
Pour eux, les écoles populaires devraient bénéficier des mêmes avantages que les établissements publics (professeurs payés par l’État, bourses pour les étudiants, délivrance de diplômes), tout en conservant une gestion autonome. « La responsabilité de l’État dans le système éducatif est de garantir l’éducation ; notre responsabilité, en tant qu’organisation sociale, est de la prendre en main, résume Fernando. Nous voulons dépasser la notion de public ou de privé. À charge pour l’État de reconnaître la valeur éducative de nos expériences, et d’accepter l’autonomie des contenus et l’autogestion des établissements. C’est ce que nous demandions, et c’est ce que nous avons fini par obtenir. »
Mais pour l’obtenir, il a fallu du temps. Une longue lutte s’en suit, ponctuée de manifestations, d’événements, d’interpellations de la puissance publique, de mises en avant des propositions pédagogiques et politiques de ces établissements différents. Jusqu’à la victoire : en 2011, l’État reconnaît les écoles populaires. Le statut de leurs enseignants s’aligne alors sur celui des écoles traditionnelles, leurs élèves ont désormais le droit de prétendre à des bourses, et les établissements peuvent même décerner le diplôme national du baccalauréat.
Mieux encore, souligne Fernando : les années de lutte ont solidement structuré le mouvement. « Il compte aujourd’hui plus de cent professeurs, liés à de nombreux mouvements et organisations sociaux. Il s’agit d’un véritable réseau, qui soutient de nombreuses luttes d’éducation populaire en Amérique latine. Nous sommes devenus un problème, une forme de menace pour la structure éducative d’un État positiviste et de matrice libérale. Pour la puissance publique, nous ne sommes plus ces douze profs délirants qui ouvrent une école différente, mais un véritable mouvement pédagogique – ça change tout. Nous ne sommes plus quarante dans la rue, mais mille ! »
Au-delà de la reconnaissance étatique, il y a aussi celle des pairs. Syndicats et mouvements d’éducation populaire institués n’ont pas toujours vu d’un bon œil ces initiatives, dont ils contestaient le sérieux. D’aucuns martelaient qu’il était contradictoire avec les positions défendues par les syndicats des personnels enseignants d’opter pour un fonctionnement interne différent de celui des écoles publiques, avec le risque de faire lutte à part.
Si le nombre ne fait pas tout, il participe grandement de la crédibilité du projet de transformation sociale, porté conjointement par le mouvement des écoles populaires et celui des usines récupérées. Conjointement, parce que tous deux aspirent à résorber l’insupportable fossé séparant le monde des savoirs de celui de la production ouvrière. Pour Ezequiel, « en récupérant écoles et entreprises, il s’agit de cheminer de concert. Cela implique de nouer des accords politiques de résistance, d’occupation et de lutte. Et cela vaut aussi pour la production, qu’elle s’inscrive dans le cadre de l’usine ou dans celui de l’école ».
Il ne s’agit donc pas seulement de partager un espace. Mais de penser ensemble pour mieux articuler projets politiques et processus de production. Les écoles populaires ont d’ailleurs repris le slogan des usines récupérées : Occuper, résister, produire. Les uns au travail, les autres à l’école.
Les espaces de l’école sont les mêmes que ceux de l’usine. Sans machines, mais avec quelques tables, chaises, tableaux parsemés d’inscriptions à la craie. Sur cette porte de classe, une inscription : « Celui qui se bat n’est pas mort. Ici, nous respirons la lutte. » Sur ce mur, une autre : « Contre les expropriations morales que nous subissons, nous construirons une éducation populaire. Nous sommes conscients de faire l’histoire et notre plan de lutte et d’action laissera des traces. »
Une dizaine d’ouvriers travaillent aujourd’hui dans l’usine de bois de l’avenida Cordoba. Dans leur grande majorité, ils ont participé à la décision de reprendre l’entreprise, en 2004. Depuis, tous sont passés par les bancs de l’école. Ils y ont acquis des connaissances utiles au processus de production, compétences d’autant plus précieuses que leur travail a évolué – la coopérative amène en effet chacun à se pencher sur la gestion de l’entreprise, sur ses relations avec les fournisseurs ou encore sur sa politique commerciale. Ils y ont travaillé leur sens du collectif, aussi. Et, cerise sur le gâteau, ils ont tous décroché leur bachot grâce à l’école populaire.
En l’espace de dix ans, les âges et trajectoires des élèves de la Maderera Cordoba ont changé. Elle est aujourd’hui fréquentée en majorité par des jeunes en échec scolaire, subissant des conditions sociales et familiales très difficiles, souvent poursuivis par la justice et vivant dans la rue. Ils ne retournent pas d’eux-mêmes sur les bancs de l’école, mais y sont envoyés par des juges. Lesquels voient l’établissement comme une sorte d’ultime recours éducatif, même s’ils ne partagent pas sa vision de la pédagogie et son positionnement politique. Paradoxal ? Sans aucun doute, note Ezequiel : « D’un côté, l’État nous critique, nous met la pression (et nous ne nous privons pas de faire la même chose à son égard) ; de l’autre, il renvoie vers notre école les enfants qui connaissent les problématiques sociales les plus lourdes. Les gens du ministère savent pourtant très bien comment nous fonctionnons ; ils savent que nous ne sommes pas comme les écoles traditionnelles. Ce n’est pas un hasard si le portrait de Guevara ne trône dans aucun autre établissement du pays… » Pas la seule différence, bien sûr. Au sein de la Maderera Cordoba, le parcours de vie des élèves est vu comme une expérience de résistance. Pour l’équipe de l’établissement, constituée de douze professeurs, c’est même un principe pédagogique fondamental. Le seul qui permette de redonner le goût d’apprendre à des élèves de plus en plus jeunes, qui ont traversé des épisodes de vol, de violence et de toxicomanie, et qui ont parfois déjà croupi derrière des barreaux.
La pédagogie de l’école doit s’articuler avec des problèmes sociaux de plus en plus lourds. « Il s’agit dans cette école de mettre en résonance nos connaissances, nos histoires de vie et nos histoires de lutte », précise Ezequiel. Les équipes pédagogiques s’appuient donc sur les expériences de lutte de chacun et chacune, et les relient à celle de l’école populaire. Il s’agit de mettre en exergue un destin partagé pour créer une communauté. Résultat : quand les profs descendent dans la rue pour défendre leur condition, les étudiants les accompagnent. Normal, puisque le fonctionnement de l’école, et la lutte pour sa pérennité, relèvent autant de la responsabilité des profs que de celle des élèves. « La lutte dans la rue est une forme de pédagogie critique. Nous y étions d’ailleurs ensemble, profs et élèves, pour exiger que ce lieu soit considéré comme un espace collectif d’éducation populaire. Nous ne le voulions pas, nous l’exigions. C’est comme ça que nous avons gagné, même si ce fut difficile », rappelle-t-il. Les engagements réciproques forment ainsi le ciment du collectif, indispensable au processus pédagogique. L’enjeu est essentiel : c’est quand les élèves commencent à saisir ce processus qu’ils ne cherchent plus à fuir l’école.
Cette pédagogie est dite « populaire » car elle se tisse à partir du groupe qui la porte. Elle est singulière, autonome, et revendiquée comme telle. En apparence, pourtant, une journée à l’école populaire ressemble fort à celle d’un établissement traditionnel – il y a des professeurs, des élèves, des tableaux, des chaises, des tables, et même des évaluations ou des travaux à rendre. Mais en réalité, tout est différent. À commencer par l’apprentissage, qui n’est pas individuel mais toujours collectif. Quant aux professeurs, ils sont aussi des animateurs, des accompagnateurs, refusant radicalement la mise en échec de leurs élèves. De plus, grâce à des réunions mêlant élèves et professeurs, chacun est impliqué dans les choix concernant la discipline et l’autorité.
Pour chacune des matières enseignées, les cours sont assurés conjointement par deux (voire trois) professeurs. Et tous estiment que les divers points de vue apportés par des disciplines distinctes constituent des conditions indispensables de l’apprentissage. C’est pourquoi les histoires de vie sont systématiquement considérées : à cause de la nécessité de comprendre les visions de chacun et de faire avec. Il s’agit en somme de mettre en perspective les opinions, les théories et les faits, pour petit à petit construire un esprit critique.
Si les écoles populaires sont autonomes dans leur fonctionnement, elles le sont donc aussi dans leur pédagogie, refusant par exemple de s’en tenir à la seule histoire nationale officielle. Les professeurs l’enseignent, mais ils la complètent par l’histoire des mouvements, des luttes culturelles et politiques qui ont aussi participé à la construction sociale du pays. Les élèves découvrent ainsi les figures argentines illustres, mais aussi celles des cultures populaires : Guevara, Marx, Freire, Eva Perón, etc.
Comme ils l’ont écrit sur les murs, ces élèves font partie d’une histoire, et font l’histoire. Comprendre cela, sentir cela, c’est entrer dans un mode de présence au monde différent. Par la preuve quotidienne d’une appartenance à une culture, un groupe, une histoire, les jeunes quittent l’idée qu’ils n’ont pas de prise sur leur sort, qu’ils sont seuls responsables de leur situation. Ils apprennent à prendre en main leur vie au sein d’un collectif, et à saisir que leurs actes portent en eux un potentiel de transformation.
C’est tout l’enjeu pédagogique et politique des écoles populaires : faire en sorte que les classes populaires maîtrisent les mêmes outils que les classes dominantes, afin qu’elles fassent entendre leur voix, qu’elles s’organisent et qu’elles puissent agir sur leur condition. Cela passe forcément par une pédagogie – dite « de l’opprimé » – basée sur la confiance dans les capacités et les savoirs d’autrui. Paulo Freire, une des références fondamentales dans la culture populaire argentine, lie ainsi l’éducation populaire à la prise en compte des conditions socio-économiques d’existence. L’application de ses principes pédagogiques cherche à contrer ce qu’il appelle « l’éducation bancaire » de l’école [4. L’acte pédagogique pratiqué serait comme un dépôt d’une matière inerte et prédéfinie dans un contenant vide prêt à recevoir et à mémoriser.] par l’éducation au politique. Objectif : aboutir à une démocratie radicale et intense. À la Maderera Cordoba, comme dans toutes les autres écoles populaires, on retrouve finalement en actes l’intuition freirienne : que « les hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde ».
Notes
| ↩1 | Pédagogue brésilien et apôtre d’une alphabétisation militante, comme moyen de lutter contre l’oppression. |
Rocky et ses bêtes
Une rétrospective animalière de l’Étalon italien
John G. Avildsen, réalisateur oscarisé de Rocky en 1976 et de Rocky V en 1990 s’est éteint ce 16 juin 2017. La sortie de Creed : l’héritage de Rocky Balboa en novembre 2015 avaient célébré les 40 ans du boxeur de Philadelphie. Film après film, match après match, l’Étalon italien s’est pris l’Histoire dans la gueule – comme autant d’imparables crochets. Le personnage totem de Sylvester Stallone a inlassablement occupé le centre du ring hollywoodien, autrement dit le territoire culturel mondial. Dans son numéro 3 (« Selle de Ch’val »), Jef Klak rendait hommage à cette figure du combat contre soi-même. Quarante ans pour devenir – et transmettre comment devenir – un être humain digne de ce nom, au milieu des bêtes, grâce aux bêtes.
Télécharger l’article en PDF.
« Toi, nous, n’importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C’est pas d’être un bon cogneur qui compte ; l’important, c’est de se faire cogner et d’aller quand même de l’avant, de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C’est comme ça qu’on gagne. »
Rocky (Sylvester) à son fils, Rocky Balboa, 2006
Rocky est né en 1945 à Philadelphie, soit un an avant son créateur – qui lui donne vie en 1976, après un tournage de vingt-huit jours. Avec un budget poids plume, il remporte trois Oscars, dont ceux de meilleur film et de meilleur réalisateur. Scorsese, Pakula, Lumet ou Bergman, dans les cordes ! Débute une saga : sept films, quarante ans de boxe, quarante ans d’Amérique, quarante ans d’alter ego pour Sylvester Gardenzio « Sly » Stallone – alias Robert « Rocky » Balboa. Fils d’un immigré italien et d’une avant-gardiste du catch féminin, Stallone a d’abord bien du mal à lancer sa carrière : il est tour à tour acteur dans un film érotique et figurant pour Woody Allen, puis pour la série TV Kojak. En 1976, après avoir été un temps SDF, l’acteur raté aux muscles saillants et à la gueule cassée a 30 ans et devient – littéralement – Rocky, « L’Étalon italien » (stallone en italien veut dire « étalon »). Comme son personnage paumé révélé par le ring, Sly est l’outsider d’Hollywood, l’acteur qui ne perce pas, celui qui va jouer sa vie sur un scénario écrit en trois jours 1 Rocky (1976) et Rocky V (1990) ont été réalisés par John G. Avildsen. Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV (1985) et Rocky Balboa (2006) par Sylvester Stallone, et Creed : … Continue reading. Rocky Balboa vit à Kensington, quartier populo de Philadelphie, avec ses briques rouges rappelant le passé industriel de la ville et son melting-pot ouvrier. Il se maintient péniblement à flot grâce à de petits matchs de boxe sans ambition ou en servant d’homme de main au mafieux local.
Rocky s’ouvre sur un combat. La figure du Christ surplombe le match entre l’Étalon italien et Spider Rico (Rico l’Araignée), dont l’enjeu n’est qu’une poignée de dollars. Vainqueur, seul et brisé, Rocky sort du ring et arpente la finitude de ses horizons, coincés entre deux trottoirs. D’un côté de la rue, une animalerie où travaille la femme dont il est amoureux. De l’autre, la salle d’entraînement de Mickey « Mighty Mick » Goldmill [2. Burgess Meredith. ], ancien champion à la gloire délavée, qui lui sert d’entraîneur et de figure paternelle.
Rocky rentre dans l’appartement miteux qu’il partage avec Cuff et Link, ses deux tortues, et Moby Dick, son poisson rouge. Les seuls êtres vivants avec qui il peut partager la maigre victoire du soir et sa condition misérable. « Je n’en serais pas là si vous saviez danser et chanter », lance Rocky à ses colocataires aquatiques. Après avoir philosophé sur la nourriture en paillettes de ses compagnons, il va se coucher, meurtri par le combat, un Christ en croix au-dessus du lit.
Dès ces dix premières minutes, tous les thèmes de la saga des Rocky sont exposés : la boxe, l’amour, la religion, la rue et les animaux. La suite, on croit la connaître. Apollo Creed [3. Carl Weathers. ], le top dog (favori), celui qui chante et danse sur le ring, l’Afro-Américain bling-bling et désœuvré champion du monde en titre, trouve ce dont il a besoin pour faire rêver l’Américain moyen et relancer sa carrière : un underdog [4. Littéralement : chien d’en-dessous. ] – celui sur lequel personne ne parie. Creed pense lui offrir une leçon de boxe et la chance de concrétiser le rêve américain. Balboa est parfait pour ça : il est blanc, à une époque où seuls les Noirs raflent le titre, et il est pauvre. Son surnom enfin, « l’Étalon italien », sent bon le coup de com’.
Or l’étiquette n’est pas le produit : Rocky est un drôle d’animal à la « fausse patte », un gaucher dans le jargon, très délicat à affronter. Tout est en place pour une nouvelle fable made in USA, terre de tous les possibles. Mais l’Étalon italien perd le match. Le Rocky de 1976 n’est pas une success-story [5. Il deviendra cependant une légende pour les six autres films et les quatre décennies à venir : une statue lui sera même érigée devant le musée de Philadelphie, à la vie comme à l’écran. ]. Tout ce qu’il parviendra à faire, c’est tenir la distance.
Tenir la distance, c’est ce que le Blanc Chuck Wepner avait fait en 1975 contre le champion Mohamed Ali, quinze rounds debout contre le champion des champions – de quoi inspirer Sylvester pour son scénario.
Premier round
Le ring est le propre de l’homme
Dans une longue première partie du film, les références animalières se multiplient. En insistant sur l’animalisation du peuple, la saga des Rocky offre un aller-retour permanent entre humanité et animalité. Dès le lendemain matin du match contre Spider Rico, encore fourbu de son combat, Rocky se rend dans l’animalerie pour discuter de ses tortues. Il y a ses habitudes et en pince pour la vendeuse, Adrian [6. Talia Shire. ]. Il reprend sa dissertation sur l’alimentation des tortues là où il l’avait laissée la veille, puis taille la bavette avec les chiots et oiseaux de la vitrine. Rocky fait le clown pour séduire Adrian, avec son chapeau de Chaplin écrasé et ses yeux pochés de Droopy bagarreur. La vendeuse ne peut ou ne sait lui répondre. C’est une femme qui porte l’oppression sur elle, les yeux constamment baissés, affichant le silence assourdissant de sa timidité. La patronne de l’animalerie, indifférente à la parade nuptiale, les sépare avec autorité : Adrian doit d’abord s’occuper de nettoyer les cages. La communication paraît plus évidente entre « l’étalon » et les animaux qu’entre êtres humains qui ne se parlent que pour s’invectiver, se commander ou s’ignorer.
Il y a Adrian, mais aussi Butkus, le chien dans la cage. Butkus est un bulldog, d’une corpulence rappelant celle de Rocky. C’est surtout le chien de Stallone dans la vie, qui devient celui de Rocky dans la saga [7. Il est crédité « Butkus Stallone » au générique final de Rocky – bien après les acteurs humains. ]. Dans les commentaires du DVD de Rocky Balboa, Stallone explique la genèse du scénario du premier film et présente Butkus comme le coscénariste : Sylvester écrivait avec son chien à côté, lui faisant relire au fur et à mesure ses notes et lui demandant un retour critique. « Qui ne dit mot consent », s’amuse l’acteur-scénariste. Dans la vie comme à l’écran, Butkus a le même statut de compagnon de galère, d’entraînement ou de réussite.
Adrian a un frère, Paulie [8. Burt Young. ], meilleur ami beauf et antithèse raciste de Rocky, qu’elle qualifie de « porc ». Le frangin a les mains gonflées à force de remuer les carcasses de bœufs pour le compte des abattoirs Viande du Trèf le. Drôle de famille : l’une vend des animaux, tandis que l’autre les découpe. Tous deux partagent une même infériorisation : leur proximité avec l’animal sert essentiellement à caractériser un peuple rabaissé, celui qui courbe l’échine dans les rapports de domination.
Même dans cette ménagerie humaine, il y a une échelle de valeurs, un continuum gradué. L’homme des abattoirs aux mains gonflées souffre de sa condition d’ouvrier et aspire à devenir homme de main: comme Rocky, il voudrait casser les pouces des dockers qui doivent de l’argent à Gazzo, macho mafieux qui roule en limo. Aux lois du marché, Paulie préfère celles de la jungle qui gouvernent les prolos de Philadelphie. Il veut décharger sa rage. Mais dans la pratique, Rocky n’est pas à la hauteur de son rôle de « sac à viande », comme l’appelle Gazzo. Il refuse de casser les pouces des travailleurs qu’il rackette. Il n’est ni la bête féroce ni le décérébré que la société voudrait le voir jouer. C’est un curieux mélange de bête et d’homme, brouillant les pistes.
Round 2
Une bonne droite et un crochet du gauche !
Les années 1960 marquaient l’apogée du modèle de l’American Way of Life, appelé à s’effriter la décennie suivante. Les contestations politiques se multiplient, le modèle américain ne rassemble plus, explosant dans les voix éparses des minorités opprimées : femmes, Noirs, Latinos, homosexuels… C’est au milieu de ce tumulte des années 1970 que Stallone, alors dans la galère, écrit le film. Adrian a peur des hommes, partageant dans le logement de son frère la banalité de la condition féminine, entre boulot, fourneau et menaces de coups. Pas de success-story pour elle non plus, pas d’émancipation réelle : elle ne quitte son frère que pour devenir femme au foyer auprès de Rocky. Malgré la tendresse entre elle et le futur champion du monde, elle ne sort pas de sa condition subalterne. Ses plus hauts faits d’armes : ses conseils prodigués dans l’ombre et ses talents culinaires. Rocky/Stallone ne casse pas les pouces du réel: les films décrivent, aussi, les crasses du quotidien.
L’existence est sombre – surtout en bas de l’échelle, pour tous les humains-moins-humains, les Étalons ou les Spiders. Les relations humaines sont régies par l’exploitation et la consommation de l’autre. Balboa est un Italo-Américain rackettant, pour le compte d’un Américano-Italien, des ouvriers partageant la même misère. Paulie ne pense qu’à la thune qu’il pourra tirer du succès de son ami Rocky, quitte à l’étiqueter « viande » pour quelques tickets. Mick s’obstine en vue de la gloire qu’il pourra retrouver avec son poulain. Quant à Creed, il ne permet le rêve américain à l’underdog que pour relancer et justifier sa propre carrière.
Stallone raconte la détresse des « petits Blancs » qui ont de plus en plus de difficulté à tenir leur rang et leur rôle dans la société américaine. L’ironie du regard porté sur ce déclassement de la société blanche ponctue la saga où, à part Rocky, ce sont les Noirs qui ont les plus beaux rôles. Ce sont eux les champions, eux qui connaissent le jeu, eux qui gardent « l’œil du tigre ». La question de la virilité est une facette de cette réflexion. Ce monde blanc est sans femme ou sans enfant. Spider, Mick ou Paulie n’ont ni épouse ni descendant. Dans le quatrième épisode, Paulie est « marié » avec un robot. À tous points de vue, Rocky est un accident. Les jeunes Blancs qu’il prend sous son aile sont fuyants, arrogants et cupides (de Tommy Gunn [9. Tommy Morrison. Boxeur dans la vie, champion du monde en 1993 grâce à une victoire aux points sur l’Afro-Américain George Foreman. ] – Rocky V – à son propre fils Robert « Rocky » Junior [10. Tour à tour Seargeoh Stallone, Ian Fried, Rocky Krakoff, Sage Stallone et Milo Ventimiglia. ]), tandis que les Noirs partagent la combativité et la dignité du maître Rocky (Steps – Rocky Balboa – et plus récemment Adonis [11. Michael B. Jordan. ] – Creed : l’héritage de Rocky). Les individus qui hantent les rues du ghetto, chantant la nuit autour d’un brasero, sont majoritairement blancs. Ils sont désormais sur un pied d’égalité avec les Noirs pour les quelques emplois ou opportunités disponibles [12. Victoria A. Elmwood « Just Some Bum from the Neighborhood: the Resolution of Post-Civil Rights Tension and Heavyweight Public Sphere Discourse in Rocky (1976) », Film & History, 35.2, 2005. ]. Au lendemain du triste combat contre Spider Rico, Balboa se rend compte qu’il n’a plus d’entraîneur ni de casier. Sa place est prise par un jeune Noir, sans doute plus prometteur. Mick a mis les affaires de Rocky dans un sac et rejeté Balboa hors de l’enclos cordé. Il n’a plus rien à y faire, lui qui ne boxe que « comme un foutu singe ». Le boxeur sans avenir devient un « animal non humain » exclu de la communauté d’exercice de la perfectibilité.
Round 3
Sortir du ring et de la cage
Dans la saga des Rocky, il se joue toujours autre chose qu’une rencontre sportive. La présence des animaux dans tous les épisodes rappelle d’abord la persistance d’une zone limite dans laquelle les formes de domination sociale, économique et politique rapprochent les plus faibles des humains et les animaux. C’est parce qu’il est renvoyé à une nature brutale, à une bestialité construite ou à une domestication sans noblesse que le peuple auquel appartient l’Étalon italien peut être associé à un bœuf, un gorille ou un chien. Par là, le film affirme l’unité fondamentale de l’humanité et postule que les clivages fondamentaux sont moins entre sexes ou entre races qu’entre classes sociales. Le ring devient le lieu de réalisation de la liberté et de la perfectibilité humaines. Chaque film est construit autour d’un combat qui renvoie au conflit guerrier, à l’âgon et à la révolte en tant que conditions de la réalisation du politique, fondée d’abord sur la liberté individuelle.
Dans le premier Rocky, le commentateur sportif résume le match Balboa-Creed à l’affrontement de « l’homme des cavernes » et du « cavalier », celui qui monte et domine la bête. Rocky incarne l’humain-moins-humain, lui qui ne sait pas écrire et n’apprendra que dans le troisième film, en même temps que son fils. Apollo Creed est symétriquement l’opposé de Rocky : il est riche, maîtrise le langage et les médias. Le spectacle qui précède le combat rappelle que tous les hommes ne sont pas égaux devant les symboles de la république. L’Étalon italien se saisit maladroitement d’un tout petit drapeau, pendant que le champion apparaît successivement en Georges Washington et en Oncle Sam. Le lieu et la date du combat ne sont pas anodins. Le match se déroule à Philadelphie, la « cité de l’amour fraternel » comme le proclame cyniquement le champion noir, et en 1976, pour le bicentenaire de la Déclaration d’indépendance signée dans cette ville. Cette année-là, les États-Unis viennent de jeter l’éponge après leur match truqué contre le Vietnam. L’image de l’Amérique est à reconstruire. Venu de sa ferme de cacahuètes, le démocrate Jimmy Carter va bientôt remplacer le républicain va-t’en-guerre Richard Nixon à la présidence. Rien ne change pourtant pour l’homme de la rue qu’incarne Balboa : il se fait dérouiller sur le ring et reste le perdant.
Dans la bouche du commissaire soviétique, le combat qui oppose Balboa au géant soviétique Drago [13. Dolph Lundgren. ] « Le Taureau de Sibérie » dans Rocky IV (1985) devient la lutte entre le « regard sur l’avenir » d’une société socialiste présentée comme obsédée par la génétique et « la faiblesse pitoyable » de la société américaine décadente. Pour le combattant états-unien, c’est une lutte entre une humanité technophile totalitaire et une humanité généreuse donnant sa chance à tous, au-delà des murs et des races. Le boxeur blanc, associé à un entraîneur noir, venge Apollo Creed dont il a repris les couleurs, celles du drapeau national. « Tout le monde peut changer », crie Rocky, victorieux, à destination du peuple soviétique. Les coups sont durs pour les déterminismes. Le soldat Drago se rebelle au milieu du match contre la nomenklentura du « socialisme réel ». Il ne veut la victoire que pour lui-même. L’hostilité initiale de l’Homo sovieticus s’est muée en communauté de condition et de pensée. En tenant la distance et en terrassant la brutalité froide, Rocky a fait vaciller les certitudes et a libéré une opinion publique naissante dans l’URSS de la Perestroïka. Même dans le camp du perdant, l’homme reste homme. À l’Est comme à l’Ouest, la Terre est round.
Sur le ring, Rocky ne cesse de se réinventer dans sa boxe : roc, étalon, gaucher, pesant, singe, droitier, léger… Il est intéressant de noter le contexte dans lequel le héros de pellicule et de sueur voit le jour : en 1975, soit un an avant la sortie du film, le philosophe utilitariste Peter Singer publie Animal Liberation. Le concept de « libération animale » renvoie aux différents fronts de libération nationale des peuples colonisés et autres mouvements visant l’émancipation [14. Voir l’article « Je suis un “terroriste” parce que j’ai défendu les droits des lapins. Entretien avec Josh Harper, militant états-unien pour la libération animale ». ]. Les années 1970 ajoutent le « spécisme » aux maux de la société.
Pour se réaliser en tant qu’homme, Rocky doit se saisir de l’animal comme d’un miroir, une ressource ou un compagnon. Alors que dans le début du premier Rocky, le personnage interprété par Stallone, renvoyé à son animalité, refuse la viande que lui tend Paulie, le début de son ascension est ensuite marqué par des œufs crus avalés, puis par le steak que son ami lui découpe et que sa compagne lui cuit. Surtout, l’entrée dans la communauté est symbolisée par l’acquisition d’un chien, véritable objet de partage et d’apprentissage de l’humanité – celle qui libère, nourrit et caresse, pas celle qui enferme dans une condition. Dans Rocky (1976), Adrian offre Butkus à Rocky pour s’entraîner en vue du Championnat du monde. Dans Rocky Balboa (2006), Butkus est mort. Cette fois-ci, Rocky n’est plus l’underdog de 1976, mais le propriétaire d’un restaurant dans son ancien quartier prolo qui décide de prendre un jeune métis sous son aile, Steps. À son tour, Rocky offre un chien au jeune des quartiers relégués : devenir son maître sera le gage de son émancipation.
Rocky : On apprend beaucoup en parlant aux chiens. Regarde celui-là. Viens, le chien. Il est mignon, dans le genre moche. Regarde-le bien. Couleur vieux meuble, comme un coffre de pirate. Tu vois ce qu’il fait ? Couché comme ça ?
Steps : Il fait rien.
– Ben si : il gaspille pas son énergie.
– Forcément, il est mort.
– Mais non. Il a encore des heures de vol. De la bonne bouffe, des nouveaux copains, et c’est reparti.
– Tu l’appellerais comment ?
– C’est pour vous, ce chien.
– C’est pour nous deux. C’est un chien communautaire. 50-50.
– Je connais rien aux chiens.
– C’est pas dur. Tu le caresses, tu le nourris, et la nature fait le reste. […] (À l’adresse du chien dans la cage du chenil) Prêt à te faire libérer ?
Round 4
Cogner la viande
Pour se libérer lui-même et s’accomplir comme humain dans la république des égaux, l’underdog du Rocky de 1976 doit user de son corps et de ses poings et démontrer au monde qu’il est plus qu’une carcasse. Devant les médias invités par Paulie, Rocky dévoile la méthode d’entraînement qu’il a inventée : prendre les carcasses pendues aux crochets de l’abattoir pour des punchingballs. « Si tu frappes Creed pareil, mec, on va finir en prison, ou accroché sur un crochet, comme ça », lui avait dit Paulie. Dans leur bureau chic d’un gratte-ciel du centre-ville, figure de notre monde capitaliste, le staff du top dog Apollo prend alors la mesure du potentiel de Balboa. À la télé, les images du boxeur prolo, les poignets couverts du sang des bêtes, contrastent avec la discussion en cours d’Apollo Creed sur les gains de ses spots publicitaires. Hors les poings, point de salut.
Quand il frappe sur les carcasses dépecées, c’est le corps nu, la chair infrapolitique qui est exposée – celle que partagent prolos et animaux. Pour briser les déterminismes, c’est-à-dire décider de son rapport au monde et le modifier, il doit cogner sur la viande qu’on voudrait qu’il soit. Une fois monté sur le ring, il ôte son peignoir marqué du slogan publicitaire des abattoirs Viande du Trèfle. L’esclave peut renverser le maître Apollo si le corps est mis en risque [15. Jason Price, « Running with Butkus: Animals and Animality in Rocky », Humanimalia – a journal of human/ animal interface studies, Vol. 5, no2, DePauw University, printemps 2014. ] : pour tenir la distance jusqu’au round final, Rocky ordonne à son soigneur de lui découper la paupière close par les coups de Creed.
Dans les sept films, Rocky ne cesse d’aller et venir entre cette faim du loup en chasse et la mollesse de l’humain repu, celui qui, après avoir gagné, n’a plus rien à (se) prouver. Une carrière en dents de scie calquée sur celle de Stallone qui, passés les premiers Rocky et la série Rambo, connaîtra la traversée du désert hollywoodien. Balboa remporte la victoire lors de sa revanche contre Apollo Creed dans Rocky II, puis devient nouveau riche dans Rocky III : il roule en berline, porte la cravate, habite un palace et perd en pugnacité. S’il enchaîne les victoires et conserve son titre, c’est seulement parce que son entraîneur, Mick, soucieux de sa santé, s’arrange pour que ses adversaires ne soient pas à la hauteur. Il s’agit de capitaliser. L’underdog qui le provoque alors, Clubber Lang [16. Mister T (Laurence Tureaud), ancien garde du corps du boxeur Mohammed Ali.], boxeur hargneux du ghetto avec des plumes en guise de boucles d’oreilles, met KO Balboa en deux rounds et rafle le titre de champion. « Il a la rage. Toi, t’as perdu ta rage en remportant le titre […]. Le pire t’est arrivé, aucun boxeur n’est à l’abri de ça : tu t’es civilisé […]. Les présidents et les généraux prennent bien leur retraite, les chevaux aussi. Même les meilleurs. On les met au haras. Toi aussi, tu dois prendre ta retraite », l’avait pourtant prévenu Mick.
Cette défaite est fatale à l’entraîneur, qui meurt d’une crise cardiaque après le match. Apollo Creed, l’ancien adversaire et désormais ami, va donc entraîner Rocky : « Quand on s’est battus tous les deux, tu avais l’œil du tigre, mec, la rage. Il faut que tu la retrouves, et pour ça, tu dois repartir de zéro. On va peut-être reprendre le titre. » Creed a l’instinct. Balboa retrouve la ville abrasive et les salles d’entraînement de seconde zone pour « apprendre à boxer comme un Noir », tenir la distance et renvoyer l’arrogant Clubber Lang au sol.
Round 5
Beyond beef… The Italian Stallion
Le choix de l’abattoir pour accueillir le rite initial de l’ascension sociale de Rocky n’est pas anodin. « Les Américains ont une histoire d’amour avec les bœufs », écrit Jeremy Rifkin dans son essai consacré à la culture de l’élevage bovin aux États-Unis [17. Jeremy Rifkin, Beyond Beef, the Rise and Fall of the Cattle Culture, Plume Printing, 1993. ]. Mais combien sont-ils à en connaître et surtout à en assumer la brutalité ? Un des intérêts de Rocky est qu’il rappelle cet ancrage de la « culture du bétail » dans la construction des États-Unis. L’histoire industrielle ou les paysages urbains du nord-est du pays sont intimement liés à cette culture, qui est aussi celle de la boulimie de viande, de l’utilisation massive de la chimie ou du détournement des ressources naturelles au profit de l’appétit d’une minorité. Un siècle s’est écoulé depuis la fin de la guerre civile américaine et l’émergence de la grande puissance mondiale. L’industrie a désormais des airs de nature morte : dans le décor du film, la plupart des ouvriers errent dans la rue, les cargos immobiles dans le port semblent désormais attendre une fin, les cheminées des fonderies et des usines continuent de scander la ligne d’horizon, les rails ou les fils téléphoniques strient tristement le champ de vision. Rocky V (1990) nous montre Kensington encore plus délabrée. Tout passe, tout casse, sauf la dureté de la ville.
Les paysages en déshérence de Philadelphie comme les ouvriers du film rappellent l’enracinement historique des abattoirs dans la cité de la liberté. L’organisation scientifique du travail a sapé l’indépendance et la sécurité des bouchers qualifiés, remplacés par les killing gangs (« bandes des tueries [18. « Tuerie » est l’ancien nom de l’espace urbain où l’on transformait l’animal en viande. Quand les abattoirs furent créés au XIXe siècle, il se mit à désigner la zone spécifique où l’animal était tué, puis subissait les premières transformations. ] ») : c’est ainsi qu’on appelait les migrants de fraîche date (Polonais, Lituaniens, Slovaques en majorité) assignés aux métiers de « casseur de pattes », « éventreur », « boyaudier » ou « saigneur ».
Le journaliste Upton Sinclair accélère sans le vouloir le passage à la grande industrie mécanisée avec son enquête La Jungle parue en 1906. Alors qu’il cherchait à dénoncer les conditions de travail de ces ouvriers immigrés, c’est la description du sort des animaux qui émeut l’opinion publique. Le Président Theodore Roosevelt, pourtant hostile à Sinclair en raison de ses positions socialistes, diligente une enquête à Chicago sur les installations de conditionnement de la viande, conduisant à l’adoption de la Loi sur l’inspection des viandes (Meat Inspection Act) et de la Loi sur la qualité des aliments et des médicaments de 1906 (Pure Food and Drug Act). « J’ai visé le cœur du public et par accident je l’ai touché à l’estomac », dira Sinclair.
Le principe de la chaîne d’assemblage a été expérimenté dans les abattoirs des grands marchés urbains dès les années 1880. Le T-bone steak a devancé la Ford-T dans l’histoire de l’automatisation : le travail à la chaîne est né de la chaîne alimentaire. À la fin du XIXe siècle, il fallait être capable de traiter les flots de bovins que les chemins de fer ramenaient des Grandes Plaines vers les zones urbaines en expansion.
La déconnexion entre producteurs et consommateurs exigeait d’aller vite, d’augmenter la productivité et le nombre de travailleurs non qualifiés.
Presque un siècle plus tard, sous la conduite de Paulie et de ses équipiers, les carcasses de bœuf glissent encore sur les rails de la jungle automatisée, mais ce que montre Stallone, ce n’est pas l’œil triste de l’animal qui va être tué froidement. On ne voit pas l’abattage des bœufs. « Qui a tué ça ? », interroge par deux fois Rocky. « Ça se fait en face », répond Paulie sans en dire plus. Ce ne sont déjà plus des animaux, mais de la nourriture : Paulie tranche rapidement un steak à Rocky dans l’usine, au milieu de la viande pendue, pour le repas du soir. « C’est une morgue pour animaux », insiste Balboa pour nous rappeler le mélange des genres et son dégoût des lieux [19. Jason Price, « Running with Butkus: Animals and Animality in Rocky », art. cité. ].
Dans Rocky II, après s’être confronté au monde factice et stigmatisant de la publicité, après s’être mêlé aux interminables queues des bureaux d’embauche pour trouver un « boulot propre », Balboa est contraint de travailler à l’abattoir. Avant de s’y résoudre, on le découvre lavant son chien dans sa baignoire, et lui confiant : « Je sais que je peux trouver un boulot si je veux. Mais est-ce que je veux d’un boulot que je ne serai pas heureux de faire ? En plus, tu sais, on a besoin d’argent maintenant, Butkus. Les chiens se moquent de mes problèmes. Oui j’aimerais être un chien des fois. Fais-moi un bisou. »
Dans une longue séquence quasi documentaire, on voit Rocky récupérer sur un chariot les morceaux de viande débités par une machine : le boxeur a le casque trop grand qui lui tombe sur le visage et la blouse d’ouvrier souillée de sang et de crasse. Seule sa musculature l’aide à se distinguer : elle lui permet de transporter les carcasses plus facilement que ses collègues. Vaine distinction, puisque le travail s’achève irrémédiablement par le nettoyage des déchets laissés sur la chaîne de dépeçage puis par le licenciement. À l’ère des abattoirs et du travail modernes, la tâche est toujours dégradante – on est toujours le chien de quelqu’un. Avant qu’il se fasse virer de l’usine par son supérieur noir, un collègue l’apostrophe alors qu’il porte une carcasse de bœuf : « Hey Rock, vous deux [toi et le bœuf], vous êtes comme de vieux potes, pas vrai ? » « Les vieux potes n’ont pas aussi bon goût », répond Rocky, conscient de sa différence. Un working class hero qui, pour transformer sa condition, la nie en redevenant sans cesse boxeur.
Le seul vieux pote, c’est Paulie. Après être enfin devenu homme de main pour Gazzo le mafieux, Paulie a dû se résoudre à reprendre son travail « honnête » dans l’abattoir (Rocky Balboa, 2006). Puncher ne lui a pas offert de piste d’envol. Il a les mains qui gonflent de l’ouvrier, les doigts du peintre du dimanche, pas les poings du cogneur. C’est à lui que, retraité et veuf, Rocky demande s’il doit une dernière fois remonter sur le ring. Ramenés à leur plus simple humanité, les deux personnages se retrouvent dans l’abattoir vide. Les crochets sont débarrassés de leurs carcasses. Dans cette scène, les seuls animaux « présents » sont le chien que Paulie peint après ses heures de labeur, et la bête qui hurle dans le ventre de Rocky. Les deux semblent encagés dans leur condition :
Paulie : Personne ne te voit plus remporter un titre.
Rocky : Je sais. J’y prétends pas.
– Alors quoi, t’es détraqué ou bien ? T’es fâché parce qu’on a démoli ta statue ?
– Pas vraiment.
– Si c’est pour le fric, attache-toi au cou un écriteau « Cognez-moi 5 $ ». Tu feras fortune. (Rires) Alors quoi, t’as pas l’impression d’avoir déjà atteint le sommet ?
– Le sommet ? J’ai encore des trucs au sous-sol.
– Au sous-sol ?
– (Montrant son ventre) Là-dedans.
– Quels trucs ? Parle-moi de tes trucs.
– (Pleurant pour la seule et unique fois de la saga) Des fois, c’est dur de respirer. Je sens une bête au fond de moi. (Il reprend ses esprits) Tu veux m’aider à m’entraîner ?
– J’ai un boulot.
– Je comprends.
– Tu te rappelles, une fois tu m’as dit : « Quand on reste trop longtemps dans un endroit, on devient cet endroit. » (Montrant l’abattoir) Tout ce que j’ai est ici.
Deux scènes plus tard, le vieux Paulie est licencié « comme un chien ». La descente est toujours plus rapide que l’ascension. Pour la dernière fois il quitte l’usine dépité, un gros morceau de barbaque subtilisé sous le bras et ses toiles animalières ratées sous l’autre.
Dernier Round
Tenir la distance de l’animal
Rappeler que Rocky a 40 ans, c’est aussi mettre en avant l’historicité d’une œuvre [20. Re-regarder sept Rocky, c’est aussi traverser quarante ans de technique cinématographique : le premier Rocky est tourné avec de toutes nouvelles steadycams, innovant ainsi dans la mobilité des prises de vue. Le grain suit la courbe du temps pour perdre en rugosité et lisser peu à peu les reliefs de la peau des boxeurs. Les contrastes bleu-orange apparaissent avec le numérique des années 2000. Le montage s’accélère avec les ans, rythmant les dialogues comme des coups distribués sur un ring. ] et d’un combat. Revenir sur ces quatre décennies, c’est rappeler que l’histoire ne s’établit qu’en fonction des sélections utiles aux sociétés présentes, au détriment du hors-champ. Depuis 1976, la réflexion sur la condition animale est sortie de la marginalité. Progressivement, à partir des années 1980, mouvements de protection animale et autres mouvances écologiques ont lutté, et parfois permis de modifier le statut des différents animaux. « Il faut sortir notre regard et notre réflexion du nombril humain », explique ainsi Éric Baratay, historien spécialiste de l’histoire culturelle des animaux : « examiner avec générosité pour mieux voir et souligner les capacités et les potentialités des animaux, dans leurs diversités spécifiques, alors qu’on n’a fait que les nier ou les masquer pour défendre la place et les privilèges que l’espèce humaine s’est attribués [21. Éric Baratay, Le Point de vue animal, éd. Seuil, 2012. ] ».
Au cours des mêmes années, Stallone, comme d’autres dans le cinéma populaire américain, subit l’influence de la New Right, beaucoup moins favorable aux mouvements d’émancipation. En des combats douteux, comme autant de matchs arrangés avec la réalité, il devient un symbole des « années Reagan », de l’exaltation nationale au libéralisme transnational. Jusqu’à être repris dans la culture populaire française : pour « Les Guignols de l’info », le visage de l’underdog de 1976 est devenu la marionnette du monde mondialisé, incarnant le cynisme de l’exploitation et de l’oubli de ces masses humaines qui ne demandent qu’à user de leur perfectibilité et de leur liberté.
Dans Rocky, et à moindre mesure dans Rocky II et Rocky Balboa, il est pourtant question de boxe, de tendresse et d’amour, et surtout des catégories de population qu’on tente de sortir du débat politique en les déshumanisant : les « sauvageons », « les sans-dents » ou les « illettrés des abattoirs » ; ceux avec qui « de toute façon, on ne peut pas parler ».
Dans les cordes du ring comme dans la froide géométrie des rues à angle droit et des rails de la chaîne d’abattage, c’est en effet des confins du cercle de la subjectivité politique qu’il s’agit. Humains et animaux sont présentés dans les films comme partageant parfois la même dévalorisation et la même crasse. Or, loin de jouer cette carte de l’opposition entre animaux et humains, Rocky se saisit d’une analogie de condition, plus que d’une communauté de nature. Pour Stallone/ Balboa, s’émanciper, c’est tenir la distance qui sépare l’homme de l’animal.
Alors que Rocky a été ruiné par les malversations de son comptable (Rocky V), et qu’Adrian est obligée de retravailler dans l’animalerie de Kensington, le clan Balboa ne succombe pas aux avances du manager cupide qui essaie de convaincre Rocky de retourner sur le ring. « Laissez-moi manager sa carrière, et vous vivrez comme des humains », propose-t-il. L’épouse, qui a connu le haut comme le bas de l’échelle, a conscience que la dignité humaine ne se mesure pas au nombre de victoires par KO, de voitures ou de domestiques. Elle retourne le stigmate à l’adresse du requin : « Nous vivons une vie d’humains. Franchement, vous devriez essayer. »

Notes
| ↩1 | Rocky (1976) et Rocky V (1990) ont été réalisés par John G. Avildsen. Rocky II (1979), Rocky III (1982), Rocky IV (1985) et Rocky Balboa (2006) par Sylvester Stallone, et Creed : l’héritage de Rocky (2016) par Ryan Coopler, qui a aussi écrit le scénario avec Aaron Covington. À part ce dernier volet, tous les autres scénarios de la saga ont été écrits par Sylvester Stallone. |
« Les moutons ont des amis et des conversations »
Comment les animaux désarçonnent la science Entretien avec Vinciane Despret
Est-ce que les primatologues revendiquent une histoire féministe ? Que se passe-t-il quand les savoirs amateurs reprennent la main sur les dogmes scientifiques ? Est-ce pertinent de se demander s’il y a une différence l’humain et l’animal ? Regarder vivre les animaux peut-il nous aider à produire un discours sur la mort ? Nous avons choisi de poser ces questions et d’autres à Vinciane Despret, auteure de Que diraient les animaux, si… on leur posait les bonnes questions ? (Éd. La Découverte, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », 2012). Où elle remet en jeu les dispositifs méthodologiques de l’éthologie, sous la forme d’un abécédaire. Depuis plus de vingt ans, elle tente de mettre à jour la rigidité des contraintes épistémologiques et dénonce la disqualification des savoirs amateurs, en particulier lorsqu’il s’agit d’étudier les animaux. Peu encline à condamner les « mauvais » résultats scientifiques, elle préfère aiguiller les chercheurs vers une science plus intéressante et plus prolifique.
Cet entretien est issu du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », traitant des relations entre les humains et les autres animaux, et toujours disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF…
Pourquoi vous êtes-vous penchée, en tant que philosophe, sur les animaux, et plus spécifiquement sur les rapports qu’entretiennent les scientifiques avec eux ?
Quand j’ai commencé à faire de la philosophie avec des cratéropes écaillés1 Le Cratérope écaillé (Turdoides squamiceps) est une espèce de passereau de la famille des Leiothrichidae, qui vit dans l’est, le sud et l’ouest de la péninsule Arabique. Son comportement … Continue reading il y a vingt-cinq ans[2. Naissance d’une théorie éthologique : la danse du cratérope écaillé, éd. Synthélabo, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », 1996. ], l’animal avait un pouvoir subversif extrêmement puissant, il offrait de l’espace pour bouger les lignes : on pouvait remettre en question certaines conceptions de l’espace politique, repenser la notion d’animal humain, le statut des sujets et des objets. Dans l’espace des sciences sociales notamment, prendre l’animal au sérieux a favorisé le mouvement des anthropologues qui voulaient en finir avec l’idée de nature. Les sciences sociales, la sociologie en particulier, ne pensaient alors qu’en termes passif/actif, sujet/objet ou agent/patient et ne voyaient dans les savoirs populaires qu’un objet d’étude, voire un support de représentation. L’animal était un lieu où se cristallisaient des possibilités de remettre en cause ces méthodologies visant à séparer l’idéologie de la science, à trier le bon grain de l’ivraie.
On a alors pu contester les objections faites jusque-là aux observations de Kropotkine, qu’on jugeait idéologiquement biaisées (s’il avait vu des comportements solidaires chez les animaux, c’est parce qu’il était russe et anarchiste). Les anthropologues de ma génération ont commencé à défendre le fait que l’observation d’un animal vivant en Russie par un anarchiste favorise certaines théories, certaines observations – tout comme l’observation d’un oiseau vivant dans des conditions toutes différentes par un Britannique victorien comme Charles Darwin en favorise d’autres.Nous disions désormais qu’il fallait tenir les deux propositions ensemble, l’éthos particulier du scientifique et les conditions concrètes de vie de tel ou de tel animal. Par exemple : qu’est-ce que ça fait de vivre sur une île ? Quel type de comportement animal cela induit-il ? Quel système politique ? Observateur et observé ne sont pas déliés, ils mangent dans le même paysage.
Est-ce qu’un projet politique sous-tendait le choix de ce sujet d’étude ?
J’ai toujours eu le sentiment de faire de la politique par d’autres moyens, « politics by other means », comme disent les féministes. Je me préoccupe du fait de savoir si les scientifiques font ou non du bon travail. Je voulais donc encourager les scientifiques quand ils font des choses vraiment bien, et notamment les enjoindre à résister aux contraintes de l’épistémologie. Ma politique s’inscrivait dans le sillage des philosophes Bruno Latour et Isabelle Stengers[3. Voir l’entretien avec Isabelle Stengers « Le prix du progrès », dans Jef Klak, no 1, « Marabout ».]. Côté Stengers : montrer à quel point les animaux sont partie prenante des expériences et prennent position par rapport à ce qu’on leur demande. Ils ne sont pas des supports passifs d’action. Ce qui rejoint le projet de Latour[4. En parlant d’actants, Bruno Latour insiste sur le fait que la passivité et l’activité ne s’opposent pas, et que les capacités d’agir sont surtout distribuées dans un régime de multiples « faire faire ». ] : remettre en cause le rapport traditionnel sujet/objet qui implique un sujet actif et un objet passif. Pour lui, les choses nous font agir, et nous les mobilisons de telle sorte qu’elles nous fassent agir. Cela nous oblige à prêter une attention plus soutenue aux modes d’action des êtres non humains.
Aujourd’hui, des scientifiques, comme Ádám Miklósi au Family Dog Project[5. Éthologiste hongrois, spécialiste des canidés, Ádám Miklósi a fondé en 1994 le groupe de scientifiques Family Dog Project qui étudie les chiens au sein de familles à qui ils appartiennent plutôt que les chiens de laboratoire, afin de mieux comprendre les relations des canidés avec les humains. ], font ce que je souhaitais voir faire il y a vingt ans : travailler en étant attentifs à rendre leurs animaux intéressants.
Que diraient les animaux si… on leur posait les bonnes questions ?, paru en 2012, semble un aboutissement de votre travail sur les animaux. Quel était le projet de ce livre en forme d’abécédaire ?
J’avais envie de clôturer quelque chose, de reprendre tous les fils que j’avais suivis jusqu’alors, et d’en tirer de nouveaux. L’abécédaire était une forme qui me permettait d’arriver très vite sur les points qui m’importent et de créer des frictions. Si vous faites un livre et que vous dites page 90 le contraire de ce que vous avez dit page 30, vous êtes obligé de vous justifier, de faire savoir que vous êtes conscient de la contradiction et de la résoudre, c’est la loi du genre. L’abécédaire était une forme qui me permettait de ne pas les résoudre. Donna Haraway[6. Donna Haraway, biologiste de formation, est une philosophe des sciences états-unienne et une figure du féminisme contemporain. Elle a notamment publié en 1985 le Manifeste cyborg. La métaphore du cyborg lui permet de montrer que les contradictions (dans ce cas, entre machine et vivant) n’ont pas nécessairement à être résolues, mais peuvent se combiner dans un seul être, le cyborg. (Voir l’article « Les affinités éclectiques », Jef Klak nº 3 « Selle de Ch’val » p. 172.) ] nous montre que nous pouvons non seulement assumer, mais chérir les contradictions, assumer que deux positions peuvent être vraies également, et incompatibles.
Vous montrez dans vos ouvrages comment, au XXe siècle, le savoir scientifique sur les animaux s’est constitué contre le savoir amateur…
Il faut remonter au XIXe siècle, lire un passage de Darwin ou de Georges John Romanes[7. Georges John Romanes (1848-1894) est un psychologue et un naturaliste britannique. Ami de Darwin, il fonde la psychologie comparée, qui s’intéresse aux similitudes (et aux différences) entre les mécanismes cognitifs des humains et des animaux de différentes espèces. ] pour comprendre. Vous y trouvez des témoignages de gardiens de zoo et de propriétaires de chiens. On a là une science peuplée d’anecdotes. Les amateurs n’ont pas encore été exclus du discours scientifique. Darwin lui-même observe ses propres chiens, il va au zoo regarder les singes, il écoute les soigneurs. Il reçoit des lettres de partout dans le monde, de cette Angleterre qui explore la planète. Le témoignage est fiable, dans un sens un peu bourgeois, dans la mesure où ce sont des témoins dignes de foi – soit des gens qui s’y connaissent, comme dans le cas des soigneurs, soit des auteurs honorables qu’on estime ne pas pouvoir mentir, pour ne pas risquer leur réputation.
Darwin comme Romanes ont tendance à expliquer le comportement des animaux par des compétences très proches des nôtres. Le projet étant d’établir une filiation entre les hommes et les autres animaux, ils cherchent des analogies plutôt que des différences. Toujours est-il qu’ils manifestent à l’égard des animaux une générosité d’attribution de subjectivité qu’on qualifiera plus tard d’anthropomorphisme débridé.
Au début du XXe siècle, s’opère un grand mouvement de purification qui prend plusieurs orientations. D’abord le principe du « canon de Morgan » qui exige que, lorsqu’une explication faisant intervenir des compétences inférieures concurrence une explication privilégiant des compétences supérieures ou des facultés cognitives complexes, ce sont les explications qui font appel à des compétences inférieures qui doivent prévaloir. Si vous voulez mobiliser les capacités supérieures d’un animal, il va falloir mettre en place un dispositif expérimental pour prouver que son comportement ne peut pas être expliqué par des capacités inférieures. L’exemple le plus fréquent est d’attribuer la réussite de quelque chose qui demande de l’intelligence à du conditionnement. David Premack et Georges Woodruff ont testé la capacité de mentir chez les chimpanzés. Si un expérimentateur demande au singe de l’aider à trouver une friandise, le chimpanzé qui sait où elle se trouve lui montre la cachette. Si l’expérimentateur ne partage pas la trouvaille avec lui, le chimpanzé le leurrera à l’épreuve suivante. Pour les deux scientifiques, c’est bien l’indice d’une capacité à anticiper et à savoir que ce que l’expérimentateur sait diffère de ce que sait le chimpanzé. Pour nombre de leurs collègues, c’est une simple association, de type conditionnement, entre l’expérimentateur « malhonnête » et l’absence de récompense. On se débarrasse ainsi des explications prétendument nébuleuses que sont la volonté, les états mentaux ou affectifs, ou encore le fait que l’animal puisse avoir un avis sur la situation et l’interpréter.
À la suite de Konrad Lorenz[8. Konrad Lorenz (1903-1989) est un pionnier de l’éthologie. Lauréat du Prix Nobel de médecine en 1973, il étudie le comportement des animaux (en particulier le rôle de l’inné dans sa détermination) et notamment l’imprégnation chez les oisillons (Voir l’article « Le blues des grues blanches », Jef Klak nº 3 « Selle de Ch’val », p.54). ], les éthologistes se mettent aussi à regarder les animaux comme limités à réagir plutôt que sentants et pensants. Ils excluent toute possibilité de prendre en compte l’expérience individuelle et subjective. C’est la naissance d’une éthologie mécaniciste, qui a pour effet de scientifiser la connaissance de l’animal. L’éthologie devient une biologie du comportement obsédée par l’instinct, les déterminismes invariants et les mécanismes innés, physiologiquement explicables en termes de causes. Par ailleurs, le contrôle devient l’instrument majeur à l’œuvre dans le laboratoire, en faisant mine que ce contrôle n’affecte pas l’animal ni les résultats ; qu’il est juste une condition de possibilité.
Robert Rosenthal incarne une des apothéoses de ce mouvement du XXe siècle en psychologie expérimentale. Après avoir montré que la performance des rats dans un labyrinthe est affectée par les attentes des expérimentateurs – la performance est meilleure lorsque ces derniers sont persuadés d’avoir affaire à des rats « doués » –, il dénonce cet effet comme un parasite à éliminer. Il veut purifier le laboratoire. Il vise une situation idéale où le rat ne serait pas influencé, quitte à utiliser des robots en guise d’expérimentateurs. Ce qu’il oublie, c’est que dans l’environnement artificiel et entièrement humain qu’est le laboratoire, l’absence de relation est aussi une forme de relation, qui influence nécessairement le rat.
L’éthologie se démarque de plus en plus des amateurs, notamment en invalidant les anecdotes. Les scientifiques constituent un certain type de méthodologie pour disqualifier ceux qui n’en respectent pas les contraintes. C’est la stratégie du « faire-science » : ils reconnaissent aux amateurs un certain savoir sur les animaux, mais leur absence de méthode, de grille d’interprétation et de rigueur scientifique invalident leurs interprétations, qualifiées d’anthropomorphiques.
La primatologie permet par la suite un assouplissement progressif. Certains primatologues commencent en effet à revendiquer que leurs méthodes doivent se rapprocher de l’anthropologie, car faute d’habituation des singes à leurs observateurs, ceux-ci ne peuvent pas réaliser d’observations de qualité. Les recherches sur les chiens participent aussi de cet assouplissement. Même si le scientifique n’est pas amateur de chien au départ, il le devient rapidement ; il y a une relation qui s’installe au laboratoire. Très souvent, d’ailleurs, les scientifiques travaillent avec leur propre animal ou ceux d’amis, des bêtes avec qui ils tissent des liens.
Qu’en est-il aujourd’hui des relations entre l’éthologie et les savoirs amateurs ?
Les choses évoluent. Ádám Miklósi, spécialiste des chiens, insère dans son livre des encarts où il raconte ce qu’on appelle des anecdotes. Ce n’est pas un hasard : entre-temps, un article écrit par deux primatologues, Lucy Bates et Richard Byrne[9. Bates Lucy A. et Byrne Richard W., « Creative or created: using anecdotes to investigate animal cognition », Methods, 2007, vol. 42, no 1, pp. 12-21. ], a proposé de ne plus jeter ces histoires à la poubelle, considérant cela comme un vrai gaspillage. Pour eux, de nombreux événements n’arrivent que très rarement sur le terrain, voire une seule fois, mais ils peuvent nous apprendre des choses intéressantes sur les compétences des animaux. Pourtant, elles ne peuvent pas figurer dans les publications, et restent donc complètement ignorées. L’article a reçu un très bon accueil et eu un impact important. Il précise quand même que pour être acceptables, les anecdotes doivent être observées sous certaines conditions contrôlées : il faut qu’elles soient notées immédiatement après avoir eu lieu et que l’observateur soit scientifique et spécialiste de l’espèce considérée. On est toujours dans une routine normative et un régime d’exclusion, mais cela permet quand même de ressortir quantité d’histoires restées jusque-là dans des tiroirs ou abandonnées à la littérature populaire.
Miklósi cite deux anecdotes racontées par deux scientifiques spécialistes des chiens, observées avec leurs propres animaux. Quand le premier rentre de promenade avec son compagnon, il va chercher un drap à la salle de bain et l’essuie. Un jour, il oublie ; l’animal se met à se frotter sur le paillasson et à le regarder d’un air interrogateur, puis va lui-même chercher le drap. La petite fille du second scientifique a pris l’habitude, par jeu, de jeter un drap de bain sur leur chien et de lui crier, en imitant la voix d’Homer Simpson : « Où est-ce qu’il est Darby ? ». Un jour, Darby prend lui-même le drap et s’enroule dedans ; il initie le jeu.
Miklósi fait un truc génial : il traite ensemble ces deux histoires pour faire émerger une faculté commune. C’est stratégique, ça lui permet de réaliser un coup de force par rapport à d’éventuels détracteurs. Il y a, dit-il, deux interprétations possibles. La première illustre la posture sceptique, et affirme qu’il s’agit de coïncidences : en détournant le geste de son maître pour en faire une demande ou en imitant celui de la petite fille, le chien n’a pas vraiment eu l’intention d’exprimer une volonté quelconque. Avec cette première interprétation, on s’arrête là, on ne peut rien faire de plus. La seconde, plus généreuse (ou plus laxiste, selon les points de vue) suppose des compétences sophistiquées : le chien imite et se montre capable, en détournant le geste imité, de généraliser et d’exprimer une demande. Le scientifique est mis au travail, il a des hypothèses à vérifier: le chien est-il capable d’imiter, de détourner un geste pour en faire une modalité expressive, d’anticiper que cet acte sera compris ? La différence entre les deux hypothèses, la sceptique et la généreuse, c’est leur fécondité scientifique.
Y a-t-il une spécificité de l’éthologie quant à la disqualification du savoir amateur par rapport au savoir scientifique ?
La relation entre les savoirs scientifiques et amateurs concernant les animaux a pris une forme particulière, celle de la rivalité. Le chimiste, lui, ne se préoccupe pas de ce que pense l’alchimiste. De même, les astrologues ne vont pas voir les astronomes pour leur dire : « Je pense que vous vous trompez, vos affirmations sont fausses. » Le médecin est en revanche encore hanté par le charlatan – ce que nous rappelle sans cesse la méfiance envers l’homéopathie, ou les pratiques alternatives… L’éthologie semble se situer plutôt du côté de la médecine, alors qu’elle aurait pu se trouver du côté des disciplines comme l’astronomie ou la chimie – des sciences qui ne cherchent pas à éliminer leur rival. Sans doute en raison de sa proximité avec les amateurs : l’éthologie dialogue avec eux, elle s’en inspire, elle les pille, même, disent certains. Et eux, de leur côté, ne se gênent pas pour aller voir les éthologues, pour se mêler de ce qui ne les regarde pas.
Les psychologues aussi restent en prise avec leurs rivaux : ils n’arrêtent pas de décrier les faux thérapeutes. Comme l’éthologie et la médecine, la psychologie dénonce les savoirs populaires parce qu’ils sont trop profondément engagés dans ce monde. Le philosophe Martin Savransky parle d’épistémologie de l’étrangéité (estrangement) pour décrire, et contester, l’idée selon laquelle le savoir ne vaut qu’à condition d’aller à l’encontre du sens commun : pour connaître le monde, il faut y être « étranger », quitter les apparences immédiates pour une réalité cachée, que les gens ne peuvent saisir, pris comme ils le sont dans le monde phénoménal.
Quel est le rôle de l’accusation d’anthropomorphisme ?
Des scientifiques récusent certaines théories en les accusant d’accorder aux animaux des capacités proprement humaines, sous-entendu trop élaborées. J’ai rencontré un tel affrontement autour des cratéropes écaillés. Ce sont de petits oiseaux du désert du Néguev, à partir desquels l’ornithologue Amotz Zahavi a élaboré sa théorie du handicap, selon laquelle certains animaux affirment leur valeur en exhibant un comportement ostentatoire. Les cratéropes se font des cadeaux, se portent volontaires pour être sentinelles, nourrissent sans bénéfice apparent d’autres nichées que la leur, prennent des risques dans les combats avec les prédateurs ; et font tout cela avec une volonté explicitement exhibitionniste. Pour leur « prestige », dit Zahavi. Jonathan Wright, un autre zoologue, relativement bien formaté et qui adhère aux postulats de la sociobiologie, considère, lui, que les cratéropes sont programmés pour agir de la façon qui assure au mieux la pérennité de leurs gênes.
Un jour, Jonathan Wright et moi-même voyons un cratérope faire le petit sifflement d’appel qui indique qu’il va donner à manger à une autre nichée que la sienne. Selon Zahavi, ce sifflement veut dire : « Je suis altruiste, regardez-moi, j’ai les moyens de faire des choses magnifiques. » Il est en train de travailler à augmenter son prestige. Sauf que cette fois-là, il ne donne rien à la nichée. Wright, convaincu que le prestige n’est pas ce qui le motive, m’explique que ce cratérope est en train de mener une expérimentation sur la nichée : il veut contrôler son état de faim réel pour ne pas perdre de temps. Il lance un stimulus et regarde l’effet.
En général, Wright pense qu’on ne peut pas émettre une hypothèse si on ne l’a pas expérimentée : c’est ce qu’exige une véritable science objective. Cette fois-là, face à quelque chose d’étrange et incompréhensible à ses yeux, il se dit : c’est une expérimentation. Il semble attribuer aux oiseaux la manière dont, lui, a appris à « faire-science ». Mais c’est quelque chose qu’il refuse tout à fait à Zahavi, qu’il accuse tout le temps d’être anthropomorphe. En fait, il ne reproche pas tant à Zahavi d’attribuer aux oiseaux des intentions semblables à celles des humains – il le fait lui aussi –, mais plutôt de ne pas procéder selon la méthode scientifique habituelle, à savoir le canon de Morgan et l’expérimentation. Il cherche à disqualifier sa façon non scientifique, à ses yeux, d’attribuer des intentions aux cratéropes. L’accusation d’anthropomorphisme est en fait une accusation d’amateuromorphisme.
Quel rôle ont joué les femmes et le féminisme dans l’évolution de l’éthologie ?
L’arrivée des femmes – de quelques femmes – sur le terrain de la primatologie a tout bouleversé. Cela a été très bien analysé d’abord par Donna Haraway, dans son livre Primate visions, puis repris par Linda Fedigan et Shirley Strum dans Primate encounters. Elles ont constaté que les changements absolument remarquables qu’opère la primatologie à partir des années 1960 sont le fait de chercheuses, sous la plume desquelles sont apparues de nouvelles observations et propositions.
À partir de là, on s’est demandé si les femmes faisaient de la science différemment. Les hypothèses se sont distribuées selon deux types de postures: une plus essentialiste et une plus constructiviste ou culturaliste. La vision essentialiste affirme qu’elles travaillent différemment parce qu’elles sont naturellement plus sensibles, plus à l’écoute du matériel, moins habitées par des théories générales, soucieuses de collecter des faits et attentives aux détails, parce qu’elles auraient une grande suspicion par rapport aux généralisations hâtives. La position constructiviste, quant à elle, revient à dire : « les femmes ont été éduquées comme cela et c’est cela qu’elles mettent en œuvre sur le terrain », ou encore « les femmes occupent une position historique particulière qui produit une conscience aiguë des rapports de pouvoir, qui les rend, par exemple, plus suspicieuses vis-à-vis des généralisations hâtives. Cela favorise d’autres données et une autre manière de les mettre en histoire, une science d’une autre qualité ». D’autres, enfin, comme Shirley Strum, affirment que cela n’a rien à voir : « Ce que l’on peut dire de nous, c’est que nous sommes restées très longtemps sur le terrain et avons fait correctement notre travail. Nous sommes simplement de bonnes scientifiques. » Reste à savoir si les femmes ne sont pas davantage obligées de faire bien leur travail, du fait d’une compétition extrêmement rude. Ne sont-elles pas contraintes à une certaine forme d’excellence, à travailler plus qu’un homme, parce qu’elles sont moins entendues ?
Pour bien comprendre pourquoi les femmes sont restées longtemps sur le terrain, il faut prendre en compte le contexte socio-économique et politique des années 1960. Les hommes avaient alors toutes les chances de devenir professeurs d’université en primatologie – science émergente qui intéressait beaucoup les anthropologues –, notamment parce que les origines de l’homme étaient une question qui fascinait. Les femmes, ayant très peu de chances d’avoir des postes de ce type-là, continuaient à fonctionner avec des bourses de recherche et ne tentaient pas trop d’enseigner dans les universités. Elles voulaient travailler avec leurs singes, obtenir des bourses et une fois sur un terrain, y rester.
Qu’est-ce que ces femmes ont changé dans la primatologie ?
D’abord, elles se sont intéressées au rôle des femelles. Auparavant, on ne le faisait que pour vérifier l’attachement au rôle maternel. Elles ont décrété que la maternité, c’était bien joli, mais que ça ne faisait pas toute la carrière des femelles. L’attention qu’elles ont prêtée à la sagacité sociale des femelles, à leur importance dans les relations sociales, a complètement modifié ce que l’on savait des mâles. Le fait que les femmes restent plus longtemps sur le terrain – ce qui est statistiquement le cas dans les années 1960 – a permis de découvrir que ce sont généralement les femelles qui restent au sein de la troupe, et les mâles qui migrent. Avant, on ne savait pas cela. Parce que si vous restez trois mois, quand un mâle disparaît, vous vous dites : « Bernard n’est plus là, il lui est arrivé des malheurs. » Mais en restant des années, vous voyez de nombreux mâles disparaître et d’autres arriver, et vous finissez par comprendre que, quand un d’entre eux disparaît, c’est qu’il est parti rejoindre une autre troupe (ce qu’ils font normalement à l’adolescence). Tandis que les femelles restent sur place et assurent le social.
L’apparente inactivité sociale féminine, c’est-à-dire le fait qu’elles ne sont pas tout le temps en train de négocier, de se bagarrer, de régler des choses, signifie simplement que, quand vous vivez depuis des années avec d’autres êtres, vous n’avez plus besoin de discuter de tout, tout le temps. Les relations sont bien installées et on ne les remet en jeu que lors de conflits ou de changements importants dans la troupe. Cette apparente inactivité est en fait une activité en soi. Ce sont elles qui font société et les mâles qui viennent s’intégrer dans la troupe. Une fois que vous avez vu ça, vous comprenez autrement l’apparente activité sociale des mâles. Avant, on pensait qu’ils étaient en lutte pour obtenir une place plus haute dans la hiérarchie. Si vous partez du principe qu’une troupe est un ensemble stable d’individus et que vous y voyez des mecs se battre tout le temps, vous n’avez pas beaucoup d’autres possibilités que de penser qu’ils se bagarrent pour la domination, surtout dans les paradigmes de l’époque. Mais une fois que vous comprenez que les prémisses sont fausses, que les mâles passent d’une troupe à l’autre et doivent sans cesse s’intégrer, une autre interprétation s’impose. Ce n’est plus un problème de hiérarchie, mais d’intégration : trouver une place dans la troupe quand on est nouveau venu n’est pas facile, on n’est pas nécessairement bien accueilli.
Tout ce qu’on avait vu de relations compétitives entre mâles mal dégrossis, peu sophistiqués, était en fait un travail incessant de socialisation, de composition de ce social. Chaparder de la nourriture, pour un mâle, c’est obliger les autres à le reconnaître, à prendre sa présence en compte. Si vous n’arrivez pas à le faire sur un mode sophistiqué parce que vous êtes trop jeune, et mal équipé socialement, vous utilisez les moyens des adolescents : on ne me regarde pas, alors je vais obliger tout le monde à me regarder, je vais faire chier. Ce qui est intéressant, relève Shirley Strum, c’est qu’au lieu de faire une science matriarcale, ces primatologues attribuent à chaque catégorie (âge, sexe, etc.) des rôles sociaux particuliers, différenciés et complémentaires.
Est-ce que ces primatologues revendiquent une histoire féministe ?
Certaines oui. Elles disent qu’elles ont pu observer ce qu’elles observent parce qu’elles étaient dans une position historique très clairement déterminée, ce qui est déjà un point de vue féministe. D’autres ajoutent que nous étions plus attentives aux relations de pouvoir à cette époque. Remettre en question le rôle des femelles, c’est être attentive aux relations de pouvoir et de subordination, à la conscience de genre, à ce qui fait que nos observations nous confortent trop vite dans l’idée que les femelles sont passives. C’est être attentive aux grandes dichotomies passivité/activité, sujet/objet – catégories que le féminisme avait commencé à sérieusement remettre en cause. C’est être méfiante vis-à-vis de ces grandes théories que sont la hiérarchie et la compétition, suspectes d’un point de vue féministe, car trop proches de la manière dont les humains s’imaginent une société. C’est remettre en cause aussi les notions de harem, de guerre de tous contre tous, de mâle alpha, tout ce qui est schème guerrier, grandes épopées héroïques – l’homme qui se redresse par-dessus les herbes de la savane, invente les armes et compagnie. À cette époque, les féministes ont commencé à revisiter ces grandes histoires, et cela a nourri la primatologie.
Est-ce que ces changements au sein de la primatologie ont touché les autres animaux ?
C’est intuitif, je ne suis pas historienne, mais j’ai le sentiment que les méthodologies de la primatologie ont imprégné celles des autres scientifiques, au moins en ce qui concerne les espèces qui ne fuient pas dès que vous approchez. Il y a un effet d’émulation entre chercheurs assez remarquable : quand les singes réussissent un truc, les spécialistes du corbeau, de la baleine ou du dauphin essayent de montrer que leurs animaux peuvent y arriver aussi. Toute éthologie est comparative, même si le projet ne l’est pas au départ.
Est-ce ainsi que la primatologue Thelma Rowell en est venue à étudier les moutons ?
Thelma Rowell voulait dénoncer l’anthropocentrisme. Selon elle, les singes nous paraissent intelligents parce que nous pouvons leur poser des questions sur la base de nos fonctionnements respectifs, très similaires. Les chimpanzés ont des amis, sont capables de réconciliation, de créer des alliances, de soigner les liens, de mentir, de manifester des relations privilégiées, d’en prendre acte et de faire en sorte que ces relations restent possibles. Mais sont-ils vraiment plus malins que les autres ? On ne peut pas comparer deux êtres si on ne leur pose pas les mêmes questions. Donc il faut poser à d’autres animaux celles qu’on pose aux chimpanzés. Thelma Rowell choisit l’animal qui, parmi les mammifères, a la réputation d’être le plus idiot, docile et suiveur, le plus mal équipé socialement : le mouton.
Si on regarde la littérature scientifique, jusque-là, on demandait aux moutons : comment tu convertis l’herbe en gigot ? On leur donnait de l’herbe et on regardait comment ils grossissaient. On s’est aussi un peu intéressé à leurs relations sociales, mais on a vite décrété qu’ils n’étaient pas très doués pour ça. On n’a pas remarqué d’attachements, de préférences… rien, seulement un modèle hiérarchique. De toute façon, en général, tout comportement qui n’a pas de sens immédiat, ou dont le sens aurait demandé beaucoup plus de confiance dans la complexité des êtres, est rabattu d’emblée comme « hiérarchique ». Problème réglé.
Les moutons étaient donc très hiérarchisés : les mâles se battaient pour les femelles, et la femelle dominante, la plus âgée, conduisait le troupeau. Thelma Rowell a fait remarquer que cette littérature scientifique affirmant qu’il n’y avait pas de relations de préférence était en fait fondée sur des troupeaux constitués pour l’occasion, et très rapidement observés. Une autre explication est que les chercheurs préfèrent étudier les moutons quand il se passe beaucoup de choses, c’est-à-dire aux périodes de reproduction durant lesquelles il y a de nombreux conflits.
Elle a donc décidé de procéder tout autrement, affirmant qu’il faut poser ses questions dans un contexte favorable, prendre le temps de créer un troupeau, de l’observer, et attendre que les relations se soient installées. Ce faisant, elle a observé que les moutons avaient des préférences, des amis, et que la hiérarchie n’était pas du tout coercitive. Au contraire, pour décider des déplacements, il y avait des conversations, des négociations. À propos des combats entre mâles, Rowell raconte qu’ils ont pour but d’attirer l’attention des femelles, et que comme les moutons n’ont pas de mains pour interpeller, ils le font avec leurs cornes. Elle est arrivée ainsi à toute une série d’interprétations sophistiquées, affirmant par exemple que lorsque les moutons se frottent les joues ou le front avant ou après un combat, il s’agit de gestes de pré-réconciliation et de réconciliation. Comme si les moutons qui ont une affinité particulière se disaient avant de se battre : « Je suis obligé de faire ce que je vais faire, mais on reste amis. » Comme un salut avant un combat de boxe.
La question du propre de l’homme, de la frontière homme-animal, vous intéresse-t-elle ?
Non ! Cette question n’a d’intérêt qu’historique, pour diagnostiquer l’évolution des rapports, observer comment les positions se modifient et quels sont les bastions qui tiennent encore. Les argumentaires sur le propre de l’homme sont en général très mal documentés. En 1930, soit, je ne vais pas jeter la pierre à Freud quand il dit que l’homme est le seul à réguler les unions incestueuses. En revanche, ceux qui le citent aujourd’hui pour défendre ce genre de banalité m’irritent. Ils n’ont généralement rien à voir avec les animaux, et prennent les positions les plus radicales et généralisantes sur ces questions.
Je ne suis pas en train de faire le tri entre savoirs populaires et savoirs d’experts, savoirs légitimés et non légitimés ; la ligne ne passe pas par là. Ce sont même souvent les personnes légitimées par une posture académique ou une position sociale, culturelle, scientifique qui émettent les théories les plus stupides sur la question de la frontière homme-animal. En revanche, quand vous interrogez des propriétaires de chiens, des éleveurs, comme nous l’avons fait avec Jocelyne Porcher[10. Jocelyne Porcher et Vinciane Despret, Être bêtes, Actes Sud, 2007. ], la question de la différence ne les intéresse pas. Et quand elle les intéresse, on obtient des réponses surprenantes.
Quels remparts du « propre de l’homme » résistent encore ?
Le rire a été un rempart important, mais a été démonté quand on a vu des animaux rire. La conscience de soi comme spécifique à l’humain a aussi été invalidée : les éthologues ont monté nombre de dispositifs expérimentaux montrant que les animaux avaient conscience d’eux-mêmes, comme le test de la tache de Gallup[11. Aussi appelé « test du miroir », il consiste à placer une marque sur le front d’un animal, puis à observer sa réaction lorsqu’il découvre son reflet dans un miroir. S’il cherche à mieux l’apercevoir ou à la toucher, on considère que cet animal est capable de reconnaître son propre corps. Ce test a été développé dans les années 1970 par le psychologue américain Gordon G. Gallup. ]. Idem pour la « culture », rempart abattu après des années de controverse. On ne compte plus les « propres de l’homme » qui ont été ingénieusement remis en cause.
La conscience de la mort et de la finitude reste un bastion, sans doute parce qu’il ne sera pas facilement démenti. Aujourd’hui, certains reconnaissent bien que les animaux ressentent le chagrin dû à la perte, qu’ils font la différence entre le cadavre d’un congénère et celui d’un autre animal. Mais d’autres leur répondent que c’est peut-être de la peur ou de l’anxiété. Ils disent aussi qu’avoir conscience que l’autre est mort, ce n’est pas la même chose qu’avoir conscience de la mort. La Mort avec un M majuscule ! Et nous, humains, avons-nous conscience de la mort ? C’est complexe. Est-ce que l’on a conscience que l’on va mourir ? Pas tout le temps. On a conscience de la finitude, qu’on n’est pas là pour toujours, oui, et encore.
Pourquoi les scientifiques, les psychologues et les sociologues en particulier, ont-ils tenu et tiennent-ils encore autant à ces remparts ?
Pour des raisons historiques et politiques. Des gens ont très sérieusement pensé, à tort ou à raison, que l’affaiblissement de la frontière entre les deux pourrait entraîner des choses terribles pour l’être humain : sa bestialisation, le non-respect de la vie. Sur cette question, Luc Ferry[12. Luc Ferry, Le Nouvel Ordre écologique. L’arbre, l’animal et l’homme, Grasset, 1992. ] a fait un très mauvais boulot : il a écrit une très mauvaise étude historique et juridique des lois nazies, en les tronquant, en les lisant mal, et sans voir que les lois de protection animale ne s’enracinaient pas dans le nazisme, comme il l’affirmait, mais avaient des origines bien antérieures. Heureusement, des gens comme Éric Baratay[13. Eric Baratay est un historien français spécialiste des relations hommes-animaux. ] et Jean Pierre Marguénaud[14. Jean Pierre Marguénaud est professeur de droit privé à Limoges et directeur de la Revue semestrielle de droit animalier. ] ont remis les choses en place. Mais la crainte de voir cette barrière tomber reste très présente. Outre cette peur, ce qui explique que ces remparts tiennent si bien, ce sont les habitudes routinières académiques. L’anthropologie s’est fondée sur l’étude de l’homme en tant qu’homme, et forcément, ça n’encourage pas à brouiller les frontières.
Qu’ont fait, selon vous, les penseurs de la libération animale par rapport à cette frontière ?
Ils n’ont pas apaisé les choses. Le système argumentatif de Peter Singer[15. Peter Singer est un philosophe australien. Il est l’auteur de La libération animale, paru en 1975, ouvrage de référence pour les mouvements en faveur des droits des animaux (Voir l’article « Je suis un terroriste parce j’ai défendu le droit des lapins »). Il a popularisé la notion de « spécisme », qui désigne un traitement discriminatoire fondé sur l’appartenance à une espèce. Peter Singer part d’une vision utilitariste, selon laquelle le but de l’action politique est la maximisation du bien-être du plus grand nombre d’êtres dotés de sensibilité. ] consiste à demander : « Pourquoi une vie d’handicapé vaudrait plus que celle d’un animal ? » C’est extrêmement dangereux et cela attise les peurs. Je crois que c’est une erreur stratégique. Il aurait dû penser aux effets de terreur qu’il allait susciter en disant cela. Pour ma part, je suis leibnizienne à la suite d’Isabelle Stengers ; je suis une pragmatiste. Si vous utilisez un argument qui suscite encore plus de peur, que vous rigidifiez les positions et que vous ne convainquez que les convaincus, il y a quelque chose à repenser. Par ailleurs, je n’ai pas de sympathie pour l’utilitarisme. Donc, je ne peux pas suivre Singer, si ce n’est sur un seul point : sa façon de déconstruire et remettre en cause les mauvaises pratiques scientifiques.
Vous avez travaillé avec Jocelyne Porcher : qu’est-ce que son approche vous a apporté ?
Jocelyne nous oblige à revisiter tout le vocabulaire utilisé pour décrire la relation entre hommes et animaux, notamment le terme d’« exploitation ». Il n’existe pas une vie qui ne repose sur la vie d’autres êtres, et voir ça automatiquement en termes d’exploitation cadenasse le débat : il y a forcément une victime et un bourreau. On ne peut plus penser, on tombe dans une éthique binaire, avec des victimes et des salopards. Mieux vaut se montrer attentif à tout ce vocabulaire de l’exploitation, parce qu’il imprègne les modes de penser.
Deux historiennes des sciences, Carla Hustak et Natacha Myers ont écrit en ce sens un très joli article sur l’évolution[16. Carla Hustak, Natacha Myers, « Involutionary Momentum: Affective Ecologies and the Sciences of Plant/ Insect Encounters », Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies 23(3), 2012. ]. Aujourd’hui, on étudie beaucoup – comme Darwin l’avait très sensuellement fait en son temps – le rapport entre les insectes pollinisateurs et les orchidées. Il y a toute une chimie écologique qui permet de mieux comprendre les rapports des parfums attracteurs, des phéromones… L’article montre que ces rapports sont généralement décrits sur le mode de l’exploitation avec un dupe et un être qui leurre. Quand la fleur crée des appâts pour faire venir des insectes, on imagine que la plante exploite l’insecte puisqu’il y va à perte, croyant féconder un être fécondable. Mais plutôt qu’un simple système d’exploitation, ne peut-on pas imaginer des relations qui se seraient instaurées, avec des plaisirs sensuels, des rencontres ? De la même manière, il faut être très attentif à ne pas penser la domestication uniquement sous le régime de l’exploitation : des tas de relations s’y créent, réciproques, asymétriques.
J’ai beaucoup d’admiration pour Jocelyne. Cela dit, nous ne sommes pas toujours d’accord stratégiquement. Elle me reproche de ne pas dénoncer, de ne pas parler de la souffrance animale. Mais que veut-on ? Que les choses changent ou que nos idées gagnent ?
Encore une fois, je pense qu’il faut être pragmatiste et accompagner les réussites : les scientifiques auront davantage envie de travailler sur des modes plus intéressants si je leur montre ce que ça produit, si je leur donne confiance en ce qu’ils font, que si je me mets à leur tirer dessus à boulets rouges, à faire peur à tout le monde. C’est aussi une question de crédibilité.
Pour mon travail, je suis allée chercher les gens qui disaient et faisaient des choses intéressantes. Jocelyne, elle, est confrontée à des éthologues positivistes, scientistes, purificateurs, et très zootechniciens[17. La zootechnie est l’ensemble des sciences et techniques utilisées pour l’élevage des animaux dans un cadre agro-industriel. ] dans l’âme. Ceux-là, je ne les fréquente pas, donc je n’en parle pas. Si je ne les critique pas, c’est pour ne pas perdre mon temps. Jocelyne considère qu’on ne perd pas son temps à critiquer. Ce sont deux stratégies différentes, et complémentaires.
Jocelyne Porcher est désespérée par la façon dont l’éthologie appliquée aux recherches sur le bien-être animal sert à valider la production animale industrielle. Les changements dans les éthologies dites naturalistes peuvent-ils être en mesure de déplacer ce type de recherches ? Le travail de Thelma Rowell sur les moutons par exemple peut-il avoir un retentissement sur la production agroalimentaire ?
Thelma Rowell n’a pas trop d’illusions là-dessus. Mais je pense que cela peut passer par d’autres voies. J’ai rencontré des scientifiques qui disent ne plus faire certaines choses après m’avoir lue, qu’ils font davantage attention à la façon dont ils s’occupent de leurs animaux. Ils réfléchissent aux conditions qui permettent à l’animal de se sentir mieux. Parfois, ça les freine un peu. Mais je pense que le fait d’être empêché est souvent le signe d’un plus grand changement que celui de commencer à faire quelque chose de nouveau. Cela manifeste une modification profonde. Ce sont peut-être de tous petits pas, mais si les moutons de Thelma Rowell n’inspirent pas d’autres pratiques dans les élevages industriels, cela a quand même des effets sur le grand public qui peut faire pression.
Comment êtes-vous passée des animaux à vos derniers travaux sur les morts ?
C’est un grand saut dans le vide. Il y a vingt-cinq ans, l’animal était l’objet le plus subversif que j’ai pu trouver ; maintenant, il n’a plus du tout cet effet. Il y a un ronronnement consensuel ; la question animale est devenue une espèce de ritournelle bien-pensante. Aujourd’hui selon moi, ce sont les morts qui sont des objets d’étude subversifs. Ce sujet diablement sulfureux permet de remettre en cause la rationalisation forcée de la société, et la laïcité telle qu’elle est pratiquée sur le mode de la neutralisation. Les morts permettent de s’attaquer au pouvoir des psys, à la normalisation et à la domestication des psychés, à l’ethnocentrisme autant qu’à l’arrogance des anthropologues et des sociologues qui se donnent pour mission de désenchanter le monde. Les scientifiques académiques ont besoin de penser que les gens croient pour pouvoir les dessiller les yeux. Quand on utilise le mot « croire » pour désigner la manière dont les gens pensent, c’est une déclaration de guerre depuis une position de surplomb[18. Voir « Quand on jette on une vierge dans un pays communiste un matin. Vie publique d’une apparition. Entretien avec Élisabeth Claverie », Jef Klak, nº 1, « Marabout », Automne-hiver 2014-2015. ].
Ce qui me passionne, ce sont les endroits où les gens sont intelligents. J’avais trouvé beaucoup d’intelligence chez ceux qui travaillent avec les animaux et j’en trouve énormément chez ceux qui cultivent des relations avec leurs morts. Ils le font avec imagination et courage, en sachant que ce n’est pas « normal », pas socialement approuvé. C’est un lieu de résistance politique : ils résistent à la théorie du deuil, à la normalisation, à la domestication de leurs expériences.
Ce qui m’importe, c’est de prendre au sérieux le fait que les gens parlent à leurs morts, que ça n’a rien de symbolique et que nous n’avons pas à statuer sur leur présence effective. Est-ce qu’ils reviennent ou pas ? On n’en sait rien. Si on sent leur présence, quel est ce mode de présence ? Ce que je fais, c’est de l’éthologie des morts, au sens de Deleuze. L’éthologie, selon lui, serait « la science pratique des manières d’être », c’est-à-dire l’étude de ce dont les êtres sont capables, des épreuves qu’ils peuvent endurer, de leur puissance. Un diamant est un être d’une exceptionnelle dureté, c’est la puissance du diamant. Un chameau peut s’arrêter de boire pendant plusieurs jours, c’est la puissance du chameau.
Je trouve cette définition de l’éthologie passionnante, car elle peut englober ce qu’on appelait trop pauvrement « biologie du comportement ». Deleuze dit que savoir de quoi un être est capable engage à des expérimentations. Quand on met un être dans un dispositif, quand on fait une expérience avec un chien, on doit se demander : de quoi es-tu capable pour aller chercher la balle, comment tu t’y prends, c’est quoi ta manière d’être ? Deleuze dit que les régimes alimentaires sont des manières d’être. C’est ça, l’éthologie : ce n’est pas seulement manger de la viande ou de l’herbe, mais tout un paysage – des manières de vivre, de penser, de bouger, d’agir, de vivre la nuit, le jour. Je dis aujourd’hui que je fais une éthologie des morts. Quelles sont les manières d’être des morts ? De quoi sont-ils capables ? De quoi rendent-ils les vivants capables ?
Notes
| ↩1 | Le Cratérope écaillé (Turdoides squamiceps) est une espèce de passereau de la famille des Leiothrichidae, qui vit dans l’est, le sud et l’ouest de la péninsule Arabique. Son comportement singulier fait de lui un exemple privilégié pour les théories éthologiques sur l’altruisme chez les animaux. |
« Je suis un “terroriste” parce que j’ai défendu les droits des lapins »
Entretien avec Josh Harper, militant états-unien pour la libération animale
Lors d’une tournée européenne de conférences en Europe, Josh Harper a fait une halte à Marseille en septembre 2015, invité par l’association Alarm1 Association pour la libération animale de la région marseillaise < alarm-asso.fr>.. L’occasion d’un entretien avec ce militant emprisonné pendant trois ans sous le coup des lois antiterroristes spécialement votées en 2006 pour protéger les intérêts des industries utilisant des animaux aux États-Unis. En s’appuyant sur plus de deux siècles de lutte dans les pays anglo-saxons, Josh Harper apporte un regard aussi critique que partisan sur l’histoire des mouvements de libération animale – ses grandeurs et ses décadences.
Cet entretien est issu du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », encore disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF.
Je suis né en 1972 dans une grande ville du sud de la Californie – ma mère était ouvrière dans une usine de plats surgelés, et mon père un petit voyou qui faisait de la mécanique pour passer le temps. Je n’étais pas spécialement ravi d’avoir un père délinquant, mais ça m’a très vite donné une piètre estime de la police. Un jour, mon père est rentré à la maison en disant « Les enfants, faites vos valises, on part en voyage », ce qui nous a pas mal excités avant qu’on comprenne que nous étions pourchassés par une bande de dealers qui lui en voulaient à mort. Nous nous sommes installés en Oregon, et j’ai découvert des paysages fort différents de la cité de béton où j’avais grandi.
Pour une famille sans le sou comme la mienne, les week-ends se passaient souvent dans la forêt, c’était gratuit, mais riche en découvertes et en amusements. À cette époque, ses arbres étaient en train de se faire laminer par des compagnies minières à coups de tronçonneuse. J’ai donc eu une conscience politique précoce des enjeux environnementaux. Mais ce n’est qu’après avoir eu vent des luttes pour les droits des homosexuels que j’ai commencé à m’engager. Je devais avoir 15 ans, et il y avait une association chrétienne conservatrice, OCA (Oregon Christian Alliance), qui faisait passer des lois locales interdisant aux homosexuels l’accès aux emplois publics. Cette association était soutenue par des groupes néonazis.
Je me suis engagé auprès d’une association LGBT [2. Lesbiennes, gays, bisexuels et trans.], HDC (Human Dignity Coalition), peu de temps avant que leurs locaux se fassent incendier. Quelques jours plus tard, en me promenant dans mon campus avec un ami, nous avons vu une manifestation de l’OCA. À l’époque, j’étais un jeune mec en colère, assez punk. On s’est regardés avec mon pote, et là, bien en face d’eux, on s’est roulé une pelle – ce qui les a autant choqués que mis en rogne. On s’est barrés en courant, morts de rire, puis on s’est séparés. Dès que je me suis retrouvé seul, je me suis fait éclater la gueule par des skins nazis, qui m’ont laissé au sol pissant le sang. Mon père était très homophobe : je savais que si j’allais à l’hôpital, ils l’appelleraient et que j’en prendrais pour mon grade. J’ai donc passé la journée à me cacher et j’ai attendu qu’il se couche pour rentrer chez moi. Mais quand j’ai passé la porte du garage en catimini, je suis tombé sur lui en train de battre sévèrement mon chien. Je crois que tout a changé pour moi ce jour-là. Mon chien ne faisait pas de maths, il ne conduisait pas de voiture et ne parlait pas ma langue, mais à ce moment précis, il était on ne peut plus proche de moi, de ma condition humaine, essayant d’échapper à la fureur de mon père comme je l’avais fait quelques heures plus tôt avec les néonazis.
Un peu plus tard, j’ai rencontré une femme qui militait pour les droits des animaux. Elle m’a parlé des théories sur la libération animale, des animaux non humains et des différentes manières dont ils étaient exploités à cause de leur corps – et souvent à cause de leur féminité (femaleness). C’était la première fois que j’entendais parler de la manière dont les vaches étaient engrossées de force pour produire du lait, puis comment leurs enfants leur étaient enlevés, sans qu’ils puissent boire le lait de leur propre mère. Elle m’a aussi parlé de la façon dont les poules étaient manipulées par l’industrie pour ovuler et produire des œufs, et elle m’a emmené dans une ferme où des vaches étaient inséminées artificiellement, enfermées dans des casiers où des hommes inséraient leur poing dans le vagin. Je me suis rendu compte qu’un viol de masse, structurel, à l’encontre d’animaux femelles est au fondement du fonctionnement de nos sociétés de consommation. C’est après cette expérience que je suis devenu végane, et que j’ai commencé à militer dans des groupes de libération animale.
Petite histoire des mouvements de libération animale au Royaume-Uni
En Angleterre, la Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux) existe depuis 1824, et a reçu l’approbation de la Reine Victoria en 1840 pour devenir la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Il s’agissait principalement de clubs d’aristocrates soucieux du bien-être des animaux, et leurs actions se focalisaient sur des réformes spécifiques ou des campagnes abolitionnistes (Stop à l’utilisation d’animaux en laboratoires, Stop au travail des chevaux jusqu’à la mort dans la rue, Stop à la chasse au renard, etc.).
La British Union Against Vivisection (BUAV) a été fondée en 1898 par Frances Power Cobbes, une essayiste, militante du vote pour les femmes, lesbienne, et socialiste. Elle voulait voir le mouvement contre la vivisection se rapprocher du mouvement ouvrier. Jusqu’ici, la RSCPA parrainée par la reine était une affaire de riches, mais la BUAV reposait sur des bases décentralisées, avec des conseils autonomes dans plusieurs villes, s’inspirant des tactiques employées par les syndicats de l’époque, notamment en ce qui concerne l’agitation publique et la propagande – avec des infokiosques et des débats publics. Le mouvement en faveur des animaux rompait avec la politique bourgeoise pour se donner une dimension plus populaire, incluant des préoccupations sociales. L’idée était de montrer que nous avons le pouvoir de faire cesser l’oppression envers les animaux non humains, et pour cela, il ne suffit pas de parler de droits des animaux en soi, il faut les confronter aux problèmes de société des humains, et donc créer des espaces de discussion qui réunissent les individus autour de ce sujet.
À partir de là, de nombreuses associations ont vu le jour, dont la plus remarquable est la League Against Cruel Sports (Ligue contre les sports cruels), fondée en 1924. Pendant une cinquantaine d’années, elle a surtout été une sorte de club où les riches venaient picoler et discuter de leur dégoût pour la chasse au renard. Puis, dans les années 1950, inspiré par les mouvements antinucléaires ou celui des objecteurs de conscience, un des intellectuels proches de la Ligue, Richard D. Ryder, a proposé d’enfreindre la loi dans la lutte contre les combats d’animaux. Témoin des mouvements de désobéissance en cours en Angleterre, surtout portés par la gauche catholique, il a commencé à faire entrer ce type d’actions dans ses écrits, qui étaient bien diffusés à cette époque.
C’est sûrement ce qui a inspiré Gwendolyn Barter, qui a mené la première action directe contre la chasse en Occident (cela avait déjà eu lieu en Inde par exemple, notamment à l’initiative de la tribu des Bishnoïs). En 1962, Gwen Barter s’est ainsi assise devant le terrier d’un renard, attendant les chasseurs et s’opposant physiquement à leur pratique. Elle a également bloqué un convoi de voitures en route vers la chasse au cerf, avec une pancarte « Le rituel barbare et cruel de la chasse au cerf doit prendre fin ». À cette époque, les jeunes lisaient de la poésie beat, commençaient à écouter de la musique rebelle, et l’un d’entre eux, John Prestige, eut vent de l’action de Gwen Barter. Il a lancé l’idée d’un mouvement de jeunesse, la Hunts Saboteurs Association, et une bande de jeunes à la coupe rockabilly et aux blousons de cuir s’est mise à aller braver les chasseurs sur le terrain.
Le débat s’est peu à peu déporté des seules questions de la chasse et de la vivisection. Un certain Ronnie Lee a alors commencé à parler de la manière dont les animaux chassés expérimentaient la peur, comment ils vivaient dans la terreur d’être poursuivis par des hordes de mecs armés de fusils sans comprendre pourquoi on leur courait après avec des trompettes beuglantes. Il y a des animaux qui mangent d’autres animaux, mais cela se fait sur le plan de la nécessité, pas par simple divertissement, pour le plaisir de la chasse ou une préférence de goût, ce qui crée un élément d’injustice qui n’existe pas entre un loup et un lapin.
En 1972, Ronnie Lee proposa d’organiser des sabotages avant que les chasses commencent, en menant des actions de désobéissance civile et des actions directes anonymes. L’organisation Band of Mercy était née, en référence à une branche de la RSCPA, créée par une militante anti-esclavagiste, Catherine Smithies, pratiquant des actions directes au cours du XIXe siècle. Le groupe de Ronnie Lee était composé de jeunes activistes qui sortaient la nuit pour bousiller des camions de chasseurs avant les battues. Mais après leur première action, Ronnie Lee et un de ses amis, Clift Goodman, ont été jetés en prison.
Ronnie avait été influencé par les groupes politiques de la gauche radicale anglaise, comme l’Angry Brigade[3. Groupe armé britannique d’inspiration communiste libertaire actif entre 1970 et 1972 en Grande-Bretagne. Influencé par l’anarchisme et les situationnistes, ce groupe avait pour cibles des banques, des ambassades ou le siège du Parti conservateur. Au total, 25 attentats lui ont été attribués par la police. Bien qu’une personne ait été légèrement blessée lors d’une action, les dommages se sont la plupart du temps limités à des dégâts matériels.]. En prison, son ton est devenu de plus en plus macho et militaire, il lisait des communiqués et des articles rédigés par les groupes armés des années 1960 et 1970, comme la RAF[4. Fraction armée rouge (Rote Armee Fraktion), organisation allemande d’extrême gauche se présentant comme un mouvement de guérilla urbaine qui opéra en Allemagne fédérale de 1968 à 1998, dans le climat de violence sociale et politique des « années de plomb ».], friands d’imaginaire guerrier, avec des images venues des groupes de libération nationale du tiers-monde ou de l’IRA [5. Irish Republican Army ( irlandais : Óglaigh nahÉireann), nom porté, depuis le début du XXe siècle, par plusieurs organisations paramilitaires luttant par les armes contre la présence britannique en Irlande du Nord.].
Quand Ronnie est sorti de prison, au bout d’un an, il était lassé par le manque de pugnacité de Band of Mercy, et a rebaptisé le groupe ALF (Animal Liberation Front), en référence aux fronts de libération nationaux qui se multipliaient à travers le monde. À partir de là, les choses ont commencé à mal tourner : autant on peut avoir recours aux armes quand on se bat frontalement contre une armée et un État, autant ça ne peut pas servir de modèle absolu pour toute forme de lutte.
À la fin des années 1970, pendant certaines périodes, il y avait près de 400 actions directes chaque nuit sur le territoire britannique en faveur des animaux non humains. Des actions locales à petite échelle, comme des graffitis, des serrures engluées, etc., mais aussi des actions plus organisées qui demandaient plus de détermination. En plus des colis piégés adressés à Margaret Thatcher ou à des partis politiques britanniques, des raids contre des universités ont permis de stopper des programmes de recherche, et des animaux ont été libérés en masse, dans des fermes ou des laboratoires. Scotland Yard a alors commencé à prendre peur et a lancé un programme d’espionnage baptisé ARNI (Animal Rights National Index). Ils ont mis sur écoute des milliers de gens et ont rédigé des rapports pour les polices locales, parce qu’il ne s’agissait plus d’une bande d’excités romantiques, mais de groupes organisés qui portaient atteinte aux intérêts économiques et industriels du Royaume. Un rapport datant de 1982 précisait que les mouvements de libération animale avaient causé plus de dommages économiques que l’IRA. Ils étaient effrayés, le mouvement d’action directe devenait de plus en plus populaire.
Malheureusement, dans les années 1980, le culte du militantisme viril et guerrier a repris du poil de la bête et s’est mis à faire des dégâts, voulant remplacer l’action collective par la radicalité d’un petit nombre. Des actions d’exhumation en représailles aux chasseurs par exemple – la tombe du duc de Beaufort, grand promoteur des combats d’animaux, fut profanée par la Hunt Retribution Squad. Des attentats à la bombe et des colis piégés aussi, notamment du fait d’un groupe autoproclamé Justice Department. Ces actions n’ont pas fait énormément avancer la lutte, mais elles ont eu un grand retentissement auprès du public. Les publications des groupes de libération animale devenaient de plus en plus pessimistes, haineuses et vindicatives, de plus en plus machistes aussi, projetant des images de pouvoir.
Quand on regarde les publications militantes des années 1960, on y voit des animaux en couverture et en pages intérieures, mais dans les années 1980, il n’y restait plus que de jeunes hommes en colère avec des cagoules, une masse à la main. La démonstration de pouvoir et de masculinité a peu à peu remplacé les animaux. Beaucoup de militants qui avaient participé aux actions collectives motivés par un sentiment de compassion, et qui étaient prêts à enfreindre la loi pour la cause animale, se sont alors éloignés du mouvement parce qu’ils ne voulaient pas se retrouver mêlés à des attentats mortels, comme cela a pu arriver. Le soutien populaire au mouvement a donc commencé à s’effriter, mais ce dernier n’a pas pour autant changé de ligne. Les militants se disaient que ce qui comptait était de continuer à sauver des animaux, et que leurs actions se propageraient comme un virus. Le discours s’est empli de désespoir : c’était nous contre le reste de l’espèce humaine.
Je me rappelle le temps où je distribuais des tracts dans la rue, habillé en cambrioleur, tout en noir, avec mon tatouage « vegan mafia », me demandant pourquoi personne n’en voulait. Aujourd’hui, on peut raconter aux nouvelles générations quelles furent les erreurs de la précédente. Trop souvent, on voit des jeunes fascinés par ces images impressionnantes de virilisme dont sont remplis les magazines des droits animaux des années 1980. Ils essaient de se rapprocher de cette image, de recréer ce qui a existé, et cela fait très peur de se dire que les mêmes erreurs peuvent se reproduire encore. En fait, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, le problème reste le même : on ne peut pas penser la lutte selon une confrontation qui opposerait une poignée d’entre nous contre des millions, lesquels millions n’ont jamais entendu parler de droits des animaux ni de libération animale. Cette déconnexion entre le public et les actions menées rend la répression plus facile et acceptable.
De nombreux autres groupes, comme les Animal Liberation Leagues, trouvaient que les actions de l’ALF étaient trop hermétiques, et voulaient socialiser l’action directe. C’est à partir de ce moment que des groupes se sont réunis pour mener des actions dans les laboratoires, avec l’envie de mobiliser les masses, pour exposer au public ce qui était en train de se passer à l’intérieur. Certaines ont rassemblé plus de 5 000 personnes pour libérer des animaux de laboratoire ou saisir des documents de recherche, ce qui faisait très peur au gouvernement. Par ailleurs, ce type d’actions en inspirait d’autres en Australie, Allemagne, Belgique, France, Canada, États-Unis, etc. Il y a même eu un groupe antivivisection au Japon qui a mené plusieurs opérations clandestines. Le concept d’action directe socialisée prenait si bien que même les groupes végétariens britanniques et états-uniens plus modérés, comme la BUAV, recevaient un nombre de demandes d’inscription sans précédent.
Stop Huntingdon Life Science
Ce genre d’actions se sont multipliées, contre Burger King, contre des labos de vivisection, contre des cirques, et les anciens de l’ALF ou d’autres groupes similaires se sont rendus compte que cela avait plus d’effet que se balader avec un fusil à pompe à la main. Mais plutôt que se disperser sur plusieurs cibles, il a paru plus stratégique de focaliser les forces des différents groupes de lutte contre une seule firme. En 1996 au Royaume-Uni, la campagne Consort Beagles a pris pour cible la firme Consort Kennels qui vendait des chiens à des laboratoires de vivisection. Puis il y a eu la campagne Save the Hillgrove Cats contre le dernier vendeur de chats destinés aux labos en Angleterre. Cette lutte ne se limitait pas à la cause animale, il s’agissait de combattre le capitalisme, notamment à travers les banques liées aux transactions de cette entreprise, qui ont été régulièrement attaquées. Le gouvernement local, qui subventionnait les recherches, et la police, qui protégeait l’entreprise, ont également été harcelés. Des vidéos montrant ce qui se passait dans la ferme à chats ont été distribuées aux voisins, jusqu’à ce que des boutiques affichent sur leur vitrine que Christopher Brown, le patron, n’était plus le bienvenu chez eux. En 1998, la RSPCA s’en est mêlée et a obtenu la libération de 800 chats. Après un an, à force de pugnacité, la ferme a mis la clé sous la porte. Cette victoire a été très importante pour le mouvement. Des actions similaires se sont multipliées les années suivantes, et de nombreuses entreprises ont dû abandonner leur petit commerce.
À partir de cette époque, une des principales tactiques utilisée par l’association états-unienne PETA [6. People for the Ethical Treatment of Animals (« Personnes (ou Peuple) pour un traitement éthique des animaux »). Créée en 1980 dans le Maryland, c’est aujourd’hui l’association pro-animale non clandestine la plus importante au monde. En 1989, PETA forme par exemple une coalition internationale composée de plus de 80 organisations de protection animale totalisant plus de 3,3 millions de membres afin d’obtenir la libération des singes d’un laboratoire de Silver Spring (Maryland) et l’appui du Congrès américain. En 2002, PETA persuade 40 sociétés (dont Nike, Reebok et Chrysler) de déclarer un moratoire sur le cuir en provenance d’Inde, où les animaux sont transportés dans des conditions effroyables et écorchés vifs : c’est une perte de quarante millions de dollars pour les producteurs indiens. Parmi les nombreuses critiques adressées à la politique de cette association (sexisme ou racisme, euthanasie des animaux libérés), la principale concerne leur engagement matériel pour la recherche génétique : la fabrication de viande in vitro étant l’un des objectifs affichés par PETA. ] a été de faire embaucher des militants pour espionner les conditions dans lesquelles étaient détenus les animaux à l’intérieur de ces laboratoires, puis de rendre public les exactions dont ils étaient victimes. L’une des vidéos sorties des labos montrait des chiots frappés à coups de poing par des scientifiques excédés par le comportement des chiens, ou alors des singes disséqués vivants. Ce fut l’une des grandes victoires du PETA, qui a donné naissance à la campagne SHAC (Stop Huntingdon Animal Cruelty).
Le laboratoire Huntingdon Life Science (HLS) était au départ divisé en deux : Huntingdon Research Center et Life Science Research. Au début des années 1950-60, dès la construction de ces labos au New Jersey (USA) et en Angleterre, des groupes de lutte se sont constitués pour essayer de les faire fermer. Dans les années 1980, le combat continuait et les labos avaient perdu tellement d’argent et de temps qu’ils ont fini par devenir insolvables – c’est alors qu’ils ont fusionné en HLS. Au milieu des années 1990, un groupe nommé Huntingdon Death Science (HDS) a mené des actions directes et de désobéissance civile contre cette firme. Par exemple, ils se pointaient au milieu de la nuit avec une pelleteuse pour arracher des pans entiers de macadam sur la route menant au site. Après avoir installé un abri dans le trou, une personne s’attachait et s’y enterrait, obligeant tout véhicule qui aurait voulu passer par là à la tuer.
Quand j’ai commencé à militer dans SHAC, HLS était la deuxième plus grosse boîte de contrats de recherche et elle faisait des centaines de millions de dollars de profits. Or son cours boursier est passé d’environ 300 livres dans les années 1990 à 1,75 début 2001, pour finalement se stabiliser à 3 pences au milieu de cette année. Aujourd’hui, il n’y a pas une seule banque qui accepterait de leur ouvrir un compte ! Ils ne peuvent plus trouver de compagnie d’assurance et c’est l’État qui doit se porter garant pour chacune de leurs démarches administratives ou financières. Ils ont même du mal à faire renouveler les contrats avec leur fournisseur de papier toilette. Ceci a mis en évidence le fait que le capitalisme prend ses racines dans les banques, les financiers, les exportateurs, les assureurs, les comptables, les fournisseurs, tous ces métiers qui font qu’une entreprise peut acquérir sa puissance. Aucune des activités n’est indépendante des autres, elles font réseau, et l’idée est donc d’affaiblir la moindre collaboration qui permet à une entreprise de croître.
Notre idée était que si nous pouvions faire fermer une entreprise multinationale, les féministes le pouvaient, la classe ouvrière le pouvait. Nous étions en train de montrer que tous peuvent agir et avoir du pouvoir en forçant les industries à les écouter. Cette idée, le gouvernement britannique l’a très bien comprise, et il ne pouvait la tolérer. La répression s’est donc finalement abattue sur le mouvement. En 2007, l’opération Achilles a notamment mobilisé 700 policiers au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Belgique, jusqu’à la condamnation des trois activistes à l’origine de la campagne à des peines allant de 4 à 11 ans de prison ferme. La plupart des personnes arrêtées au cours de ces opérations de police n’avaient pas enfreint la loi, mais il fallait frapper fort.
On essaie de dire aux jeunes qui commencent à devenir activistes qu’ils peuvent bien sûr avoir un impact, mais qu’ils doivent toujours se préparer à la réponse de leur adversaire. Parce qu’elle viendra nécessairement : l’empire contre-attaque toujours ! Toute l’énergie ne doit pas passer dans l’attaque, il faut en garder pour se défendre. SHAC a eu une trentaine de procès, sous la législation du crime organisé, selon les mêmes procédures que celles utilisées contre la Mafia. Aux États-Unis, les entreprises sont considérées comme des personnes morales qui peuvent poursuivre en justice des individus, en utilisant les lois anticriminelles. Nous avons fait perdre plusieurs millions de dollars à la banque d’investissement qui soutenait HLS, et ils ont dû dépenser des sommes folles pour améliorer la sécurité de leurs placements. Ils ont par exemple commencé à mettre des vitres blindées au rez-de-chaussée de leurs immeubles – alors que nous n’avons jamais utilisé ni même eu de flingues !
Depuis 2006 et en réaction aux activités du SHAC, l’Animal Entreprise Terrorism Act (AETA)[7. Refonte du Animal Enterprise Protection Act voté dès 1992.] est venu se superposer aux lois antiterroristes post-2001 (Patriot Act), en visant spécifiquement les mouvements pour les droits des animaux. L’AETA vise quiconque « cause un dommage ou un blocage aux activités d’une entreprise en lien avec les animaux », « cause des dommages ou la perte d’une propriété réelle ou personnelle » ou « place une personne dans une situation de peur raisonnable d’être blessée [sic [8. « places a person in reasonable fear of injury ».]] ».
Dans le cadre de l’opération que nous appelons « Green Scare »[9. Peur verte, en référence au « Red Scares » (Peurs rouges), désignant les deux périodes d’anticommunisme états-unien (1917-1920, puis le maccarthysme de 1947-1950). La période post-2006 du Green Scare s’est étendue bien au-delà du cas du SHAC.] du FBI, j’ai moi-même été envoyé en prison en 2006 pour avoir prononcé des discours, ce qui normalement n’est pas tolérable aux États-Unis et révolte l’opinion publique, même dans les franges les plus conservatrices. Alors que je faisais partie d’un groupe qui animait un site web avec des contenus favorables aux actions de SHAC, l’État a établi que notre but était de faire fermer HLS, et non de réformer son fonctionnement. Nous passions donc dans la catégorie « terroristes ». Avec six autres camarades, nous avons été arrêtés simplement pour avoir parlé de la possibilité de hacker certaines entreprises – non pas pour avoir mené des actions. Puis nous avons été jugés par un jury antiterroriste composé d’anonymes (à qui on avait dit que leur sécurité serait menacée si nous connaissions leur identité).
Les preuves à ma charge étaient deux discours que j’avais prononcés, prônant la désobéissance civile par des moyens électroniques, en recourant à une vieille tactique appelée « Black Fax », qui consiste à envoyer sans cesse des feuilles noires au numéro de fax visé. La machine se trouvait ainsi saturée et rendue inutile pour la journée, ce qui est assez embêtant quand c’est par là que passent les transactions bancaires et les contrats. J’ai donc été envoyé trois ans en isolement dans une prison de haute sécurité simplement pour avoir évoqué cette tactique, et non pour l’avoir mise en application. Vous imaginez le mec qui arrive au milieu de dangereux criminels en disant « Salut les gars, je suis là parce que j’ai défendu les droits des lapins ». En fait, j’ai surtout été condamné parce que je suis citoyen d’un pays passablement crétin. Depuis 2001, la chasse aux terroristes est ouverte. Or si vous êtes un agent du FBI, que vous êtes payé pour arrêter des terroristes, mais qu’il n’y en a pas tant que ça, que faites-vous ? Vous en créez.
Malheureusement, personne n’était plus là pour nous soutenir : durant cette époque de répression sauvage, beaucoup de militants avaient continué à pratiquer le véganisme par conviction, mais à la maison, loin des engagements collectifs, car ils avaient trop peur de voir ressurgir la violence du passé.
D’un continent à l’autre
Dans les années 1970 et 1980, en France, il y avait aussi des militant.e.s très énergiques pour les droits des animaux, qui avaient formé des unités commando pour mener des raids sur les laboratoires. L’un des plus spectaculaires a eu lieu en 1985 : dix-sept babouins ont été libérés du CNRS lors de l’opération « Greystoke », filmée par des caméras de télévision. Il y avait aussi un groupe qui s’appelait Cat’Pat, dont les membres enlevaient des animaux de laboratoire, en risquant leurs vies pour les soustraire à la violence et à la souffrance. Mais pour le grand public, il s’agissait plutôt d’une croisade morale que d’un mouvement social. Ils étaient vus comme de doux romantiques, ce qui déplaçait le discours d’un combat contre l’industrie à une révolte individuelle.
La longue histoire des mouvements pour la libération animale dans le monde anglo-saxon, depuis la fin du XIXe siècle, a permis à la société d’avoir le temps de penser ces problèmes, de créer des espaces de rencontre pour discuter de la vie animale. Il y a donc eu un développement très lent, avec des allers-retours entre violence groupusculaire et luttes populaires. C’est assez différent de ce qui s’est passé en France, où des groupes de militants inspirés par les Anglo-saxons sont pour ainsi dire sortis de nulle part à la fin des années 1970, sans les deux siècles d’histoire et de discussions sur ces idées, et sans que ces dernières aient eu le temps de se diffuser. Tout d’un coup, ils se sont mis à dire : tout le monde doit devenir végane et il faut arrêter immédiatement toute utilisation des animaux – ce qui est un défi assez costaud pour une culture qui depuis des millénaires pense que les animaux sont sur Terre pour notre usage, notre ventre ou notre divertissement.
C’est pourquoi le travail d’archive que nous menons avec le collectif Talon Conspiracy[10. Notamment chez des figures du mouvement, comme Rod Coronado ou Jonathan Paul qui viennent d’Earth First, organisation radicale écologiste du sud-ouest des États-Unis fondée en 1980.] est primordial. Il contribue à ce que l’histoire du mouvement ne soit pas oubliée ou effacée, à ce que les discussions du passé ne recommencent pas sans cesse à zéro. On ne peut pas faire l’impasse sur une ouverture au public. J’ai pu parler avec pas mal de gens, en France, en Lituanie ou en Estonie où je viens de passer quelque temps. Sans l’expérience propre aux États-Unis ou au Royaume-Uni, les groupes d’activistes européens ont remporté des victoires remarquables en très peu de temps. Mais ils rejouent parfois la violence que les mouvements anglo-saxons cherchent de leur côté à oublier.
Je sais qu’en France, le courant anti-industriel critique le progrès technique et la société industrielle, mais sans militer pour le droit des animaux. Beaucoup de petits éleveurs d’animaux peuvent donc se sentir proches d’une critique de l’industrie, mais continuent à légitimer l’utilité sociale de leur activité et de leurs soins, en disant que, sans leur travail avec les animaux, beaucoup de ces derniers mourraient. Or il y a un temps où les enfants travaillaient très jeunes à l’usine. Beaucoup d’entre eux étaient orphelins dès 3 ou 4 ans. L’argument du patronat pour les faire travailler dans des cheminées d’usine était que, sans cette mise au travail, personne ne s’en occuperait et qu’ils mourraient. C’est une justification plutôt fallacieuse de la domination. De la même manière, on ne peut pas dire qu’il faut continuer à exploiter les animaux sous prétexte de les garder en vie.
Cependant, il est certain que nous ne devrions pas avoir des milliards de poulets de batterie sur la planète, comme au Texas où il y a plus de vaches que d’habitants. Je souhaite évidemment que le nombre de ces animaux élevés industriellement diminue. Certes, moins on aura besoin de les exploiter, moins il y aura d’animaux domestiqués. Mais il y aura toujours des animaux qui vivront, et j’ai envie de les voir de nouveau travailler pour leur propre intérêt et non exclusivement pour le nôtre. J’aimerais les voir reprendre ce que nos discours leur ont ôté. Parmi les pires choses que produit le capitalisme, il y a l’esprit de compétition, le calcul de la valeur en termes financiers, et la notion de hiérarchie. En cultivant une philosophie antispéciste, on participe à la démolition de ce concept de hiérarchie. L’idée n’est donc pas de faire sortir les animaux de nos vies, mais de les laisser libres de nous approcher, de les laisser décider s’ils ont envie de vivre avec nous.
Bref, je comprends la critique anti-industrielle, et il est fort probable que je fasse plus de tort aux animaux en étant végane aux États-Unis qu’en vivant comme un chasseur amazonien. L’industrie qui produit mes fringues, ma nourriture bio, mes transports en commun, tout cela a un impact très négatif sur les animaux – humains comme non humains. Du coup, je n’ai pas grand intérêt à me battre contre celles et ceux qui combattent la société industrielle et essaient de s’en retirer. Les luddites, les primitivistes, les anarchistes écologistes sont bien moins une menace pour les animaux non humains que les grandes entreprises capitalistes. Je n’ai donc pas vraiment envie de dépenser mon énergie combative contre eux. Même si je n’adhère pas à certains de leurs arguments, ils restent davantage mes camarades qu’un mec en costard qui bosse dans une banque.
Quand un espace est si longtemps dominé par les humains, il y a une normalisation des pratiques sociales. Je pense ainsi que les Européens ont une histoire beaucoup plus longue que ceux qui ont émigré aux États-Unis dans leur rapport à l’espace colonisé. La culture européenne est habituée à la terre cultivée par la main de l’homme, et le concept de wilderness [qu’on pourrait traduire par « sauvagité »], très important dans l’histoire du mouvement des droits animaux, lui est étranger. Le langage guide plus la pensée que l’inverse. Les activistes queer utilisent par exemple la notion d’hétéronormativité pour pointer combien notre culture est focalisée sur le concept de relation entre un homme et une femme, renforcé en permanence par tout ce qu’on lit, tout ce qu’on voit. Ils insistent sur le fait qu’il n’existe pas de langage autour des formes de vie queer, autour de quelque chose qui créerait une brèche dans cette hétéronormativité.
Aux États-Unis, quand vous allez dans le Sud, là où la religion contrôle l’école, l’université et le gouvernement locaux, et que vous parlez des concepts queer, c’est souvent très difficile de se faire comprendre. Car toutes les significations à partir desquelles les gens développent leurs idées et prennent leurs décisions ont gardé ces concepts à distance. Sans cette possibilité de mobiliser des concepts, comme celui d’hétéronormativité ou de wilderness, les gens sont perdus et ont recours à d’autres vocables beaucoup plus ancrés comme « contre-nature ». C’est ce mot-là qui vient quand les individus se retrouvent face à une réalité qui ne rentre dans aucune définition connue : l’événement vient se cogner contre les barrières de leur esprit.
Dans le discours ambiant, les femmes sont comparées aux animaux, on les appelle des « chiennes », des « poulettes », de la même manière qu’à l’époque de l’esclavage, les Noirs étaient des « brutes sauvages » sans âme, ayant très peu à voir avec les humains. La comparaison était faite pour les opprimer, les sortir de la société humaine et donc de la puissance politique. En tant qu’animaux, ils n’auraient pas à prendre part aux décisions.
Il est selon moi aussi important de combattre cela que de repenser ce que signifie notre propre animalité. Nous aimons oublier qu’il y a une partie animale en nous, une part de nos désirs et de notre nature qui est mêlée à cette animalité. Beaucoup de pensées philosophiques tentent de trouver la singularité de l’humain par rapport à l’animal : nous serions les seuls à faire ceci ou cela, par opposition aux animaux. Or le langage, le rire, la notion du temps sont présents chez beaucoup d’autres espèces, même quand cela existe sous des formes différentes. Nous sommes des animaux, nous avons aussi une part sauvage en nous, ni domestiquée ni civilisée, qu’il faut assumer, et c’est aussi en tant qu’animaux que nous pouvons demander que nos droits soient respectés.
On compare souvent les luttes des femmes avec celles des racisé.e.s et des animaux non humains, mais je crois que le seul point commun, c’est la vision de l’oppresseur qui impose les mêmes dualités entre Noirs et Blancs, mâles et femelles, humains et tout ce qui n’est pas humain. Ce genre de dichotomies est à combattre en tant que système. Aux États-Unis, on débat en permanence sur les différences entre luttes pour les droits (réformisme) ou pour la libération (abolitionnisme), essayant de déterminer quel est le meilleur angle d’attaque, mais ces querelles ne sont pas les plus intéressantes. En fait, il y a beaucoup de différences entre ces mouvements, et on met généralement tout le monde en colère quand on a recours à des analogies rapides. On essaie souvent par là de s’approprier leur langage et de créer des comparaisons factices pour unifier les oppressions. Il me semble qu’il vaut mieux essayer de parler avec précision des vies animales, sans les comparer aux vies humaines.
Les Indiens d’Amérique du Nord demandent clairement que leurs luttes ne soient pas comparées à celles pour la libération des animaux, de même pour les activistes des mouvements noirs, et spécifiquement ceux qui sont véganes (comme VPOC, Vegan People of Colour). Par ailleurs, distinguer les spécificités de chaque lutte permet de porter de l’attention à chacune, sans les hiérarchiser. J’ai grandi dans des petites villes avec une population très blanche, et je dois avouer qu’à l’époque, je n’avais pas développé une analyse très élaborée sur les liens entre les questions de race et d’impérialisme.
Quand j’étais jeune, j’ai participé à une action contre la chasse des baleines par des Amérindiens. La cause de ces derniers m’importait peu, je ne pensais qu’à sauver les baleines grises, traquées sur la route de leur migration. Aujourd’hui, je me rends bien compte que ce type d’actions crée, dans les groupes humains opprimés, plus d’opposition que d’empathie envers les militant.e.s de la libération animale. Je pense que les changements ne peuvent venir que de l’intérieur d’une communauté, ils ne peuvent pas être imposés depuis l’extérieur. Ces dernières années, de nombreuses actions pour les droits des animaux non humains ont eu lieu dans des pays comme la Chine, l’Inde ou le Vietnam ; ce que les gens ont fait dans leur propre pays n’aurait pas pu aussi bien réussir si l’impulsion était venue des États-Unis ou d’ailleurs.
Notes
| ↩1 | Association pour la libération animale de la région marseillaise < alarm-asso.fr>. |
Little Big Buffalo
L’animal, la marchandise, et les Indiens d’Amérique
Carte réalisée par Quentin Dugay (quentindugay.com)
Au XVIIIe siècle, la mondialisation est déjà à l’œuvre : les empires français, anglais et espagnol se disputent âprement les ressources naturelles du Nouveau Monde.
Si la vision de la conquête héroïque de l’Ouest a encore la peau dure, une nouvelle histoire s’impose depuis une vingtaine d’années. Celle où les Amérindiens cessent d’être un bloc radicalement autre, rarement sujet, ne pouvant que résister ou céder face aux assauts des colons. On doit aux éditions Anacharsis la traduction de deux ouvrages porteurs de cette évolution historiographique : Le Middle Ground de Richard White et L’Empire comanche de Pekka Hämäläinen. On y découvre des peuples colonisés résolument acteurs des changements de l’Amérique du Nord, mais emportés par des mutations techniques, économiques, culturelles et environnementales dont l’ampleur et la rapidité les dépassent fatalement.
Cet article est le troisième d’une série de six publications issues du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », et publiées en ligne à l’occasion de la sortie du nouveau numéro, « Ch’val de course ».
Télécharger l’article en PDF.
« Le buffalo […] accomplissait sa destinée auprès des indiens en leur fournissant tout ce dont ils avaient besoin : de la nourriture, des habits, un toit, des traditions et même une religion. Mais le buffalo n’était pas vraiment adapté à la civilisation blanche en marche. […] c’était un désaxé (misfit). alors il devait disparaître1 Toutes les citations en exergue sont tirées de Tueur de bisons, Anacharsis, 2010. Il s’agit d’un entretien réalisé dans les années 1940 avec Frank Mayer (1850-1954), qui courut le bison à … Continue reading. »
Frank Mayer
Coureur [2. Bien qu’armés d’un fusil et tirant à bonne distance, les chasseurs occidentaux de bison se désignent eux-mêmes par le terme de « coureurs », en référence à la technique de chasse des Indiens des Plaines.] de bison
Au début du XIVe siècle, un cycle humide de cinq cents ans commence et l’herbe se remet à pousser drue sur les Grandes Plaines d’Amérique du Nord. Le Bison bison n’en attendait pas plus pour repeupler les quelque trois millions de km2 d’abondance qui s’offrent à lui. La concurrence n’y est pas féroce : à la fin de la dernière grande glaciation, il y a 10 000 ans à peu près, les trois quarts des grands mammifères du coin ont disparu. La faute au réchauffement climatique, sans doute, et aux humains, peut-être, qui avaient débarqué quelque 3 000 ans plus tôt ; le Bison bison n’en sait rien, il n’y pense pas, de toute façon.
Bien sûr, le temps de cette mégafaune du pléistocène est révolu, le Bison bison n’a pas la taille ni les cornes de son fier ancêtre Bison latifrons, mais il fait ce qu’il peut ; tout seul sur les prairies, il repeuple. Il passe l’été dans les plaines riches en herbe, et l’hiver il rejoint les vallées et les collines légèrement boisées, à l’abri du froid. Il n’est peut-être pas bien gros, mais toujours bien assez pour décourager la plupart des prédateurs. Dans les Plaines du Sud, les bisons sont bientôt entre sept et neuf millions, et pas loin de trente millions sur l’ensemble des plaines [3. Dan Flores, « Bison Ecology and Bison Diplomacy : The Southern Plains from 1800 to 1850 », The Journal of American History, Vol. 78, no 2, 1991.].
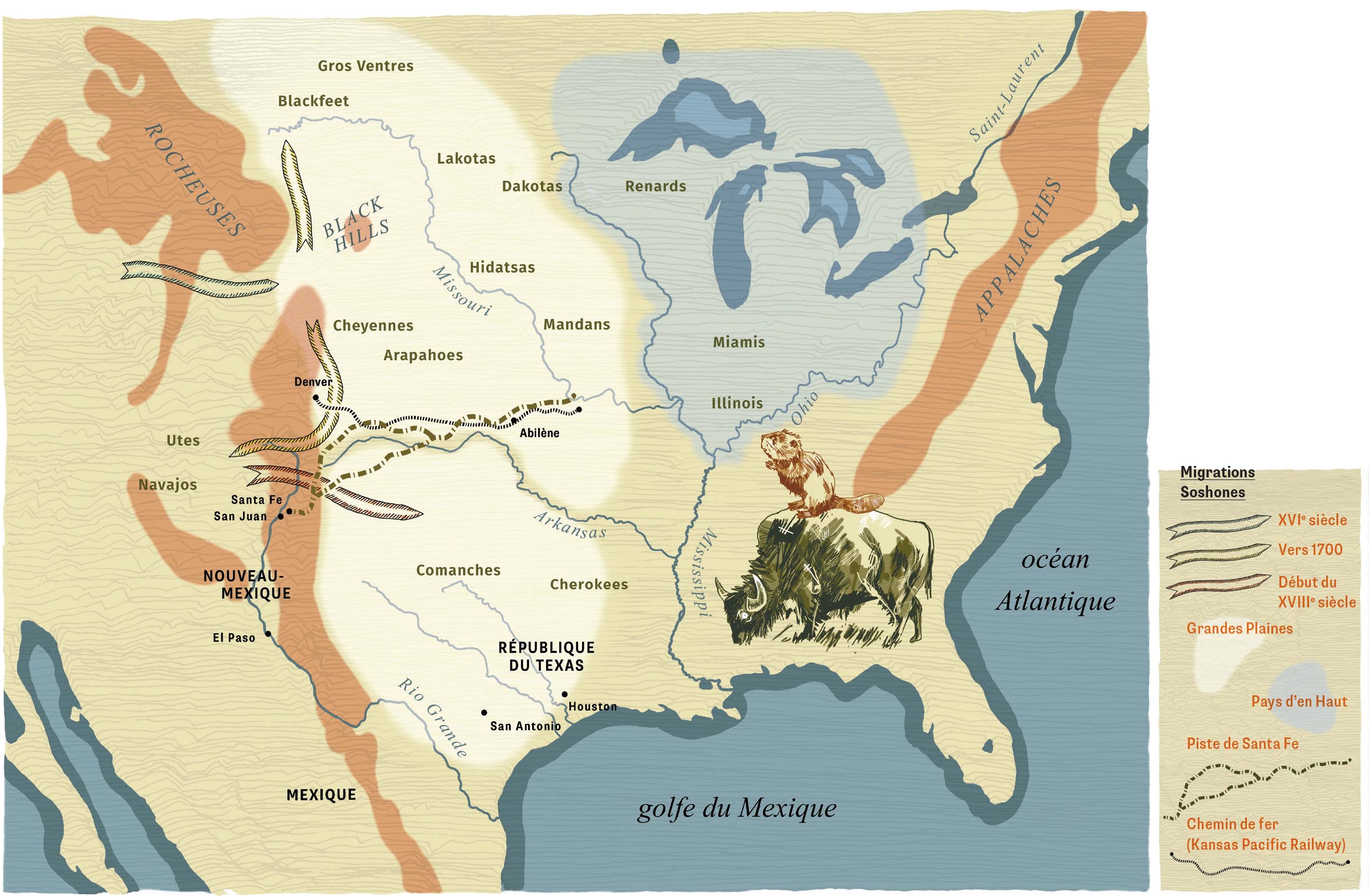
Sud
Au XVIe siècle, les Shoshones vont à pied. Cela ne les empêche pas d’occuper la quasi-totalité du nord-est du Grand Bassin nord-américain, jusqu’aux marges des Grandes Plaines. Ils ont adopté un cycle annuel très précis, adapté aux conditions offertes par les différents environnements qu’ils traversent : montagnes et plaines semi-arides, rives de lacs ou marécages. Quand le temps est clément, ils chassent à l’arc (l’antilope, le cerf et le mouton sauvage), ils pêchent du saumon, ramassent des noix ou des tubercules. Les rigueurs de l’hiver les poussent tous les ans à emprunter la Passe du Sud vers le versant oriental des Rocheuses. Là, dans les sillons entre les montagnes et les prairies, à l’abri du froid, ils chassent le bison et l’élan [4. Pekka Hämäläinen, L’Empire comanche, Anacharsis, 2012, pp. 51-54.].
Aux alentours de 1600, les Shoshones entrent de plus en plus souvent sur les Grandes Plaines pour la saison des chasses. Pour eux comme pour d’autres tribus plus au nord, les campagnes les plus fructueuses sont les grandes chasses collectives. Il s’agit d’entraîner un troupeau vers de la neige poudreuse, des glaces fragiles ou un précipice, en l’encerclant ou en le repoussant vers de gigantesques entonnoirs patiemment érigés à partir de troncs d’arbres et de pierres. Cela demande une organisation considérable, ne serait-ce que pour rassembler un nombre suffisant d’individus habituellement dispersés. Malgré tout, l’abondance de gibier permet aux Shoshones d’entrer dans une ère de prospérité.
Nord
Au même moment, en Europe, les chasses abusives ont éradiqué le castor scandinave. Privés de matière première de qualité, les chapeliers doivent se rabattre sur le feutre de laine de mouton. Toutefois, ce dernier est trop grossier, les chapeaux ne sont pas vraiment étanches et leur couleur reste désespérément terne. Il y a bien les trappeurs russes qui approvisionnent les marchés depuis la Sibérie, mais les coûts du transport terrestre sont trop élevés. Fatalement, les chapeaux hollandais s’avachissent, et dans le reste de l’Europe l’engouement pour le feutre s’affaisse. En un mot, c’est l’angoisse [5. Timothy Brook, Le Chapeau de Vermeer, Petite Bibliothèque Payot, 2012, p. 67-68.].
Heureusement, les pêcheurs européens officiant dans l’Atlantique découvrent, à l’occasion de pêches à l’embouchure du Saint-Laurent, que les forêts avoisinantes regorgent de castors et que les trappeurs indigènes sont disposés à vendre les peaux à bon prix. Pour les Français, qui cherchent à installer des colonies dans la vallée du fleuve, c’est une aubaine ; d’autant que l’arrivée des premières peaux en provenance du Canada déclenche en 1580 un véritable phénomène de mode en Europe : le prix du feutre de castor explose.
Sud
« Et ils n’appartenaient à personne. Si tu les tuais, ce qu’ils rapportaient était à toi. C’était de l’or sur pattes, disaient les Anciens, et un jeune gars qui avait des tripes et de la jugeote pouvait faire fortune. »
Frank Mayer
À la fin du XVIIe siècle, les Shoshones vont toujours à pieds, mais ils ont déjà commencé à réorganiser leur société autour du bison. Ils se reposent de plus en plus sur l’animal pour se nourrir, se loger ou se vêtir, et ont de fait développé une nouvelle culture et un ensemble de rituels adaptés. Ils doivent à présent se déplacer périodiquement pour suivre les troupeaux, ce qui les oblige à réduire au strict minimum les biens qu’ils transportent eux-mêmes ou qu’ils disposent sur des travois tirés par des chiens, guère capables de porter plus de quarante kilos. Les femmes ont volontiers plusieurs compagnons, et les personnes les plus faibles sont régulièrement abandonnées à leur triste sort lors des changements de camp, si bien que la population totale reste de taille modeste, sans doute autour de 5 000 individus. Cependant, les Shoshones s’adaptent parfaitement à cette nouvelle vie semi-nomade, et les troupeaux de bisons semblent suffire à combler la majorité de leurs besoins.
Les Apaches, de leur côté, ont la vie plus dure. Une série de sécheresses au milieu du XVIIe siècle a décimé les troupeaux des Plaines centrales, les rendant méfiants à l’égard d’un mode de subsistance si aléatoire. En outre, la variole, qui fait rage dans le Nouveau Monde, est susceptible de porter un coup fatal à n’importe quelle tribu. Aussi les Apaches font-ils le choix de diversifier leur économie : sous l’influence notamment des réfugiés pueblos [6. Les Pueblos étaient un peuple autochtone établi au Nouveau-Mexique. Après avoir été assujettis par les Espagnols au début du XVIIe siècle, ils se révoltèrent en 1680 et en 1696, faisant à chaque fois main basse sur les biens espagnols, et notamment sur un grand nombre de chevaux. Nous en reparlerons.], ils réalisent des ouvrages d’irrigation dans les lits des rivières, construisent des maisons en pisé à toit plat, et se mettent à cultiver la terre. Dès la fin du siècle, ils prospèrent sur les plaines, exerçant de fait une pression accrue sur le territoire shoshone [7. Voir L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 65-66.].
Ces derniers, stoppés dans leur conquête de l’Est, se séparent en deux groupes : le premier part vers le nord chercher des bisons et des noises aux Blackfeet et aux Gros Ventres, tandis que le second prend le chemin du Sud entre les Grandes Plaines et les contreforts des Rocheuses, à distance respectueuse de leurs envahissants voisins.
Les Shoshones partis vers le sud rencontrent bientôt les Utes. En échange de soutien militaire, ces derniers initient leurs nouveaux alliés à leur territoire et à leurs pratiques. Ils leur donnent également un nouveau nom : « Kumantsi », qui deviendra plus tard « Comanches ». De l’automne au début du printemps, ils restent dans les contreforts des Rocheuses et dans les régions boisées pour chasser l’antilope et le lièvre, cueillir des baies, des noix et des racines. Au printemps, ils pénètrent dans les plaines en grands groupes, dans la haute vallée de l’Arkansas, pour y chasser le bison, et l’été est consacré aux raids menés en territoire espagnol, au Nouveau-Mexique. Par ailleurs, les Utes introduisent les Comanches sur les marchés de Taos et de San Juan, où ils échangent des peaux, de la viande et des esclaves navajos contre du maïs, des poteries et des couvertures en coton. Et par dessus tout, contre des chevaux [8. Ibid., p. 57.].
Après leur révolte de 1680, les Pueblos se sont emparés d’un grand nombre de montures espagnoles qui ont rapidement alimenté un commerce soutenu avec les autres peuples des Plaines. Issus de la race Barbe d’Afrique du Nord, ces chevaux petits et résistants étaient adaptés à la vie des Plaines du Sud relativement arides, mais fournissant un fourrage abondant presque toute l’année. Tout comme le bison d’Amérique 9 000 ans plus tôt, le cheval investit naturellement une des nombreuses niches écologiques laissées vacantes par l’extinction du pléistocène [9. « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité.].
Les Crees et les Assiniboines appellent le cheval « great-dog », les Sarcees « seven dogs » et les Lakotas « medecine-dog » : l’omniprésence du chien dans les sociétés nomades des plaines facilite l’incorporation du cheval dans leur quotidien, mais les Indiens comprennent immédiatement que ses capacités hors du commun leur ouvrent de nouvelles perspectives. Et pour cause, un cheval peut transporter 100 kg sur son dos et traîner 150 kg avec un travois, soit quatre fois plus qu’un chien. Il permet de se déplacer plus vite et plus loin, en emmenant plus de peaux, de viandes ou d’objets ménagers. Son adoption lève l’ancienne limitation sur la taille des tipis et étend considérablement les territoires de chasse – mais sa plus grande qualité en tant qu’animal de bât reste son alimentation. Tandis que le chien consomme une quantité non négligeable de viande issue des chasses, le cheval puise directement dans une ressource jusque-là imparfaitement exploitée : l’herbe des plaines.
Tout va très vite pour les Comanches en ce début de XVIIIe siècle, notamment grâce à leur exceptionnelle capacité d’adaptation. L’alliance avec les Utes leur donne accès à des armes à feu, des couteaux, des poinçons, des aiguilles ou encore des chaudrons en fer. Ils basculent en une génération de l’âge de la pierre à l’âge du fer. Leur nouvel équipement, plus efficace et plus résistant, révolutionne la plupart de leurs tâches quotidiennes : chasse, préparation des peaux, cuisine, couture, etc. Pourtant, c’est avant tout l’intégration de la culture équestre qui les fait basculer dans une nouvelle ère.
L’emploi du cheval bouleverse leurs pratiques de chasse. En longeant au grand galop les troupeaux de bisons en fuite et en tirant sur des animaux soigneusement choisis, un groupe limité de chasseurs peut à présent abattre de 200 à 300 bisons en moins d’une heure, soit bien assez pour vêtir et nourrir plusieurs centaines de personnes pendant plus d’un mois [10. Pekka Hämäläinen, « The First Phase of Destruction Killing the Southern Plains Buffalo, 1790-1840 », Great Plains Quaterly, article 2227, 2001.]. En outre, le rayon d’action étendu du cheval évite aux Comanches d’avoir à suivre au plus près les troupeaux, et sa capacité de transport leur permet d’accumuler des réserves conséquentes de viande séchée, constituées pendant une saison de chasse allongée par le climat favorable du Sud. Les avantages sont si évidents pour leur peuple qu’ils décident de réorganiser toute leur économie de subsistance autour du bison. La société comanche devient ainsi l’une des rares dans l’Histoire à se reposer aussi largement sur une ressource alimentaire unique. Cette mutation fait littéralement exploser son apport calorique global, engendrant une progression démographique rapide et soutenue, et par conséquent une véritable « comanchérisation » des Plaines du Sud. Ainsi libérés du souci de l’approvisionnement en produits de première nécessité, les Comanches peuvent se consacrer au développement d’un véritable empire commercial et militaire.
L’accès aux seuls biens manufacturés du Nouveau-Mexique ne leur offrant que de maigres perspectives, ils se séparent de leurs alliés Utes et pénètrent durablement dans les plaines, notamment dans la haute vallée de l’Arkansas, lieu important du transit de peaux et de viandes déjà exploité par les Français depuis 1700 avec les Apaches [11. L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 64.]. Toutes les conditions y sont réunies pour opérer une conversion totale vers le nomadisme équestre, soit plus qu’une capacité de déplacement accrue : « Le cheval était aux Comanches ce que les bateaux, les fusils et l’or étaient aux puissances impériales européennes – un moyen de transport qui réduisait les unités spatiales à une taille autorisant la conquête, une arme de guerre qui leur permit de jouir d’un pouvoir beaucoup plus grand que leur nombre aurait pu le suggérer, et un bien très recherché sur lequel un empire commercial pouvait être bâti[12. Ibid., p. 386.]. »
L’accès privilégié au cheval favorise très vite l’épanouissement de presque tous les peuples des Grandes Plaines. Jouissant d’un environnement propice, les Comanches développent une activité pastorale de plus en plus soutenue qui requiert des déplacements incessants pour fournir de nouveaux pâturages aux troupeaux. Cela pénalise directement l’économie nomade spécialisée dans le bison – qui, elle, requiert des périodes d’immobilité. Au milieu du XVIIIe siècle, les Comanches adoptent une économie mixte de chasse et de pastoralisme, devenant moins des chasseurs à cheval que des éleveurs de chevaux chassant par ailleurs.
Ils deviennent des éleveurs talentueux capables d’assurer une augmentation soutenue de la taille de leurs troupeaux domestiques. La reproduction sélective leur permet aussi de maîtriser l’endurance, la rapidité, la taille ou la robe de leurs bêtes, si bien que le mustang comanche finit par être largement apprécié comme un cheval sûr, rapide, agile, bien proportionné et d’humeur égale [13. Ibid., p. 394-397.].
Nord
Au tournant du XVIIIe siècle, les récentes guerres contre les Iroquois ont jeté les Algonquiens du Pays-d’en-Haut [14. Le Pays-d’en-Haut est la région à l’ouest de la vallée du Saint-Laurent, correspondant à peu près au bassin des Grands Lacs, jusqu’à la vallée de l’Ohio au sud. Il est peuplé par une grande variété de tribus de langue algonquienne comme les Miamis, les Ojibwés, les Illinois et les Renards.] toujours plus à l’ouest. Ces migrations et la concentration de population ont perturbé leur cycle habituel d’abondance et de disette. L’intrusion – bien que difficile – du commerce de fourrure a épuisé le gibier dans certaines régions, rendant les campagnes de chasse plus rudes et risquées. Dans ce contexte, la survie reste la priorité et le commerce de fourrure est loin de constituer une sphère à part dans leur organisation : il est complètement intégré à leur économie de subsistance. Les Algonquiens préfèrent choisir des terres propices à l’agriculture et offrant un gibier plus abondant. Peu leur importe que ces terres soient pauvres en castors, puisqu’ils restent largement indépendants du commerce de sa peau.
Même sur les Plaines du Nord, cette indépendance des Indiens restera une épine dans le pied des commerçants européens jusqu’au milieu du siècle suivant. C’est à ce moment que l’acquisition du cheval par les Shoshones et les Têtes Plates, et leur entrée sur les territoires des Blackfeet et des Gros Ventres, poussent ces derniers à rechercher désespérément des chevaux et des armes à feu. Cela marque le début d’un commerce d’armes très actif avec les Anglais et les Français. La Hudson’s Bay Company et la North West Company sautent sur l’occasion et construisent plusieurs avant-postes dans les années 1780, transformant les Plaines du Nord en un vaste district du commerce de fourrures [15. Ibid.].
Incapables de faire prospérer les chevaux dans de trop rudes conditions climatiques [16. L’hiver de 1801-1802, par exemple, laissa les Blackfeet et les Gros Ventres pratiquement sans chevaux. Voir ibid.], les Indiens des Plaines du Nord sont confrontés à une pénurie chronique qui les rend de plus en plus dépendants du commerce européen. Ce dernier se nourrit d’ailleurs des cinquante années de guerre – les horse wars – qui s’ensuivent, ravageant les tribus les plus faibles, incapables de constituer un troupeau suffisant, et régulièrement exposées aux microbes apportés par les colons.
Sud
« L’aventure ? Pas plus que tirer un bœuf dans un enclos. »
Frank Mayer
Au sud de l’Arkansas, les températures sont certes plus clémentes et le pâturage plus abondant, mais le succès des Comanches dans les Plaines n’aurait pas été si éclatant sans le pillage incessant des régions limitrophes. Ils utilisent les raids comme un véritable moyen de production destiné à alimenter leur économie pastorale. Dès la fin des années 1730, ils combattent armés de longues lances à pointe de métal et de petits arcs adaptés à la guerre montée, et ils ont adopté d’épaisses armures de cuir pour se protéger, eux et leurs montures. Leur adresse, associée à la grande mobilité apportée par l’utilisation du cheval, rend les Comanches quasiment insaisissables [17. L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 82.].
Le pillage des colonies jouxtant les Plaines du Sud permet aux Comanches d’augmenter leur capacité à commercer sans réduire les pâturages disponibles pour leurs troupeaux. Les raids procurent aussi des chevaux déjà domestiqués, c’est-à-dire une marchandise prête à la vente, contrairement aux mustangs, dont le dressage requiert beaucoup d’investissement de la part des guerriers. Sanaco, un chef des Comanches de l’Est, refuse par exemple de vendre son mustang favori aux Américains sous prétexte que ce serait « une calamité pour toute sa bande, qui [a] souvent besoin de la rapidité de cet animal pour assurer la réussite d’une chasse au bison. En outre, dit-il, je l’aime énormément [18. « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité.] ».
La première victime des razzias comanches est le Nouveau-Mexique, qui se trouve étranglé économiquement à la fin des années 1770. La colonie espagnole, qui possédait quelque 7 000 chevaux en 1757, n’en a plus assez en 1775 pour ses soldats, incapables dès lors d’assurer sa défense. La terreur devient telle que les agriculteurs refusent régulièrement de s’éloigner des places fortes pour travailler la terre. Le colon se retrouve lui-même colonisé, non par une occupation effective de ses terres, mais par l’utilisation de celles-ci comme une ressource qu’on peut ponctionner à l’envi. L’Empire espagnol est à ce point humilié qu’il doit alimenter les foires commerciales du Nouveau-Mexique en produits divers – cigarettes, ponchos, lainages et sacoches – afin de racheter ses propres mules, chevaux ou esclaves aux Comanches. Il aura beau décréter un embargo sur la vente d’armes à feu aux Indiens, ces derniers le contourneront en utilisant le nœud commercial du haut bassin de l’Arkansas et les échanges avec les Grandes Plaines du nord et de l’est pour établir un flux substantiel d’importation d’armes à feu. Dès 1767, les officiels espagnols s’inquiètent de l’éventualité que les Comanches soient mieux armés que leurs propres soldats [19. Ibid., p. 132.].
Alors qu’ils comptaient moins de 1 500 âmes en 1726, les Comanches sont déjà plus de 10 000 en 1750 et sans doute près de 24 000 au début des années 1780. Ils établissent à cette époque un nouveau lien commercial avec la vallée inférieure du Mississippi et la Louisiane espagnole, alimenté par le pillage systématique du Texas. Les raids y seront si intenses que, vers 1810, l’État est pour ainsi dire déserté : les industries du cuir, du textile et du sucre périclitent, et de nombreux troupeaux de bêtes non marquées divaguent, faute de cavaliers pour les surveiller [20. Ibid., p. 173-174 et 305.].
La puissance militaire et économique des Comanches est directement liée à leur richesse en chevaux. Au début du XIXe siècle, ils disposeront de près de quatre chevaux par individu, soit entre 90 000 et 120 000 bêtes excédentaires. Cette situation quasi monopolistique sur les Plaines du Sud leur assurera une grande stabilité, et surtout l’indépendance par rapport aux puissances européennes et américaines, voire une insolente domination sur ces dernières.
Nord
« Là où on trouvait le buff[21. C’est-à-dire « le buffalo », le bison.], on était les rois de tout ce qu’on pouvait voir – et tuer. C’était une règle généralement bien établie qu’aucun homme ne pouvait rentrer dans un troupeau qui était en train d’être travaillé par son premier découvreur. »
Frank Mayer
Dans le Pays-d’en-Haut, comme dans le reste du continent, « les Européens ont altéré à la fois l’objet, l’intensité et la forme du commerce [22. « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité.] ». En s’appuyant sur une tradition à la peau dure de propriété commune des biens et des terres, les Indiens permettaient à toute population affamée de chasser le gibier là où elle le trouvait, y compris le castor… mais les fourrures destinées au commerce échappent dès le début du XVIIIe siècle à ce régime. La question de la légitimité à chasser sur un territoire donné devient dès lors pointilleuse et génère nombre de conflits. Elle accroît également d’un cran la pression sur le gibier : les fourrures devenant de plus en plus convoitées, les chasseurs se mettent à négliger les règles élémentaires permettant aux populations d’animaux de se renouveler. De plus en plus de jeunes castors ou de femelles parturientes sont tués, avec bien souvent pour seule justification la certitude qu’un autre ne se priverait pas de le faire.
Une telle évolution est principalement due au grand attrait des Algonquiens pour les produits manufacturés européens. À la fin du XVIIIe siècle, parmi les vêtements qu’ils portent, les Indiens du Pays-d’en-Haut ne fabriquent pratiquement que leurs mocassins, et encore à l’aide de poinçons européens. Outre les armes des guerriers, la quasi-totalité des ustensiles ménagers est d’origine européenne : couteaux, marmites, outils de couture, bols et cuillères en bois[23. Le Middle Ground, ouvr. cité, p. 650-651.]… Dans de telles conditions, certains décideurs du Vieux Continent sont portés à croire que la dépendance des Indiens vis-à-vis des colons est totale. Cependant, tout au long du XVIIIe siècle, ils sauront tirer profit de la concurrence entre Français et Anglais, et des enjeux stratégiques de la région pour lutter contre les logiques du marché. Par ailleurs, ils n’ont pas oublié du jour au lendemain leurs anciennes pratiques et restent capables, en cas de désaccord sur les prix par exemple, de se passer des produits européens : les Piankashaws en 1780, ou encore les villageois de la Wabash en 1782 se remettent à chasser avec arcs et flèches, et à porter des peaux de bisons en guise de couverture.
Sud
« De deux choses l’une : soit les buffalos doivent disparaître, soit les Indiens doivent disparaître. C’est seulement quand l’Indien sera absolument dépendant de nous pour tous ses besoins qu’on pourra le maîtriser. »
Un commandant de l’armée américaine, vers 1875
Incapables de maîtriser militairement les insaisissables Comanches, les Espagnols s’en remettent à la diplomatie et au commerce. En 1786, le gouverneur de la Nouvelle-Espagne, Bernardo de Gálvez, diffuse ses Instructions pour gouverner les Provinces Intérieures de la Nouvelle-Espagne, qui définissent la nouvelle stratégie coloniale. Les Instructions prévoient les moindres détails : les fusils échangés doivent par exemple avoir « des culasses fragiles et être dans un acier moins bien trempé », avec de longs canons les rendant « peu maniables lors des longues chevauchées, ce qui entraînera des dommages constants et des besoins répétés de réparation ou de remplacement ». Gálvez espère ainsi que lorsque les Indiens auront « commencé à perdre leur habileté à l’arc, […] ils [seront] contraints de rechercher notre amitié et notre aide [24. L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 223-224.] ».
Malheureusement pour les colons, l’étendue du réseau commercial des Comanches leur permet bientôt de s’approvisionner en fusils de qualité auprès des Anglais du Missouri, grâce à leurs alliés Panismahas. Toutes les tentatives espagnoles resteront inefficaces tant que leur nouveau mode de vie assure aux Indiens la supériorité militaire et un rayonnement commercial sans égal sur les Plaines du Sud.
En déclarant, en 1793, qu’« aucun homme n’a le droit de vivre de la chasse sur des terres susceptibles d’être cultivées » et que si « les sauvages ne peuvent être civilisés et n’abandonnent pas leurs occupations, ils dépériront et disparaîtront du fait même de leur obstination », Benjamin Lincoln [25. 1733-1810, tout premier Secrétaire à la guerre des États-Unis, de 1781 à 1783 (À ne pas confondre avec Abraham Lincoln, futur président des États-Unis). La citation vient du Middle Ground, ouvr. cité, p. 636.] fait montre d’une méconnaissance profonde de la variété des modes de vie des Indiens d’Amérique du Nord. Il s’obstine à appliquer la vieille équation sauvage = chasse / civilisé = agriculture. Pendant près d’un siècle, d’autres après lui nourriront et justifieront leur foi en la fin prochaine et nécessaire des civilisations autochtones avec des arguments similaires.
Du côté de la Nouvelle-Espagne, on craint que ce soit surtout les colons frontaliers qui « dépériront et disparaîtront » si les Comanches continuent sur leur lancée. À la fin du XVIIIe siècle, les autorités militaires ordonnent au gouverneur du Nouveau-Mexique de trouver un moyen de les inciter à s’installer dans des villages d’agriculteurs pour qu’ils oublient la chasse. Lors d’une période de paix relative, les Espagnols iront jusqu’à construire – en vain – des maisons en adobe munies d’enclos pour les moutons et les bœufs dans l’espoir d’y voir les Comanches se transformer en fermiers sédentaires. La méfiance des Indiens vis-à-vis d’un mode de vie sédentaire [26. L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 214-216.] s’explique par le destin tragique de ceux qui, comme les Apaches, ont fait ce choix, et se sont ainsi retrouvés à la merci des raids, des sièges, et surtout de la variole qui décime par exemple un tiers des Hidatsas, la moitié des Arikaras et presque tous les Mandans lors de l’épidémie de 1837-1838 [27. « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Culture », art. cité.].
Nord
« Le massacre était peut-être une chose scandaleuse et inutile. Mais c’était aussi une chose inévitable, une nécessité historique. »
Frank Mayer
Le castor presque disparu, les chasseurs du Pays-d’en-Haut se tournent vers le cerf à queue blanche [28. Le « buck », qui à l’époque correspond à la valeur d’une peau de cerf, désigne encore aujourd’hui un dollar.]. Quand ce dernier se fait rare à son tour, les commerçants se mettent à accepter les « menues pelleteries » – c’est-à-dire les fourrures des ratons laveurs, des daims ou encore des ours – jusque-là peu prisées. Durant tout le XVIIIe siècle, l’équilibre des forces coloniales en présence dans la région a beau changer, le commerce détermine toujours plus les pratiques de chasse, et le gibier disparaît.
Au tournant du XIXe siècle, les Indiens se voient obligés de compléter leur activité de chasse avec l’élevage des animaux domestiques – chevaux, bétail, porcs et volailles [29. Le Middle Ground, ouvr. cité, p. 656.]. Cette nouvelle économie mixte bouleverse leur cycle migratoire, et le gibier ne peut plus repeupler les régions habituellement laissées à l’abandon pendant une partie de l’année. Les chasses sont de moins en moins fructueuses, et la conversion est loin de convaincre tout le monde. Certains prophètes expliquent même la disparition des animaux sauvages par l’adoption des animaux domestiqués. En 1803, une vieille Indienne interprète quant à elle la situation ainsi : « La conversion fait de l’Indien un être “domestiqué”, et, une fois “domestiqués”, les Indiens peuvent être massacrés par les Blancs comme du bétail [30. Ibid., p. 682]. »
Sud
« J’ai appris que le dépeçage était un boulot dégueulasse, désagréable, pénible et répétitif. Évidemment, j’ai jamais dépecé moi-même. J’étais le chasseur, le tueur, et le dépeçage c’était pour les dépeceurs. J’avais de la peine pour ces pauvres gars […]. Mais c’était leur rôle dans la partie. »
Frank Mayer
En entrant dans les Plaines, les Comanches perdent les deux tiers de leurs connaissances botaniques [31. « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité.]. Dès 1750, la cueillette a perdu de son importance, et le poisson est devenu tabou ; la volaille reléguée au rang d’alimentation alternative. Le régime alimentaire des Comanches devient extrêmement riche en protéines et pauvre en glucides. Ce déséquilibre nutritionnel chronique cause des fausses couches, des insuffisances pondérales à la naissance et des altérations cognitives. L’intensification de leur économie de chasse devient dès lors pour eux une question de survie : il leur faut assurer un accès aux marchés pour pouvoir échanger leur excédent de viande, de graisse et de peaux contre des produits agricoles dans les foires commerciales [32. Voir « The First Phase of Destruction », art. cité.]. Le passage à une économie principalement pastorale ne change rien au problème : la pérennité de l’empire comanche repose sur son aptitude à maintenir ses troupeaux de chevaux comme accès aux produits qui lui manquent.
Ce besoin vital est à la base de toutes les transformations que connaît la société comanche au cours du XVIIIe siècle. La première concerne leur unité politique de base : le numunahkahnis, ou la ranchería en espagnol. Le cheval a besoin d’environ 10 kg d’herbe par jour [33. L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 389-390.], et il est relativement difficile en ce qui concerne son pâturage, si bien qu’un troupeau de mille têtes a besoin d’une zone d’au moins trois hectares par jour. Par conséquent, les Comanches sont rapidement obligés, dès le début du siècle, de se scinder en de nombreuses bandes de taille réduite. Ces groupes sont constitués de vingt à plusieurs centaines d’individus sous la houlette d’un chef unique, le paraibo, qui en assure la cohésion. Cette unité sociale de base est une des explications de la flexibilité et de la résilience de la société comanche : « Vue de l’extérieur, cette nation constituait une entité amorphe sans centre identifiable avec lequel négocier – ou susceptible d’être supprimé – et sans structure interne explicite qui aurait pu rendre sa politique extérieure prévisible. De fait, la puissance des Comanches existait non malgré leur organisation sociale informelle voire atomisée, mais bien grâce à elle [34. Ibid., p. 436.]. »
La transformation la plus violente et radicale a trait à l’organisation du travail, au sein même des rancherías. Une famille comanche possède en moyenne trente-cinq chevaux et mules, soit cinq à six fois plus que les besoins basiques en nourriture et transport [35. Voir « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité.]. L’excédent accroît considérablement le pouvoir commercial des Comanches, mais exige également de consacrer de plus en plus de temps à la surveillance et au soin des troupeaux, leurs principales activités à partir de 1800. Certes, l’adoption du cheval a transformé la chasse au bison en une activité extrêmement efficace, libérant une grande quantité de force de travail, néanmoins, les nouveaux débouchés commerciaux requièrent toujours plus de main-d’œuvre dédiée aux tâches pastorales et à la préparation des peaux. La polygynie [36. La polygynie est la relation conjugale où les hommes ont plusieurs femmes, la polyandrie celle où les femmes ont plusieurs hommes. La polygamie étant le nom générique pour le fait d’avoir plusieurs conjoints, hommes ou femmes.] et l’esclavage leur fournissent la solution.
La nouvelle organisation productive repose sur une division stricte du travail en fonction du sexe et de l’âge : ce sont des hommes qui ont à leur charge la planification stratégique – concernant les déplacements et les zones de pâturage –, la préparation et la réalisation des raids. Ce sont également les hommes adultes qui capturent et dressent les chevaux destinés à la chasse et à la guerre. Les adolescents, quant à eux, n’ont pas le loisir de passer leurs journées à s’exercer à des jeux guerriers. Ils sont responsables d’à peu près cent cinquante chevaux chacun qu’ils doivent déplacer entre les pâturages et faire boire deux à trois fois par jour. Par ailleurs, il leur faut protéger leur troupeau des prédateurs, soigner les bêtes blessées, et rentrer chaque soir les chevaux les plus précieux à l’intérieur du campement. L’hiver est la période la plus rude pour eux, puisqu’ils doivent aller chercher l’herbe ou le complément de fourrage de plus en plus loin du campement, avec des chevaux toujours plus faibles.
Pourtant, ils sont loin d’être les plus mal lotis. La chasse et la guerre montées ont mis en valeur l’audace et la prise de risque, et conféré un prestige important aux activités masculines. Les hommes dominent clairement la sphère publique et contrôlent la redistribution des biens les plus précieux, dispensateurs de richesse. Les femmes, cantonnées à la sphère domestique, se voient assigner depuis le début du XVIIIe siècle une charge de travail de plus en plus harassante. Un observateur contemporain, John Sibley, décrit ainsi leur condition en 1807 : « Elles semblent être constamment et laborieusement occupées à préparer les peaux de bisons, à les peindre et les décorer avec une grande variété de couleurs et de motifs, à fabriquer leurs vêtements et ceux de leur mari, à ramasser le combustible, à surveiller et garder leurs chevaux et leurs mules, à cuisiner, à fabriquer des licous et des cordes en cuir, à construire et à réparer leurs tentes et à fabriquer les selles de monte et de bât [37. John Sibley, A report from Natchitoches in 1807, p. 79. <archive.org/details/reportfromnatchi00sibluoft>.]. » Une femme seule ne peut évidemment pas s’occuper de tous les chevaux capturés par un homme, pas plus qu’elle ne peut préparer toutes les peaux qui s’accumulent avec l’adoption de la chasse montée. Les chefs de famille qui le peuvent prennent donc plusieurs femmes, bouleversant ainsi l’ancien système polyandrique, et augmentent par ce moyen la réserve de main-d’œuvre disponible pour le foyer.
Quant à l’esclavage, il existait dans la société comanche avant le contact avec les Européens [38. Voir par exemple Le Middle Ground, ouvr. cité.]. Toutefois, ce sont les épidémies de variole du début du XIXe siècle et la pénurie chronique de main-d’œuvre qui en découle qui transforment l’esclavage en institution à visée essentiellement économique et productive. En s’appuyant sur des raids fréquents au Texas et dans le nord du Mexique, les Comanches alimentent leur nouvelle classe laborieuse avec une telle efficacité que, rapidement, leur population se compose de 10% à 25% d’individus serviles.
Nord
« Mais j’étais pas un Indien. J’étais un businessman. Et je devais apprendre à moissonner la récolte de buffalos comme un businessman. »
Frank Mayer
Au grand dam des colons français, la société algonquienne est étrangère à tout pouvoir coercitif. Or, si le regard européen croit identifier des chefs, il s’agit avant tout d’individus influents autorisés par la communauté à négocier avec les étrangers, et non de caciques capables d’imposer leur volonté au reste de la population. Leur capacité à être écoutés, et donc leur puissance politique, dépend principalement de l’étendue des réseaux de solidarité qu’ils peuvent satisfaire. On attend d’eux qu’ils captent le plus de présents possible auprès des Français et qu’ils les redistribuent équitablement. Il ne faut pas, cependant, négliger leur importance : l’ampleur du commerce de fourrure et les nouveaux enjeux liés aux biens manufacturés européens en font des personnages essentiels dans les jeux diplomatiques et économiques des deux camps. Essentiels, mais pas irremplaçables ; d’autant qu’ils ne produisent pas les richesses sur lesquelles se fonde leur pouvoir – ils ne sont que des intermédiaires.
Dans les Plaines du Nord, la stratification sociale est plus précoce et plus marquée, notamment parce que le cheval y est à la fois extrêmement précieux et rare. Ainsi, posséder ne serait-ce qu’un cheval supplémentaire peut avoir des répercussions sociales importantes. Les propriétaires acquièrent non seulement un niveau de vie supérieur, mais accèdent aussi plus facilement au commerce de fourrures. L’arrivée des Américains dans le nord du Missouri, vers 1830, et leur demande exceptionnelle en fourrures de bison accentue le besoin de main-d’œuvre et donc, là encore, l’importance du travail des femmes. Or seuls les grands propriétaires ont le pouvoir d’avoir plusieurs femmes – achetées en chevaux – et de produire toujours plus de peaux. Leur accès privilégié à ces « moyens de production », ainsi qu’aux marchés globaux, leur permet d’employer des gens contre salaire et de leur éviter ainsi tout travail manuel [39. « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité.].
Sud
Plus au sud, le cheval n’est pas une denrée rare, mais reste très précieux. Les familles les plus riches peuvent posséder jusqu’à trois cents chevaux et mules, ce qui représente une source de capital économique, politique et social immense. Si la plupart des hommes participent aux échanges, peu le font à grande échelle. Ceux qui peuvent se le permettre ont généralement plus de cinquante ans, et ils ont accumulé suffisamment de richesses pour transformer leurs numunahkahnis en véritables unités de production. Ils ont souvent plusieurs dizaines d’esclaves, leurs fils chassent et pillent pour eux, tandis que les courtisans de leurs filles s’attirent leurs faveurs à l’aide de cadeaux [40. L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 416-417.].
« On rapporte que Chief A Big Fat Fall by Tripping (Chef Gros Lard Tombe en Trébuchant) possédait 1 500 chevaux, mais qu’il était si gros qu’il ne pouvait en monter aucun et se déplaçait sur un travois [41. Ibid., p. 415.]. » De toute évidence, la nouvelle élite comanche du début du XIXe siècle ne passe plus par les exploits guerriers pour se distinguer. Elle préfère louer des chevaux aux jeunes gens contre une part de leur butin, ou encore marier ses filles en échange de travail gratuit pendant quelques années. Inutile dans ces conditions de se fatiguer à chasser ou voler, d’autant qu’on peut facilement perdre la vie dans ce genre d’aventures. Les membres de cette nouvelle aristocratie préfèrent porter leur poids comme un signe distinctif de prestige, ils quittent les habits de chasseur pour des vêtements ostentatoires et se coiffent d’une quantité impressionnante de tresses coupées sur le crâne de leurs prisonnières ou de leurs femmes. Alors que la société comanche était traditionnellement non capitaliste, ces Big Men sont de véritables protocapitalistes. Leurs réseaux étendus de subalternes sociaux et l’accès privilégié aux moyens de production leur permettent d’échapper aux travaux domestiques. Spectaculairement riches, ils ont les moyens de paraître désintéressés, de se soucier du bien-être du groupe en étant généreux en femmes et en chevaux. De cette manière, ils assoient leur autorité morale et leur pouvoir politique et, devenus un réel facteur de stabilité du groupe, ils peuvent songer à fonder leur propre ranchería.
Nord
« Tuer plus qu’on en avait besoin, ç’aurait été gaspiller le buff, ce qui n’était pas important ; ça gaspillait aussi des munitions, et ça, ça l’était. »
Frank Mayer
Dès 1780, le missionnaire morave David Zeisberger alertait ses contemporains à propos des nouvelles pratiques de chasse des Delawares : « En raison du commerce considérable des peaux, les cerfs sont avant tout abattus pour leurs peaux et la viande n’est utilisée que dans la mesure où les Indiens peuvent la consommer durant leur chasse. C’est pourquoi une grande partie de la viande est abandonnée dans les bois aux animaux sauvages. […] Comme un Indien tue de cinquante à cent cerfs chaque automne, on peut aisément comprendre pourquoi le gibier se raréfie [42. Le Middle Ground, ouvr. cité, p. 661.]. » Néanmoins, c’est au tournant du XIXe siècle que le processus s’accélère. Au sud de l’Indiana, dans l’Ohio et l’Illinois, les nouveaux arrivants américains s’emparent de tous les territoires possibles. Persuadés que ce qui se trouve dans la région appartient à qui veut bien s’en saisir, ils massacrent bisons, cerfs, ours et élans. Ceux qui échappent à la tuerie voient leur habitat naturel détruit. Les Blancs forcent également les Indiens à modifier leurs habitudes, à vivre dans des régions plus circonscrites ou à renoncer à la pratique du brûlis. Ces changements privent la faune de territoires libres où profiter d’un peu de répit, ainsi que de sources de nourriture [43. Ibid., p. 660.].
Dans les Grandes Plaines, les horse wars jouent un rôle critique dans le déclin du gros gibier, et notamment du bison. Le besoin insatiable en armes pousse les Indiens à la surexploitation des troupeaux, lesquels se voient privés des zones tampons séparant habituellement les tribus rivales, et donc de tout refuge. Dans les années 1840, le bison montre des signes alarmants d’épuisement sur les deux rives du Missouri, ouvrant une période de famines qui balayent les Indiens des Plaines [44. « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité.].
Sud
« On le savait pas, alors, et si on l’avait su, on s’en serait pas fait pour autant, mais nous autres coureurs, on ouvrait le chemin aux éleveurs avec leurs immenses troupeaux et leurs pâturages illimités, plus tard aux sédentaires et plus tard encore aux drive-in, aux “hamburger palace”, aux clubs de femmes et à l’agriculture subventionnée. »
Frank Mayer
L’effondrement de l’empire espagnol, en 1821, entraîne la levée des limitations imposées par les autorités hispaniques : un raz-de-marée de négociants déferle sur les Plaines du Sud par la piste de Santa Fe, et des avant-postes commerciaux américains fleurissent un peu partout. Jusque-là, les Comanches se contentaient de satisfaire des besoins locaux immédiats avec le commerce de viande et de peaux de bisons. En moins d’une décennie, les bisons du territoire comanche se transforment en matière première commerciale, destinée aux marchés industriels lointains, et les troupeaux montrent rapidement des signes de surexploitation. Dans les années 1840, par exemple, les 11 470 Comanches, Kiowas, Cheyennes et Arapahoes tuent plus de 112 000 bisons par an, c’est-à-dire au moins 60 000 au-delà de la limite permettant aux troupeaux de se renouveler [45. « The First Phase of Destruction », art. cité. ]. En outre, les marchés sont friands du cuir fin et maniable des jeunes vaches de 2 à 5 ans, et les peaux les plus prisées sont produites en hiver, quand les fourrures sont les plus fournies. Or les vaches donnent leurs premiers veaux à l’âge de 3 ou 4 ans et sont en gestation de mi-juillet à avril…
Bientôt, les Comanches commencent à se sentir à l’étroit dans les Plaines. En 1830, les Américains votent l’Indian Removal Act qui force le déplacement des Indiens depuis l’est du Mississippi vers l’ouest. Les territoires comanches sont rapidement envahis par les Cherokees, Creeks, Chiskasaws et Choctaws. Des centaines de Delawares, Shawnees et Kickapoos sont installés au Texas pour servir de tampon contre les pillards. Les Comanches font alliance avec les Cheyennes et les Arapahoes, attirés quelques années plus tôt sur les Plaines du Sud par un climat plus hospitalier et la proximité des marchés du Nouveau-Mexique, pour continuer à exploiter les troupeaux texans [46. « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité.].
Ces concessions reflètent l’affaiblissement de la position des Comanches au XIXe siècle, dû en grande partie à la pression toujours plus accrue sur leurs territoires, mais aussi à la raréfaction du bison dans les plaines. Acculé par la démultiplication des chasseurs, le grand mammifère est constamment perturbé dans ces migrations le long de la piste de Santa Fe. De plus, les zones tampons aux marges des Grandes Plaines ont disparu, le privant d’un havre traditionnel où les troupeaux pouvaient jadis se reconstituer. Au cœur des plaines, ce n’est guère mieux : à partir de 1825, on estime que d’entre 250 000 et 500 000 chevaux domestiques et plus de deux millions de mustangs sauvages concurrencent le bison sur près de 80% de son alimentation et sur ses besoins en eau. Il souffre aussi de maladies (anthrax, tuberculose et brucellose) introduites depuis la Louisiane dès 1800, ou transmises par les troupeaux domestiques du Texas [47. « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité.].
Le système économique des Comanches s’avère écologiquement précaire. La fin du petit âge glaciaire [48. Période climatique froide survenue en Europe et en Amérique du Nord du début du XIVe siècle et qui s’achèvera vers la fin du XIXe siècle.] et les dix ans de sécheresse qui commencent en 1846 leur portent un coup dont ils auront du mal à se relever. Privés de leur base de subsistance et incapables d’utiliser le pillage avec autant d’efficacité que par le passé, ils en sont réduits à se procurer de la viande de bœuf, des fruits et des vêtements sur les marchés. Quelques-uns se mettent à élever des moutons et des chèvres ; le tabou sur la consommation de poisson et les restrictions sur les volatiles sont levées. Les famines successives les poussent même à manger leurs chevaux. Sans doute près de 20 000 en 1840, les Comanches ne sont plus que 10 000 en 1850 [49. L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 476.]. Leur société a certes su s’adapter à des changements extraordinaires, mais comme l’a écrit Dan Flores : « Deux siècles se sont avérés trop courts pour leur laisser le temps d’élaborer un système écologique viable autour du cheval […]. Certaines forces, telles le besoin des tribus d’étendre leur nombre et les bénéfices d’une participation au commerce de fourrures, allèrent à l’encontre de leur besoin de préserver les troupeaux de bisons. En outre, nombre des forces qui façonnèrent leur monde échappaient largement aux tribus des Plaines [50. « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité.]. »
En 1871, la demande en bœuf des grandes villes du Nord explose et le Texas, fort de ses cinq millions de têtes de bétail et du terminus ferroviaire de la compagnie Kansas Pacific à Abilène, rêve de saisir cette opportunité. Pour permettre l’avènement d’un capitalisme post-esclavagiste, il ne manque plus à l’élevage texan qu’un accès libre et stable aux herbages et aux voies naturelles des Plaines du Sud.
La survie même des Comanches, qui contrôlent encore largement les Plaines, gâche le rêve américain. Dès lors, l’état-major américain ne tarde pas à lancer une guerre totale contre eux, les privant d’abris et de moyens de subsistance, détruisant leurs camps hivernaux, leurs vivres et leurs troupeaux. Cette campagne militaire d’envergure contraint les Comanches à se déplacer sans cesse, bouleversant ainsi leur cycle de subsistance. Les Américains, qui ont longtemps misé sur la disparition du bison pour affaiblir leurs ennemis, passent à l’offensive en s’appuyant sur une infrastructure impressionnante basée à l’est. Un assaut crucial, la bataille d’Adobe Walls, a lieu en juin 1874, et les Comanches, vaincus et pratiquement sans ressources, rejoignent les réserves en masse. En 1867, de retour de Washington où il avait pu contempler les villes, les usines, les chemins de fer et les fermes à perte de vue, le chef comanche Paruasemena s’était déjà rendu à l’évidence : « Il est trop tard, l’homme blanc possède le pays que nous aimions et nous ne demandons plus qu’à errer sur la prairie jusqu’à notre disparition [51. Ibid., p. 518-519.]. »
Épilogue
« Ouais, on était devenus efficaces et économes au moment où y avait plus de raison de l’être. On est devenus efficaces trop tard. On avait appris le métier, mais on pouvait plus le pratiquer et ça, c’est toujours tragique. »
Frank Mayer
En 1870, les tanneurs de Philadelphie inventent un nouveau procédé chimique pour la transformation des peaux de bisons en un cuir industriel extensible permettant de fabriquer des courroies pour les machines. Les peaux, déjà très appréciées dans l’Est, voient leur prix exploser, et ce malgré une augmentation soutenue de l’approvisionnement. Cette innovation accélère l’exploitation industrielle du bison des plaines et précipite des milliers d’Américains en quête d’aventure et de profit vers l’Ouest. Ces coureurs de bisons bénéficient d’un support logistique important grâce au chemin de fer, qui assure le transport rapide de la marchandise, et à l’armée des États-Unis qui leur procure volontiers des munitions.
En sept ans de massacres, ils tuent quelque dix millions de bisons sur l’ensemble des Grandes Plaines. Le mammifère ne devra d’être sauvé de l’extinction totale qu’à l’action de quelques éleveurs passionnés, perçus à l’époque comme de sacrés illuminés tant les troupeaux semblent alors inépuisables. Une fois les prairies jonchées de cadavres pourrissants, les personnes les plus entreprenantes de l’époque empoisonnent les carcasses pour piéger les charognards venus s’en repaître. Les ossements, quant à eux, servent à alimenter l’industrie des fertilisants. Décidément, tout est bon dans le bison.
Notes
| ↩1 | Toutes les citations en exergue sont tirées de Tueur de bisons, Anacharsis, 2010. Il s’agit d’un entretien réalisé dans les années 1940 avec Frank Mayer (1850-1954), qui courut le bison à partir de 1872. |
« Les vaches rêvent-elles du travail ? »
Bien-être animal et souffrance au travail Entretien avec Jocelyne Porcher et Lise Gaignard
Quel point commun entre un cochon élevé à la chaîne par l’industrie agroalimentaire, une professeure de musique en collège, une brebis paissant dans les alpages et un directeur des services vétérinaires pendant la crise de la vache folle ? Tous travaillent. Partant de là, se pose la question de leurs conditions de travail et de leur rapport à cette activité.
Jocelyne Porcher, éleveuse de brebis devenue sociologue, étudie les relations de travail entre humains et animaux d’élevage1 Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, 2011, La Découverte.. Lise Gaignard est psychanalyste et chercheuse en psychodynamique du travail[2. Chroniques du travail aliéné, 2015, éditions D’une.]. Elle s’intéresse non pas à la « souffrance » ou au « bien être », mais plutôt à « la construction psychique liée à l’activité de travail ». Elles confrontent ici leurs manières de penser cette activité particulière qui lie humains et animaux plus souvent qu’on le croit.
Cet article est le deuxième d’une série de six publications issues du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », et publiées en ligne à l’occasion de la sortie du nouveau numéro, « Ch’val de course ».
Télécharchez l’entretien en PDF.
Sur quoi travaillez-vous et comment vous êtes-vous rencontrées ?
Jocelyne Porcher : J’ai été éleveuse de brebis puis j’ai dû arrêter. À 33 ans, j’ai repris un cursus de formation et j’ai obtenu un brevet de technicien agricole et un BTS Productions animales. Lors d’un stage, je me suis retrouvée dans une porcherie industrielle. La rencontre avec la violence productiviste a été un choc. Plus tard, quand je suis arrivée à l’Inra (Institut national de la recherche agronomique) pour un stage d’ingénieur agricole, j’ai découvert les recherches sur le « bien-être animal » : mettre des vaches dans des labyrinthes, infliger des chocs électriques à des moutons pour prouver leur capacité à anticiper… J’ai pu constater que les chercheurs sur le « bien-être animal » ne connaissaient ni les animaux, ni les éleveurs – qu’ils méprisaient ouvertement –, ni même l’élevage. Seules semblent compter leurs petites manip’, leurs publications scientifiques et leur place dans le monde académique. C’est en travaillant avec eux que j’ai décidé de devenir moi-même chercheuse, pour servir d’autres intérêts que ceux de l’agro-industrie. J’ai d’abord travaillé sur l’attachement entre éleveurs et animaux, ce lien formidable observé lors de mon expérience d’éleveuse, mais c’est surtout la souffrance des éleveurs qui ressortait de mes études et donc, j’ai cherché à la comprendre.
Lise Gaignard : Je suis pour ma part psychanalyste et j’ai travaillé dans des cliniques pratiquant la psychothérapie institutionnelle[3. La psychothérapie institutionnelle est une théorie et une pratique thérapeutique en institution psychiatrique qui met l’accent sur la désaliénation, la dynamique de groupe et la relation entre soignants et soignés. Selon celui qu’on considère comme son fondateur, François Tosquelles, la psychothérapie institutionnelle « marche sur deux jambes : Karl Marx et Sigmund Freud », qui permettent de penser ensemble les deux aliénations, l’une psychopathologique, l’autre sociale.]. Pendant la crise de la vache folle, au début des années 2000, j’ai été sollicitée sur la « souffrance au travail » – comme ils disent – des directeurs des services vétérinaires (DSV). Ils n’arrivaient pas à organiser les abattages de troupeaux ; cela leur faisait des cauchemars. Ils s’étaient dit qu’une psychanalyste, c’était bien, pour leur enlever les cauchemars.
J. P. : C’est à cette époque que nous nous sommes rencontrées, au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Suite à mon recrutement à l’Inra, j’avais été détachée au Laboratoire psychodynamique du travail et de l’action de Christophe Dejours : je faisais des enquêtes sur le travail dans les porcheries industrielles, et c’est en mobilisant la psychodynamique[4. La psychodynamique du travail est une discipline créée par Christophe Dejours au début des années 1970 afin d’analyser les processus psychiques mis en place par une personne face à la réalité du travail. Elle étudie les problèmes de relations entre les différents partenaires de travail et les processus subjectifs et psycho-affectifs mobilisés par les contraintes du travail.] que j’ai pu faire ces recherches en étant moi-même moins en souffrance. J’allais chez les gens, ils étalaient leurs histoires, ils pleuraient et je les laissais en larmes sur leur table de cuisine. Je me suis dit que quelque chose n’allait pas, qu’il fallait prendre les choses autrement, avoir une réponse collective à la souffrance exprimée par les éleveurs.
L. G. : L’élevage industriel est quelque chose de construit collectivement dont, au fond, tout le monde est plus ou moins responsable. Les enquêtes de Jocelyne sur la souffrance dans les porcheries ont politisé la question, laquelle est complexe, puisque les victimes sont aussi les coupables. La psychodynamique du travail montre que les victimes, ce sont aussi bien les cochons que les éleveurs ou les vacanciers qui vont sur les plages pleines d’algues vertes. Son travail permet de sortir des fausses alternatives que portent les experts du bien-être animal et les abolitionnistes de toute forme « d’exploitation animale[5. C’est-à-dire y compris l’élevage (qu’il soit industriel ou paysan) ainsi que toute forme de domestication.] ».
J. P. : Surtout que les cochons ne sont pas seulement des victimes ; ils collaborent au travail. Ils sont comme nous : ils sont trop bons, ils supportent tout par excès de gentillesse. C’est en cela que la question du travail est intéressante : les cochons perçoivent nos désirs et cherchent à bien se comporter pour nous faire plaisir.
Sur quelle définition du travail vous appuyez-vous pour questionner l’une, les animaux au travail, l’autre les salariés qui vous consultent ?
J. P. : Pour penser les animaux au travail, je me suis d’abord appuyée sur Le Manuscrit de 1844 de Karl Marx : le travail y est avant tout décrit comme un rapport émancipateur à la nature, une action sur le monde pour le transformer. Cela m’a permis de comprendre comment et pourquoi on vivait avec les animaux. Je suis partie de cette hypothèse : c’est le travail qui nous réunit et qui nous permet de vivre ensemble. Les éleveurs ne vivent pas avec les animaux pour gagner de l’argent. Ils n’en gagnent pas. Ils travaillent avec les animaux parce qu’ils veulent vivre avec eux.
Car travailler, c’est d’abord vivre ensemble, c’est chercher à s’émanciper des contraintes et de la tragédie de la vie. En élevage, le travail permet, aux animaux comme à nous-mêmes, de comprendre et d’appréhender les choses, de les maîtriser un peu pour que le moment de vie en commun entre éleveurs et animaux devienne autre chose qu’une tragédie – même si ça finit tragiquement pour les animaux et pour nous-mêmes.
L. G. : Il faut bien distinguer travail et emploi. J’utilise deux définitions. D’abord celle de Claude Veil dans Psychiatrie et milieu de travail[6. Dans Psychiatrie française, vol. XXVII/96.] : le travail, c’est toute production de services ou de biens entraînant des liens entre les personnes. Quand on emmène son gamin à l’école, on travaille. Ça permet de déstabiliser la question, de la complexifier. On sort de la définition sociologique du travail, qui est souvent recouverte par la question de l’emploi, ce qui fait qu’on ne sait souvent plus de quoi on parle dans les débats publics. Le travail pose la question de la production commune d’une société.
L’autre définition, c’est celle de la psychodynamique du travail, de Christophe Dejours : le travail est l’effort ajouté à la prescription pour qu’elle devienne réalisable. On a toujours une prescription qu’on ne pourra pas mettre en œuvre parce qu’elle est trop loin du réel, parce qu’il y a des prescriptions contradictoires – faire vite et faire bien et en toute sécurité. On doit donc arbitrer en permanence entre ce qu’on fait et ce qu’on dit. Le travail, c’est alors l’effort que je produis pour faire au mieux, c’est-à-dire au moins mal, en fonction de ce qu’on m’a demandé et de ce qui est possible. Cela dépend aussi de si je suis fatiguée ou en pleine forme, de retour de vacances ou déjà à bout le lundi. Il s’agit de réfléchir sur cet investissement, qui est totalement invisible, car les arbitrages ne durent qu’un quart de millième de seconde : on est pris dedans. Or, c’est là que réside la marge de manœuvre qui permet de ne pas laisser les gens en train de pleurer sur la table de la cuisine.
J. P. : J’ai pu aussi le vérifier dans mes recherches : le travail des vaches ne réside pas tant dans le suivi de procédures que dans leur effort pour bien faire, sans lequel ça ne marche pas. Nous l’avons montré avec Tiphaine Schmitt en étudiant le rapport des vaches au robot de traite dans une exploitation laitière[7. Jocelyne Porcher et Tiphaine Schmitt, « Les vaches collaborent-elles au travail ? Une question de sociologie », Revue du MAUSS, 2010/1 (no 35), p. 235-261.], pour lequel il n’y a pas de procédure : les vaches se débrouillent entre elles pour accéder à la machine. Nous avons montré que cet ajustement n’est pas de l’ordre du conditionnement ni de la hiérarchie, mais consiste en un ensemble d’arrangements entre les vaches elles-mêmes, assez drôle à observer. Certaines peuvent même enrayer la machine : il y en a une par exemple qui s’était arrêtée une demi-heure à l’entrée du robot, avec les autres qui piétinaient derrière. Elle a bloqué le système, volontairement.
L’enjeu est de montrer aux éleveurs qui ne le perçoivent pas que les vaches conservent une marge d’autonomie, même si elles ont l’air d’agir soit par conditionnement soit parce qu’elles sont contraintes. Les concepteurs des machines à traire s’efforcent d’ailleurs de réduire cette marge, pour que les vaches ne soient que des pions, forcées de suivre le chemin prévu. Ils s’efforcent en fait de les empêcher de travailler.
L. G. : Ici, le travail de la vache, c’est l’effort pour rendre le robot de traite à peu près utile.
J. P. : Le travail est un investissement dans la production, mais la vache ne produit pas du lait. Elle se moque de la courbe de production. En revanche, elle a conscience de toute l’organisation autour d’elle, et agit pour que tout se passe bien. C’est plus facile de parler de travail concernant les chiens de berger, les chiens policiers ou d’aveugle, parce qu’ils ont une vision de la finalité de leur travail : c’est une production de services. Mais même ceux qui forment les chiens le perçoivent souvent comme du conditionnement. Pourtant, les chiens de berger sont encore plus au fait du travail que le berger lui-même, car ils connaissent mieux les brebis. Il y a donc ceux qui prennent des initiatives et ceux auxquels le berger dit sans cesse : « À droite, à gauche, devant, derrière », qui sont finalement comme des automates. Mais on retrouve plus souvent les chiens automates dans les concours que dans les alpages.
L. G. : Au fond, la plupart des salariés ne savent pas plus ce qu’ils produisent que la vache qui produit du lait ou de la viande. Ils font, ils aménagent, souvent ils désobéissent, mais ils ne savent pas ce qu’ils produisent. Par exemple, un maître d’école n’a pas forcément conscience de participer à la production d’une société inégalitaire. On ne produit pas forcément ce qu’on croit.
J. P. : En tous cas, si on dit que les animaux travaillent, cela nous oblige à questionner l’organisation de ce travail, par exemple la question du temps de travail. Avec une vache laitière, on peut penser une organisation qui tienne compte de son statut de travailleur, y compris les pauses. En revanche, un porc charcutier est à l’usine 24 h/24. Et la seule porte de sortie, c’est l’abattoir.
Le travail est-il le seul mode de relation possible avec les animaux domestiques ?
J. P. : Le travail est partout, même dans les relations avec les animaux de compagnie. J’ai une chienne, et si son travail, c’est de me tenir compagnie, où est le champ du hors-travail ? Si je lui dis : « Aujourd’hui je travaille », et que je m’installe devant mon ordinateur, elle se met dans un coin et ne bouge plus. C’est un travail sur soi : elle est en forme, elle voudrait courir, aboyer, mais tant que je suis plantée devant mon ordinateur, elle attend. En revanche, si j’emmène ma chienne à la plage, elle fait ce qu’elle veut, et c’est moi qui suis à son service, qui surveille : c’est moi qui travaille.
À un moment, il y a du travail, de la production, de l’engagement, et à un autre du dégagement. C’est un changement de monde : les animaux sont dans le travail, dans notre monde à nous, ou plutôt le monde commun humains/animaux, et à un moment donné, ils sont dans leurs propres affaires.
Les animaux sauvages travaillent-ils aussi ?
J. P. : Pas tous. Les fourmis et moi, nous n’interférons pas. Peut-être sont-elles travailleuses, mais leur concept de travail ne regarde qu’elles. En revanche, certains animaux dits sauvages travaillent, comme les cétacés qu’on équipe d’un GPS pour surveiller le climat. On les capture, on les surveille, et les animaux le savent. Sans doute en pensent-ils quelque chose, et il se peut que cela fausse les résultats, comme dans les expérimentations animales[8. Voir Jef Klak nº 3 « Selle de ch’val »: « Les moutons ont des amis et des conversations. Comment les animaux désarçonnent la science. Entretien avec Vinciane Despret. ».]. Peut-être que ces baleines continuent leur vie comme avant de « travailler » pour nous, mais peut-être pas, ou pas autant qu’on ne le croit. À partir du moment où les animaux se demandent ce qu’on bidouille avec eux, ce qu’on leur veut, et qu’ils répondent, on peut considérer qu’ils travaillent.
Les animaux ont-ils un statut différent en « production animale » – c’est-à-dire industrielle – et dans les élevages paysans ?
J. P. : Lors de la crise porcine de 2015, un gros producteur de porc se plaignait dans la presse : « Je vais être obligé de licencier mes ouvrières. » Là, les truies renvoient à l’ouvrier aliéné, jetable, exploité au maximum. En revanche, dans l’élevage « véritable », les animaux ont un statut de travailleur, de partenaire, de collègue de travail. Un idéal de la relation de travail peut alors s’inventer, équitable dans une certaine mesure, où la coopération serait privilégiée – sans nier que nos relations aux animaux sont de toute façon asymétriques.
L. G. : Cette notion de « collègue de travail » est tout de même compliquée : normalement, on ne tue pas les collègues et on ne les mange pas à la fin de leur contrat.
Comment circule la souffrance entre salariés et animaux dans les porcheries industrielles ?
J. P. : On force la truie à produire de dix-huit à vingt-six porcelets par portée – une truie n’a que seize tétines. Par conséquent, la mise à bas est trop longue et les derniers porcelets risquent de mourir. Donc un salarié doit « fouiller » la truie, c’est-à-dire aller chercher les porcelets dans l’utérus. Ça lui fait mal. Le salarié se met à sa place. Si c’est une femme ayant des enfants, elle se dit : « Je suis mère moi aussi. » Il y a un côté charnel, une empathie de corps : on est si près des animaux qu’on ressent leur souffrance dans son propre corps.
J’appelle cela la « contagion de la souffrance ». Plus qu’une interaction, c’est une espèce de balance mutique de la souffrance, comme une contagion de quelque chose de sourd qui passe des animaux aux humains. C’est plus explicite chez les femmes que chez les hommes, qui ont des défenses viriles plus fortes[9. Ce concept de défense virile a été développé notamment par Christophe Dejours dans Souffrances en France. La banalisation de l’injustice sociale, Seuil, 1998.]. Même si les salariées essaient de maintenir un écart avec l’animal, comme un filtre, les animaux le dissolvent en se rapprochant d’elles. Cela produit une espèce de magma où la souffrance passe facilement. « On fait souffrir les animaux, et moi, je participe à ça. Les truies ne m’aiment pas, je sais pourquoi, mais j’aimerais bien qu’elles m’aiment. Je les fais souffrir, mais je fais de mon mieux. Mon chef me dit de tuer les porcelets chétifs, mais je ne le fais pas, je leur donne le biberon, j’y passe des heures. » Il y a aussi une souffrance éthique, morale, liée à la conscience de sa collaboration à un système qui génère de la souffrance.
Et les producteurs, est-ce qu’ils souffrent aussi ?
J. P. : Les producteurs sont coincés, ils ne peuvent pas quitter ce système de production. Ils ont fait le mauvais choix au mauvais moment et se sont laissé bourrer le mou, par intérêt voire par cupidité. En plus, ils ont souvent un taux d’endettement de 180% et les banquiers sur le dos. Dès lors, ils ne pensent qu’à extirper la matière animale des bestioles pour la transformer en fric et rembourser la banque. C’est pour ça qu’ils sont obligés d’aller pleurer à la télévision pour réclamer moins de normes : « Arrêtez de nous saouler avec l’environnement, avec le bien-être animal. » Le bien-être animal est bien utile à la filière dont il permet de redorer le blason, mais c’est une autre histoire pour le pauvre gars qui se retrouve bloqué par ces nouvelles contraintes, et ne peut plus inséminer ou faire ses piqûres comme il veut…
Quels sont les soubassements théoriques du bien-être animal ? En quoi consistent les études sur le bien-être animal dans les productions industrielles ?
J. P. : Le bien-être animal est directement issu de la zootechnie[10. La zootechnie est l’ensemble des sciences et techniques mises en œuvre dans l’élevage des animaux pour l’obtention de produits ou de services à destination de l’homme (viande, lait, œufs, laine, traction, loisirs, etc.).], qui cherche à rendre la machine animale productive dans un certain environnement. Il faut aussi chercher du côté des théories du conditionnement, de l’éthologie comportementale et surtout de l’éthologie appliquée, qui est devenue la véritable zootechnie du XXIe siècle : l’étude du comportement animal à visée économique – comment faire pour que la caille, le porc ou le chat produisent le plus possible dans les systèmes industriels et intensifiés, et pour que cela soit accepté socialement.
Cela fait quarante ans que l’Union européenne finance les études sur le bien-être animal en industrie. Quand j’ai commencé à travailler dans les porcheries industrielles, les truies avaient une sangle qui s’incrustait parfois dans leur chair. La souffrance était visible. Ils ont enlevé la sangle et ont mis les truies en cage. Désormais, bien-être animal oblige, ils ont aussi enlevé la cage, en partie – la truie gestante, théoriquement, n’y reste qu’un mois. Mais ils mettent huit truies ensemble dans un minuscule espace en béton, sur caillebotis, et elles finissent par se battre entre elles – par ennui. Cela nous est présenté comme une amélioration du bien-être animal.
Dans les faits, mes collègues qui étudient la question ne mettent jamais les pieds dans une porcherie ; ils collaborent jour après jour, depuis quarante ans, faisant tourner un système qu’ils prétendent améliorer mais qu’ils ne connaissent pas. Bref, le bien-être animal se résume à assurer la durabilité de cette abjection qu’est le système industriel.
Et le « bien-être au travail », quel est son origine, ainsi que son rôle ?
L. G. : Les sciences du travail et les psychologues du travail existent depuis l’avènement du taylorisme à la fin du XIXe siècle. Les premières études se sont focalisées sur la fatigue, l’engagement, les recrutements, les tests d’aptitudes. Auparavant, personne ne se préoccupait de savoir si un cordonnier aimait le cuir ou pas, comment faire pour qu’il soit tout le temps en forme psychiquement et ne se suicide pas le lundi matin. Il a fallu attendre l’ingénieur américain Frederik Taylor – puis Henry Ford et leurs successeurs – pour que soit théorisée la productivité humaine. Ils ont d’ailleurs très bien réussi : le travail humain n’a jamais autant rapporté qu’actuellement. Aujourd’hui, les psychologues du travail sont toujours au même endroit, sauf qu’ils ont deux casquettes : coachs et spécialistes de la « souffrance au travail », avec les mêmes formations, employeurs et conditions de travail. Le coaching marche moins bien ces derniers temps, mais avec la récente loi sur les risques psychosociaux[11. Le Code du travail français est longtemps resté sans inclure l’aspect mental pour définir les mesures de protection de la santé au travail. Cette idée a été introduite en 2002 par la loi de modernisation sociale, qui remplaça le mot « santé » par les mots : « santé physique et mentale » dans le Code du travail. L’employeur doit désormais prendre en compte tous les risques psychosociaux (RPS) c’est-à-dire les risques concernant non seulement l’intégrité physique des salariés, mais aussi leur santé mentale : le stress, l’épuisement, la souffrance, ou encore le harcèlement moral.], nombre de psychologues se retrouvent à travailler dans les entreprises, se spécialisant dans la filière du bien-être au travail. Ils travaillent pour EDF ou pour la Poste, et reçoivent les salariés pour leur dire : « Ayez des pensées positives ! » C’est un marché juteux.
Le changement le plus frappant dans le monde du travail aujourd’hui est justement cette idée d’envoyer les salariés « chez le psy » pour évacuer la perception de la souffrance : il faut qu’ils soient de nouveau en mesure d’exercer des techniques de travail toujours plus désocialisantes. C’est une dépolitisation totale.
Le pire, c’est que cette mascarade est parfois défendue par les syndicats eux-mêmes : au lieu de lutter sur les conditions de travail, ils voudraient que l’on dénonce les chefs harceleurs. Or, ces cadres sont eux-mêmes constamment sous pression : comme leurs évaluations, et donc leurs salaires, dépendent désormais directement de la production des autres, ils harcèlent leurs subalternes pour que ça aille plus vite, pour les pousser à enlever les sécurités, etc.
Il m’arrive de recevoir dans mon cabinet des salariés que m’envoient des médecins du travail ou des syndicalistes, mais je ne veux pas figurer sur le listing des psys spécialisés dans la « souffrance au travail ». Ceux-là se contentent de conseiller aux personnes harcelées par des chefs pervers-narcissiques de se mettre en arrêt-maladie. Mais le problème n’est pas médical. Après l’arrêt-maladie, si le salarié ne peut pas retourner travailler, la Sécu va l’envoyer à la Maison départementale des personnes handicapées avec une allocation adulte handicapé, et ses revenus vont baisser rapidement. C’est la manière la plus pratique et la plus courante de se débarrasser des travailleurs aujourd’hui. Je ne me bats donc pas tant contre le « bien-être au travail » que contre ceux qui sont obnubilés par la question de la souffrance au travail, et qui emmènent tout le monde dans ce qui est clairement une catastrophe nationale.
Comment se passe la consultation ?
L. G : Des salariés qu’on n’a pas réussi à calmer arrivent dans mon cabinet : ceux qui embarrassent tout le monde, qui parlent de se suicider au travail et risquent de faire exploser les statistiques. Pour éviter ça, certains services de médecine du travail acceptent de payer 110 euros pour qu’ils viennent passer une ou deux séances de deux heures dans mon bureau.
Ce sont en général des cadres, des professions intermédiaires, très peu d’ouvriers. Jamais des précaires. Ils commencent toujours l’entretien en racontant comment on les a rendus malades. Ils démarrent toujours de la même manière : « J’ai un chef pervers narcissique. » Ils en ont toujours un. Je leur demande ensuite ce qu’ils font comme travail. Ils répondent par exemple : « Je suis professeur de musique. » Et ils décrivent donc leur activité : « On a cinq classes de sixième la première année, on ne sait jamais le nom des élèves, on les a une heure par semaine, on n’y comprend rien. » Ils parlent ensuite des rapports de domination, de la hiérarchisation symbolique des matières : au collège, le haut, c’est les maths, après c’est la physique-chimie, puis les lettres, les langues et en dernier, il y a les arts plastiques et la musique.
Puis vient l’anecdote : elle s’est fait caillasser par des élèves avec de grosses boules de neige, jusqu’à l’intérieur de sa voiture, où elle se retrouve toute trempée le dernier jour de l’école avant Noël. Le directeur du collège passe à côté, elle lui demande de l’aide, et lui rigole. Elle a fait une dépression et n’est jamais retournée travailler.
Bref elle était désagréable avec les élèves, ces derniers étaient d’une cruauté effroyable envers elle, et le directeur également. C’était un rapport terrifiant.
Elle est donc entrée dans mon bureau avec des élèves délinquants et un principal de collège pervers-narcissique – et elle en avait des preuves. Mais elle est ressortie avec une autre vision : « Professeur de musique, ce n’est pas une vie, et les collèges, c’est l’enfer pour tout le monde. » Et c’est vrai. Elle était moins « rendue folle », mais plus embarrassée. Elle a arrêté de croire qu’on lui voulait du mal et s’est retrouvée dans une espèce d’incertitude, alors qu’avant, elle avait une solution : dresser les gosses et faire virer le principal. C’était pas compliqué – à part à mettre en œuvre –, mais le prix de tout cela, c’est qu’elle ne dormait pas, que plus personne ne lui téléphonait. Elle était seule car elle était trop pénible.
Le prix d’une vie plus lucide, c’est d’être davantage contrarié et, éventuellement, de passer à l’action. Qu’est-ce que l’action pour un prof de musique ? Se remettre au piano ? Je n’en sais rien. Ce sont les gens qui savent ce qu’il faut qu’ils fassent. Mais à un moment, on rentre dans l’embarras de la question de la société, du vivre ensemble au sens noble. Comment faire pour ne pas s’entretuer ? Comment faire un collège ? Il y a des établissements où ça se passe extrêmement bien. Même avec les profs de musique !
Au début des années 2000, tu as enquêté sur la « souffrance au travail » des directeurs de services vétérinaires pendant la crise de la vache folle. Peux-tu nous raconter cette expérience ?
L. G. : Les directeurs de services vétérinaires (DSV) ressentaient de la « souffrance au travail » parce qu’ils devaient abattre des troupeaux entiers à la moindre alerte, alors que, ne sachant pas comment la maladie se propageait, ils étaient scientifiquement contre les abattages. Mais ils étaient obligés.
Ces directeurs sont des hauts fonctionnaires qui travaillent avec le préfet pour faire appliquer les réglementations étatiques à propos du commerce de la viande : en temps normal, ils ne s’occupent pas d’animaux mais uniquement de produits animaux.
Peu de temps avant, on leur avait demandé d’organiser la mise à mort de tous les veaux d’un jour[12. Les éleveurs pouvaient à l’époque bénéficier de « la prime Hérode », une compensation financière européenne accordée pour l’abattage des jeunes veaux.], ce qui ne leur avait pas posé trop de problèmes ; il suffisait de signer un bout de papier pour les envoyer à l’abattoir. Mais cette fois, on leur demandait d’organiser l’abattage eux-mêmes, dans des équarrissages[13. L’équarrissage est le lieu où on traite les cadavres d’animaux morts hors des abattoirs.] qui n’étaient pas assez grands. Il fallait inventer. Ils ont dû faire appel à des gens qui savent tuer les bêtes – ceux qui avaient travaillé toute la semaine à l’abattoir rempilaient donc le dimanche – et ils abattaient aussi dans les champs. Et puis les bêtes ne sont pas si bêtes que ça : par exemple, des veaux d’un jour dont on venait de tuer la mère passaient à travers les clôtures. Bref, ç’a été un merdier total.
Pour les DSV, voir arriver sur leur écran : « Il y a un sérodiagnostic positif dans l’élevage de M. Machin, trois cents vaches », c’était l’angoisse. Comment faire alors pour ne pas souffrir ? D’autant qu’on leur demandait de faire couper toutes les têtes pour prélever un bout de cerveau et l’envoyer à Paris : il pouvait y avoir de grandes tables avec trois cents têtes de vaches. Les DSV n’ont jamais eu les résultats des examens.
Après ça, ils devaient répondre aux médias et raconter qu’ils donnaient des biftecks hachés à leurs propres enfants. On allait manger au restaurant La Boucherie le midi avec eux et ils commandaient du tartare… Une vétérinaire avait même dit : « Je suis prête à me faire filmer en train de mettre du sang de vache dans le biberon de mon bébé. » C’est un réflexe défensif : comment faire quand on réprouve son travail ? Il faut aller jusqu’au bout, sinon c’est trop dur. Les éleveurs, quant à eux, souffraient énormément. Or la consigne du préfet était « Aucun suicide d’éleveur ». Et ils ne se sont pas suicidés !
J. P. : Pas tout de suite !
L. G. : Les autorités ont proposé de leur offrir deux fois le prix du troupeau en compensation. Mais les éleveurs disaient : « Ce n’est pas une histoire de fric ! Comment vais-je refaire un troupeau ? Celui-là, ça fait trente ans que je le fabrique ! »
Est-ce pour des raisons similaires que certains éleveurs de brebis refusent une compensation financière quand quelques bêtes sont tuées par des loups – ce qu’on appelle la « part du loup » ?
J. P. : Pas exactement. Les brebis ont été domestiquées il y a 8 000 ans, c’est l’animal d’élevage par excellence. La brebis fait confiance à l’éleveur pour pâturer tranquillement, pour échapper à son destin de proie. Le premier engagement de l’éleveur est de protéger ses bêtes de la tempête, des ravins, de la maladie, du loup. Si une brebis se fait manger, c’est le troupeau entier qui est stressé, les liens entre les brebis et l’éleveur sont pulvérisés. Les éleveurs s’en fichent du chèque de compensation ; au contraire, c’est le prix de leur trahison. Je me suis appuyée sur la théorie du don de Marcel Mauss[14. Marcel Mauss, « Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques », L’Année sociologique, 1923-1924.] pour penser l’élevage : nous mangeons les animaux domestiques, en échange de quoi nous sommes tenus de leur offrir une belle vie. Et la mort des animaux n’est pas le but du travail mais le bout. Aujourd’hui, les éleveurs ont l’impression de ne plus être à la hauteur de ce que donnent les animaux.
Je n’ai rien contre les loups, mais ils ont compris qu’ils étaient protégés : puisqu’on élève des brebis pour eux, pourquoi se fatigueraient-ils à chasser d’autres animaux ? Ils sont eux aussi domestiqués, mais contre les brebis.
Tu dis souvent que travailler avec des animaux, c’est aussi se coltiner la mort, et par extension le vivant, question qu’écartent selon toi les véganes et les abolitionnistes…
J. P. : Le problème, c’est que les abolitionnistes croient avoir la solution : c’est mal de faire souffrir et de tuer les animaux, donc il faut arrêter de les manger, de les élever, de se les approprier. Il y aurait le bien d’un côté et le mal de l’autre. Il suffirait d’abolir l’élevage, y compris pour les animaux familiers. Comme le bien-être animal, qui consent à la violence du système industriel, la libération animale se donne comme vertueuse envers les animaux, mais consent de fait à leur disparition – avec pour logique implicite « Si tu ne nais pas, tu ne souffres pas ».
Selon moi, le véganisme rejoint les intérêts de ceux qui veulent prendre en main l’élevage, en l’occurrence les multinationales et les fonds d’investissement. La Fondation Bill Gates soutient par exemple des entreprises[15. Beyond meat et Hampton Creek Foods. Hampton Creek Foods est également soutenue par des fonds d’investissement comme Khosla Venture. La firme multinationale Cargill, de son côté, a breveté un substitut de fromage, le Lygomme ACH Optimum, essentiellement constitué d’amidons.] qui proposent des ersatz de poulet sans poulet, du bœuf sans bœuf, du fromage sans lait, de la mayonnaise sans œufs… Ça les arrange qu’on soit convaincus que c’est mal de manger des animaux : cela leur permet de nous vendre leurs nouveaux produits.
On arrive au bout du bout de notre rapport industriel aux animaux, que ce soit au niveau de l’éthique, de l’environnement, de la santé… Mais nous vivons dans un monde capitaliste où la solution est une nouvelle industrialisation. En plus de ces succédanés de viande, les multinationales et les fonds d’investissement cherchent à créer une industrie de la viande 2.0, à produire une viande sans animaux, car les animaux restent un frein à la production. En défendant le projet d’une production de viande in vitro (élaborée en cultivant des cellules souches en laboratoire), les abolitionnistes ne font pas le service après-vente, mais le service avant-vente. Les consommateurs de viande industrielle consentent tout de suite à un système industriel qui a cours, alors que les véganes militants consentent à un système qui arrive.
Bien sûr, les productions animales font souffrir horriblement les animaux et les salariés, elles contribuent à la destruction de la biodiversité et ont un impact réel sur le climat. Mais ce sont les systèmes industrialisés qui en sont responsables, pas l’élevage. Depuis 10 000 ans, l’élevage est, au contraire, en harmonie avec la planète. L’élevage, c’est vivre et travailler avec des animaux. Faire naître et élever. C’est un métier de la reproduction et de la relation. Une relation entre humains et animaux, et une relation commune à la nature. Les vaches font la prairie, comme les moutons dessinent les pentes de la montagne. Sans les animaux d’élevage, la forêt est à la merci des incendies : ils rendent notre environnement habitable, varié, beau.
La filière bio ne s’est que tardivement intéressée à l’élevage. Pourquoi ?
J. P. : La viande bio est commercialisée comme bonne pour la santé et l’environnement, pas pour la qualité du travail des éleveurs et des animaux. Quand je travaillais à Ecocert[16. Organisme de certification de l’agriculture biologique.], lors de sa naissance au début des années 1990, j’étais étonnée que beaucoup de maraîchers soient végétariens et considèrent les éleveurs comme des « viandards ». La filière bio est née des enjeux de la relation à la terre, à la plante, sans considérer tout de suite – sauf les biodynamistes – la relation homme-animal-plante. Aujourd’hui, ce secteur s’intéresse à l’élevage, notamment sous l’impulsion des consommateurs, depuis que les pratiques des systèmes industriels se sont ébruitées, et bien sûr à cause des scandales sanitaires.
Quand on vit en ville, sans contact avec des éleveurs, on n’a quasiment pas d’autre choix que de ne pas manger de viande si on ne veut pas alimenter l’industrie de production animale…
J. P. : Il est plus compliqué de vendre une viande saine et de qualité en circuit court que des légumes bio, notamment parce que la viande et le fromage doivent être réfrigérés pour le transport et la conservation. Mais pourquoi ne pas mettre en commun une camionnette frigorifiée et s’organiser avec des éleveurs ?
L. G. : La question de l’élevage concerne la vie quotidienne de tout le monde. Comment fait-on au jour le jour ? Que promouvoir de façon collective ? Les Amap fonctionnent bien pour les légumes, les petits maraîchers se sont bien débrouillés pour se rendre accessibles, pourquoi pas les éleveurs ? Des listes de psychanalystes féministes, non homophobes, élaborées par des usagers circulent sur Internet, et c’est une très bonne chose. On pourrait s’inspirer de ça pour les bouchers, les éleveurs. On ne s’organise pas assez sur la viande.
Ne devrait-on pas repenser aussi l’abattage ?
J. P. : C’est une question centrale, qui revient sans cesse chez les éleveurs que je connais : comment faire pour abattre à la ferme ? C’est pourquoi je participe à la création d’un groupe avec des éleveurs, des vétérinaires, des journalistes et la Confédération paysanne, pour faire changer la loi qui oblige à passer par les abattoirs[17. À ce sujet, lire J. Porcher, E. Lécrivain, S. Mouret, N. Savalois : Livre blanc pour une mort digne des animaux, Les Éditions du Palais, 2014. ]. Aujourd’hui encore, certains se risquent à abattre à la ferme, ni vu ni connu. Quand j’étais éleveuse, je ne suis jamais allée à l’abattoir, mais je n’aurais pas tué mon mouton moi-même : il faut un tueur pour cela, c’est un métier, et il y en a de moins en moins.
Pour ma part, je défends l’abattage à la ferme, mais mes collègues scientifiques défendent au mieux l’abattoir de proximité. L’Institut technique du porc (ITP) veut court-circuiter les résistances en créant des abattoirs de proximité dépendants de la filière industrielle. C’est ce qui m’étonne toujours avec l’industrie, et le capitalisme en général : pourquoi veulent-ils tout ? Pourquoi forcent-ils les petits bergers du Lubéron à passer par des abattoirs industriels ?
L. G. : Le capitalisme n’existe pas, ce ne sont que des gens qui le mettent en œuvre, comme dans l’exemple des Directeurs des services vétérinaires. Ce sont eux qui font appliquer les lois et les réglementations commerciales, et toute alternative leur donne des cauchemars, surtout si ça concerne la vie et la mort. Vu que ce ne sont pas les petits éleveurs qui nourrissent la France, ils peuvent les faire fermer. C’est ça le progrès, c’est ça la vie hygiénique.
J. P. : J’essaie de travailler la question du rituel avec les éleveurs. Une d’entre eux m’a dit récemment : « À l’abattoir, on n’a même plus la place de parler une dernière fois aux animaux. » Avant, au moment de laisser l’animal, son mari récitait une poésie indienne rituelle, à voix haute. Depuis que je travaille sur cette question, je me suis rendu compte que beaucoup d’éleveurs font ça. Moi, je le faisais aussi, dans ma tête. Et quand je mange de la viande, je visualise l’animal. J’en mange en conscience, en lien avec les animaux.
L. G. : Notre rapport au monde est fondé en premier sur notre rapport au vivant. Les animaux sont là, qu’on les mange, qu’on les tape ou qu’on les caresse, et nos relations avec eux sont fondatrices. Les psychanalystes nient trop souvent ce qui est de l’ordre de l’environnement et de l’expérience vécue, au bénéfice de relations strictement familiales de type père-mère-enfant. Alors que sur le divan, les gens nous parlent de leurs nourrices, de leurs maîtresses d’école, de leur chien, de leurs vaches. Cela a longtemps été considéré comme des résistances au triangle œdipien, mais la théorie psychanalytique est en train de changer. Il est courant que quelqu’un ait bien tenu le choc suite à la mort d’un proche, mais s’effondre deux ans plus tard suite à la mort de son chat, pour les deux. Et d’autres assument qu’ils ont eu plus de mal à faire le deuil de leur chien que celui de leur mère. Tout le monde le sait, mais on ne l’écrit jamais.
J. P. : Ce que je me demande, c’est comment ça se passe pour les animaux. Les animaux engagés dans le travail rêvent-ils du travail ? Est-ce que les vaches rêvent du travail ?
L. G. : De quoi d’autre veux-tu qu’elles rêvent ?
Notes
| ↩1 | Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXIe siècle, 2011, La Découverte. |























