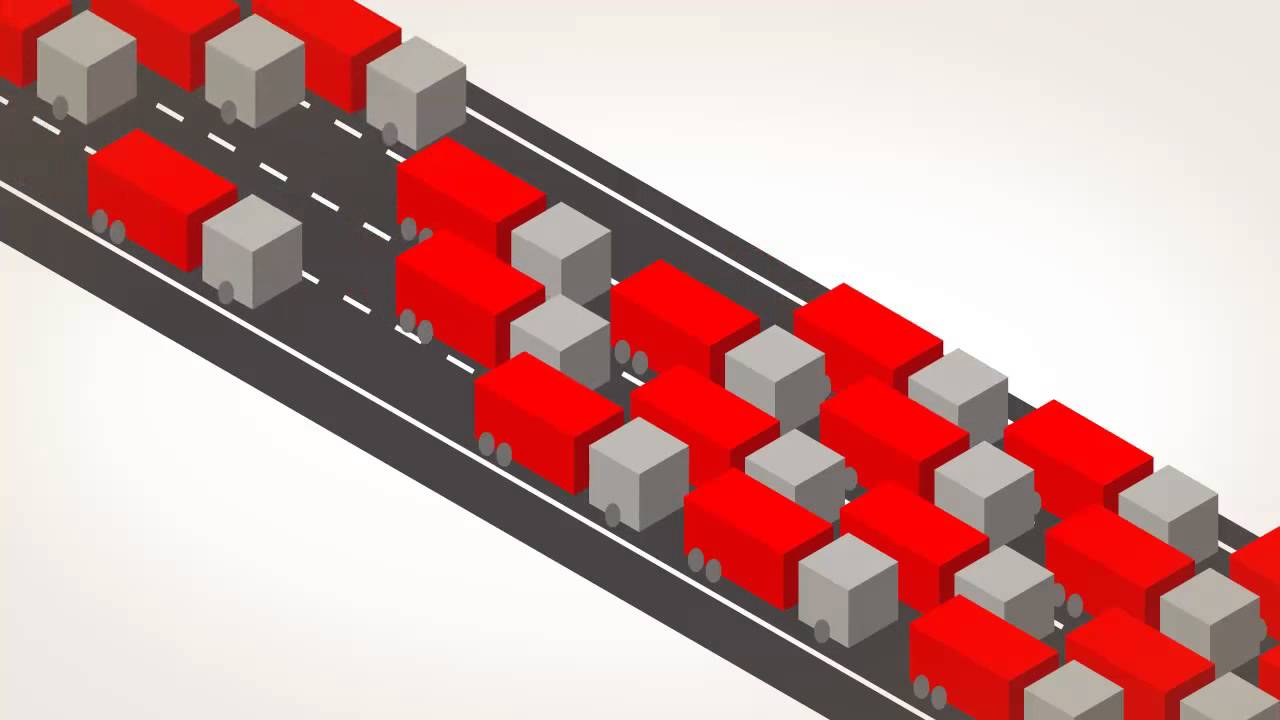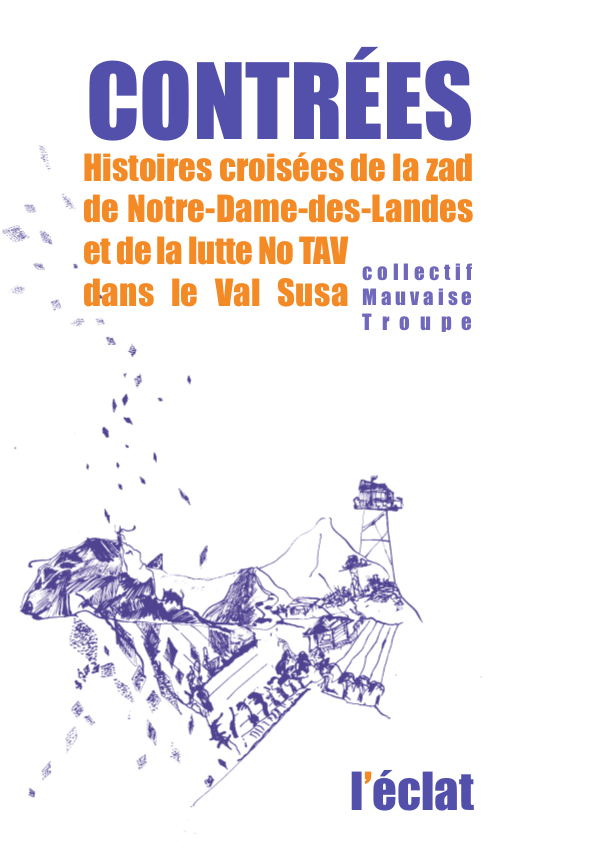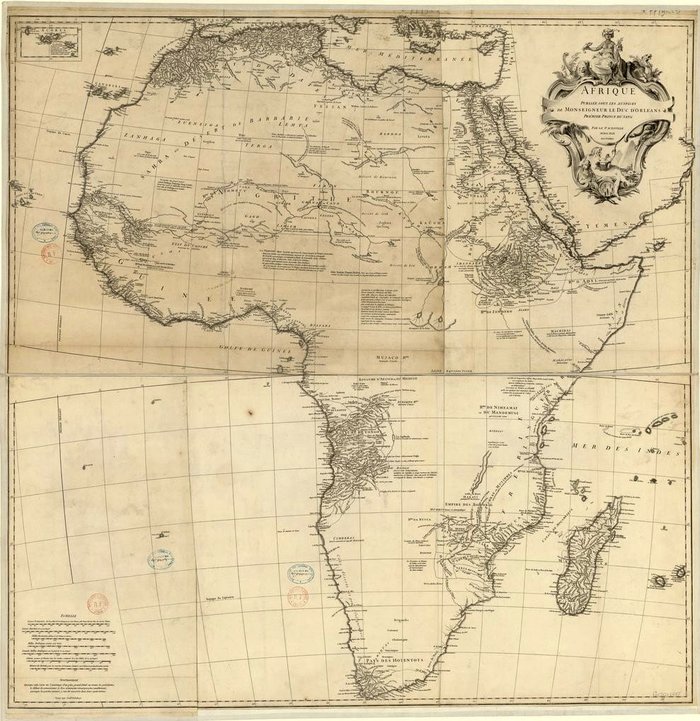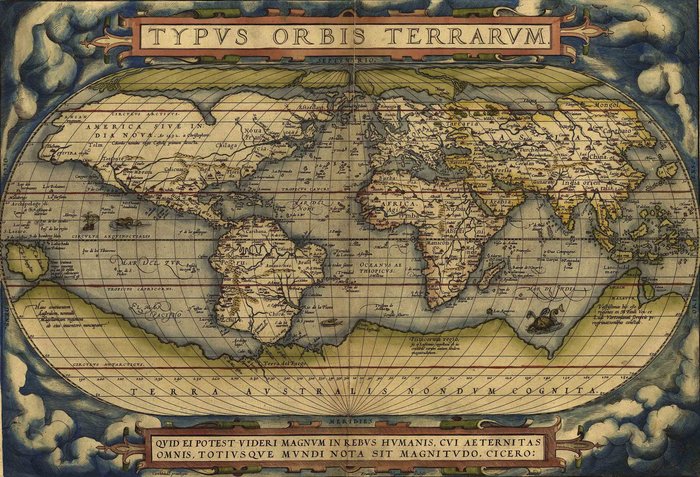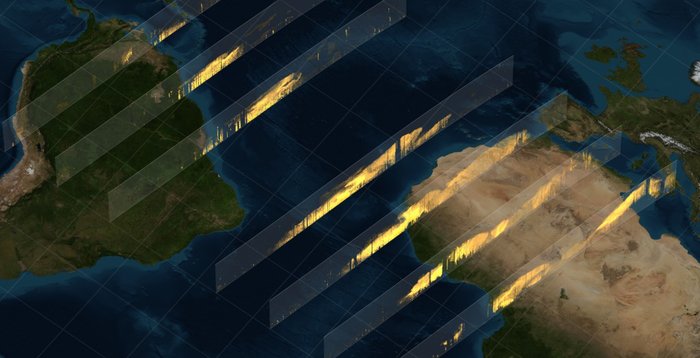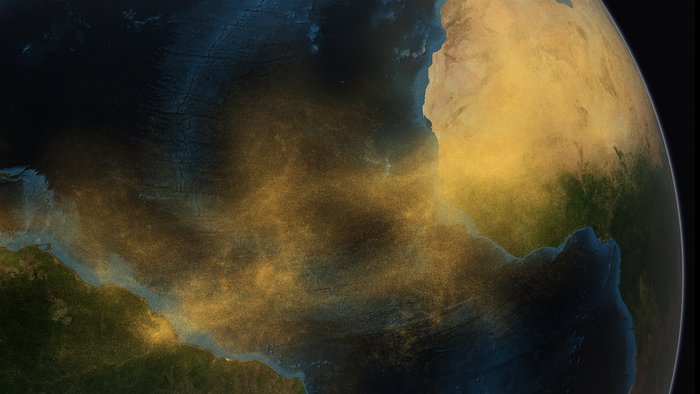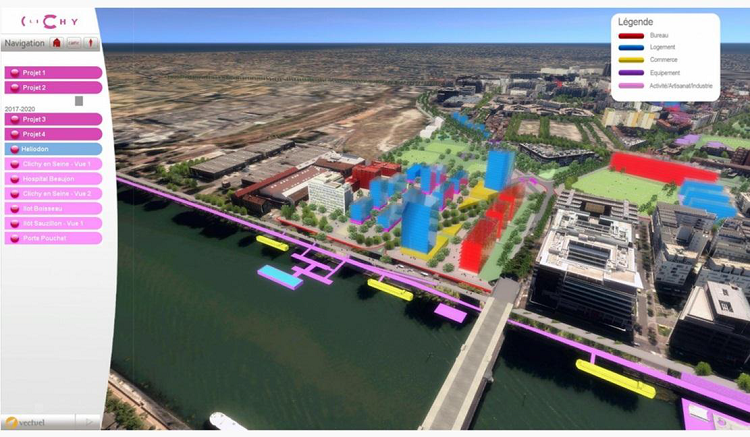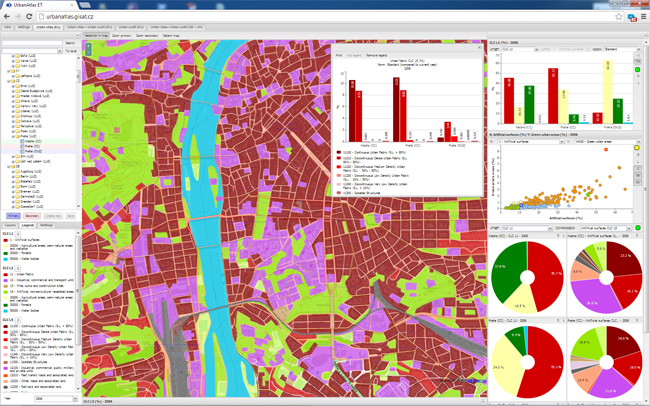Traduit de l’italien par Cabiria Chomel et Livia Cahn
Article original en deux parties, sur le site Carmilla.org – littérature, imaginaire et culture d’opposition, ici et ici.
Novembre 2015. Deux cents personnes entrent dans la gare de San Pietro Vernotico, région des Pouilles, en Italie. En bloquant les voies ferrées, elles s’opposent au plan Silletti, qui prévoit l’abattage massif des oliviers du Sud, supposément infectés par la bactérie « Xylella », ainsi que la pulvérisation massive de pesticides mortels. 46 personnes passent en procès ce 6 novembre 2017 pour « manifestation non déclarée et interruption d’un service public ». L’occasion de revenir sur une lutte contre le développement industriel imposé aux habitant.es du sud de l’Italie par l’État, les laboratoires de recherche publics et une poignée de multinationales : comment la modernité combat ses méfaits en en produisant de nouveaux. Et comment les arbres résistent.
Appel à solidarité avec les inculpé.es.
Télécharger l’article en PDF.
Il y a une armée dans les campagnes du Salento. Une armée de guerriers grands et puissants. Ancrés dans la terre, ils font barrage à tout type de spéculation. Protègent les sols menacés d’être transformés en zones commerciales, stations touristiques, champs de panneaux solaires, cultures agricoles intensives, corridors pour gazoducs. C’est une armée de onze millions d’oliviers, héritiers d’une histoire millénaire, incompréhensible pour qui mesure le temps selon le rythme saccadé des mandats électoraux.
Ces guerriers portent la culture de ces lieux, le savoir transmis depuis des générations, contrastant avec la prestigieuse érudition des technocrates. Ils sont l’oxygène qui dilue les venins des désastres chimiques d’ILVA 1 Société sidérurgique du groupe Riva SpA spécialisée dans la production et la transformation de l’acier. À Gênes et dans la région de Tarente, la production de coke (combustible de houille … Continue reading et de Cerano [2. La centrale thermoélectrique Federico II de Cerano, dans la région de Brindisi, est le site énergétique le plus polluant d’Italie, relâchant dans l’air des métaux lourds provoquant cancers du poumon, de la prostate, du pancréas, du foie, du colon, etc. Autour du site, les enfants naissent avec 18% de malformations de plus que dans le reste de l’Europe, 68 % pour les malformations cardiovasculaires. NdT. ], seuls héritages du modèle industriel qui promettait au sud de l’Italie un destin de progrès et développement. Ils sont la beauté de ces troncs tourmentés, l’ombre qui rafraîchit la terre et s’oppose aux suffocantes cathédrales de ciment.

C’est pour ça qu’il faut les abattre.
Ils sont incompatibles avec une perspective de développement prédateur, exigeant un saut qualitatif dans l’accaparement des terres. Depuis vingt ans, d’illustres savants dénoncent leur obsolescence technologique, leur faible productivité, leur manque de compétitivité. Ce n’est pas le CoDIRO (Syndrome de dessèchement rapide de l’olivier) qui brûle aujourd’hui les branches des oliviers depuis le Cap de Leuca jusqu’à Brindisi, mais une maladie tout à fait humaine.
Néolibéralisme agricole
La contamination a eu lieu à Barcelone au cours du mois de novembre 1995, lorsque se rencontrèrent des représentants de l’Union européenne et de dix États de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient [3. Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie, Turquie, auxquels s’ajoutera ensuite la Libye. ]. La stratégie de l’Union européenne consistait à mettre en place une zone de libre échange dans la région méditerranéenne, qui éliminerait les obstacles aux commerces et aux investissements, comme les droits de douane et les différentes restrictions à l’import-export. L’European Union-Mediterranean Free Trade Area (EMTFA, appelée en français Zone euro-méditerranéenne de libre-échange, EuroMed) a vu le jour le 1er janvier 2010, prévoyant, entre autres choses, la libéralisation progressive de l’importation dans les pays de l’UE d’huiles d’olive extra vierges à bas coût provenant du Sud de la Méditerranée.
C’est alors que de prestigieux docteurs en université commencèrent à accuser les oliviers italiens traditionnels de solliciter une main d’œuvre trop coûteuse face à celle des pays concurrents. Ils proposèrent « d’innover par rapport aux modèles existants, grâce à des modèles de culture alternatifs, permettant une baisse réelle des coûts de production, principalement par la diminution drastique du besoin de main d’œuvre qui pèse encore aujourd’hui plus de 80 % du coût total de la production des olives [4. Angelo Godini, L’olivicoltura italiana tra valorizzazione e innovazione, Rapport présenté à la journée d’études « Problèmes et perspetives de l’oléiculture », Academia del Georgofili, Florence, 11 février 2010.]. »
Au-delà de la question de la main d’œuvre, c’est 85 % de la production oléicole nationale qui était considérée comme obsolète. Exception faite des oliviers dédiés à la confection d’huile extra-vierge de luxe, ainsi que de quelques oasis paysagers à préserver, aux frais « des entrepreneurs du secteur agri-tourisme/hôtelier » qui en tirent des bénéfices.
Le plan des chercheurs prévoyait de remplacer l’existant par des cultures intensives d’oliviers à rendement élevé, composées de rangées denses d’arbustes mornes. Des arbrisseaux tous identiques, soigneusement sélectionnés et brevetés, tout dégarnis et sans ombre, sans branches latérales, enfin, pour ne pas gêner les outils de récolte. Des arbustes pensés pour une agriculture hypermécanisée, une agriculture dite « labour saving », pauvre en arbres et en travailleurs de la terre.
Quant aux enjeux sociaux, plus le temps passe, plus ils perdent de leur importance, étant donné que la population italienne active employée dans le secteur agricole diminue constamment et tend à devenir de plus en plus rare et chère. Lors du recensement de 1951, cette population représentait 41,8 % (plus de 60 % dans le Sud de l’Italie), tandis qu’en 2001, elle était descendue a 5,2 % (11 % dans le Sud de l’Italie).
Puisque l’abandon des campagnes est un processus irréversible, encore à l’oeuvre aujourd’hui, lors du prochain recensement de 2011, ces pourcentages auront encore baissé, allégeant d’autant les préoccupations sociales, mais augmentant considérablement les difficultés liées aux recrutement et au coût de la main d’oeuvre [5. Ibid.]. »
Tel est le raisonnement que nous livre Angelo Godini, professeur à l’Accademia dei Georgofili et directeur jusqu’en 2011 du département des Sciences des productions végétales de l’université de Bari [6. Désormais département des Sciences agricoles, environnementales et territoriales. NdT.]. Une pensée qui exprime la sensibilité sociale de l’auteur : vu que la force de travail agricole décline, introduisons des méthodes de culture qui l’affaiblira encore plus. Des mots plaisants à entendre en ces temps de crise de l’emploi.
Godini est un des pionniers de l’agriculture intensive, promoteur des premiers champs expérimentaux dans les Pouilles [7. Le premier champ expérimental d’oléiculture intensive piloté par l’université de Bari a été aménagé en 2001 à Cerignola, le deuxième en 2002 à Cassagno Murge et le troisième en 2006 non loin de Valenzano.] :
C’est à l’occasion d’un voyage en Catalogne, en novembre 1999, que nous fûmes convaincus de développer dans les Pouilles des études concernant un modèle intensif de culture des oliviers, avec une mécanisation intégrale de toutes les opérations liées à la culture… L’auteur, auquel se joignent ses collaborateurs (S. Camposeo, G. Ferrara, A. Gallotta et M. Palasciano) et le professeur F. Bellomo, du département PRO.GE.SA de l’université de Bari, s’attribue le mérite d’avoir, le premier en Italie, compris la potentialité de ce modèle innovant, en le considérant dès 1999 [8. A. Godini, ouvr. cité.]. »
Qu’y avait-il en Catalogne de si intéressant ? C’est là-bas qu’est née en 1994 la première oléiculture à forte densité, conçue et expérimentée par la société Agromillora Catalana SA – appartenant au groupe Sumarocca, d’une famille de gros entrepreneurs de la région, liés à l’indépendantisme catalan libéral conservateur [9. Le groupe Sumarroca est actif dans divers secteurs : bâtiment, panneaux publicitaires et production vinicole. Carles Sumarroca Coixet a été en poste au sein du syndicat patronal catalan et de la banque catalane. Il a été l’un des fondateurs de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) – parti indépendantiste catalan, libéral conservateur, présent au parlement de la région jusqu’en 2015, devenu Unió Democràtica de Catalunya après un scandale de corruption en 2016.].
Les oliviers d’Agromillora permettent une concentration de 1600 à 1800 arbres par hectare ainsi qu’une mécanisation intégrale des techniques de récolte. Tous les oliviers ne s’y prêtent pas : ceux-ci doivent être peu vigoureux, avec une faible croissance et une entrée en production rapide. Les variétés espagnoles Arbequina et Arbosana y sont les mieux adaptées , ainsi que la variété grecque Koroneiki.
Rapidement, la recherche a produit et breveté des clones et des variétés spécialement conçues pour les cultures intensives, comme l’Arbequina i-18® et la Koroneiki i-38®, développées par l’IRTA [10. Institut d’investigació agroalimentària de la Generalitat de Catalunya.], la SikititaP, élaborée dans le cadre du programme d’amélioration génétique de l’UCO-IFAPA [11. Universidad de Cordoba e Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía. ], ou l’Oliana®, obtenue par Agromellora. Les variétés FS-17® (ou « Favolosa ») et Don Carlo® ont été adaptées au contexte italien par le Conseil national de la recherche (CNR) de Pérouse, dans la région de l’Ombrie.
La plupart du temps, les recherches sont développées via des partenariats public/privé (PPP). Agromilla règne en maître dans ce domaine : collaborant avec de nombreuses universités espagnoles et américaines, avec l’Alma Mater de Bologne, avec l’Embrapa [12. L’Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Entreprise brésilienne de recherche agricole, Embrapa) est une entreprise d’État brésilienne fondée le 26 avril 1973 et spécialisée dans l’agronomie. Elle est largement responsable de la transformation du Brésil en grande puissance agricole en ayant notamment adapté les variétés les plus courantes (blé, maïs, soja) au climat sub-tropical d’une grande partie du Brésil, notamment du sertão et du cerrado. NdT] du gouvernement brésilien, avec le ministère de l’Agriculture états-unien, avec le CRA (Conseil pour la recherche et l’expérimentation agricole) italien, etc.
Ainsi qu’avec l’université de Bari, dans le cadre d’une convention pour « l’évaluation, le brevetage et la commercialisation de nouvelles sélections d’oliviers de faible vigueur ». Une convention selon laquelle 70 % de royalties sont versés à l’université sur l’ensemble des recettes annuelles provenant de l’exploitation des brevets issus de ce partenariat [13. Préfecture de Lecce, Decreto di sequestro preventivo d’urgenza, 18 déc. 2015, p. 18. ]. C’est dans ce cadre qu’a été développée la variété « Leciana », une évolution intensive du Leccino [14. Olint, no 27, juin 2015, p. 10. ].
Il est toujours intéressant d’assister à de tels élans d’amour entre public et privé – où le secteur privé met la recherche publique au service de ses intérêts, et où université et entreprise partagent le même goût du profit. Nonobstant, la question reste entière : à qui profitera finalement cette grande évolution du savoir humain ? Aux être vivants, humains ou végétaux, ou à cette union infernale que sont les PPP ?

Sur l’autre rivage
Une agriculture sans travailleurs de la terre. C’est le modèle proposé par l’université pour affronter lesdits ennemis de l’huile italienne : ces ouvriers agricoles « maghrébins, turcs, jordaniens [15. A. Godini, ouvr. cité. ] » qui gagnent entre 0,50 et 0,60 € de l’heure.
Oui mais… sommes-nous certains que quelqu’un ne soit pas en train de servir ce même discours aux ouvriers agricoles maghrébins ? Que la main invisible des marchés n’appartienne vraiment à personne ? N’y a-t-il réellement aucun doute sur le fait qu’elle soit dirigée par un vaste ensemble de sujets qui la meuvent selon leurs intérêts ?
Prenons un cas complètement au hasard : Agromillora. Voilà une multinationale, aujourd’hui leader dans le domaine de l’agricultural technology, spécialisée dans la production et la commercialisation des espèces ligneuses à haut rendement (oliviers mais aussi agrumes, vignes et arbres fruitiers). Ses pépinières et ses laboratoires de recherche sont présents dans neuf pays et sur cinq continents. En 2016, elle a vendu 65 millions de plantes dans le monde entier.
Peu avant l’inauguration de l’Association européenne de libre-échange (AELE [16. Le premier objectif de l’AELE est de libéraliser le commerce des produits originaires des États membres de l’Union européenne, via une organisation purement économique et intergouvernementale.]) en 1994, Agromilla a commencé à délocaliser des pépinières et des laboratoires de recherche au Maroc, en Tunisie et en Turquie, afin de promouvoir également sur l’autre rive de la Méditerranée l’expansion de cultures intensives (oléicoles ou autres) destinées à l’exportation vers l’Europe, en vue de la libéralisation des quotas et des droits. En 2015, la multinationale a également ouvert une pépinière en Jordanie. L’agriculture dite « labour saving » s’est ainsi propagée au-delà de la Méditerranée, grâce à des capitaux européens initialement investis dans ces technologies qui tuent le travail en Italie.
Il pourrait sembler paradoxal qu’une entreprise aux mains d’indépendantistes catalans, ayant contribué à faire de la Catalogne la terre de l’agriculture intensive, Sumarocca, travaille aujourd’hui à l’annulation de son avantage compétitif, en promouvant un type de culture à haut rendement chez ses concurrents. Cela n’est paradoxal que si l’on oublie qu’Agromilla n’appartient plus aujourd’hui à Sumarocca. Elle a d’abord été rachetée à 49% par le fonds spéculatif espagnol Nazca, qui en 2016 a cédé ses actions à Investcorp, un autre fond spéculatif du Bahreïn. Or ce dernier détient actuellement la majorité de l’entreprise – et l’Espagne s’en fiche.

Les profits se portent bien au Bahreïn, pendant que les royalties arrivent en Espagne grâce à la vente de plantes brevetées . En effet, face au manque de variétés locales adaptables dans les pays du Sud, telles que la Chemlali et la Chetoui tunisienne, Agromillora continue de propager en Afrique du Nord et en Asie Mineure des cultures d’Arbequina, Arbosana, Koroneiki, Sikitita, c’est-à-dire les quelques variétés du Nord qui s’adaptent à l’agriculture intensive. De manière générale, donc, où que se répande ce système, les variétés brevetées tendent à remplacer les variétés autochtones, impliquant une grande perte en biodiversité et une standardisation des productions destinées à la consommation de masse.
L’ensemble de la Méditerranée se retrouve dès lors à produire une huile d’olive uniforme en termes de qualité et de saveur, qui ne se différencie que par le prix, dans une course au rabais effrénée. Dans ce genre de cas, le travail humain est le premier à en faire les frais. Et pas seulement celui des ouvriers agricoles. Plus largement, l’agriculture intensive se passe très bien de paysans.
Il s’agit d’une agriculture d’entrepreneurs et d’investisseurs qui n’a besoin que de capitaux de base et d’une vaste quantité de terres pour installer ses plantations. Cela va de pair avec le processus de concentration de la propriété terrienne, comme au Maroc où l’Oléa Capital – un fonds d’investissement créé par le Crédit agricole du Maroc et la Société générale – a développé des plantations d’oliviers à forte densité sur des milliers d’hectares. Les petites et moyennes parcelles des paysans traditionnels, avec leurs faibles capacités d’investissement, sont un obstacle.

De ce côté du rivage
De ce côté-ci du rivage, le bilan moral n’est pas plus rose.
Les autorités de la recherche publique du vieux continent (financées par nous) participent à des PPP qui ont pour but final la destruction du travail et de la biodiversité, en plus d’un accroissement des profits pour les entreprises de l’agricultural technology, ainsi que pour les fonds d’investissements spéculatifs. Pendant ce temps là, en Italie, malgré tous les efforts des « sachants », l’oléiculture intensive n’a eu jusqu’à présent que peu de succès, avec 1200 hectares sur plus d’un million dédiés à la récolte d’olives au niveau national [17. Olint, no 27, giugno 2015, p. 8. Confagricoltura Puglia, L’olivicoltura pugliese. Criticità e sviluppo, p. 3. ].
Là où je vis, dans la partie basse du Salento, la grande majorité des paysans n’ont pas les capitaux nécessaires à la mise en place des infrastructures, ni de grandes propriétés terriennes qui permettent de les rentabiliser. Par ailleurs, même les entreprises agricoles plus structurées, attentives au rapport coût/bénéfice, se demandent pourquoi devraient-elles planter des milliers d’arbrisseaux, attendre trois ans avant qu’ils soient productifs et les retirer au bout de quinze ans (telle est la durée de leur productivité), quand ils ont à leur disposition des oliviers qui résistent depuis des siècles ou des décennies et donnent des fruits chaque automne sans réelles interruptions ?

Pourquoi devraient-ils planter des arbustes qui requièrent une irrigation importante, sur une terre où il n’y a pas de rivières et où les pluies sont rares, quand les oliviers traditionnels ne nécessitent pas d’irrigation supplémentaire ? Pourquoi devrait ils dépenser plus en herbicides et pesticides en grandes quantités comme l’exige une agriculture de type intensive ? Pourquoi payer les pépinières et les royalties tous les 15 ans pour racheter les plants ? Tout ça pour produire de l’huile d’une qualité nettement inférieure ?…
Pour donner un exemple : l’huile de la traditionnelle Cellina di Nardo (variété locale) contient en moyenne 350mg/kg de polyphénols [18. Les polyphénols constituent une famille de molécules organiques largement présente dans le règne végétal, caractérisés par la présence d’au moins deux groupes phénoliques. Ils sont reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la santé : leur rôle d’antioxydants naturels suscite de plus en plus d’intérêt pour la prévention et le traitement du cancer, des maladies inflammatoires, cardiovasculaires et neurodégénératives. NdT.] ; en comparaison, la teneur en polyphénols de l’huile d’Arbequina, Arbosana, Koroneiki varie entre 123 et 187 mg/kg. Une différence telle que même les supporters de l’intensif suggèrent la possibilité de « corriger » leur huile brevetée avec un ajout d’huile traditionnelle « s’il devait y avoir un manque d’un composant essentiel [19. Camposeo S., Vivaldi G.A., Gallotta A., Barbieri N. e Godini A., Valutazione chimica e sensoriale degli oli di alcune varietà di olivo allevate in Puglia con il modello superintensivo, Actes de la Convetion nationale sur l’huile et l’olive, Portici (NA), 1-2 oct. 2009, p. 295-298. ] ». Certaines analyses publiées dans les revues spécialisées finissent même par avouer que ce type de production « n’est pas si avantageuse » en termes de coûts et résultats.
À moins que…
À moins qu’une épidémie ne commence à dessécher les oliviers.
À moins que l’Union européenne, sur le conseil d’illustres docteurs, n’en impose alors la destruction (et non le soin).
À moins qu’on ne permette de replanter dans les zones infectées seulement ces cultivars [20. Variété de plante obtenue en culture, généralement par sélection, pour ses caractéristiques réputées uniques : qualités morphologiques, esthétiques, techniques, de vitesse de croissance , d’adaptation à un biotope ou de résistance à certaines maladies. NdT. ] qui, comme par hasard, s’adaptent mieux au modèle intensif.
Mais ce serait là de la pure science fiction…
Ou peut-être l’histoire d’aujourd’hui.
On abat bien les arbres
Ils vinrent avec les bulldozers.
Ils vinrent avec leurs uniformes et une feuille à la main : « Injonction d’abattre, au nom de la loi, de l’Europe et de la Science ». Au nom d’analyses menées dans le secret des laboratoires, et qui n’ont jamais été montrées aux propriétaires terriens.
C’était le 13 avril 2015, lorsque le premier olivier séculaire d’Oria (province de Brindisi), marqué comme étant infecté, éclata en morceaux sous les tronçonneuses. Autour, les paysans indignés et solidaires, avaient réussi en protestant, à bloquer les bulldozers pendant quelques heures.

Triste épilogue de la gestion du gouvernement régional de Vendola, qui avait commencé avec la loi de Protection des oliviers millénaires et qui se terminait par leur abattage. Ce même service phytosanitaire régional qui devait défendre ses ancêtres et qui a finalement servi à les condamner.
Trois mois auparavant, le Conseil des ministres avait décrété l’état d’urgence « suite à la propagation sur le territoire de la région des Pouilles de la bactérie pathogène de quarantaine Xylella Fastidiosa [21. Déclaration du Conseil des ministres du 10 février 2015 : déclaration de l’État d’urgence pour la diffusion de la bactérie Xylella fastidiosa dans les Pouilles, 10 février 2015. ] ». Rien de nouveau sous le soleil du pays de l’urgence permanente.
L’ennemi : un micro-organisme transporté par un insecte, banni par l’Union européenne et accusé d’être le seul responsable du dessèchement rapide, qui depuis des années brûle les oliviers de l’agriculture de Lecce et Brindisi. Un ennemi à annihiler par pulvérisation massive de poison contre les insectes porteurs, et par l’abattage massif des arbres, dans une logique à courte vue, où pour sauver les oliviers, il faut les détruire et détruire avec l’équilibre de leur écosystème.
Hypothèse : peut-être que sauver les oliviers traditionnels du « dessèchement rapide » n’était pas vraiment dans l’objectif de tout le monde.

Combattre le mal par le pire
Le « syndrome de dessèchement rapide des oliviers » (CoDIRO) est une phytopathologie qui porte une complexité [22. Syndrome, ou complexe : complesso en italien. NdT.] déjà inscrite dans son nom. Et la science semblait avoir pris acte d’une telle complexité dans les premières années de développement de la maladie, en la considérant comme le résultat de l’attaque d’une série de facteurs pathogènes en connexion entre eux, dans un contexte de baisse des défenses immunitaires des arbres due à… la dégradation des terres à cause des pesticides.
De nombreuses analyses révèlent sur les arbres malades, non seulement la présence sporadique de Xylella fastidiosa, mais également l’existence de champignons lignicoles qui empêchent la circulation lymphatique, cela s’ajoutant aux galeries creusées par les larves des zeuzères qui ouvrent la voix aux infections fongiques. De quoi suggérer que la bactérie de quarantaine n’est pas seule responsable de la pathologie. L’Observatoire phytosanitaire régional a ainsi découvert une multiplicité de pathogènes, via les études menées à l’université de Foggia, l’université et le CNR de Bari, et le Réseau des laboratoires publics de recherche SELGE [23. Note du 15/10/2013 no 16/2013 du CRN – Institut de Virologie végétale de Bari, Université des études de Bari, Département des Sciences du Sol, de la Plante et des Aliments, Selge – Réseaux des Laboratoires Publics de Recherche. Antonia Carlucci, F. Lops, F. Cibelli, M. L. Raimondo (2015). « Phaeoacremonium Species associated with Olive Wilt and Decline in southern Italy », European Journal of Plant Pathology (2015) 141:717–729 DOI 10.1007/s10658-014-0573-8. A. Guario, F. Nigro, D. Boscia, M. Saponari, « Disseccamento rapido dell’olivo. Cause e misure di contenimento », Informatore Agrario, no 46, 2013, p. 51/54. Nigro F., Boscia D., Antelmi I., Ipp olito A. (2013), « Fungal Species associated with a severe Decline of Olive in southern Italy », Journal of Plant Pathology, 95, 668. Nigro F., Antelmi I., Ippolito A. (2014), « Identification and characterization of fungal species associated with the quick decline of olive. Proceedings International Symposium of the European Outbreak of Xylella fastidiosa », dans Olive. Gallipoli-Locorotondo, Italie, 29. ].
Pietro Perrino, directeur de l’Institut de Germoplasma du CNR de Bari, a quant à lui mis en corrélation la forte utilisation de glyphosate, utilisé pendant des décennies pour désherber les oliviers, avec une plus grande vulnérabilité des arbres, l’appauvrissement des sols, la destruction d’un équilibre micro-biologique, la virulence des infections fongiques [24. Pietro Perrino, « Xylella ? Les vraies causes du CoDIRO sont le glyphosate, les venins et la criticité du système », Il Foglietto, 22 juillet 2015. ]. Et Cristos Xiloyannis, doyen de l’université de Basilicate, de démontrer l’importance de renforcer les défenses immunitaires des oliviers en les nourrissant, en restaurant la strate de substances organiques détruite par des décennies de gestion chimique des sols [25. « Cures durables contre Xylella, la méthode Xiloyannis fait le tour de l’Italie », Telerama news, 29 mai 2015. ].
Un type d’intervention antithétique à celles imposées par la Commission européenne, dont l’objectif a toujours été ouvertement d’avoir exclusivement recours à « l’éradication » (l’usage des guillemets est ici nécessaire étant donné les faibles possibilités d’une réelle éradication) de la bactérie de quarantaine, même si cela implique des doses massives de produits chimiques. Le recours au diagnostic des causes complexes du CoDIRO ainsi que le recours aux cures sont pour leur part exclus, surtout s’il s’agit de méthodes allant à l’encontre du marché des pesticides.
Identifier un objectif restreint, coupé de son contexte, et avancer au bulldozer, sans se préoccuper des méthodes utilisées et de leurs conséquences plus ou moins dévastatrices, voilà qui est typique de la mentalité technocrate. C’est par exemple le cas de la décision exécutive UE 2015/789 qui impose, dans un rayon de 100m de toute plante supposément infectée par Xylella, la suppression de tous les arbres potentiellement porteurs de la pathologie, indépendamment de leur état de santé.
Concrètement, l’UE a ordonné de créer un désert de trois hectares autour de chaque olivier déclaré positif aux analyses. Une mesure dévastatrice et dont il est permis de douter de l’efficacité, si l’objectif est bien celui d’éradiquer la bactérie. En effet, au niveau mondial, les échecs sont nombreux pour éliminer Xylella par la destruction des plantes, comme le montre le recensement de l’European Food Safety Authority (EFSA) : « Les tentatives d’éliminer X. fastidiosa ont été faites partout dans le monde, dont l’élimination de la chlorose panachée des agrumes au Brésil et la maladie de Perce sur les vignes du centre de Taïwan. Malgré ces tentatives, le pourcentage de plantes infectées au Brésil est passé de 15,7 % en 1994 à 34 % en 1996 et, selon des enquêtes récentes, environs 40 % des 200 millions de plantes d’oranges douces à São Paolo sont infectées par X. fastidiosa. À Taïwan, la maladie persiste malgré la suppression de milliers de vignes touchées par la maladie de Pierce, depuis la découverte de la maladie en 2002. En Californie, la maladie de Pierce est endémique. Purcell observe que “malgré l’éradication des vignes à divers endroits, ce qui a impliqué des opérations de grande ampleur sur plusieurs années, il n’y avait aucune preuve que l’effort d’éradication n’ai eu un quelconque avantage mesurable.” »

Empoisonnement de masse
La Commission européenne était au courant de ces échecs, étant donné que l’EFSA est sa consultante scientifique en ce qui concerne Xylella. Mais l’inutilité de ces destructions préconisées n’a pas suffi à changer la donne, et l’Italie a été mise sous procédure d’infraction pour n’avoir pas détruit assez. Ou, pour le dire avec les mots de Pietro Perrino, généticien au CNR : « En lisant les directives des décisions de la Commission européenne, on a l’impression que celle-ci fixe d’abord l’objectif qu’elle veut atteindre (l’abattage des oliviers), puis qu’elle construit astucieusement le chemin pour y arriver. »
Pour tenter de résoudre l’urgence imposée par Xylella dans le Salento, toutes les mesures normatives européennes, nationales et régionales prévoient des actions à fort impact écologique, comme la pulvérisation d’insecticide afin d’éliminer le Philaenus Spumarius, l’insecte porteur. À ce propos l’EFSA, avertit : « L’utilisation intensive du traitement par insecticide pour limiter la transmission des maladies et le contrôle du vecteur par insectes, peut avoir des conséquences directes et indirectes sur l’environnement en modifiant complètement des chaînes alimentaires, ce qui entraîne des conséquences par cascade impliquant différents niveaux trophiques. Par exemple, l’impact indirect des pesticides sur la pollinisation est actuellement une question de grande importance. Par ailleurs, les traitements à grande échelle par insecticides présentent également des risques pour la santé humaine et animale. »

Peu importe, l’utilisation massive des insecticides a été imposée aux agriculteurs, avec contrôle des factures [26. D.M. 2777/2014 – « Mesures phytosainaitaires obligatoires pour la retenue des contaminations de Xylella fastidiosa à appliquer dans la zone infectée ». région des Pouilles, Determinazione del Dirigente Ufficio Osservatorio Fitosanitario, 6 février 2015, no 10. ] attestant de leur emploi. Un empoisonnement massif, un dommage environnemental aux conséquences imprévisibles. La région des Pouilles conseille en particulier l’utilisation :
-
du chlorpyriphos : reconnu par le ministère de la Santé italien comme un perturbateur endocrinien, avec de graves effets sur le foetus et les enfants.
-
du diméthoate : neurotoxique. Nocif pour l’humain par ingestion, inhalation et contact avec la peau.
-
Des pyréthrinoïdes: neurotoxiques. N’étant pas sélectifs, ils éliminent tous les insectes dans le champ de pulvérisation.
-
De l’éthofenprox : toxique pour les abeilles et autres insectes non ciblés.
-
De l’imidaclopride : néonicotinoïde. Suspecté d’être responsable de la mort massive d’abeilles de 2008 à 2009, ainsi que de celle d’insectivores.
-
De la buprofézine : irritant.

Appel à solidarité avec les inculpé.es.
Notes
| ↩1 | Société sidérurgique du groupe Riva SpA spécialisée dans la production et la transformation de l’acier. À Gênes et dans la région de Tarente, la production de coke (combustible de houille hautement toxique) a entraîné une augmentation de 10 à 15 % de la mortalité entre 1995 et 2002. Dans la région de Tarente, cela représente environ 38 000 morts. 53 hauts responsables politiques et dirigeants de la firme ont été poursuivis pour « désastre environnemental ». NdT. |