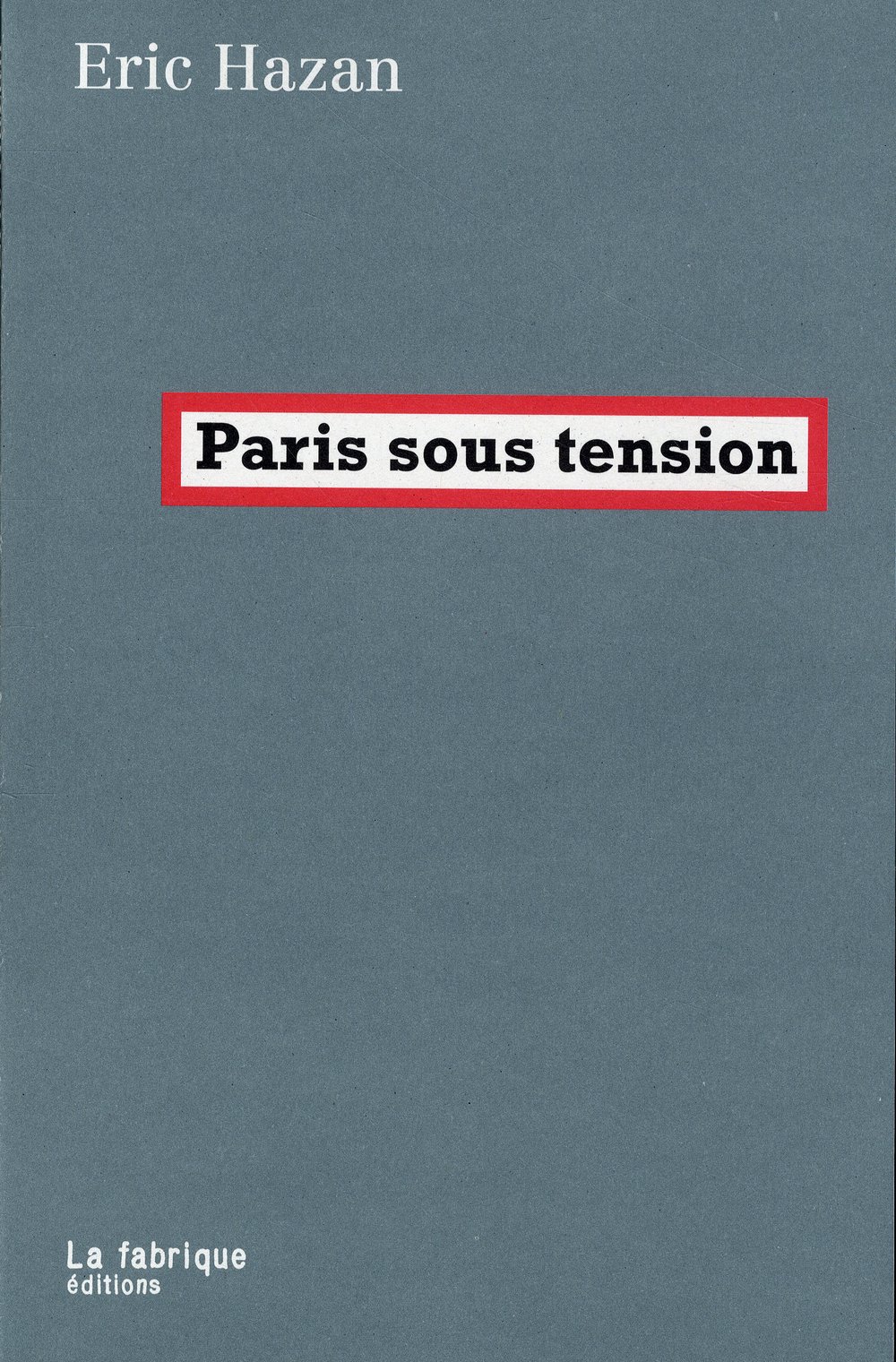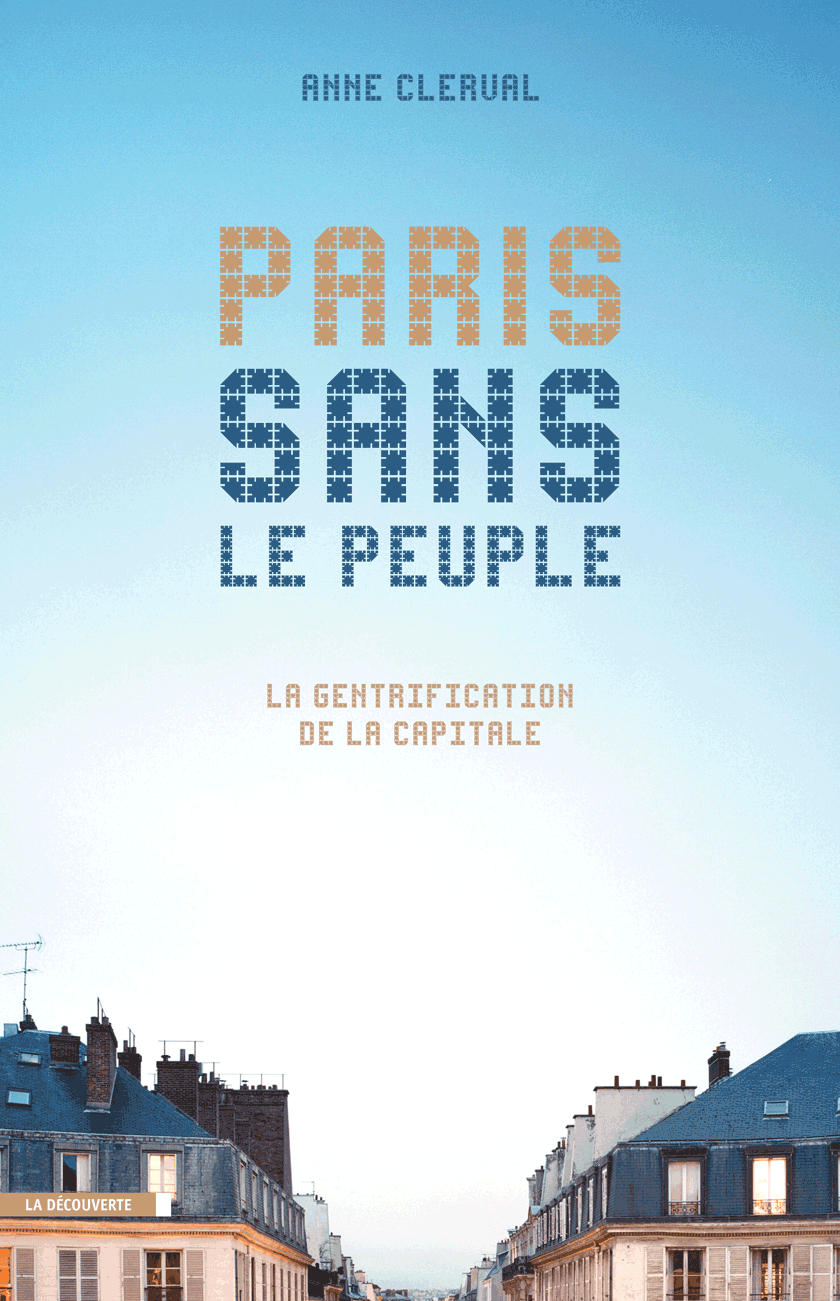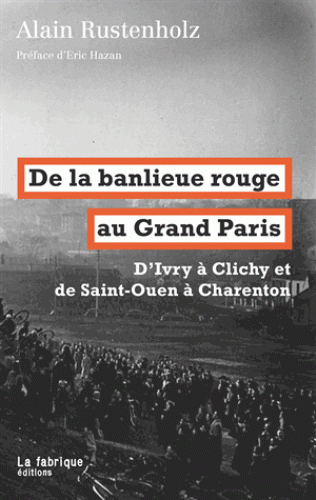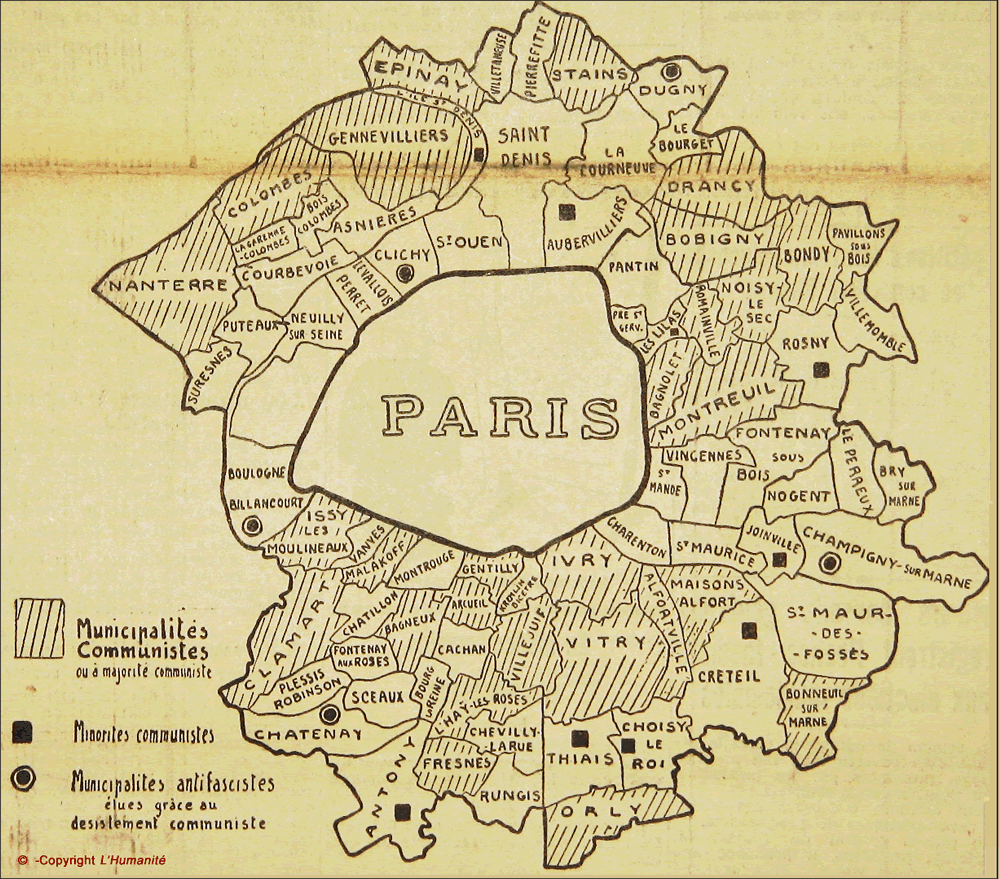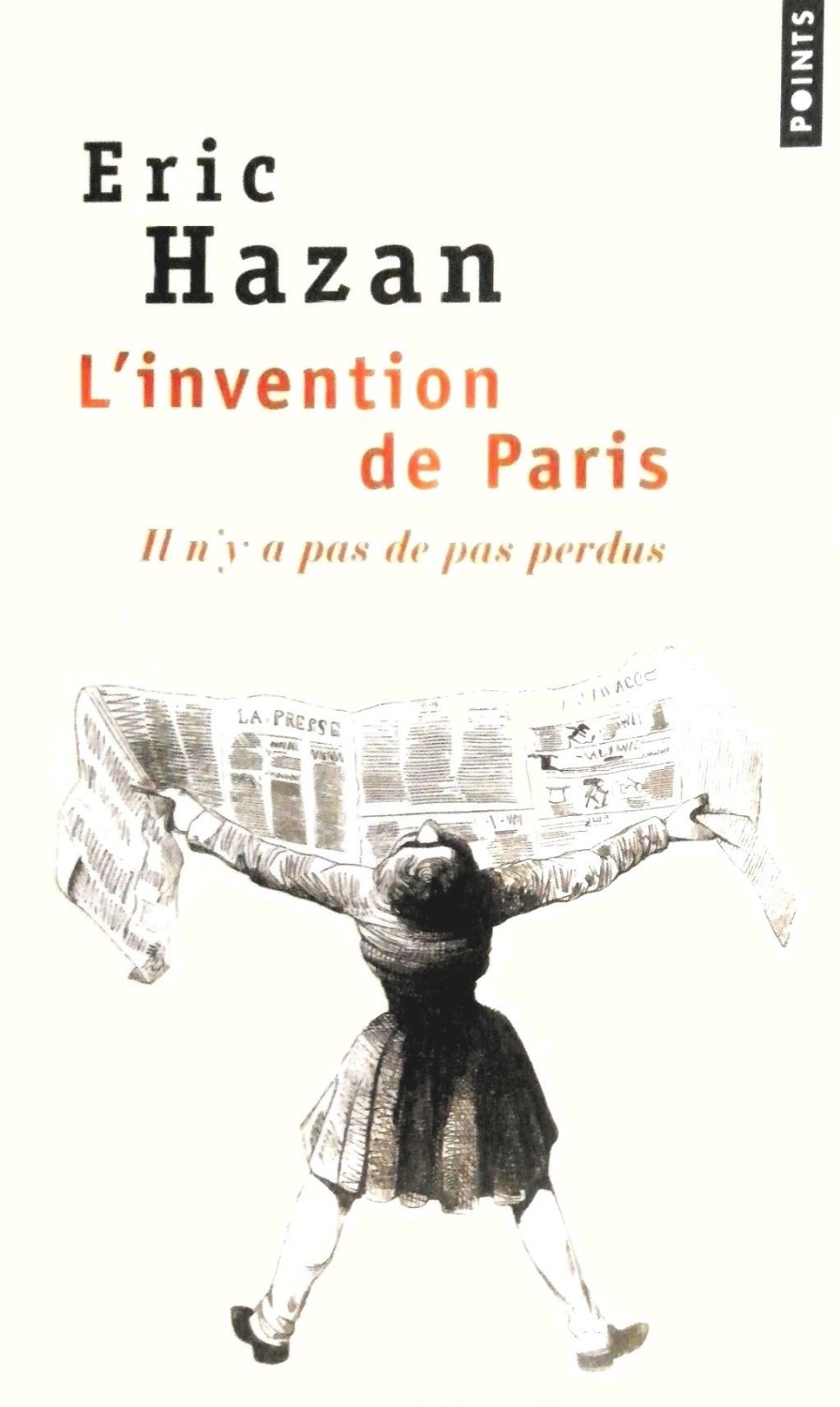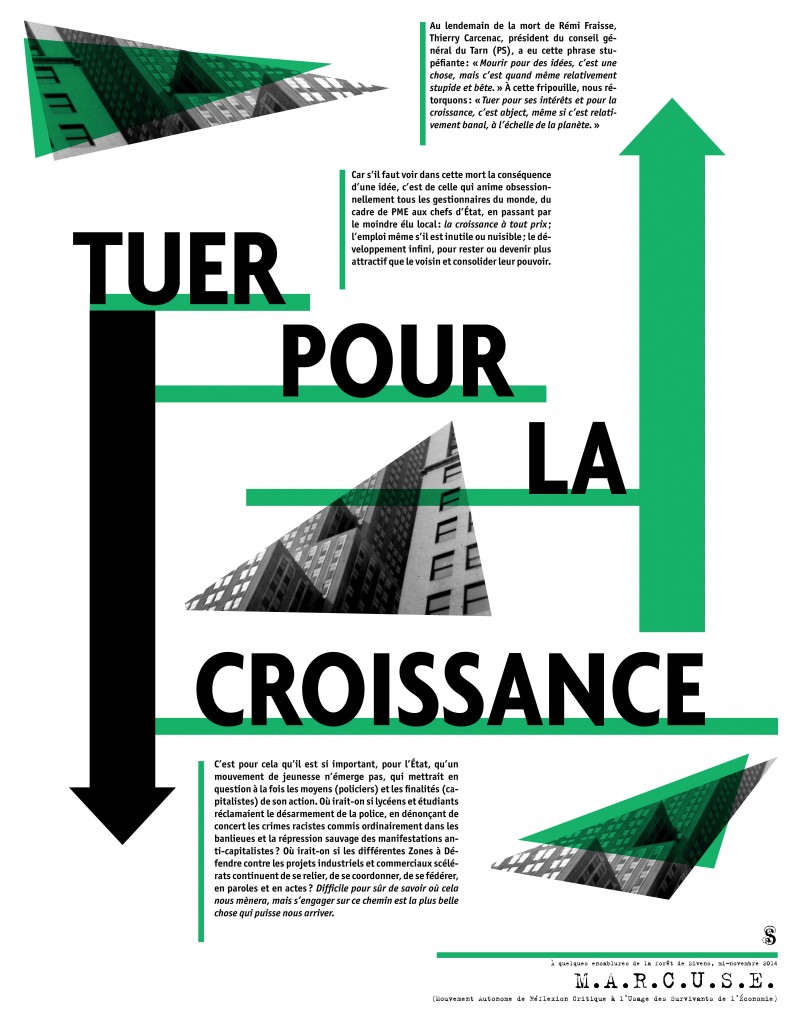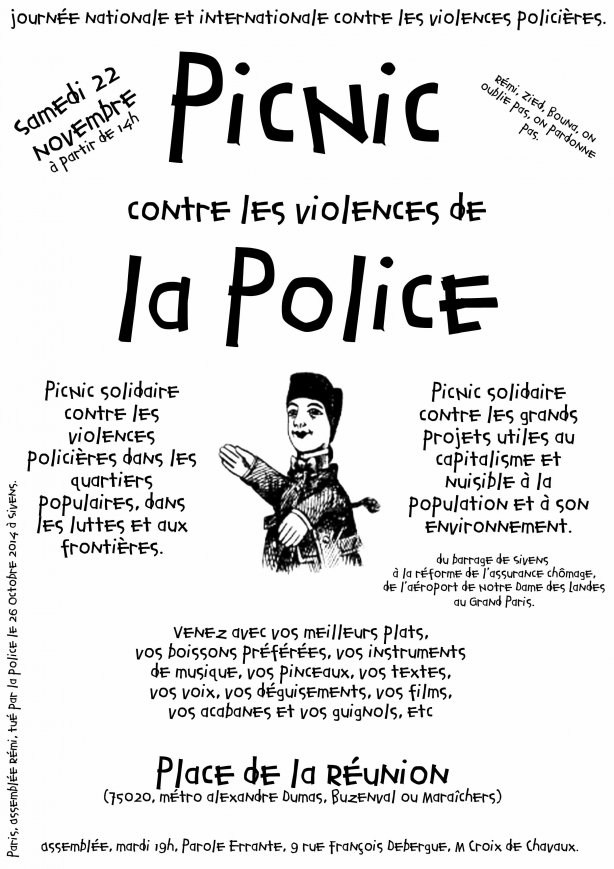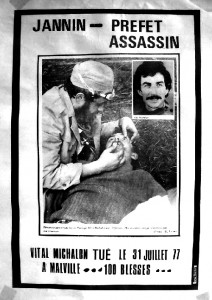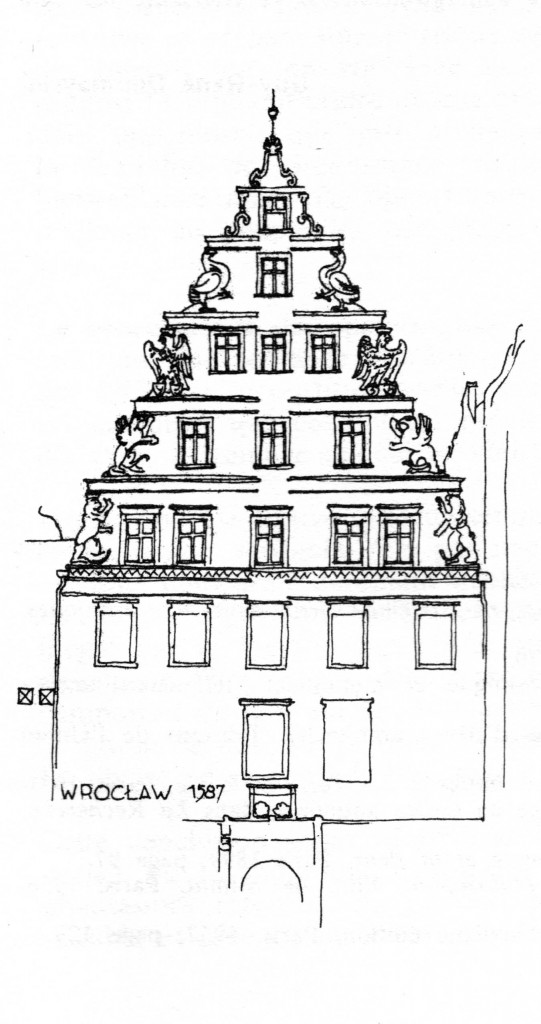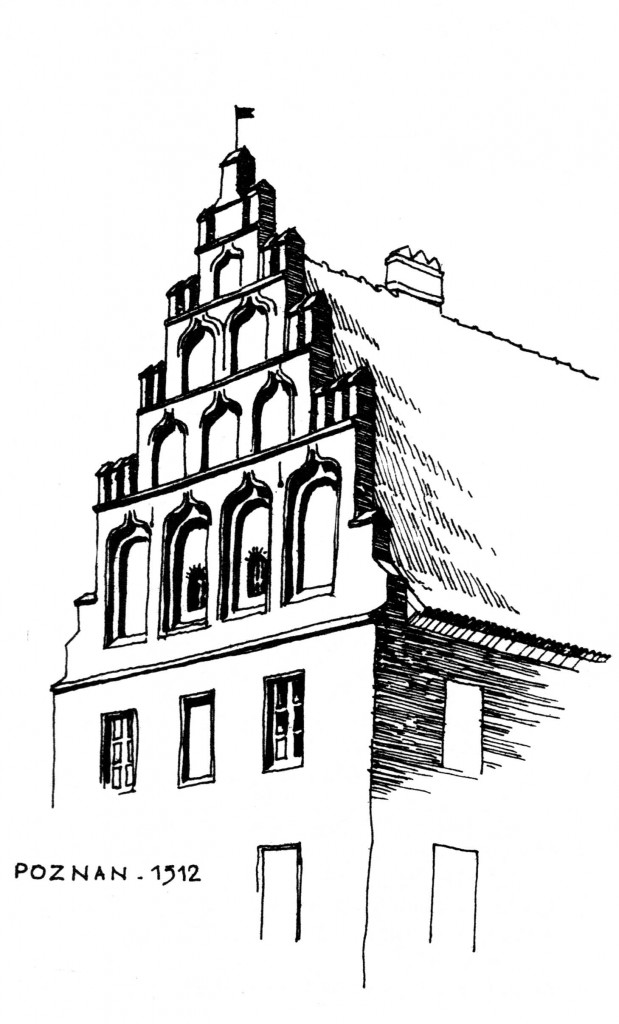Quand Google se met à investir dans l’immortalité et engage le champion du transhumanisme Ray Kurzweil à un poste clé de son organigramme, on peut se demander où la société californienne veut en venir. Quand l’Armée américaine investit des milliards dans l’augmentation biomécanique du corps humain et que des chantiers européens de grande envergure comme l’Humain Brain sont financés pour modéliser le cerveau humain et permettre une plus grande fusion entre biologique et informatique, on peut se demander où les États veulent en venir. Mais d’où ces idées viennent-elles ? Il faudrait aussi analyser les mythes fondateurs de cette course au cyborg dans laquelle se sont lancées les grandes puissances économiques et étatiques… Où l’on verrait ressurgir des idéologies et des mystiques qu’on pensait oubliées.
Ce texte est extrait du numéro 1 de Jef Klak, «Marabout», dont le thème est Croire/Pouvoir. Sa publication en ligne est la dernière d’une série limitée (6/6) de textes issus de la version papier de Jef Klak, toujours disponible en librairie.
Peut-on menacer d’autre chose que de mort ?
Ce qui serait intéressant, original,
serait de menacer d’immortalité.
Jorge Luis Borges
Il aime être appelé Blade Runner. Été 2011, l’athlète sud-africain Oscar Pistorius devient la coqueluche des médias sportifs. Amputé des deux jambes, il s’est mesuré aux coureurs valides lors des épreuves de 400 mètres du Championnat du monde d’athlétisme. Grâce à ses prothèses innovantes – des lames de carbones lui donnant une allure de félin – Pistorius1 Devenu héros national en Afrique du Sud, Oscar Pistorius fait depuis régulièrement la une des tabloïds pour ses frasques, son goût pour les armes à feu et les belles voitures. Il a été … Continue reading est passé sous le chrono de la fédération sud-africaine pour accéder à cette compétition.
Premier athlète handicapé à se qualifier aux épreuves pour valides aux Jeux olympiques de Londres l’année suivante, Pistorius devient à la fois héros national en Afrique du Sud et objet de controverse au sein du monde sportif : ne serait-il pas avantagé par ses prothèses ? Son handicap ne se serait-il pas transformé en avantage physique ? Doit-il être considéré comme un athlète réparé suite à son amputation ou comme un homme augmenté grâce à la technologie de ses prothèses ?
Prothèses, exosquelettes et intelligence artificielle
Dans le champ de la médecine, les limites entre réparation et augmentation pour les personnes en situation de handicap s’estompent. Les prothèses de main « biomécatroniques » tournent désormais à 360° et les nouveaux implants rétiniens ou cochléaires sont sensibles aux infrarouges ou aux ultrasons. Aimee Mullins, ancienne championne paralympique née sans péronés, mannequin égérie d’une marque de cosmétiques, aime rappeler que son dressing recèle une bonne quinzaine de paires de jambes différentes : « Nous avons déjà nos prothèses : nos portables, ordinateurs… Un jour, nous aurons des membres sous garantie avec option, des prothèses au choix dans nos armoires2 Le Monde, 21 mai 2011.. »
Les frontières entre nos corps biologiques et les technologies de réparation médicale disparaissent : les premiers pacemakers datent des années 1960, et de nombreuses sociétés privées (RSLSteeper avec leur main bionique BeBionic3 ou encore Touch Bionics) ont depuis rendu à plusieurs milliers de personnes amputées de leur bras les fonctions de préhension, voire le sens du toucher, grâce à des membres bioniques branchés directement sur le système nerveux. Affectueusement nommée Luke en référence à Star Wars, une des mains bioniques les plus innovantes, fabriquée par Deka Integrated Solutions, a même bénéficié d’un investissement de 40 millions de dollars de la part de la Darpa, l’Agence états-unienne pour les projets de recherche militaire.
Les technologies d’augmentation du corps humain intéressent en effet de très près l’armée américaine. Dès 2000, l’agence lance un programme « Exosquelettes pour l’augmentation des performances humaines » doté d’un budget de 75 millions de dollars. Ces exosquelettes, sortes d’armures de combat high-tech, permettent de décupler la puissance des soldats sur le terrain. Le projet Talos (en référence au géant de bronze envoyé par Zeus pour protéger l’île de Crète) a été testé cet été et mobilise actuellement 56 sociétés, 16 agences gouvernementales et 13 universités. En France, le projet Hercule (autre mythe, autre budget – 3 millions d’euros), présenté dans les salons de l’armement depuis 2011, est soutenu par la Direction générale de l’armement (DGA) ; une version civile serait commercialisable d’ici peu, pour la réduction de la pénibilité du travail physique ou la rééducation post-traumatique.
Ces dernières années, la rationalisation et l’informatisation des systèmes armés a considérablement réduit le nombre d’hommes engagés sur les zones de conflit. Appui technique de la doctrine « Zéro mort » pour toute opération militaire, les drones militaires se sont ainsi généralisés et, depuis 2004, près de 5000 personnes auraient déjà été tuées par des drones de la CIA au Pakistan3 AFP, 21 février 2013.. Moins « performant » qu’une machine, l’humain est interprété comme une source d’erreur potentielle dans les systèmes de défense, et les fonds de recherche et développement ont massivement investi vers l’automatisation de la guerre. La Darpa mise ainsi sur le développement de l’intelligence artificielle pour créer des systèmes militaires autonomes : des « essaims » de drones qui peuvent ensemble élaborer des tactiques de combat en fonction de l’environnement sans aucune intervention humaine. L’agence a également investi 58 millions de dollars pour mettre au point un drone naval autonome aussi performant et intelligent qu’un navire avec équipage, et elle a soutenu la création d’un robot humanoïde nommé Atlas (contrat de développement de 11 millions de dollars). En 2009, un « Big Dog » était testé en Afghanistan, robot quadrupède piloté par un ordinateur embarqué permettant de transporter de lourdes charges.
Avec huit autres entreprises de robotique, Boston Dynamics, la société qui a créé pour la Darpa le robot Big Dog et l’humanoïde Atlas, a été rachetée en décembre 2013 par Google. Le moteur de recherche a également repris DNNresearch, une start-up canadienne qui travaille dans les neurosciences, ou encore Deep Mind, spécialisée en intelligence artificielle pour 500 millions de dollars début 2014. Afin d’améliorer la puissance de son moteur de recherche omniprésent dans la vie quotidienne et acteur incontournable de l’économie mondiale, Google s’intéresse de plus en plus à la compréhension du cerveau humain, pour développer des algorithmes capables d’anticiper les comportements des internautes. Via son laboratoire de recherche Google X, la firme travaille également à la réplication informatique des schémas de pensée humaine dans une machine capable d’apprendre par elle-même. Google a par ailleurs créé en septembre 2013 Calico, une société de biotechnologie dédiée à la lutte contre le vieillissement et aux maladies associées. Enfin, à l’échelle industrielle, les Google Glass, lunettes augmentant les capacités visuelles en étant connectées en permanence aux fonctionnalités du moteur de recherche, sont d’ores et déjà dans le commerce.
Prothèses technologiques sur ou dans nos corps, guerre avec des hommes surpuissants assistés par la technologie, systèmes de défense automatisés et autonomes, acquisitions de Google au croisement de la robotique, de l’intelligence artificielle et des biotechnologies… Toutes ces orientations médicales, militaires, industrielles et technologiques sont motivées par la « convergence NBIC » : l’avènement de recherches scientifiques pluridisciplinaires alliant les nanotechnologies, les biotechnologies, l’intelligence artificielle et les sciences cognitives. Or de tels bouleversements dans des domaines sociétaux aussi cruciaux ne peuvent être interprétés sous un prisme purement technique. Il n’existe en effet pas de « main invisible » du progrès, et si de tels budgets sont alloués à certains secteurs de la recherche et développement, c’est qu’un type d’idéologie y concourt, qu’elle soit économique ou plus… spirituelle. Ainsi, la « philosophie transhumaniste », dont les chantres acquièrent de plus en plus de postes clés dans les sphères décisionnelles, est-elle bien souvent à l’œuvre dans la prospective de ces nouvelles technologies, en proposant autant de concepts que de symboles nourrissant les innovations en cours.
Cyberculture & techno-utopies financées
La paternité du mot « transhumanisme » est attribuée au biologiste Julian Huxley (frère de l’écrivain Aldous Huxley, auteur de Le meilleur des mondes) en 1957, qui définit le transhumain comme « un homme qui reste un homme, mais se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles de, et pour, sa nature humaine4 Julian Huxley, « Transhumanism », New Bottles for New Wine, Chatto & Windus (1957).. » Courant de pensée protéiforme qui prend ses racines au sein de la Silicon Valley en Californie dans les années 1980, le transhumanisme repose sur un postulat simple : le corps humain n’est qu’un ensemble de fonctions biologiques aux capacités limitées et non maximisées. Il serait possible de s’affranchir des limites physiques et biologiques par l’hybridation puis la fusion du corps avec les technologies nées de la convergence NBIC, en manipulant les atomes (la matière), les gènes (le vivant), les bits (l’information) et les neurones (les sensations).
Cette pensée puise ses origines dans la contre-culture californienne des années 1960, quand les communautés hippies côtoyaient les jeunes chercheurs et entrepreneurs de la Silicon Valley5 Avec son Whole Earth Catalog publié entre 1968 et 1972, le journaliste et auteur Stewart Brand a beaucoup participé au rapprochement de ces deux « communautés »., à une époque où les tout premiers ordinateurs étaient accueillis comme une technologie d’émancipation spirituelle pour l’humanité6 Principe spirituel New Age qui a notamment influencé Steve Jobs, créateur de la société Apple.. Dès 1972, Robert Ettinger, universitaire américain et pionnier de la cryogénisation, publie Man into Superman, ouvrage qui esquisse les premiers concepts phare du transhumanisme. Mais c’est en 1989 que ces idées se popularisent, via la parution de Êtes-vous un transhumain ?, écrit par le professeur Fereidoun M. Esfandiary, mort en 2000, et dont le corps a été cryogénisé en Arizona en attendant une résurrection grâce aux technologies à venir7 Se faisant appeler FM-2030, il écrit que « le nom 2030 reflète ma conviction que les années aux alentours de 2030 seront des années magiques. En 2030, nous serons immortels et tout un chacun … Continue reading.
En 1990, le réseau des penseurs transhumanistes se structure grâce au philosophe britannique Max More qui fonde alors l’Extropy Institute (dissous en 2006) rassemblant près de 2000 biologistes, des artistes issus des milieux cyberpunks, des psychologues et autres informaticiens. En 2002, More déclare : « Nous avons des capacités limitées parce que nous pouvons avoir tendance à être dépressifs, anxieux, en colère ou jaloux. Tout cela vient de notre passé biologique. Nous ne devons pas accepter ces limites émotionnelles. (…) L’utilisation de la science et de la technologie est le meilleur moyen d’avoir raison des contraintes qui pèsent sur notre durée de vie, notre intelligence ou notre vitalité personnelle. (…) Mon scénario favori est de mettre des machines à l’intérieur de nos cellules, des ordinateurs. Pas les ordinateurs que nous voyons, mais des ordinateurs organiques qui pourraient soutenir notre pensée et notre raisonnement et seraient très intimement liés à nous8 Rencontre avec le docteur Max More, fondateur de l’Extropy Institute, interview du 1er juin 2002, nutranews.org.. »
En 1998, la World Transhumanist Association – « Humanity + » depuis 2008 – voit le jour ; elle encourage la recherche et développement sur le transhumanisme pour augmenter la visibilité du mouvement auprès du grand public. Basée en Californie, l’association se targue de rassembler aujourd’hui plusieurs milliers de chercheurs, ingénieurs ou citoyens lambda. Elle assure que « la félicité perpétuelle par modification chimique (paradise engineering) et la colonisation de l’espace font partie de la sphère d’intérêt des transhumanistes. (…) Des scénarios plausibles font aussi bien état de l’extinction de toute vie intelligente que de l’avènement d’un futur posthumain merveilleux et radieux9 transhumanism.org.. »
Au-delà de l’augmentation de nos corps, certains prônent même une fusion totale entre l’homme et la machine, tel l’apôtre médiatique Ray Kurzweil, un des théoriciens de la « singularité technologique ». Ce concept désigne le moment historique (Kurzweil l’estime entre 2030 et 2045) où la puissance exponentielle des ordinateurs créerait une intelligence supérieure au cerveau humain. Cette intelligence artificielle serait en constante progression, capable de répliquer la complexité de la pensée humaine au point que l’humain pourrait être téléchargé sur un support informatique (le mind-uploading), le rendant par là même immortel. La singularité remplirait ainsi le fantasme démiurgique parcourant nombre des grands mythes de l’humanité, du Golem à Frankenstein : permettre au scientifique de créer à son tour une créature vivante à sa propre image. Selon Kurzweil, « En 2029, les ordinateurs auront l’intelligence humaine, avec ses émotions, son humour, la capacité d’aimer (…). Les ordinateurs seront en nous, au sens propre10 Ray Kurzweil, Qu’est-ce que la singularité ?, Arte, septembre 2011.… » Une mutation radicale de l’humanité qui pousse certains transhumanistes à affirmer que « ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s’améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur11 Propos tenus par le cybernéticien Kevin Warwick dans Libération, 11 mai 2002.. »
Le discours techno-prophétique de Ray Kurzweil trouve un écho positif dans les sphères politiques et scientifiques, et il reçoit des mains du président Bill Clinton la National Medal of Technology en 1999. Membre du conseil d’administration du très réputé Massachusetts Institute of Technology, conseiller officiel de l’armée américaine (au sein de l’Army Science Advisory Board) dans les domaines scientifiques et techniques, il est soutenu par l’astrophysicien George Smoot, Prix Nobel de physique 2006, et le magazine Forbes lui a décerné le titre de « Machine à penser ultime ». Mais Ray Kurzweil est surtout, depuis décembre 2012, directeur de l’ingénieurie prospective chez Google, après avoir créé la Singularity University, école privée de la Silicon Valley financée par Google et la Nasa. « Google s’inspire de concepts [transhumanistes] déjà connus, mais le groupe a l’équipe et l’argent pour les faire fructifier. C’est là sa valeur », a alors déclaré Natasha Vita-More, actuelle présidente de Humanity +12 « Google, une certaine idéologie du progrès », Le Monde, 26 septembre 2013..
Certains chantiers de recherche font office de locomotives dans la fabrication d’une telle singularité technologique. Initié fin 2013 par le neurobiologiste Henry Markram, associant treize centres de recherche en Europe et financé à hauteur d’un milliard d’euros sur dix ans, le projet Human Brain, basé à Genève, a pour objet de créer en collaboration avec IBM un ordinateur super puissant capable de reproduire la complexité de pensée d’un cerveau humain. L’objectif annoncé est de mieux comprendre les maladies neurodégénératives, mais ce cerveau digital en devenir n’est rien de moins que la première brique du mind-uploading tant désiré par les transhumanistes : « D’ici dix ans, nous pourrons savoir si la conscience peut être simulée dans un ordinateur », affirme Henry Markram13 « Transhumanistes sans gêne », Libération, 18 juin 2011.. En avril 2013, Barack Obama annonçait la naissance du concurrent états-unien du Human Brain : l’Initiative Brain (Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies), financée sur dix ans à hauteur de 300 millions d’euros par an, avec pour objectif affiché de trouver de nouveaux traitements contre la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson…
C’est ainsi une véritable course au cyborg qui est lancée, pour abolir la souffrance et le handicap, reculer les limites du vieillissement – jusqu’à créer une nouvelle espèce humaine techno-hybridée voire atteindre l’immortalité selon les discours les plus délirants.
Discours magico-religieux
Si cette guerre déclarée contre la mort et cette volonté de maîtrise totale du vivant peut rappeler le vieux rêve de Pasteur de voir la science éradiquer les maladies les plus terribles, la philosophie transhumaniste ne se contente pas d’une froide logique technoscientifique, et fait appel à de nombreux référents mythologiques voire religieux. Pour le philosophe Jean-Michel Besnier, les transhumanistes endossent le rôle de nouveaux Prométhée, pensant avoir dépassé l’hybris – littéralement la démesure, inspirée par l’orgueil14 Jean-Michel Besnier, Demain les posthumains, le futur a-t-il encore besoin de nous ?, Hachette littératures, coll. Haute tension, 2009. : dans la mythologie grecque, l’hybris pousse l’humain hors des limites de la sagesse, jusqu’à vouloir se mesurer aux dieux et résoudre les contradictions du cosmos. Comme l’hybris capitaliste qui prétend vaincre les finitudes de notre planète, l’hybris transhumaniste affirme pouvoir dépasser celles de notre corps biologique.
« Le mythe reste à la base de l’acte scientifique. […] Icare est le mythe de l’aviation, Golem celui de l’automate, de la cybernétique », rappelle Abraham Moles, précurseur français des sciences de l’information et de la communication15 Abraham Moles, « La fonction des mythes dynamiques dans la construction de l’imaginaire social », Cahiers de l’imaginaire, no 5/6, 1990.. D’autres commentateurs, comme Jacques Perriault, professeur en sciences de l’information et de la communication à l’université de Nanterre, parlent de la « magie transhumaniste », puisant sa symbolique dans la magie parastatique16 Jacques Perriault, « Le corps artefact. Archéologie de l’hybridation et de l’augmentation », L’humain augmenté, Édouard Kleinpeter (dir.), CNRS, 2013. qui consiste en l’art de donner l’illusion de dématérialiser un homme ou des objets. Développée du XIIIe au XVIe siècle, la magie parastatique repose sur des jeux de lumière et de miroirs, faisant croire à une réalité virtuelle, à la possibilité de la téléportation. Les jésuites utilisaient déjà cet art pour projeter l’image du Christ grâce à une lanterne cachée, « l’augmentation consistant ici à renforcer la foi des fidèles ».
La filiation des discours transhumanistes avec le christianisme passe par de nombreuses autres références, comme celle de l’Apocalypse avec l’avènement du règne des machines, suite auquel « le monde sera divisé (…) entre les Élus (ceux qui auront été augmentés par la technique et qui auront une chance de survivre) et les Déchus (les autres, les Homo sapiens sapiens)17 Thibaut Dubarry, Jérémy Hornung, « Qui sont les transhumanistes ? », 2008 / 3, sens-public.org. ». Nombre de transhumanistes reprennent à leur compte la rhétorique chrétienne des prophéties (« Les aveugles verront et les paralytiques marcheront. ») pour promouvoir la puissance d’une possible augmentation technologique de nos corps18 Ibid.. D’autres développent des théories scientifiques sur le christianisme, tel Franck Tipler19 Franck J. Tipler, The Physics of Immortality : Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead, Anchor, 1997., professeur de physique mathématique qui a repris le concept de noosphère élaboré par le père jésuite et scientifique Pierre Teilhard de Chardin20 Pierre Teilhard de Chardin, Le Phénomène humain (1955), Points Seuil, 2007.. À la jonction du mysticisme et de l’évolutionnisme, cette notion de noosphère, c’est-à-dire le milieu de vie de la conscience concurrent à l’atmosphère ou à la biosphère, est aujourd’hui le concept clé de projets de recherche autour du cerveau artificiel comme le Human Brain.
Mais le principal point commun avec les origines du christianisme tient dans la vision dualiste de l’être par les transhumanistes qui s’inspire en partie de la conception platonicienne (et néo-platonicienne) du corps, pensé comme prison, dans lequel la connaissance est enfermée. Selon Platon, dans une autre dimension de la réalité, celle des Idées, l’âme est érigée en principe divin, seule capable de nous donner accès à la Vérité de l’Être (« Nous serons purs, étant séparés de cette chose insensée qu’est le corps21 Phédon, 67a. »). Cette opposition a traversé la pensée philosophique occidentale et marqué la division chrétienne entre le corps, soumis aux souffrances terrestres, et l’âme, seule capable d’entrer en relation avec Dieu.
Or, là où les transhumanistes innovent par rapport au dualisme historique, c’est en espérant l’immortalité de notre esprit ailleurs que dans sa délivrance par rapport au corps biologique (notre corps-prison) : la vie éternelle ne serait ni dans le monde des Idées platoniciennes ni dans le Royaume de Dieu, mais dans la création humaine d’un corps modifié, technicisé, libéré du biologique mais pas de la matière. Au XVIIe siècle, Descartes avait jeté les bases de cette conception du corps mécanique22 Notamment dans Discours de la méthode (1637) et Méditations métaphysiques (1641)., le corps de l’homme ou des animaux n’étant que des machines soumises aux lois de la nature. Mais face à ce corps-machine, radicalisé par les automates de La Mettrie un siècle plus tard23 Julien Jean Offray de La Mettrie, L’homme Machine, 1747., Descartes opposait la pensée comme « principe spirituel non matériel qui garantit la spécificité des êtres humains24 Farid El Moujabber, « Le post-humanisme, un épiphénomène du dualisme. Utopie et mythe à l’âge technologique », Metabasis no16, novembre 2013. ». Cependant, pour les tenants du transhumanisme, l’esprit humain est, au même titre que le corps, une mécanique quelconque réductible à un ensemble d’informations que l’on peut répliquer, améliorer, transférer dans un nouveau corps-machine, tel n’importe quel logiciel informatique. C’est par ce subterfuge dialectique que la pensée transhumaniste devient idéologie et spiritualité « post-humaniste », comme l’explique le philosophe des sciences Farid El Moujabber : « Du dualisme platonicien et cartésien au matérialisme et à la cybernétique, il semble que les post-humanistes se sont acharnés à confectionner, à la manière des alchimistes, une recette magique de leur homme parfait et immortel. En amalgamant le corps-prison au corps-machine à l’esprit-information, le post-humanisme a conçu une nouvelle créature25 Ibid.. »
Société posthumaine et monde-machine
Le post-humain, réponse au dégoût transhumaniste pour ses propres imperfections humaines, cette « honte prométhéenne d’être soi » décrite par Günther Anders26 Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme, Encyclopédie des Nuisances (2002)., préfigure un homme non plus appréhendé dans sa dimension sociale, culturelle ou politique, mais uniquement dans sa potentialité d’hybridation technologique, forcément synonyme de progrès et d’émancipation. Ce nouvel homme-machine amélioré par la technique est également vecteur d’une société post-industrielle en devenir qui continue de s’en remettre entièrement au progrès scientifique et technologique. Le technoscientisme exacerbé des transhumanistes, à travers le corps augmenté et la création d’intelligences artificielles supérieures à toute capacité de maîtrise par leurs créateurs, est alors proposé comme ultime garant du bonheur individuel et social.
Certes, face à la déferlante technologique, nombreux sont ceux qui font appel à « l’urgence d’une réflexion éthique » pour juguler les différents projets transhumanistes et « porter débat sur la place publique »27 Le premier grand colloque français organisé par le CNRS sur le transhumanisme a eu lieu en décembre 2012 et était intitulé « L’humain augmenté. États des lieux et perspectives … Continue reading. Cependant, philosophes, professeurs en sciences de l’information et autres sociologues cristallisent leurs discussions et publications sur notre rapport individuel aux technologies28 Lire L’humain augmenté, Édouard Kleinpeter (dir.), CNRS, coll. Les Essentiels d’Hermès (2013). Le philosophe Bernard Andrieu y écrit par exemple que « l’homme hybridé (…) doit … Continue reading. Et quand la question morale est abordée, ou celle de l’égalité d’accès aux technologies d’augmentation dans un souci de progrès social, tous s’appuient sur le mythe de la possibilité d’un contrôle social de ces technologies, présupposant que celles-ci sont par essence « neutres », subordonnées aux usages que l’homme choisit d’en faire29 Jacques Ellul, Le Système technicien (1977), Cherche midi, 2012.. « Un autre transhumanisme est possible » (sic), brandit sans ambages l’Association française transhumaniste Technoprog via son président, Marc Roux, qui propose aussi un revenu universel pour un accès égal aux technologies d’augmentation… Se définissant comme « technoprogressiste », Marc Roux prône des sociétés « où augmentation rime avec amélioration du “vivre ensemble’’ », une « démocratie transhumaniste » soucieuse de justice sociale ou de protection de l’environnement30 Marc Roux, « Un autre transhumanisme est possible », L’humain augmenté, Édouard Kleinpeter (dir.), CNRS, coll. Les Essentiels d’Hermès, 2013.. La teneur des débats éthiques ou politiques semble ainsi plutôt participer à l’acceptabilité sociale de ces technologies d’augmentation, cherchant à convaincre qu’elles peuvent être synonymes de progrès social, et que le transhumanisme est un humanisme. Mais toutes ces technologies sont loin d’être amorales ou apolitiques : elles portent en elles des valeurs intrinsèques de performance, de simplification, de quantification et leur production, aux mains des tenants de la technoindustrie, est soumise à des impératifs de rentabilité, restant déconnectée de toute perspective de transformation sociale.
Les systèmes technologiques, jugés plus rationnels et objectifs, sont ainsi censés apporter des solutions là où le jeu démocratique et les communautés humaines ont échoué. Mais au-delà de cette croyance en un progrès techno-scientifique salvateur, le transhumanisme entérine également l’asservissement des corps aux technologies, augurant une humanité évoluant dans un monde-machine en constante amélioration et en perpétuelle hybridation entre le naturel et l’artificiel, entre vivant et non vivant – où l’homme n’est qu’un système connecté de plus. Dans ce monde-machine, tout ce qui est de l’ordre du sensible ou de l’émotion, du rapport direct entre êtres humains ou de la relation avec notre environnement naturel, n’est appréhendé que comme autant de sources d’erreurs potentielles qui devront, au fil des augmentations des post-humains, être updatées, comme dans un banal logiciel.
Loin de promettre l’égalité aussi universelle que mortifère des atomes et des bits, la pensée transhumaniste répercute en les amplifiant les logiques de domination d’une humanité à deux vitesses, avec d’un côté les post-humains améliorés, une élite physiquement et intellectuellement augmentée et, de l’autre, un cheptel humain coincé dans des corps version 1.0 – les différences de classe corporelle renforçant désormais celles de classe sociale. « Les gens qui, pour une raison ou une autre, n’évolueront pas dans le même sens, s’ils existent, deviendront l’espèce inférieure incapable de survivre ou ne pouvant survivre que pour servir d’esclaves ou de viande pour les autres (comme les vaches aujourd’hui) », déclare en ce sens l’écrivain transhumaniste américain Bruce Benderson31 Bruce Benderson et Christian Godin « Ce que pense un transhumaniste », Cités n° 55, 2013.. Cette humanité biologiquement inégalitaire se prépare également dans les discours eugénistes d’un Nick Bostrom, directeur du Future Humanity Institute (créé en 2005 par l’université d’Oxford), lorsqu’il prône la sélection des embryons pour augmenter les capacités intellectuelles de l’être humain dans les cinquante ans à venir. Quant aux possibilités de surveillance et de contrôle généralisés inhérentes aux nouvelles technologies, si n’importe quel objet technologique connecté (ordinateur, téléphone portable, smartphone ou puces RFID) est déjà synonyme de traçabilité et de fichage, qu’en sera-t-il lorsque nos corps, dépendants pour leur survie de leurs plugins biomécaniques, seront devenus leurs propres mouchards ?
Un ultime mythe, celui de Thésée, fait office de miroir au transhumanisme. Après avoir combattu le Minotaure, Thésée revient à Athènes et les habitants de la cité s’attellent à préserver son bateau, brisé par mille péripéties. Au fil du temps et des intempéries, les vieilles planches du navire sont alors une à une remplacées. Plus aucun élément originel de l’embarcation héroïque ne rappelant l’original, les Athéniens débattent sans fin sur le fait de savoir si les planches ainsi renouvelées forment encore le même bateau, ou un pâle ersatz du navire mythique. De même, les corps post-humains ne seraient plus une entité biologique et culturelle autonome, mais une triste hybridation de chair et de bits sans cesse rafistolée qui, tels Achille et son talon, se révèlerait à la fois invulnérable et terriblement fragile. Quittant les rivages de son humaine singularité, le corps augmenté et fusionné que prônent les transhumanistes ne serait ainsi qu’un funeste bateau de Thésée, produit en série. Jusqu’au naufrage.
Images : Wilder Mann ou la figure du sauvage. Charles Fréger. Recueil de photos disponible aux éditions Thames & Hudson.
Aller sur le site de Charles Freger
Chaque année, dans toute l’Europe, des hommes, le temps d’une mascarade multiséculaire, entrent littéralement dans la peau du « sauvage ».
Dans l’ordre d’apparition :
Babugeri, Bulgarie.
Caretos de Lazarim, Portugal.
Cerbul din Corlata, Roumanie.
Ursul din Palanca, Roumanie.
Krampus, Autriche.
Notes
| ↩1 | Devenu héros national en Afrique du Sud, Oscar Pistorius fait depuis régulièrement la une des tabloïds pour ses frasques, son goût pour les armes à feu et les belles voitures. Il a été récemment inculpé pour homicide involontaire en 2013 de sa compagne, la mannequin et présentatrice de télévision Reeva Steenkamp. |
| ↩2 | Le Monde, 21 mai 2011. |
| ↩3 | AFP, 21 février 2013. |
| ↩4 | Julian Huxley, « Transhumanism », New Bottles for New Wine, Chatto & Windus (1957). |
| ↩5 | Avec son Whole Earth Catalog publié entre 1968 et 1972, le journaliste et auteur Stewart Brand a beaucoup participé au rapprochement de ces deux « communautés ». |
| ↩6 | Principe spirituel New Age qui a notamment influencé Steve Jobs, créateur de la société Apple. |
| ↩7 | Se faisant appeler FM-2030, il écrit que « le nom 2030 reflète ma conviction que les années aux alentours de 2030 seront des années magiques. En 2030, nous serons immortels et tout un chacun aura de grandes chances de vivre éternellement ». |
| ↩8 | Rencontre avec le docteur Max More, fondateur de l’Extropy Institute, interview du 1er juin 2002, nutranews.org. |
| ↩9 | transhumanism.org. |
| ↩10 | Ray Kurzweil, Qu’est-ce que la singularité ?, Arte, septembre 2011. |
| ↩11 | Propos tenus par le cybernéticien Kevin Warwick dans Libération, 11 mai 2002. |
| ↩12 | « Google, une certaine idéologie du progrès », Le Monde, 26 septembre 2013. |
| ↩13 | « Transhumanistes sans gêne », Libération, 18 juin 2011. |
| ↩14 | Jean-Michel Besnier, Demain les posthumains, le futur a-t-il encore besoin de nous ?, Hachette littératures, coll. Haute tension, 2009. |
| ↩15 | Abraham Moles, « La fonction des mythes dynamiques dans la construction de l’imaginaire social », Cahiers de l’imaginaire, no 5/6, 1990. |
| ↩16 | Jacques Perriault, « Le corps artefact. Archéologie de l’hybridation et de l’augmentation », L’humain augmenté, Édouard Kleinpeter (dir.), CNRS, 2013. |
| ↩17 | Thibaut Dubarry, Jérémy Hornung, « Qui sont les transhumanistes ? », 2008 / 3, sens-public.org. |
| ↩18 | Ibid. |
| ↩19 | Franck J. Tipler, The Physics of Immortality : Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead, Anchor, 1997. |
| ↩20 | Pierre Teilhard de Chardin, Le Phénomène humain (1955), Points Seuil, 2007. |
| ↩21 | Phédon, 67a. |
| ↩22 | Notamment dans Discours de la méthode (1637) et Méditations métaphysiques (1641). |
| ↩23 | Julien Jean Offray de La Mettrie, L’homme Machine, 1747. |
| ↩24 | Farid El Moujabber, « Le post-humanisme, un épiphénomène du dualisme. Utopie et mythe à l’âge technologique », Metabasis no16, novembre 2013. |
| ↩25 | Ibid. |
| ↩26 | Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme, Encyclopédie des Nuisances (2002). |
| ↩27 | Le premier grand colloque français organisé par le CNRS sur le transhumanisme a eu lieu en décembre 2012 et était intitulé « L’humain augmenté. États des lieux et perspectives critiques ». Les vidéos des interventions sont en ligne : iscc.cnrs.fr. |
| ↩28 | Lire L’humain augmenté, Édouard Kleinpeter (dir.), CNRS, coll. Les Essentiels d’Hermès (2013). Le philosophe Bernard Andrieu y écrit par exemple que « l’homme hybridé (…) doit éviter la stigmatisation en revendiquant sa mixité » tout en avançant que l’hybridation est synonyme de « démultiplication des références identitaires » ou encore de « métissage du corps humain »… |
| ↩29 | Jacques Ellul, Le Système technicien (1977), Cherche midi, 2012. |
| ↩30 | Marc Roux, « Un autre transhumanisme est possible », L’humain augmenté, Édouard Kleinpeter (dir.), CNRS, coll. Les Essentiels d’Hermès, 2013. |
| ↩31 | Bruce Benderson et Christian Godin « Ce que pense un transhumaniste », Cités n° 55, 2013. |